Căbīrus, i, m. (Κάϐειρος),
¶1. divinité adorée surtout en Macédoine et dans l'île de Samothrace : Cic. Nat. 3, 58 ; pl. Cabiri Acc. Tr. 526

¶2. fleuve voisin de l'Indus : Plin. 6, 94.
Digital Gaffiot project. (C) 2011-2015, Katsuhiko OHKUBO.
Acknowledgment: This text was proofread by French earnest volunteers.
Very Special Thanks To : M. Gérard Gréco. Mmes Hélène Chaillot, Anne-Marie Chazal, Valérie Delhomez, Ombeline Galletti,Véronique Guillaume, Sylvie Launay, Anaïs Monchy, Annette Ruttun. MM. Bernard Maréchal, Guy Labit.
NOTE: Search "#word#" without diacritical marks to find the entry (ex. #Academia#, #amo# etc.).
WARN: æ = æ = ae, œ = œ = oe are indiscernible in some fonts (ex. "Times New Roman", "CM Roman" etc).
¶1. divinité adorée surtout en Macédoine et dans l'île de Samothrace : Cic. Nat. 3, 58 ; pl. Cabiri Acc. Tr. 526

¶2. fleuve voisin de l'Indus : Plin. 6, 94.
¶1. mesure hébraïque : Vulg. Reg. 4, 6, 25
¶2. = caballus : Isid. 12, 8, 4.
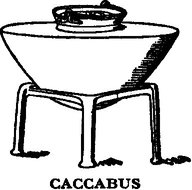
¶1. int., rire aux éclats : Cic. Verr. 3, 62 ; Lucr. 4, 1176
— [fig.] faire du bruit, retentir [en parl. des flots] : Acc. Tr. 573
¶2. [avec acc.] dire en riant : Juvenc. 4, 698
— se moquer de : Apul. M. 3, 7.
¶1. graine de romarin : Plin. 24, 101
¶2. bourgeon hivernal qui pousse sur le sapin, le noyer, le tilleul, le platane : Plin. 16, 30
¶3. petite amande qu'on trouve dans la graine du pourpier marin : Plin. 26, 82.
¶1. int., aller à la selle : Catul. 23, 20 ; Hor. S. 1, 8, 38
¶2. tr., rendre par le bas : Mart. 3, 89
— embrener : Catul. 36, 1.
¶1. sommet, extrémité, pointe : Cat. Agr. 6, 3 ; Varr. R. 1, 40, 6 ; ramorum cacumina Cæs. G. 7, 73, 2, les extrémités des branches ; in acutum cacumen fastigatus Liv. 37, 27, 2, dont le sommet se termine en pointe aiguë
— sommet, cime [d'une montagne, d'un arbre, etc.] : Lucr. 6, 464 ; Virg. B. 2, 3
¶2. [fig.] comble, faîte, perfection, apogée : Lucr. 2, 1130
— accent sur les syllabes : Diom. 433, 21 ; Capel. 273.

¶1. de Cadmus, de Thèbes : Stat. Th. 1, 376 ; Prop. 1, 7, 1
¶2. des Carthaginois [descendants des Tyriens] : Sil. 1, 6
— -mēa, æ, f., la Cadmée [citadelle de Thèbes] : Nep. Epam. 10, 3.
¶1. fils d'Agénor, frère d'Europe, fondateur de la Cadmée : Cic. Tusc. 1, 28 ; Ov. M. 1, 15 ; F. 1, 490
¶2. nom d'un bourreau à Rome : Hor. S. 1, 6, 39
¶3. Milésien qui le premier a écrit l'histoire en prose : Plin. 5, 112
¶4. montagne de Phrygie : Plin. 5, 118.
¶1. [en parl. des choses et des êtres animés] tomber, choir : homini ilico lacrumæ cadunt Ter. Ad. 536, aussitôt les larmes lui tombent des yeux ; cadentes guttæ Cic. de Or. 3, 186, gouttes d'eau qui tombent ; puto saxum tamen casurum fuisse Cic. Fat. 6, je pense que le rocher serait tombé quand même ; in terram cadentibus corporibus Cic. Tusc. 1, 36, les corps tombant à terre ; si de cælo cadit (ignis) Sen. Nat. 2, 13, 1, si ce feu tombe du ciel (cælo Virg. G. 1, 487); cadunt de montibus umbræ Virg. B. 1, 83, l'ombre tombe des montagnes
— omnibus istis latronibus de manibus arma cecidissent Cic. Phil. 14, 21, les armes seraient tombées des mains de tous ces brigands (de manibus audacissimorum civium Cic. Off. 1, 77, des mains des citoyens les plus audacieux) ; cum offa cecidit ex ore pulli Cic. Div. 2, 72, quand une miette de nourriture est tombée du bec du poulet sacré ; vela cadunt Virg. En. 3, 207, les voiles tombent ; cecidere a pectore vestes Stat. Ach. 7, 878, le vêtement tomba de sa poitrine ; (tecta) si aut vi tempestatis aut terræ motu aut vetustate cecidissent Cic. Off. 2, 13, (les maisons) si elles étaient tombées ou sous l'effort de la tempête ou par suite d'un tremblement de terre ou par l'effet de la vétusté
— ex equo Cic. Fat. 5 ; de equo Cic. Clu. 175, tomber de cheval
— [métaph.] : minime in lubrico versabitur... numquam cadet Cic. Or. 98, [l'orateur du genre simple] ne s'aventurera guère sur un terrain glissant... il ne tombera jamais ; alte cadere non potest Cic. Or. 98, il ne peut tomber de haut
¶2. tomber, succomber, mourir : in prœlio cadere Cic. Fin. 2, 61, tomber dans la bataille (pro patria Cic. Tusc. 1, 89, pour la patrie)
— referes, telo cecidisse Camillæ Virg. En. 11, 689, tu leur rapporteras que tu es tombé sous le fer de Camille ; Hectoreā hastā Ov. M. 12, 68, tomber sous la lance d'Hector ; non armis telisque Romanis ceciderunt Tac. G. 33, ce n'est pas sous nos armes et nos traits qu'ils sont tombés ; multa tibi ante aras nostra cadet hostia dextra Virg. En. 1, 334, de nombreuses victimes seront immolées de notre main en ton honneur devant les autels
— [avec ab] ab aliquo cadere, tomber sous les coups de qqn : Ov. M. 5, 192 ; F. 6, 564 ; Tac. An. 16, 9 ; Suet. Oth. 5
¶3. [fig.] tomber : labentem et prope cadentem rem publicam fulcire Cic. Phil. 2, 51, soutenir le gouvernement en train de glisser et presque de tomber ; cecidi sciens, ut honestissime exsurgere possem Cic. Phil. 12, 24, je suis tombé sciemment, pour pouvoir me relever avec honneur ; non debemus cadere animis Cic. Fam. 6, 1, 4, nous ne devons pas nous laisser abattre
— [en part.] causa cadere Cic. de Or. 1, 167 ; in judicio cadere Cic. Mur. 58, perdre son procès ; repetundarum criminibus ceciderant Tac. H. 1, 77, ils avaient été condamnés du chef de concussions
¶4. [fig.] tomber, disparaître : mundis aliis nascentibus, aliis cadentibus Cic. Nat. 1, 67, les mondes, les uns naissant, les autres disparaissant ; ea tua laus pariter cum re publica cecidit Cic. Off. 2, 45, cette gloire que tu acquérais est tombée avec la république ; cecidere illis animi Ov. M. 7, 347, leur courage tomba, cf. Liv. 1, 11, 3 ; 2, 65, 7 ; non tibi ira cecidit ? Liv. 2, 40, 7, ta colère n'est pas tombée ? pretia militiæ casura in pace ægre ferebant Liv. 34, 36, 7, ils voyaient avec peine que la solde disparaîtrait avec la paix ; venti vis omnis cecidit Liv. 26, 39, 8, toute la force du vent tomba ; cadente jam Euro Liv. 25, 27, 11, comme l'Eurus [le vent d'est] commençait à tomber ; postquam cecidit superbum Ilium Virg. En. 3, 2, quand fut tombée la superbe Troie
¶5. [rhét. et gram.] tomber, se terminer, finir : verba eodem pacto cadentia Cic. Or. 84, ὁμοιόπτωτα, mots ayant la même désinence casuelle [cf. Or. 135 similiter desinentia, ayant la même terminaison ὁμοιοτέλευτα], cf. Rhet. Her. 4, 28 ; Cic. de Or. 3, 206 ; Or. 135
— [chute de la phrase] : Cic. Or. 38 ; 219, etc.; sententia cadit numerose Cic. Br. 34, la phrase (l'expression de la pensée) a une fin rythmique, cf. Or. 175 ; 199 ; etc.
¶6. arriver [surtout avec un adverbe ou un adjectif attribut] : hoc cecidit mihi peropportune, quod... venistis Cic. de Or. 2, 15, fort heureusement pour moi, vous êtes venus...; intellexi nihil mihi optatius cadere posse, quam ut me quam primum consequare Cic. Att. 3, 1, j'ai compris que rien ne pourrait être plus désirable pour moi que de te voir me rejoindre le plus tôt possible ; a te mihi omnia semper honesta et jucunda ceciderunt Cic. Q. 1, 3, 1, de ton fait, tout ce qui m'est arrivé a toujours été honorable et agréable (de toi je n'ai jamais eu qu'honneur et agrément) ; si non omnia caderent secunda Cæs. C. 3, 73, 4, si tout n'arrivait pas heureusement ; si minus fortissimi viri virtus civibus grata cecidisset Cic. Mil. 81, si le courage de cet homme si énergique n'avait pas l'heur de plaire à ses concitoyens
— valde optanti utrique nostrum cecidit, ut in istum sermonem delaberemini Cic. de Or. 1, 96, conformément à ce que chacun de nous deux souhaitait vivement, il s'est trouvé que vous êtes tombés sur ce sujet d'entretien ; sed ita cadebat ut Cic. Br. 149, mais il arrivait que..., cf. Fam. 3, 12, 2 ; Att. 3, 7, 1 ; cecidit belle Cic. Att. 13, 33, 4, cela est joliment bien tombé
— sortes ductæ, ut in rem apte cadant Cic. Div. 1, 34, sorts tirés avec une exacte appropriation à l'objet
— aboutir à : nimia illa libertas in nimiam servitutem cadit Cic. Rep. 1, 68, cette liberté excessive aboutit à une excessive servitude ; in irritum Tac. An. 15, 39 ; ad irritum Liv. 2, 6, 1 ; in cassum Lucr. 2, 1165, n'aboutir à rien, avorter, être sans effet
¶7. tomber, venir à, s'exposer à : sub imperium alicujus Cic. Att. 8, 3, 2 (sub potestatem Cic. Verr. 5, 144), tomber sous la domination, sous le pouvoir de qqn ; in eandem suspicionem Cic. Phil. 11, 24, être exposé au même soupçon ; in offensionem Atheniensium Cic. Nat. 1, 85, s'exposer à l'hostilité des Athéniens ; in vituperationem Cic. Att. 14, 13, 4, s'exposer au blâme
— tomber, coïncider : in id sæculum Romuli cecidit ætas, cum.... Cic. Rep. 2, 18, l'époque de Romulus coïncide avec un siècle où..., cf. Fam. 15, 14, 4 ; scribis in eam diem cadere nummos qui a Quinto debentur Cic. Att. 15, 19, 4, tu écris que c'est le jour d'échéance de la dette de mon frère Quintus
¶8. tomber sur [in aliquem, in aliquid], se rapporter à, cadrer, convenir : si cadit in sapientem animi dolor Cic. Læ. 48, si le sage est susceptible de souffrance morale ; de hac dico sapientia, quæ videtur in hominem cadere posse Cic. Læ. 100, je parle de cette sagesse qui paraît accessible à l'homme ; cadit ergo in virum bonum mentiri emolumenti sui causa ? Cic. Off. 3, 81, alors, cela cadre avec un homme de bien de mentir pour son intérêt ? non cadit in hunc hominem ista suspicio Cic. Sull. 75, ce soupçon ne convient pas à un tel homme (n'est pas de mise avec un tel homme) ; quod facinus nec in hominem imprudentem caderet, nec in facinerosum... Cic. Dej. 16, un forfait qui ne s'expliquerait ni d'un imprudent ni d'un scélérat ; dictum cadit in aliquem Cic. Tusc. 5, 40, un mot s'applique bien à qqn [une plaisanterie Cic. de Or. 2, 245]
— id verbum in consuetudinem nostram non cadit Cic. Tusc. 3, 7, ce mot n'est pas conforme à l'usage de notre langue ; sustinendi muneris propter imbecillitatem difficultas minime cadit in majestatem deorum Cic. Nat. 2, 77, avoir de la peine par faiblesse à soutenir cette tâche est incompatible avec la grandeur divine
— tomber sur, sous, dans : omnia, quæcumque in hominum disceptationem cadere possunt Cic. de Or. 2, 5, tout ce qui peut venir en discussion (être l'objet de) ; in cernendi sensum Cic. Tim. 9, tomber sous le sens de la vue ; sub aspectum Cic. Tim. 11 ; sub oculos Cic. Or. 9, tomber sous la vue, sous les yeux ; sub aurium mensuram aliquam Cic. Or. 67, être susceptible d'une mesure (d'une appréciation) de l'oreille
— quoniam plura sunt orationum genera neque in unam formam cadunt omnia Cic. Or. 37, comme il y a plus d'un genre d'éloquence et qu'ils ne rentrent pas tous dans le même type.
¶1. qui tombe du haut mal, épileptique : Aug. Beat. 2, 16
¶2. caducaria lex, loi sur l'aubaine, qui établit le droit d'aubaine : Ulp. Lib. Regul. 28.

===> m. Varr. d. Non. 528 ; n. Gell. 10, 27, 1.
¶1. fleur tombée : C.-Aur. Chron. 4, 3, 52
¶2. un bien caduc : Juv. 9, 88.
¶1. vitis natura caduca est Cic. CM 52, la vigne tombe naturellement, cf. CM 5 ; ab legendo ligna, quod ea caduca legebantur in agro Varr. L. 6, 66, ligna (bois) vient de legere, parce qu'on le recueillait tombé sur le sol dans la campagne [pour faire le feu]; bacæ glandesque caducæ Lucr. 5, 1363, les baies et les glands tombés sur le sol ; videbis frondes volitare caducas Virg. G. 1, 368, tu verras voltiger les feuilles tombées des arbres ; bello caduci Dardanidæ Virg. En. 6, 481, les Troyens tombés du fait de la guerre (dans la guerre) ; qui statuit te triste lignum, te caducum in domini caput immerentis Hor. O. 2, 13, 11, celui qui t'a planté, bois fâcheux, fait pour tomber sur la tête du maître innocent ; caduco juveni Virg. En. 10, 622, pour ce jeune guerrier voué à la mort
— qui tombe du mal caduc [du haut mal, de l'épilepsie] : Apul. Apol. 43, etc.; Isid. 10, 61
¶2. caduc, périssable, fragile : corpore caduco et infirmo Cic. Nat. 1, 98, d'un corps caduc et faible ; res humanæ fragiles caducæque sunt Cic. Læ. 102, les choses humaines sont fragiles et périssables ; spes caducæ Ov. M. 9, 597, espoirs fragiles
¶3. [jurisc.] : caduca possessio Cic. de Or. 3, 122, bien sans maître ; caducæ hereditates Cic. Phil. 10, 11, héritages vacants ; [en part., par suite des lois caducaires d'Auguste, lex Julia et Papia Poppæa, qui privaient du droit d'héritage total les célibataires ou partiel les orbi, mariés sans enfant, il restait souvent des parts d'hérédité vacantes, caducæ] Gaius Inst. 2, 206, etc.
¶1. drap ou couverture de lit [fabrication des Cadurci, d'où l'appellation] : Juv. 7, 221
¶2. lit : Juv. 6, 537.
¶1. récipient de terre dans lequel on conserve le vin [qqf l'huile, le miel, etc.], jarre : Pl. Amp. 429 ; Aul. 571, etc.; Virg. En. 1, 195 ; Hor. O. 1, 35, 26, etc.; Plin. 36, 158
— vase en airain ; urne funéraire : Virg. En. 6, 228

¶2. mesure [attique] pour les liquides, valant 3 urnes ou 12 congii ou 72 sextarii ; gén. pl. cadum : Varr. d. Plin. 14, 96.
¶1. sorte de laitue : Col. 10, 190
¶2. sorte de lézard ; v. cæcula : Veg. Mul. 4, 21.

¶1. cécité : Cic. Tusc. 5, 113
— [fig.] aveuglement : Tusc. 3, 11
¶2. obscurité, ténèbres : Ps. Quint. Decl. 6, 4.
¶1. aveugler, priver de la vue : Lucr. 4, 325
— [fig.] aveugler, éblouir : Cic. Sest. 139
¶2. obscurcir : Avien. Orb. 504
— [fig.] oratio cæcata Cic. Br. 264, discours rendu obscur, inintelligible.
¶1. qui cæcus est factus Cic. Dom. 105, qui est devenu aveugle ; Appius et cæcus et senex Cic. CM 37, Appius, à la fois aveugle et vieux ; nudum et cæcum corpus ad hostes vertere Sall. J. 107, 1, tourner vers l'ennemi la partie du corps qui est nue et aveugle (cf. Xen. Cyr. 3, 3, 45 = le dos)
— m. pris substt, un aveugle : apparet id etiam cæco Liv. 32, 34, 3, la chose est claire même pour un aveugle ; cæcis hoc satis clarum est Quint. 12, 7, 9, ce serait clair pour des aveugles
¶2. [fig.] aveugle, aveuglé : non solum ipsa Fortuna cæca est, sed eos etiam plerumque efficit cæcos, quos complexa est Cic. Læ. 54, non seulement la Fortune elle-même est aveugle, mais elle frappe d'aveuglement ceux auxquels elle s'attache ; cæcus cupiditate Cic. Quinct. 83, aveuglé par la passion ; cæcus animo Cic. Fin. 4, 64, l'esprit aveuglé ; cæca futuri mens hominum fati Luc. 2, 14, l'esprit humain aveugle en ce qui concerne l'avenir ; cæcus animi Quint. 1, 10, 29 (Gell. 12, 13, 4), ayant l'esprit aveuglé
— cæca avaritia Cic. Phil. 2, 97, aveugle cupidité ; cæco quodam timore salutis Cic. Lig. 3, par une sorte de crainte aveugle pour leur salut
¶3. privé de lumière, obscur, sombre : in cæcis nubibus Cic. Dom. 24, dans de sombres nuages ; cæcæ latebræ Lucr. 1, 408, retraites obscures ; cæco pulvere campus miscetur Virg. En. 12, 444, la plaine se couvre d'une sombre poussière
— cubiculum si fenestram non habet, dicitur cæcum Varr. L. 9, 141, d'une chambre sans fenêtre, on dit qu'elle est borgne
¶4. qu'on ne voit pas, caché, dissimulé : res cæcæ Cic. de Or. 2, 357, choses obscures ; vallum cæcum cavere Cæs. C. 1, 28, 4, prendre garde aux trous de loup [pieux dissimulés en terre] ; cæcæ fores Virg. En. 2, 453, porte dissimulée (secrète); cæcum dare vulnus Virg. En. 10, 733, porter un coup par derrière
— cæca pe\-ri\-cula Cic. Rep. 2, 6, dangers imprévus
¶5. incertain, douteux : cur hoc tam est obscurum atque cæcum ? Cic. Agr. 2, 36, pourquoi cette expression aussi obscure et imprécise ? cæca exspectatione pendere Cic. Agr. 2, 66, être en suspens dans une attente vague ; cæcos volutat eventus animo secum Virg. En. 6, 157, il médite sur cet événement mystérieux ; in Achæis cæcum erat crimen Liv. 45, 31, 11, à propos des Achéens, l'accusation était sans preuve ; cæci ictus Liv. 34, 14, 11, coups portés à l'aveugle
— cæca murmura Virg. En. 10, 98, bruit sourd (indistinct) ; cæca die emere Pl. Ps. 301, acheter à crédit [avec date de paiement incertaine].
¶1. meurtre, [et surtout] massacre, carnage : orbem terræ cæde atque incendiis vastare Cic. Cat. 1, 3, dévaster le monde par le meurtre et l'incendie ; magna cæde nostrorum Cæs. C. 3, 65, 1, après avoir fait un grand carnage des nôtres ; cædem facere Cic. Flacc. 88, commettre un meurtre ; magistratuum privatorumque cædes effecerat Cic. Mil. 87, il avait perpétré le meurtre de magistrats et de particuliers : fit magna cædes Cæs. G. 7, 70, 5, il se fait un grand carnage ; jam cædi perpetratæ Romani supervenerunt Liv. 28, 23, 3, le massacre était déjà consommé quand les Romains arrivèrent
¶2. [dans les sacrifices] : temptare deos multa cæde bidentium Hor. O. 3, 23, 14, solliciter les dieux par un grand sacrifice de victimes, cf. Ov. M. 15, 129, etc.
¶3. sang versé : abluta cæde Virg. En. 9, 818, les souillures du carnage étant lavées ; mixta hominum pecudumque cæde respersus Liv. 10, 39, 16, éclaboussé du sang mêlé des hommes et des animaux
¶4. corps massacrés : crastina lux ingentes Rutulæ spectabit cædis acervos Virg. En. 10, 245, la lumière de demain verra des monceaux de Rutules égorgés ; equitum acies cæde omnia replet Liv. 8, 39, 1, ce corps de cavaliers remplit tout de carnage, cf. Tac. An. 6, 24 ; H. 3, 29 ; stratam innocentium cædibus celeberrimam urbis partem Tac. H. 3, 70, [il disait] que le quartier le plus fréquenté de la ville était jonché de cadavres innocents
¶5. [retour au sens premier] action de couper, d'abattre : ligni atque frondium cædem facere Gell. 19, 12, 7, faire un abatage de bois et de feuillages ; capilli cæde cultrorum desecti Apul. M. 3, 16, cheveux abattus sous l'entaille des couteaux
— coups violents, voies de fait : Papin. Dig. 29, 5, 21, 2.
===> nom. arch. cædis Liv. 1, 98, 10 ; 3, 5, 9, etc. ; gén. pl. poét. cædum Sil. 4, 351 ; 4, 422, etc.
===> .
¶1. loris aliquem cædere Pl. Merc. 1002, frapper qqn du fouet, donner les étrivières ; virgis ad necem Cic. Verr. 3, 69, battre de verges jusqu'à ce que mort s'ensuive ; lapidibus duo consules ceciderunt Cic. fg. A 14, 7, ils attaquèrent les deux consuls à coups de pierres ; eum cædere destiterunt Cic. Sest. 79, ils cessèrent de le frapper ; Etruscis terga cædit Liv. 2, 11, 9, il frappe (attaque) de dos les Étrusques
— cædit calcibus arva Virg. En. 10, 404, il frappe le sol de ses talons
¶2. abattre : arbores Cic. Div. 2, 33 ; silvas Cæs. G. 3, 29, 1, abattre des arbres, des forêts ; ripis fluvialis harundo cæditur Virg. G. 2, 415, on coupe sur les rives le roseau de rivière
— materiam Cæs. G. 3, 29, 1 ; C. 1, 36, 5 ; Liv. 21, 27, 5, couper le bois de construction
— [prov.] vineta sua cædere Hor. Ep. 2, 1, 220, couper ses propres vignes, jeter des pierres dans son propre jardin, se faire du tort à soi-même
¶3. briser, fendre : silicem Cic. Div. 2, 85, fendre une pierre ; montes Sen. Nat. 5, 15, 2, fendre les montagnes ; murum Liv. 21, 11, 9, saper un mur
— [en part.] tailler : lapis aliqui cædendus et apportandus fuit Cic. Verr. 1, 147, il y avait quelques pierres à tailler et à porter en place ; cum cædendum esset saxum Liv. 21, 37, 2, comme il fallait tailler le rocher ; ut nec virgulta vallo cædendo nec terra cæspiti faciendo apta inveniri posset Liv. 25, 36, 5, en sorte qu'on ne pouvait trouver ni broussailles propres à façonner (tailler) des pieux ni de terre propre à faire des mottes de gazon
¶4. abattre, tuer, massacrer : tot legionibus cæsis Cic. Phil. 14, 12, tant de légions étant massacrées ; ille dies, quo Tib. Gracchus est cæsus Cic. Mil. 14, ce jour où Tib. Gracchus fut assassiné
— [avec idée de vaincre] : legiones nostras cecidere Liv. 7, 30, 14, ils ont taillé en pièces nos légions
— [poét.] : cæsi corporum acervi Catul. 64, 359, monceaux de cadavres ; cæso sparsuri sanguine flammas Virg. En. 11, 82, victimes destinées à arroser de leur sang répandu les flammes du bûcher
¶5. égorger [des animaux] : cædit greges armentorum Cic. Phil. 3, 31, il égorge les troupeaux de bétail ; (cervos) rudentes cædunt Virg. G. 3, 275, ils égorgent (les cerfs) malgré leurs bramements
— immoler, sacrifier : Cic. Leg. 2, 57 ; Virg. En. 5, 96, etc.; cæsis hostiis placare (mentes deorum) Cic. Clu. 194, apaiser les dieux par l'immolation des victimes
¶6. [poés. érotique] : Catul. 56, 7 ; Priap. 26, 10.
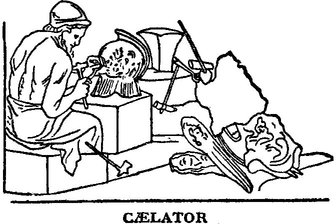
¶1. du ciel, céleste : Cic. Rep. 6, 17 ; Nat. 2, 120
¶2. d'origine céleste, qui se rapporte aux dieux d'en haut : Cic. Har. 20
— [fig.] divin, excellent, merveilleux : Cic. Phil. 5, 28 ; Quint. 10, 2, 18
— cælestis, is, subst, m., ordint au plur., habitant du ciel, dieu : Cic. Off. 3, 25 ; au fém., déesse : Tert. Apol. 24
— cælestĭa, ium, n. pl., choses célestes : Cic. CM 77.
===> -tior Sen. Ep. 66, 11 ; -tissimus Vell. 2, 66, 3
— abl. -te au lieu de -ti Ov. M. 15, 743 ; gén. pl. -tum au lieu de -tium Varr. L. 6, 53 ; Lucr. 6, 1272.
¶1. qui porte le ciel : Virg. En. 6, 796
¶2. qui porte au ciel : cæliferæ laudes Capel. 6, 637, louanges qui portent aux nues.
¶1. venant du ciel : Lact. Inst. 4, 2, 6
¶2. [fig.] venant d'en haut [de l'empereur] : Cod. Th. 6, 32, 2.
¶1. (mons exprimé ou s.-ent.) : le Cælius [une des sept collines de Rome] : Cic. Rep. 2, 33 ; v. Cæliculus
¶2. L. Caelius Antipater, historien et juriste du temps des Gracques : Cic. Br. 102
¶3. M. Cælius Rufus, défendu par Cicéron : Cic. Br. 273.
¶1. graver, ciseler, buriner : cælare argento Cic. Div. 1, 79 ; in auro Virg. En. 1, 640, ciseler dans l'argent, dans des objets d'or ; cælatum aurum Cic. Tusc. 5, 61, or ciselé
— [fig.] Hor. Ep. 2, 2, 92
¶2. orner : auro calvam cælavere Liv. 23, 24, 12, ils montèrent le crâne en or
¶3. broder : Sil. 14, 558.
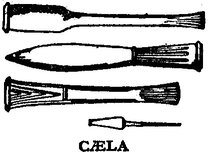
¶1. ciel, voûte céleste : rotundum ut cælum terraque ut media sit... sol ut circumferatur Cic. de Or. 3, 178, à savoir que le ciel soit rond, que la terre soit au centre, que le soleil tourne autour ; in cælum ascendere naturamque mundi et pulchritudinem siderum perspicere Cic. Læ. 88, monter dans le ciel et contempler la nature de l'univers, la beauté des astres ; sidera infixa cælo Cic. Nat. 1, 34, astres fixés à la voûte du ciel
— phénomènes célestes, signes du ciel : de cælo servare Cic. Div. 2, 74, etc., observer le ciel [chercher à voir des signes dans le ciel] ; de cælo apud Etruscos multa fiebant Cic. Div. 1, 93, en Étrurie, il se produisait dans le ciel beaucoup de phénomènes ; de cælo percussus Cic. Cat. 3, 19 (tactus Liv. 22, 36, 8); e cælo ictus Cic. Div. 1, 16, frappé, atteint de la foudre ; cælo albente Cæs. C. 1, 68, 1 ; vesperascente Nep. Pelop. 2, 5, au point du jour, à la tombée de la nuit ; eodem statu cæli et stellarum nati Cic. Div. 2, 92, nés avec le même état du ciel et des astres
— [prov.] : cælum ac terras miscere Liv. 4, 3, 6, soulever (remuer) ciel et terre ; toto cælo errare Macr. Sat. 3, 12, 10, se tromper lourdement
— [séjour de la divinité] : de cælo delapsus Cic. Pomp. 41, tombé (envoyé) du ciel (de cælo demissus Liv. 10, 8, 10) ; Herculem in cælum sustulit fortitudo Cic. Tusc. 4, 50, son courage a porté au ciel Hercule
— [poét.] cælo gratissimus Virg. En. 8, 64, chéri du ciel ; me adsere cælo Ov. M. 1, 761, admets-moi au ciel (au rang des dieux)
¶2. ciel, hauteur des airs : ad cælum manus tendere Cæs. C. 2, 5, 3, tendre ses mains vers le ciel ; ad cælum extruere villam Cic. Dom. 124, élever jusqu'au ciel une maison ; aer natura fertur ad cælum Cic. Nat. 117, l'air monte naturellement vers le ciel
— [fig.] in cælum Cato tollitur Cic. Arch. 22, on porte aux nues Caton (aliquem ad cælum ferre Cic. Verr. 4, 12 ; efferre Cic. Marc. 29) ; in cælo sum Cic. Att. 2, 9, 1, je suis au septième ciel [je triomphe], cf. digito cælum adtingere Cic. Att. 2, 1, 7, toucher du doigt le ciel ; Bibulus in cælo est Cic. Att. 2, 19, 2, on élève Bibulus jusqu'aux cieux ; de cælo detrahere aliquem Cic. Phil. 2, 107, faire descendre qqn du ciel [de son piédestal]
¶3. air du ciel, air, atmosphère : omnes naturæ, cælum, ignes, terræ, maria Cic. Nat. 1, 22, tous les éléments, le ciel, le feu, la terre, les mers ; repente cælum, solem, aquam terramque adimere alicui Cic. Amer. 71, enlever soudain à qqn le ciel, le soleil, l'eau, la terre (les 4 éléments)
— climat, atmosphère d'une contrée : quæ omnia fiunt ex cæli varietate Cic. Div. 1, 79, tout cela résulte de la diversité des climats ; crasso cælo atque concreto uti Cic. Nat. 2, 42, vivre dans une atmosphère épaisse et dense ; Athenis tenue cælum... crassum Thebis Cic. Fat. 7, à Athènes l'atmosphère est subtile... épaisse à Thèbes ; ubi se cælum, quod nobis forte alienum, commovet Lucr. 6, 1119, quand l'atmosphère d'une contrée, qui se trouve nous être contraire, se déplace ; paluster cælum Liv. 22, 2, 11, air (atmosphère) des marais
— ciel, état du ciel : cælo sereno Cic. Fam. 16, 9, 2, par un ciel serein ; dubio cælo Virg. G. 1, 252, avec un ciel incertain
¶4. voûte, dôme d'un édifice, voussure : Vitr. 7, 3, 3
— capitis Plin. 11, 134, voûte du crâne.
===> l'orth. cœlum est défectueuse ; pour le pl. cæli, v. cælus.
¶1. ciel : Enn. An. 546 ; Petr. 39, 5 ; 45, 3 ; Vitr. 4, 5, 1 ; pl. cæli Lucr. 2, 1097 ; Serv. En. 1, 331
¶2. Ciel, fils d'Éther et de Dies : Cic. Nat. 3, 44
— père de Saturne : Enn. An. 27 ; Cic. Nat. 2, 63 ; etc.
¶1. appelée ensuite Cæneus, v. ce mot : Ov. M. 12, 189, etc.
¶2. une concubine de Vespasien : Suet. Vesp. 3, 23.
===> gén. cæpis Charis. 59, 6.
¶1. [sens rare] caractère sacré : legationis Cic. Amer. 113, caractère sacré d'une députation (deorum Cæs. d. Suet. Cæs. 6) ; Tac. An. 4, 64 ; 3, 61 ; 14, 22
¶2. vénération, respect religieux : summa religione cærimoniaque sacra conficere Cic. Balb. 55, accomplir des sacrifices avec le plus grand scrupule, le plus grand respect religieux ; superioris cujusdam naturæ, quam divinam vacant, cura cærimoniaque Cic. Inv. 2, 161, le culte et la vénération d'une nature supérieure qu'on appelle divine ; religionem eam, quæ in metu et cærimonia deorum sit, appellant Cic. Inv. 2, 66, ce qui constitue la religion, c'est la crainte et la vénération des dieux, cf. Verr. 5, 36 ; Har. 21 ; Nep. Them. 8, 4 ; Liv. 29, 18, 2 ; 40, 4, 9
¶3. manifestation de la vénération, culte : cærimoniæ sepulcrorum Cic. Tusc. 1, 27, le culte des tombeaux
— cérémonie (surtout au plur.) : quo more eorum gravissima cærimonia continetur Cæs. G. 7, 2, 2, ce qui dans leurs coutumes constitue la cérémonie la plus solennelle ; cærimonias polluere Cic. Dom. 105, profaner les cérémonies religieuses ; institutas cærimonias persequi Cic. Dom. 141, achever une cérémonie selon les rites établis ; cærimonias retinere Cic. Div. 2, 148, garder (maintenir) les cérémonies religieuses ; colere Cic. Mil. 83, les observer, les pratiquer.
===> n. cærimonium et pl. cærimonia, ōrum, Fort. Mart. 3, 53 ; CIL 11, 3933
— orth. cerem-, décadence.
===> .
¶1. la mer (les plaines azurées) : Cic. poét. Fin. 5, 49 ; Virg. En. 4, 583
¶2. l'azur du ciel : Lucr. 1, 1090
— l'azur des sommets des montagnes : Ov. M. 11, 158.
¶1. bleu, bleu sombre : Cic. Ac. 2, 105 ; Nat. 1, 83 ; Cæs. G. 5, 14, 2
— foncé, sombre, noirâtre : Cic. fr. H. 4 a, 448 ; Virg. En. 8, 622 ; Ov. A. A. 2, 518
— subst. n. cærŭlĕum, azur, couleur bleue : Vitr. 7, 11, 1
¶2. subst. m., bleu ou peau bleue [poisson] : Isid.
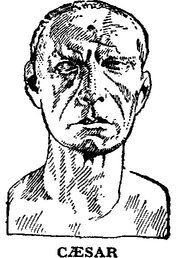
¶1. nom de diverses villes de Palestine, Cappadoce, Pisidie, Arménie, Mauritanie, Lusitanie : Plin., Tac., etc.
¶2. nom d'une île située entre la Bretagne et la Gaule [auj. Jersey] : Anton.
— Cæsarea Augusta, c. Cæsaraugusta
— -ĭensis, e, de Césarée : Tac. H. 2, 58 ; pl., habitants de Césarée : Plin. 5, 120.
¶1. chevelu : Pl. Mil. 768
— equis cæsariati Tert. Pall. 4, qui ont le casque orné d'une crinière de cheval
¶2. [fig.] orné de feuillage, de feuilles : Apul. Mund. 23.
===> mot. poét., toujours employé au sing.
¶1. cæsim petere hostem Liv. 22, 46, 5, frapper l'ennemi de taille, cf. 7, 10, 9 ; Suet. Cal. 58
¶2. [rhét.] par incises : Cic. Or. 225 ; Quint. 9, 4, 126.
¶1. motte de gazon [en forme de brique : P. Fest. 45] : obstruere portas singulis ordinibus cæspitum Cæs. G. 5, 51, 4, boucher les portes chacune avec un seul rang de mottes de gazon ; primum cæspitem posuit Tac. An. 1, 52, il posa la première motte
¶2. [fig.] hutte : Hor. O. 2, 15, 17
— autel de gazon : Tac. H. 4, 53
¶3. touffe, bourgeon : Plin. 17, 153
¶4. terre couverte de gazon, sol : cæspes gramineus Virg. En. 11, 566, le sol herbu
¶5. contrée, pays : Avien. Perieg. 227.

¶1. action de couper, coupe : cæsura silvæ Plin. 17, 150, coupe d'un bois
¶2. coupure, endroit où une chose est coupée : Plin. 8, 96
— césure [terme de métrique] : Diom. p. 496.
¶1. fleuve de Mysie : Cic. Flac. 72
¶2. un des compagnons d'Énée : Virg. En. 1, 183.
¶1. nourrice d'Énée : Virg. En. 7, 2
¶2. ville et port du Latium [auj. Gaète] : Cic. de Or. 2, 22
— -ētānus, a, um, de Caiète : Val.-Max. 1, 4, 5.

===> au gén. plur. qqf. calamitatium : Sen. Contr. 1, 1, 11 ; Plin. 7, 87 ; Just. 16, 4, 5.
¶1. qui fait du dégât, des ravages, ruineux, désastreux, pernicieux, funeste (au pr. et au fig.) : Cic. Verr. 1, 96 ; Mur. 33
¶2. exposé à la grêle, au ravage : Cat. Agr. 35, 1 ; Cic. Agr. 2, 81
— malheureux, accablé par le malheur : Cic. Mur. 50 ; Læ. 46 ; Tusc. 4, 82
— -tosior Cic. Quinct. 95
— -tosissimus Cic. Phil. 11, 34.

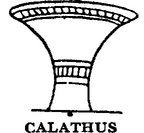
¶1. crieur, héraut au service de prêtres divers : Suet. Gram. 12
¶2. esclave de magistrats [Gloss. 2, 95, 42] ou de particuliers : Pl. Merc. 852 ; Ps. 1009
— peut-être le même que le nomenclator, cf. Charis. 126, 20.
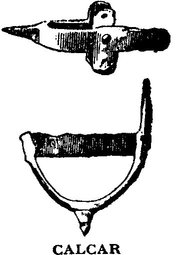
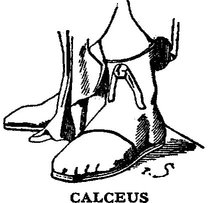
===> formes de la 1re décl. : gén. æ Prisc. 6, 53 ; acc. am Pac. et Pl. d. Char. 66, 22 ; abl. a Pl. Men. 748.
===> .
¶1. herba in pratis non calcanda Varr. R. 1, 47, 1, il ne faut pas fouler l'herbe dans les prés ; eo deliciarum pervenimus, ut nisi gemmas calcare nolimus Sen. Ep. 86, 7, nous en sommes venus à ce point de délicatesse (de raffinement) que nous ne voulons plus fouler que des pierres précieuses ; calcanda semel via leti Hor. O. 1, 28, 16, on ne doit fouler qu'une fois le chemin de la mort
¶2. piétiner, comprimer en foulant [la terre] : Cat. Agr. 61, 2, etc. ; Virg. G. 2, 243 ; [les raisins pour extraire le jus] Cat. Agr. 112 ; Varr. R. 1, 54, 2
— faire entrer en foulant : oleas in orculam Cat. Agr. 117, comprimer des olives dans une jarre, cf. Col. 12, 15, 2 ; Varr. L. 5, 167
— morientum acervos Ov. M. 5, 88, piétiner les monceaux de mourants
¶3. [fig.] fouler aux pieds : libertas nostra obteritur et calcatur Liv. 34, 2, 2, notre liberté est écrasée et foulée aux pieds, cf. Sen. Ben. 4, 1, 2 ; Ep. 12, 10, etc.
¶1. la pierre, [calculs dans la vessie] C.-Aur. Tard. 5, 4, 60
¶2. calcul, compte : Cassiod. Ep. 1, 10.
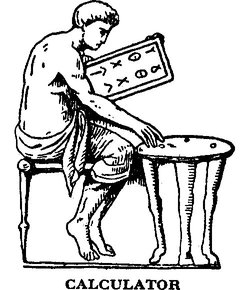
¶1. caillou : conjectis in os calculis Cic. de Or. 1, 261, s'étant mis des cailloux dans la. bouche ; dumosis calculus arvis Virg. G. 2, 180, des graviers dans un sol hérissé de buissons
— calcul de la vessie, pierre, gravelle (Isid. 4, 7, 32) : Cic. Div. 2, 143 ; Vitr. 8, 3, 17 ; Cels. 2, 7, etc.
¶2. caillou pour voter : Ov. M. 15, 44 ; Apul. M. 10, 8, etc. ; [d'où] vote, suffrage : album calculum adjicere alicui rei Plin. Ep. 1, 2, 5, accorder un vote favorable à qqch (cf. Ov. M. 15, 41), donner une approbation à qqch
— caillou blanc [pour marquer les jours heureux] : Plin. Ep. 6, 11, 3 (cf. Hor. O. 1, 36, 10 ; Plin. 7, 131)
¶3. caillou, pion [d'une espèce de jeu de dames ou d'échecs] : calculum reducere Cic. frg. F. 5, 60, ramener un jeton en arrière ; promovere Quint. 11, 2, 38, le pousser en avant, cf. Ov. A. 2, 207 ; 2, 478 ; 3, 358 ; Sen. Tranq. 14, 7 ; ut sciat, quomodo alligatus exeat calculus Sen. Ep. 117, 30, pour savoir comment un pion bloqué se tirera d'affaire
¶4. caillou de la table à calculer (Isid. 10, 43), [d'où] calcul, compte : ad calculos aliquem vocare Liv. 5, 4, 7, inviter qqn à calculer (à faire un compte) ; ad calculos aliquid vocare Cic. Læ. 58, mettre qqch en calcul, calculer qqch ; calculos ponere Sen. Polyb. 9, 1 (Plin. Ep. 2, 19, 9), établir un calcul ; utrosque calculos ponere Sen. Ep. 81, 6, faire des comptes en partie double
— [fig.] voluptatum calculis subductis Cic. Fin. 2, 60, après avoir fait un calcul des plaisirs ; ad calculos amicitiam vocare Cic. Læ. 58, soumettre l'amitié à un calcul exact
¶5. cailloux des escamoteurs : Sen. Ep. 45, 8
¶6. poids le plus faible possible : Grom. p. 373, 21.
¶1. chaud, chauffé : Plin. Ep. 5, 6, 26
¶2. qui se travaille à chaud : Plin. 34, 94
¶3. subst. f.:
a) étuve : M. Emp. 25 ;
b) chaudron : Apul. Herb. 59
¶4. subst. n. caldarium, ĭi, étuve, chaudière, chaudron : Sen. Ep. 86, 11 ; Cels. 1, 4, 6.
===> formes : calface Cic. Fam. 16, 18, 2 (cf. Quint. 1, 6, 21) ; calfacias Cic. Fam. 9, 16, 9 ; calficiunt Cæl. Fam. 8, 6, 4 (M) ; calficiendum Cic. Nat. 2, 151 ; calficimur Cic. frg. E. 6, 23.
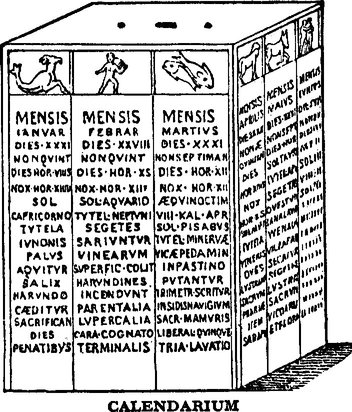
¶1. chaud, brûlant : Cic. Nat. 2, 25 ; Hor. O. 2, 6, 22, etc.
¶2. [fig.] : calentibus ingeniis vinum subtrahere Sen. Ir. 2, 20, 2, interdire le vin aux tempéraments bouillants ; jam calentibus (animis) Quint. 4, 1, 59, quand les esprits sont déjà échauffés (préparés).
¶1. être chaud, être brûlant : sentiri hæc putat, ut calere ignem Cic. Fin. 1, 30, il pense que ces choses-là se sentent, comme on sent que le feu est chaud
— [pass. imp.] cum caletur Pl. Capt. 80, quand il fait chaud ; Truc. 65 ; Apul. M. 4, 1
— Sabæo ture calent aræ Virg. En. 1, 417, les autels sont brûlants de l'encens de Saba [l'encens brûle sur les autels] ; calituræ ignibus aræ Ov. M. 13, 590, autels destinés à être brûlants du feu des sacrifices
¶2. [fig.] être sur les charbons, être embarrassé : velim me juves consilio ; etsi te ipsum istic jam calere puto Cic. Att. 7, 20, 2, je voudrais que tu m'aides de tes conseils ; et pourtant toi-même là-bas tu commences à être, je crois, sur les charbons
— être échauffé, être agité : clamant, calent, rixant Varr. Men. 454, ils crient, sont échauffés, se gourment ; an ego, cum omnes caleant, ignaviter aliquid faciam ? Hirt. Att. 15, 6, 2, eh quoi ! quand tout le monde est en feu, resterais-je engourdi ? amore Ov. A. 3, 571, brûler d'amour ; spe Curt. 4, 1, 29, être enflammé d'espérance ; Romani calentes adhuc ab recenti pugna Liv. 25, 39, 9, les Romains encore tout échauffés du combat qu'ils venaient de livrer ; calebat in agendo Cic. Br. 234, il était tout feu dans l'action [oratoire]
— ad nova lucra calere Prop. 4, 3, 62, brûler pour de nouveaux profits (brûler de faire de nouveaux profits)
— [avec inf.] brûler de, désirer vivement : Stat. Th. 4, 261
¶3. [fig.] être chauffé, être à point : posteaquam salis calere res Rubrio visa est Cic. Verr. 1, 66, quand il eut paru à Rubrius que l'affaire était chauffée à point
— être dans tout son feu (en pleine activité) : calebant in interiore ædium parte totius rei publicæ nundinæ Cic. Phil. 5, 11, c'était dans tout son feu, à l'intérieur de sa maison, un marché où l'on trafiquait de l'État entier ; indicia calebant Cic. Att. 4, 18, 3, les dénonciations battaient leur plein
— illi rumores Cumarum tenus caluerunt Cæl. Fam. 8, 1, 2, ces bruits se sont développés à Cumes seulement et pas au-delà ; illud crimen de nummis caluit re recenti, nunc refrixit Cic. Planc. 55, cette accusation à propos des écus a produit son effet dans la nouveauté, maintenant il est éteint
— [prov.] nil est nisi, dum calet, hoc agitur Pl. Pœn. 914, rien ne va si on ne profite pas de ce qu'une chose est à point pour la faire.

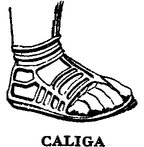
¶1. tout état sombre de l'atmosphère : nox obruit ingenti caligine terras Lucr. 5, 650, la nuit couvre la terre d'un immense voile sombre ; caliginis aer Lucr. 4, 313, couche d'air obscure ; (ventus) crassa volvit caligine fumum Lucr. 6, 691, (le vent) pousse en tourbillon une fumée d'un noir épais (les noirs tourbillons d'une fumée épaisse) ; picea caligine Virg. G. 2, 309, d'un noir de poix ; nubis caligo crassa Lucr. 6, 461, l'épaisseur sombre d'un nuage
— obscurité, ténèbres : tætris tenebris et caligine Cic. Agr. 2, 44, par des ténèbres et une obscurité affreuses ; pandere res alta terra et caligine mersas Virg. En. 6, 266, dévoiler les secrets enfouis sous l'épaisseur de la terre dans les ténèbres (dans les sombres profondeurs de la terre)
— brouillard, vapeur épaisse, nuage : solum densa in caligine Turnum vestigat lustrans Virg. En. 12, 466, Turnus est le seul qu'il cherche des yeux dans l'épais nuage de la bataille ; noctem insequentem eadem caligo obtinuit Liv. 29, 27, 7, la nuit suivante, le même brouillard persista ; densa caligo occæcaverat diem Liv. 33, 7, 2, un brouillard épais avait aveuglé le jour ; discussa caligine Curt. 4, 12, 22, le brouillard s'étant dissipé ; videre quasi per caliginem Cic. Phil. 12, 3, voir comme à travers un nuage, cf. Fin. 5, 43 ; discussa est illa caligo, quam paullo ante dixi Cic. Phil. 12, 5, il s'est dissipé ce nuage dont je parlais tout à l'heure
— brouillard qui s'étend sur les yeux : cum altitudo caliginem oculis offudisset Liv. 26, 45, 3, comme la hauteur leur causait le vertige (étendait un brouillard sur leurs yeux) ; cervix ejus saxo ita icta est, ut oculis caligine offusa collaberetur Curt. 7, 6, 22, il fut frappé d'une pierre à la tête de telle sorte, qu'un brouillard s'étant étendu sur ses yeux, il s'écroula [sans connaissance]
¶2. [fig., métaph. diverses] : ténèbres [= époque troublée] : vide nunc caliginem temporum illorum Cic. Planc. 96, vois maintenant les ténèbres [le malheur] de ces temps-là (Sen. 5 ; Verr. 3, 177)
— nuit, détresse : illa caligo bonorum Cic. Prov. 43, cette nuit dans laquelle se trouvaient les gens de bien
— nuit, brouillards de l'intelligence, ignorance : philosophia ab animo tamquam ab oculis caliginem dispulit Cic. Tusc. 1, 64, la philosophie a dispersé loin de l'esprit, comme on le ferait des yeux, les nuages qui l'enveloppaient ; hic error, hæc indoctorum animis offusa caligo est, quod... Cic. Tusc. 5, 6, cette erreur, ces ténèbres sont répandues sur les esprits des ignorants, parce que...
¶1. être sombre, obscur, couvert de ténèbres, enveloppé de brouillard : Cic. Arat. 205 ; 246 ; caligantem nigra formidine lucum ingressus Virg. G. 4, 468, pénétrant dans le bois qu'enveloppe une effroyable nuit
— [fig.] lucem caliganti reddere mundo Curt. 10, 9, 4, rendre la lumière au monde plongé dans la nuit ; (nubes) quæ circum caligat Virg. En. 2, 606, (le nuage) épaissi autour de toi
— (videmus) caligare oculos Lucr. 3, 156, (nous voyons) que les yeux se couvrent d'un brouillard
— [médecine] avoir les yeux brouillés, obscurcis, faibles : Cels. 6, 6, 32 ; Gell. 14, 1, 5
¶2. [fig.] avoir la vue obscurcie, être ébloui, être aveuglé : ad pervidendum, quid sit quod beatam vitam efficiat, caligant Sen. Beat. 1, 1, quant à voir pleinement ce qui est capable d'assurer le bonheur, ils sont dans la nuit ; non aliter caligabis quam quorum oculi in densam umbram ex claro sole redierunt Sen. Nat. 3, præf. 11, tu n'y verras plus, exactement comme ceux dont les yeux passent d'un clair soleil à une ombre épaisse ; (utraque materia) ad quam cupiditas nostra caligat Sen. Ben. 7, 10, 1, (les deux métaux, or, argent) devant lesquels notre cupidité reste éblouie ; ad cetera caligant Curt. 10, 7, 4, pour le reste ils sont aveugles ; caligant vela carinæ Stat. S. 5, 3, 238, les voiles du vaisseau vont à l'aveugle (ne savent où se tourner) ; caligare in sole Quint. 1, 2, 19, n'y pas voir en plein jour
¶3. [emploi trans. à la décadence] obscurcir : Fulg. Virg. p. 103.


I. int., [au pr.] avoir la peau dure : Plin. 11, 211
— avoir des callosités, des durillons : Pl. Pers. 305 ; Pseud. 136, etc.
II. [fig.], int. et tr.,
¶1. int. être endurci : Sulp. Fam. 4, 5, 2 (cf. percallesco)
— être rompu à, être façonné, être au courant : Pl. Pers. 176, etc. ; alicujus rei usu callere Liv. 35, 26, 10, être rompu à la pratique d'une chose ; fallendo callere Acc. Tr. 475, être passé maître en tromperies ; in re rustica Col. 3, 17, 3, être versé dans l'art de la culture ; ad suum quæstum *Pl. Truc. 932, être expert en vue de son profit
¶2. tr., être expert en qqch, savoir à fond : Pœnorum jura callere Cic. Balb. 32, être versé dans la connaissance du droit carthaginois (jus civile Gell. 16, 10, 3, du droit civil) ; urbanas rusticasque res pariter callebat Liv. 39, 40, 5, [Caton] était également rompu à tout ce qui concerne la vie de la ville et de la campagne [droit civil, économie rurale] ; legitimum sonum digitis callemus et aure Hor. P. 274, nous savons reconnaître du doigt [en battant la mesure] et de l'oreille un son conforme aux règles
— [avec inf.] savoir parfaitement : Lucr. 2, 978 ; Hor. O. 4, 9, 49 ; Curt. 3, 2, 14
— [avec prop. inf.] Sisenna H. 44 (dans Non. 258, 8) ; Apul. M. 1, 3
— [avec int. indir.] Ter. Haut. 548 ; Apul. Plat. 2, 23.
¶1. [en mauv. part.] rusé, roué, madré : considera, quis quem fraudasse dicatur ; Roscius Fannium !... callidum imperitus Cic. Com. 21, examine qui l'on nous présente comme l'auteur de la fraude et comme sa victime : Fannius victime de Roscius ! la ruse victime de l'inexpérience ! callida assentatio Cic. Læ. 99, flatterie habile (astucieuse)
¶2. [en bonne part] qui a le savoir-faire, l'expérience, habile : Chrysippus, homo versutus et callidus (versutos eos appello, quorum celeriter mens versatur, callidos autem, quorum tamquam manus opere, sic animus usu concaluit) Cic. Nat. 3, 25, Chrysippe, esprit souple et exercé (j'appelle versuti, souples, ceux dont l'intelligence se meut promptement ; callidi, exercés, ceux dont l'esprit s'est fait (s'est durci) par l'exercice, comme la main par le travail) ; [en parl. d'un orateur] Cic. Clu. 140 ; de Or. 1, 109 ; 1, 218 ; Br. 178, etc. ; [d'un général] Cic. Off. 1, 108 ; Nep. Hann. 5, 2 ; [en gén.] : homines prudentes natura, callidi usu, doctrina eruditi Cic. Scaur. 24, gens que la nature a faits prudents, l'expérience avisés, la culture éclairés
— callidissimo artificio Cic. Tusc. 1, 47, avec un art souverainement habile ; versutum et callidum factum Solonis Cic. Off. 1, 108, l'acte retors et habile de Solon
¶3. [constr.] : qui ad fraudem callidi sunt Cic. Clu. 183, ceux qui excellent dans la ruse ; in dicendo callidus Cic. Clu. 140, habile orateur ; rei militaris callidus Tac. H. 2, 32, habile dans la science militaire, cf. H. 4, 33 ; Ov. F. 1, 268 ; accendendis offensionibus callidi Tac. An. 2, 57, habiles à attiser les ressentiments
— [avec inf.] Hor. O. 1, 10, 7 ; 3, 11, 4 ; Pers. 1, 118.
¶1. Callimaque [poète élégiaque de Cyrène] : Cic. Tusc. 1, 84
— -chīus, a, um (Καλλιμάχειος), de Callimaque : Serv. Cent. 5, 4
¶2. sculpteur célèbre : Plin. 34, 92
¶3. médecin : Plin. 21, 12.

¶1. Callirhoé [fille d'Achéloüs] : Ov. M. 9, 414
¶2. fontaine près d'Athènes : Stat. Th. 12, 629
¶3. fontaine d'eau chaude de Palestine : Plin. 5, 72
¶4. autre nom d'Édessa en Arabie : Plin. 5, 86.
¶1. capillaire [plante] : Plin. 26, 160
¶2. espèce de singe d'Éthiopie : Plin. 8, 216.
¶1. statuaire de l'île d'Égine : Quint. 12, 10, 7
¶2. statuaire d'Élis : Plin. 34, 49.
===> les mss. portent cal- et non chal-.
¶1. valet d'armée : Cæs. G. 2, 24, 2 ; 6, 36, 3 (cf. P. Fest. 62 ; Schol. Hor. S. 1, 2, 44)
— palefrenier, valet : Cic. Nat. 3, 11 ; Hor. S. 1, 6, 103 ; Sen. Ep. 110, 17
¶2. [les anciens croyaient que le mot venait de cala : P. Fest. 62 ; Porph. Hor. Ep. 1, 14, 42 ; Non. 62 ; Serv. En. 1, 39] [d'où le sens] bateau portant le bois : Isid. 19, 1, 15.
¶1. broc, cruche où l'on conserve le vin : Non. p. 546 ; P. Fest. 46
¶2. vin nouveau : P. Fest. 65.
¶1. accusation fausse, calomnieuse [devant les tribunaux], chicane en justice : causam calumniæ reperire Cic. Verr. 2, 21, trouver prétexte (matière) à chicane ; mirantur omnes improbitatem calumniæ Cic. Verr. 2, 37, tout le monde apprend avec étonnement cette chicane malhonnête (cette action intentée malhonnêtement, par mauvaise chicane); calumniam jurare Cæl. Fam. 8, 8, 3, jurer qu'on n'accuse pas de mauvaise foi, cf. Liv. 33, 47, 5
— condamnation et punition pour accusation fausse : calumniam non effugiet Cic. Clu. 163, il n'évitera pas le châtiment de son injuste accusation [poursuite] ; calumniam ferre Cæl. Fam. 8, 8, 1, encourir la condamnation pour accusation fausse ; accusare propter calumniæ metum non est ausus Cic. Dom. 49, il n'a pas osé intenter l'accusation par crainte d'une condamnation pour chicane
¶2. [en gén.] accusation injuste, chicane : in hac calumnia timoris Cæcin. Fam. 6, 7, 4, dans ces accusations qu'on se forge contre soi-même par crainte ; de deorum immortalium templis spoliatis in capta urbe calumniam ad pontifices afferre Liv. 39, 4, 11, porter devant les pontifes de vaines chicanes sur le pillage des temples effectué dans une ville prise d'assaut ; nimiā contra se calumniā Quint. 10, 1, 115, par excès de sévérité envers soi-même (en se chicanant trop)
¶3. emploi abusif de la loi, chicane du droit, supercherie, manœuvres, cabale : exsistunt sæpe injuriæ calumnia quadam et nimis callida, sed malitiosa juris interpretatione Cic. Off. 1, 33, il se produit souvent des injustices par une sorte d'emploi abusif de la loi, par une interprétation trop subtile et même frauduleuse du droit ; calumnia litium Cic. Mil. 74, procès intentés par pure chicane ; senatus religionis calumniam comprobat Cic. Fam. 1, 1, 1, le sénat approuve le prétexte imaginaire d'un obstacle religieux ; Metellus calumnia dicendi tempus exemit Cic. Att. 4, 3, 3, Métellus, usant par manœuvre du droit de parole, empêcha de rien faire [épuisa la séance]; res ab adversariis nostris extracta est variis calumniis Cic. Fam. 1, 4, 1, nos adversaires firent traîner la discussion par des manœuvres diverses ; Academicorum calumniam effugere Cic. Nat. 2, 20, échapper aux subtilités (aux chicanes) des Académiciens (Ac. 2, 14) ; ne qua calumnia, ne qua fraus, ne quis dolus adhibeatur Cic. Dom. 36, à condition de n'employer aucune manœuvre, aucune supercherie, aucun subterfuge ; calumniam coercere Cic. Ac. 2, 65, réprimer la chicane.
===> orth. kal- Gloss. 5, 29, 33 ; 5, 79, 19.
===> orth. kal-, v. Cic. Amer. 57.
===> .
¶1. intenter de fausses accusations devant les tribunaux : Cic. Amer. 55 ; Verr. 3, 38 ; etc.
— aliquem Quint. Decl. 269, p. 100, 11 ; Ulp. Dig. 47, 2, 27, etc., intenter de fausses actions judiciaires contre qqn
¶2. [en gén.] accuser faussement, élever des chicanes, se livrer à des manœuvres, à des intrigues : jacet res in controversiis isto calumniante biennium Cic. Quinct. 67, l'affaire se traîne dans les débats pendant deux ans grâce aux chicanes de cet individu ; calumniabar ipse Cic. Fam. 9, 2, 3, je soulevais moi-même des chicanes sans objet (je me créais des inquiétudes chimériques) ; se calumniari Quint. 10, 3, 10, se chercher des chicanes, se corriger trop sévèrement, cf. 8, proœm. 31 ; quod antea te calumniatus sum Cic. Fam. 9, 7, 1 (M ; ante a te HD), quant aux accusations que j'ai portées faussement contre toi auparavant ; dicta factaque quorumdam calumniari Suet. Aug. 12, incriminer faussement les paroles et les actes de certaines personnes ; non calumniatur verba nec vultus ; quicquid accidit, benigne interpretando levat Sen. Ep. 81, 25, il n'incrimine pas méchamment (avec malveillance) les paroles ou les airs du visage ; tout ce qui arrive, il l'atténue par une interprétation bienveillante
— [avec prop. inf.] Apul. M. 1, 17 ; [avec quod] Phæd. 1, prol. 5
¶3. emploi int. avec dat., décad. : Ambr. Incarn. 8, 33, etc.
===> la forme active calumnio, āvi, āre est de la décad.; p. ex. Greg. Tur. Jul. 53
— sens passif, Staber. d. Prisc. 8, 18.
===> .
===> .
===> la forme active calvo Prisc. 10, 13
— sens passif calvi, être trompé : Pacuv. 240 ; Sall. H. frag. 3, 109
— forme calvio Serv. En. 1, 720.
¶1. talon : pugnis et calcibus uti Cic. Sull. 71, se servir des poings et des talons [des mains et des pieds] ; calcem terere calce Virg. En. 5, 324, toucher du talon le talon du rival qui précède [courir sur ses talons, le serrer de très près] ; advorsum stimulum calces Ter. Phorm. 78 (s.-ent. jactare) regimber contre l'aiguillon [=opposer une résistance inutile] ; calcem impingere alicui rei Petr. 46, 5, donner un coup de pied à qqch, repousser, mettre de côté, délaisser
¶2. [fig.] [archit.] patin d'escalier : Vitr. 9, præf. 8
— pied d'un mât : Vitr. 10, 3, 5
— [agric.] : cum sua calce (malleolus avulsus) Plin. 17, 156, rameau (scion) détaché de l'arbre avec son talon [avec le bois adhérent à la base].
===> masc. dans Gratt. 278 ; v. Charis. 93, 2.
¶1. petite pierre, caillou servant à jouer (P. Fest. 46, 2) : Pl. Pœn. 908 ; Lucil. 458
¶2. chaux : Cat. Agr. 14, 1, etc.; Cic. Mil. 74 ; cæmenta non calce durata erant Liv. 21, 11, 8, les moellons n'étaient pas assujettis par de la chaux
¶3. [fig.] extrémité de la carrière marquée primitt par de la chaux : quasi decurso spatio ad carceres a calce revocari Cic. CM 83, après avoir en quelque sorte parcouru toute la carrière être ramené de la borne au point de départ, cf. Læ. 101
— [en gén.] fin, terme : Cic. Rep. frg. 7 ; Tusc. 1, 15 ; Quint. 8, 5, 30 ; Gell. 14, 3, 10.
===> masc. très rare : Varr. Men. 288 ; Cat. Agr. 18, 7
— nomin. calcis décad. : Fort. 11, 11, 12 ; Isid. 16, 3, 10
— pl. calces Greg. Tur. Patr. 2, 4.
¶1. fleuve de Cilicie : Amm. 14, 2, 15
¶2. promontoire de Cilicie : Liv. 38, 38, 9.
¶1. ville de la côte s.-ouest de Sicile : Plin. 3, 89
— -nus, a, um, Virg. En. 3, 701 ; Prisc. Peri. 489, de Camarina
¶2. marais près de Camarina : Claud. Pros. 2, 69.
===> 4e conj. campsi, cambire Charis. 247 ; 262 ; Prisc. 10, 52.
¶1. peuple de la Narbonnaise : Plin. 3, 36
¶2. de l'Aquitaine : Plin. 4, 108.
¶1. Cambyse [mari de Mandane et père du premier Cyrus] : Just. 1, 4, 4
— le fils du premier Cyrus : Just. 1, 9
¶2. fleuve d'Albanie : Mel. 3, 5, 6
¶3. fleuve de Médie : Amm. 23, 6, 40.
===> anc. forme Casmena : Varr. L. 7, 26 ; P. Fest. 205 ; 67.
¶1. toit recourbé, voûte, plafond voûté : Cic. Q. 3, 1, 1 ; Sall. C. 55, 4
¶2. barque à toit voûté : Tac. H. 3, 47.
¶1. v. Cameria
¶2. v. Camarina.
¶1. fourneau, fournaise : Cat. Agr. 37, 5 ; Plin. 33, 69 ; Ov. M. 7, 106
— [poét.] forge [de Vulcain et des Cyclopes sous l'Etna] : Virg. En. 3, 580
¶2. cheminée, âtre : Hor. Ep. 1, 11, 19
¶3. foyer, feu [d'une cheminée] : caminus luculentus Cic. Fam. 7, 10, 2, foyer bien garni
— [prov.] camino oleum addere Hor. S. 2, 3, 321, jeter de l'huile sur le feu.

¶1. sorte de peson, romaine : Isid. 16, 25, 6
¶2. cloche : Dig. 41, 1, 12.
¶1. de plaine, uni, plat : Cæs. G. 7, 72, 3 ; 7, 86, 4 ; campestre iter Liv. 21, 32, 6, chemin de plaine : campester hostis Liv. 22, 18, 3, ennemi qui recherche les combats en plaine ; Scythæ campestres Hor. O. 3, 24, 9, les Scythes qui habitent les plaines
— -trĭa, ĭum, n., v. ce mot
¶2. qui a rapport au champ de Mars, du champ de Mars ; exercices ; comices, élections : Cic. Cæl. 11 ; Hor. Ep. 1, 18, 54
— gratia campestris Liv. 7, 1, 2, influence dans les comices ; temeritas campestris Val.-Max. 4, 1, 14, le caprice des élections
— -tres, ĭum, m., les dieux qui président aux luttes du champ de Mars : CIL 7, 1114.
===> nom. m. -tris Cat. Orig. 7 ; Col. 3, 13, 8.

¶1. plaine (v. l'étym. de Varron Varr. L. 5, 36) : erat ex oppido despectus in campum Cæs. G. 7, 79, 3, on avait de la ville une vue plongeante sur la plaine
— plaine cultivée, champs : molli flavescet campus arista Virg. B. 4, 28, la campagne jaunira sous les souples épis ; is Divum, qui vestros campos pascit placide Liv. 25, 12, 10, le dieu qui nourrit (protège) vos champs dans la paix
— plaine, rase campagne : Cæs. G. 3, 26, 6 ; C. 1, 65, 2, etc. ; numquam in campo sui fecit potestatem Nep. Ages. 3, 6, jamais il n'accepta le combat en rase campagne
— insistere Bedriacensibus campis Tac. H. 2, 70, fouler les plaines de Bédriac [le sol du champ de bataille]
— campi Elysii Virg. G. 1, 38 (campi seul Virg. En. 6, 640 ; 887), champs Élyséens, Champs-Élysées
— [en gén.] plaine : [de la mer] Pl. Trin. 834 ; Lucr. 5, 488 ; Virg. G. 3, 198, etc.; [du ciel] Ov. M. 6, 694
— [fig.] campus cereus Titin. Com. 160, tablette à écrire
¶2. place [dans la ville de Rome] : campus Esquilinus Cic. Phil. 9, 17 ; campus Agrippæ Gell. 14, 5, 1, champ Esquilin, champ d'Agrippa
— [mais surtout] campus Martius, ou abst campus, le champ de Mars : [lieu des comices] non in cunabulis, sed in campo consules facti Cic. Agr. 2, 100, consuls élus non pas au berceau, mais en plein champ de Mars ; dies campi Cic. Mil. 43, le jour du champ de Mars [le jour des comices] ; campum appellare pro comitiis Cic. de Or. 3, 167, dire champ de Mars au lieu de comices ; [lieu de promenade, de jeu, d'exercices militaires] Cic. Fin. 1, 69 ; Fat. 34 ; Off. 1, 104, etc.; Hor. O. 1, 8, 4 ; Ep. 1, 7, 58, etc.
¶3. [fig.] champ libre, large espace (carrière, théâtre) : nullum vobis sors campum dedit, in quo excurrere virtus posset Cic. Mur. 18, le sort ne vous a pas donné un champ d'action où pût se déployer votre talent ; magnus est in re publica campus Cic. Phil. 14, 27, il est vaste le champ qui s'offre dans la vie politique ; hinc rhetorum campus de Marathone, Salamine, Platæis... Cic. Off. 1, 61, de là le vaste champ qu'offrent aux orateurs Marathon, Salamine, Platées...
¶1. disposer en treillis : Col. 4, 2, 2
¶2. biffer : Ulp. Dig. 28, 4, 2
— délimiter : Grom.
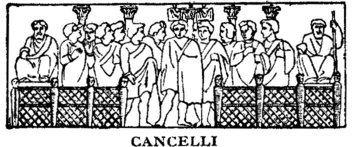
¶1. cancre, crabe, écrevisse : Plin. 9, 97
¶2. le Cancer, signe du zodiaque : Cic. Arat. 263 ; Lucr. 5, 617
— [poét.] le sud : Ov. M. 4, 625
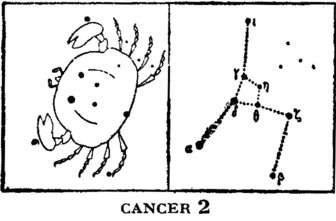
¶3. chaleur violente : Ov. M. 10, 127
¶4. cancer, chancre : Cels. 5, 26, 31 ; [dans ce sens qqfois neutre : Prisc. 6, 43]
— [fig.] Orci cancri Apul. M. 6, 8, les griffes de Pluton.
===> qqf. gén. canceris et pl. -eres au sens de maladie : Cat. Agr. 157, 3 ; Arn. 1, 50.
¶1. blanchir [un objet] : Pl. Most. 259 ; Gell. 6, 5, 9
¶2. chauffer à blanc : Plin. 33, 64
— candēfīo, factus sum, ĭĕri, pass., devenir chaud, être chauffé : Plin. 34, 96.
¶1. chandelle, cierge [de suif, de cire ou de poix] : Plin. 16, 178 ; 33, 122 ; Vitr. 7, 9, 3
¶2. corde enduite de cire [pour la conservation] : Liv. 40, 29, 6 ; Hemin. H. 37.

¶1. blanc brillant : [lait] Lucr. 1, 258 ; [marbre] Lucr. 2, 767 ; [soleil] Lucr. 6, 1197 ; [lune] Cic. Rep. 1, 23
¶2. ardent : carbone candente Cic. Off. 2, 25, avec un charbon ardent ; aqua candens Col. 6, 5, 2, eau bouillante
— candentior V.-Fl. 3, 481 ; -issimus Solin. 52, 25.
¶1. robe blanche du candidat : Spart. Sev. 3, 3
¶2. spectacle [combat de gladiateurs] donné par un candidat : candidam edere Ps. Ambr. Serm. 81, donner des jeux
¶3. attente, espérance : Tert. Anim. 58 ; Marc. 4, 34
¶4. autorité, prestige : Tert. Ux. 1, 7 ; Scorp. 12.
¶1. part. de candido, vêtu de blanc : Pl. Cas. 446 ; Rud. 270 ; Suet. Aug. 98
¶2. candĭdātus, i, m., candidat [vêtu d'une toge blanche] : Cic. Verr. 4, 37 ; Mur. 43, etc.; prætorius Cic. Mur. 57 ; consularis Cic. Mur. 62 ; tribunicius Cic. Att. 4, 15, 7 ; quæsturæ Suet. Tib. 42, candidat à la préture, au consulat, au tribunat, à la questure
— candidatus Cæsaris, candidat de César [recommandé par César] : Vell. 2, 124, 4 (Quint. 6, 3, 62, candidat de César = sûr du succès)
— [en gén.] prétendant, aspirant à : candidatus non consulatus tantum, sed immortalitatis et gloriæ Plin. Pan. 63, candidat (aspirant) non seulement au consulat, mais à l'immortalité et à la gloire ; eloquentiæ Quint. 6, præf. 13, aspirant à l'éloquence, candidat orateur ; candidatus socer Apul. Apol. 99, aspirant au titre de beau-père.
===> fém. candidata, æ, candidate : Quint. Decl. 252.
¶1. de couleur blanche : candide vestitus Pl. Cas. 767, de blanc vêtu
¶2. avec candeur, de bonne foi, simplement : Cæl. Fam. 8, 6, 1 ; Quint. 12, 11, 8.
¶1. couleur blanche : Plin. 30, 121 ; Juv. 3, 30 ; Ov. M. 11, 314
¶2. le blanc de l'œuf : Plin. 29, 39.
¶1. blanc éclatant, blanc éblouissant ; [en parl. de la neige] : candidum Soracte Hor. O. 1, 9, 1, le Soracte éblouissant [de la neige qui le recouvre] ; [des lis] Virg. En. 6, 708 ; [du peuplier] Virg. B. 9, 41 ; [de pierres] Cat. Agr. 38, 2 ; [de la cigogne] Virg. G. 2, 320 ; [d'un agneau] Tib. 2, 5, 38 ; [de la barbe] Virg. B. 1, 28 ; [des cheveux] Plin. 7, 28 ; [du corps] Liv. 38, 21, 9 ; [du cou] Virg. G. 4, 337 ; [du vêtement] : toga candida Liv. 27, 34, 12 ; 39, 39, 2 (Isid. 19, 24, 6), toge blanche du candidat ; candida turba Tib. 2, 1, 16, foule vêtue de blanc (Ov. F. 2, 654 ; 4, 906) ; [du sel] Cat. Agr. 88, 1 ; [du pain] Varr. R. 3, 7, 9 ; Plin. 22, 139
¶2. d'une lumière claire (éclatante, éblouissante) ; [en parl. des astres] Enn. An. 90 ; Pl. Amp. 547 ; Rud. 3 ; Lucr. 5, 1210 ; Virg. En. 7, 8 ; Sen. Nat. 1, 17, 2 ; [du jour] Ov. F. 5, 548 ; Tr. 2, 142 ; candidus Zephyrus Col. 18, 78, le clair Zéphyre [=qui rend le ciel clair]
— d'une blancheur éclatante, d'une beauté radieuse, [épithète de dieux, de héros, d'héroïnes, etc.] : candida Dido Virg. En. 5, 571, la radieuse Didon ; (Galatea) candidior cycnis Virg. B. 7, 38, (Galatée) plus blanche que les cygnes ; candide Bacche Ov. F. 3, 772, ô radieux Bacchus
¶3. [fig.] radieux, heureux, favorable : [en parl. d'un jour anniversaire] Tib. 1, 7, 64 ; [de la paix] Tib. 1, 10, 45 ; [de présages] Prop. 4, 1, 67
— clair, franc, loyal : Plotius, Varius, Vergilius, animæ quales neque candidiores terra tulit Hor. S. 1, 5, 41, Plotius, Varius, Virgile, chères âmes, comme la terre n'en a jamais porté de plus limpides ; Albi, nostrum sermonum candide judex Hor. Ep. 1, 4, 1, Albius, juge sincère de mes satires
— clair, net, sans détours, sans apprêt : elaborant alii in puro quasi quodam et candido genere dicendi Cic. Or. 53, d'autres s'attachent à une sorte de style, pour ainsi dire limpide et transparent ; dulcis et candidus Herodotus Quint. 10, 1, 73, le doux (l'agréable) et limpide Hérodote ; candidissimus Quint. 2, 5, 19
— (voix) claire (opp. à fusca, sourde) : Plin. 28, 58 ; Quint. 11, 3, 15
— v. candida, candidum.
¶1. blancheur éclatante : solis candor Cic. Nat. 2, 40, la blancheur éclatante du soleil
— [en parl. des personnes] éclat, beauté : Cic. Cæl. 36
¶2. chaleur brûlante : candor æstivus Claud. Cons. Prob. 219, la chaleur brûlante de l'été
¶3. [fig.] clarté, limpidité : Livius clarissimi candoris Quint. 10, 1, 101, Tite Live, écrivain de la plus limpide clarté
— bonne foi, franchise, innocence, candeur : Plin. Pan. 84 ; Ep. 3, 21, 1.
===> pl. candores Pl. Men. 181.

===> acc. Canephoram Plin. 34, 70
— Canifera P. Fest. 65, 6.
===> .
===> .
¶1. chien, chienne : canes venatici Cic. Verr. 4, 31, chiens de chasse
— [fig.] chien [terme injurieux] : Hor. Epod. 6, 1
— limier, agent, créature : Cic. Verr. 4, 40
— tergeminus canis Ov. Am. 3, 322, le chien aux trois têtes [Cerbère] ; infernæ canes Hor. S. 1, 8, 35, les chiennes de l'enfer [qui accompagnent les Furies] ; cf. les chiens qui selon la fable entourent Scylla : Lucr. 5, 892 ; Cic. Verr. 5, 146 ; Virg. B. 6, 77
— [prov.] cane pejus vitare Hor. Ep. 1, 17, 30, fuir comme la peste ; cave canem Inscr., prenez garde au chien
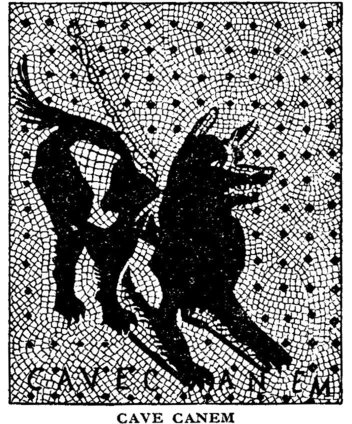
¶2. la Canicule [constellation, auj. du Grand Chien] : Hor. S. 1, 7, 26
— chien de mer : Plin. 9, 110
— coup du chien [aux dés, amener tous les as] : Ov. Tr. 2, 474 ; tam facile quam canis excidit Sen. Apocol. 10, 2, aussi facilement qu'on amène l'ambesas [coup de dés qui fait sortir deux as]
— philosophe cynique : Lact. Epit. 39, 4
— carcan, collier : Pl. Cas. 389 ; P. Fest. 45.

===> .
¶1. [au pr.] canne, jonc mince plus petit que le roseau : Ov. M. 8, 337 ; Col. 4, 32, 3 ; Ov. F. 2, 465, etc.
¶2. roseau, flûte pastorale : Ov. M. 2, 682 ; 11, 171
— barque (en roseau) : Juv. 5, 89
¶3. ustensile mal défini : Fort. Radeg. 19, 44
¶4. canna gutturis C.-Aur. Acut. 2, 16, 97, trachée-artère.
===> abl. -bi ; mais -be Pers. 5, 146.
I. intr.,
¶1. [en parl. d'hommes] chanter : canere ad tibicinem Cic. Tusc. 1, 3, chanter avec accompagnement de la flûte ; absurde Cic. Tusc. 2, 12, chanter faux
— [diction chantante des orateurs asiatiques] Or. 27
¶2. [animaux] : [chant de la corneille, du corbeau] Cic. Div. 1, 12 ; [du coq] Cic. Ac. 1, 74 ; [des grenouilles] Plin. 8, 227
¶3. [instruments] résonner, retentir : modulate canentes tibiæ Cic. Nat. 2, 22, flûtes rendant un son mélodieux ; cum symphonia caneret Cic. Verr. 3, 105, alors que résonnaient les concerts ; tubæ cornuaque ab Romanis cecinerunt Liv. 30, 33, 12, les trompettes et les clairons sonnèrent dans le camp romain ; ut attendant, semel bisne signum canat in castris Liv. 27, 47, 3, qu'ils observent si le signal de la trompette retentit une fois ou deux fois dans le camp, cf. 1, 1, 7 ; 24, 15, 1 ; 28, 27, 15 ; [fig.] neque ea signa audiamus, quæ receptui canunt Cic. Rep. 1, 3, et n'écoutons pas le signal de la retraite
¶4. jouer de (avec abl.) : fidibus Cic. Tusc. 1, 4, jouer de la lyre ; ab ejus litui, quo canitur, similitudine nomen invenit (bacillum) Cic. Div. 1, 30, (le bâton augural) a tiré son nom, lituus, de sa ressemblance avec le lituus dont on joue, le clairon ; cithara Tac. An. 14, 14, jouer de la cithare.
II. tr.,
¶1. chanter : carmen Cic. de Or. 2, 352, chanter une poésie ; versus Enn. An. 214, chanter des vers ; nec tam flebiliter illa canerentur... Cic. Tusc. 1, 85, et l'on n'entendrait pas les chants si plaintifs que voici...
— chanter, commémorer, célébrer : ad tibiam clarorum virorum laudes Cic. Tusc. 4, 3, chanter au son de la flûte la gloire des hommes illustres ; quæ (præcepta) vereor ne vana surdis auribus cecinerim Liv. 40, 8, 10, (mes préceptes) que j'ai bien peur d'avoir donnés vainement, comme si je les avais chantés à des sourds
— chanter = écrire en vers, exposer en vers : ut veteres Graium cecinere poetæ Lucr. 5, 405, comme l'ont chanté les vieux poètes grecs ; Ascræum cano Romana per oppida carmen Virg. G. 2, 176, chantant à la manière du poète d'Ascra, je fais retentir mes vers à travers les bourgades romaines ; arma virumque cano Virg. En., 1, 1, je chante les combats et le héros... ; motibus astrorum quæ sit causa canamus Lucr. 5, 509, chantons la cause des mouvements des astres ; canebat uti magnum per inane coacta semina... fuissent Virg. B. 6, 31, il chantait comment dans le vide immense s'étaient trouvés rassemblés les principes (de la terre, de l'air, etc.)
¶2. prédire, prophétiser : ut hæc, quæ nunc fiunt, canere di immortales viderentur Cic. Cat. 3, 18, en sorte que les événements actuels semblaient prophétisés par les dieux immortels, cf. Sest. 47 ; Div. 2, 98 ; Virg. En. 3, 444 ; 8, 499 ; Hor. O. 1, 15, 4 ; S. 1, 9, 30 ; Tib. 2, 5, 16
— [avec prop. inf.] : fore te incolumem canebat Virg. En. 6, 345, il prédisait que tu serais sain et sauf, cf. 7, 79 ; 8, 340 ; Liv. 1, 7, 10 ; 26, 5, 14, etc.; nec ei cornix canere potuit recte eum facere, quod populi Romani libertatem defendere pararet Cic. Div. 2, 78, une corneille ne pouvait lui annoncer qu'il faisait bien de se préparer à défendre la liberté du peuple romain ; hoc Latio restare canunt Virg. En. 7, 271, les devins annoncent que cette destinée est réservée au Latium
¶3. jouer d'un instrument, faire résonner (retentir) : omnia intus canere Cic. Verr. 1, 53, jouer tout à la sourdine [en parl. d'un joueur de luth qui se contente de toucher les cordes de la main gauche, c.-à-d. en dedans, de son côté ; tandis que les faire vibrer de la main droite avec le plectrum, c'est foris canere : Ps. Ascon. Verr. p. 173] ; classicum apud eum cani jubet Cæs. C. 3, 82, 1, il donne l'ordre que les sonneries de la trompette soient faites près de lui [marque du commandt] ; tubicines simul omnes signa canere jubet Sall. J. 99, 1, il donne l'ordre que les trompettes exécutent tous ensemble leurs sonneries [signa canere jubet Sall. C. 59, 1, signa peut être ou sujet ou compl. direct]
— bellicum me cecinisse dicunt Cic. Phil. 7, 3, ils disent que j'ai donné le signal de la guerre (Mur. 30) ; ubi primum bellicum cani audisset Liv. 35, 18, 6, aussitôt qu'il aurait entendu retentir le signal de la guerre [mais (Thucydides) de bellicis rebus canit etiam quodam modo bellicum Cic. Or. 39, (Thucydide) dans les récits de guerre semble même faire entendre des sonneries guerrières, bellicum, acc. n. de qualif.]
— tuba commissos canit ludos Virg. En. 5, 113, la trompette annonce l'ouverture des jeux ; ut (bucina) cecinit jussos inflata receptus Ov. M. 1, 340, quand (la trompe) dans laquelle il a soufflé a sonné l'ordre de la retraite.
===> parf. arch. canui Serv. G. 2, 384 ; canerit = cecinerit Fest. 270, 32
— impér. cante p. canite Saliar. d. Varr. L. 6, 75
— forme caniturus décad. : Vulg. Apoc. 8, 13.
¶1. qui concerne une règle, une mesure, régulier : canonica ratio Vitr. 5, 3, la théorie de l'harmonie [en musique] ; canonicæ defectiones solis Aug. Civ. 3, 15, les éclipses (dans l'ordre) régulières du soleil
— pl. n. canonica, ōrum, théorie : Plin. Ep. 1, 2, 12
¶2. relatif à une redevance, à une contribution : canonici equi Cod. Th. 11, 17, 3, chevaux donnés pour se conformer à une contribution
¶3. canonique (latin ecclés.) : Aug. Civ. 18, 36.
a) théoricien : Plin. 2, 73 ;
b) clerc, [plus tard] chanoine : Eccl.
¶1. sonore, mélodieux, harmonieux : vox canora Cic. Br. 234, voix harmonieuse ; profluens quiddam habuit Carbo et canorum Cic. de Or. 3, 28, Carbon avait qqch de coulant et d'harmonieux ; canorum illud in voce Cic. CM 28, cette sonorité dans la voix
— [en mauv. part] : sine contentione vox nec languens nec canora Cic. Off. 1, 133, ton de voix naturel ni languissant ni chantant
¶2. qui fait entendre des sons harmonieux : canorus orator Cic. Br. 105, orateur à la voix harmonieuse (bien timbrée)
— animal (gallus) canorum sua sponte Cic. Div. 2, 57, animal (coq) qui chante spontanément ; aves canoræ Virg. G. 2, 328, ramage des oiseaux
— fides canoræ Virg. En. 6, 120, lyre mélodieuse ; æs canorum Virg. En. 9, 503, airain sonore [trompette].
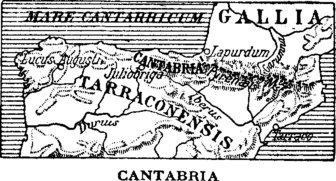
¶1. son [de céréale] : C. Aur. Chron. 3, 4, 63
¶2. bannière, étendard : Tert. Apol. 16.
===> .
¶1. cheval hongre : Varr. R. 2, 7, 15 ; P. Fest. 46
— [en part.] cheval de main ou cheval monté : Pl. Cap. 814 ; Cic. Nat. 3, 11 ; Sen. Ep. 87, 9
¶2. [archit.] chevron : Vitr. 4, 2, 1
— sorte de joug où l'on fixe la vigne : Col. 4, 12, 1
— appui pour soutenir le pied malade d'un cheval : Veg. Mul. 2, 47.
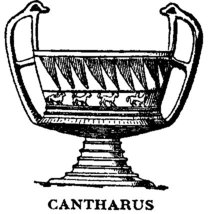
¶1. chant, chanson : Gell. 9, 4, 14 ; 10, 19, 2 ; 19, 9, 8
— air rebattu, refrain, rabâchage : Cic. Att. 1, 19, 8 ; neque ex scholis cantilenam requirunt Cic. de Or. 1, 105, ils ne recherchent pas les refrains de l'école ; cantilenam eamdem canis Ter. Phorm. 495, tu chantes toujours le même refrain [la même chanson] ; totam istam cantilenam ex eo pendere, ut Brut. Fam. 11, 20, 2, que tout ce bavardage dérive de l'intention de
— vers satiriques, pamphlet : Vop. Aur. 7, 2
¶2. musique [d'instruments] : Chalc. Tim. 44
— accord : Chalc. Tim. 45 ; 46.
I. int.,
¶1. chanter : saltare et cantare didicerunt Cic. Cat. 2, 23, ils ont appris à danser et à chanter, cf. de Or. 3, 86 ; Off. 1, 145, etc. ; cantare ad chordarum sonum Nep. Epam. 2, 1, chanter en s'accompagnant sur la lyre ; cantare et psallere jucunde scienterque Suet. Tit. 3, savoir chanter et jouer d'un instrument à cordes avec de l'agrément et du talent ; inde ad manum cantari histrionibus cœptum Liv. 7, 2, 11, dès lors le chant commença à soutenir l'acteur en se réglant sur ses gestes
¶2. [chant du coq] Pl. Mil. 690 ; Cic. Div. 2, 56 ; [du cygne] Virg. B. 2, 29 ; [des oiseaux] Prop. 4, 1, 68 ; 4, 9, 30
¶3. [instruments] : bucina cantat Prop. 4, 10, 30, la trompe retentit ; cantabat tibia ludis Ov. F. 6, 659, la flûte résonnait pour les jeux
¶4. jouer de (avec abl.) : fidibus cantare seni Pl. Ep. 500, jouer de la lyre pour le vieillard ; scienter tibiis Nep. præf. 1, jouer de la flûte avec art ; cithara Varr. R. 3, 13, 3, de la cithare ; calamo Sen. Ben. 4, 6, 5, jouer du chalumeau ; lituo Gell. 20, 2, 2, jouer du clairon.
II. tr.,
¶1. chanter : incondita cantare Varr. Men. 363, chanter des choses informes ; hymenæum Pl. Cas. 809, chanter le chant de l'hyménée ; Niobam Suet. Ner. 21, chanter le rôle de Niobé
¶2. chanter, célébrer : cantabimus Neptunum et virides Nereidum comas Hor. O. 3, 28, 9, nous chanterons Neptune et la verte chevelure des Néréides ; cantant laudes tuas Ov. F. 2, 658, ils chantent tes louanges
¶3. déclamer : nil præter Calvum et doctus cantare Catullum Hor. S. 1, 10, 19, habitué à ne déclamer que du Calvus et du Catulle, cf. Mart. 5, 16, 3 ; 11, 3, 5 ; Plin. Ep. 4, 19, 4, etc.
¶4. chanter, raconter, prêcher, avoir sans cesse à la bouche : Pl. Most. 980 ; Trin. 289 ; Ter. Haut. 260 ; jam pridem istum canto Cæsarem Cic. Q. 2, 11, 1, depuis longtemps je chante ton César [j'ai toujours son éloge à la bouche]; insignis tota cantabitur urbe Hor. S. 2, 1, 46, désigné par moi à l'attention, il sera glosé dans toute la ville
¶5. chanter, exposer en vers : carmina non prius audita canto Hor. O. 3, 1, 4, ce sont des vers, comme on n'en a pas encore entendu, que je chante ; nova cantemus Augusti tropæa Cæsaris Hor. O. 2, 9, 19, chantons les nouveaux trophées de César Auguste, cf. 1, 6, 19 ; 2, 19, 11 ; P. 137 ; Prop. 2, 12, 21, etc.
¶6. prononcer des paroles magiques, frapper d'incantation : cantando rumpitur anguis Virg. B. 8, 72, par les chants magiques on fait périr les serpents ; cantato densetur carmine cælum Ov. M. 14, 369, par l'effet du chant magique le ciel s'épaissit ; cantatæ herbæ Ov. M. 7, 98, herbes enchantées, cf. F. 2, 575, etc.
¶1. chanteur, musicien : Hor. S. 1, 3, 1
— [fig.] qui répète, qui rabâche : cantor formularum Cic. de Or. 1, 236, qui rabâche des formules
— panégyriste : cantores Euphorionis Cic. Tusc. 3, 45, les panégyristes d'Euphorion
¶2. le chanteur [v. canticum] dans une pièce de théâtre
— l'acteur qui harangue le public et à la fin de la pièce crie «plaudite» : Hor. P. 155 ; Cic. Sest. 118.
===> .

¶1. rivière d'Étrurie : Sil. 13, 85
¶2. v. Capena.
¶1. bouc : Virg. B. 7, 7
— odeur forte des aisselles : Catul. 69, 6
— le Capricorne [constellation] : Manil. 2, 178
¶2. espèce de poisson : *Plin. 11, 267.
¶1. tr., rider, froncer [le sourcil] : caperrata frons Næv. d. Varr. L. 7, 107 ; caperatum supercilium Apul. M. 9, 16, sourcil froncé
¶2. int., se rider, se renfrogner : Pl. Ep. 609.
¶1. prendre [avec de l'empressement], saisir : cibum dentibus Cic. Nat. 2, 122, saisir la nourriture avec les dents ; sociis, arma capessant, edico Virg. En. 3, 234 (Ov. M. 11, 378 ; Liv. 4, 53, 1), j'ordonne à mes compagnons de saisir leurs armes
¶2. tendre vers un lieu, chercher à atteindre : Melitam capessere Cic. Att. 10, 9, 1, gagner Malte, cf. Virg. En. 4, 346 ; 5, 703 ; 11, 324, etc. ; omnes partes mundi medium locum capessentes nituntur æqualiter Cic. Nat. 2, 115, toutes les parties du monde tendent vers le centre avec une force égale ; is animus superiora capessat necesse est Cic. Tusc. 1, 42, cette âme [formée d'un air enflammé] doit forcément gagner les régions supérieures
— [arch.] se capessere, se porter, se rendre vivement qq part : domum, Pl. Amp. 262, se rendre vite à la maison, cf. Asin. 158 ; Bac. 113 ; Rud. 172 ; Titin. Com. 180 ; [ou abst] saxum, quo capessit Pl. Rud. 178, le rocher où elle cherche à parvenir
¶3. se saisir de, embrasser, entreprendre : capessere rem publicam Cic. Off. 1, 71, embrasser la carrière politique, entrer dans la vie politique ; libertatem Cic. Phil. 10, 19, se saisir de la liberté ; juvenum munia Liv. 44, 41, 1, assumer le rôle des jeunes gens ; obsidia urbium Tac. An. 12, 15, se charger du siège des villes ; pe\-ri\-cula Liv. 21, 4, 5, affronter les dangers
— fugam Liv. 1, 27, 7, prendre la fuite ; pugnam Liv. 2, 6, 8, engager la lutte ; bellum Liv. 26, 25, 5, entreprendre la guerre ; viam Liv. 44, 2, 8, adopter (prendre) une route, un itinéraire
— embrasser par la pensée, comprendre : Gell. 12, 1, 11.
===> arch. capissam = capessam Pacuv. Tr. 52 ; parf. capessi donné par Diom. 370, 12, et Prisc. 10, 46
— formes sync. capessisse Liv. 10, 5, 4 ; capessisset Tac. An. 13, 25.
¶1. comme un cheveu : Plin. 12, 114
¶2. fait avec des cheveux : Aug. Civ. 22, 8.
¶1. chevelure : P.-Nol. Ep. 23, 23
¶2. trichiase, maladie dé la vessie : C. Aur. Chron. 5, 4, 60.
a) prêtre de Cybèle : CIL 6, 2262 ;
b) pl., jeunes nobles : Cassiod. Var. 4, 49
— Capillāti, ōrum, m., les Chevelus (Ligures des Alpes-Maritimes) : Plin. 3, 135.
I.
¶1. prendre, saisir : cape saxa manu Virg. G. 3, 420, prends des pierres dans ta main ; clipeum Virg. En. 10, 242, prendre son bouclier ; cibum potionemque Liv. 24, 16, 13, prendre la nourriture et la boisson (= manger et boire) ; ab igne ignem Cic. Off. 1, 52, prendre du feu au feu
— collem Cæs. G. 7, 62, 8, prendre, occuper une colline ; montem Cæs. G. 1, 25, 6, une montagne
— atteindre : insulam Cæs. G. 4, 26, 5 ; portus Cæs. G. 4, 36, 4, atteindre l'île, les ports ; locum Cæs. G. 5, 23, 4, prendre terre ; terras capere videntur (cycni) Virg. En. 1, 395, (ces cygnes) vous les voyez gagner la terre
¶2. [fig.] : eum sonitum aures hominum capere non possunt Cic. Rep. 6, 1, ce bruit, les oreilles humaines ne peuvent le percevoir ; misericordiam Cic. Quinct. 97, prendre pitié [se laisser attendrir] ; patrium animum virtutemque capiamus Cic. Phil. 3, 29, prenons (ressaisissons) le courage et la vertu de nos pères ; deorum cognitionem Cic. Nat. 2, 140, prendre une connaissance de la divinité
— fugam Cæs. G. 7, 26, 3, prendre la fuite ; tempus ad te adeundi capere Cic. Fam. 11, 16, 1, saisir l'occasion de t'aborder, cf. Liv. 3, 9, 7 ; 26, 12, 15 ; Tac. H. 4, 34 ; augurium ex arce Liv. 10, 7, 10, prendre les augures du haut de la citadelle ; consilium Cic. Verr. pr. 32, adopter un conseil [mais aussi « prendre une résolution », v. consilium] ; ex aliqua re documentum capere Cic. Phil. 11, 5, tirer d'une chose un enseignement ; specimen naturæ ex optima quaque natura Cic. Tusc. 1, 32, prendre (tirer) le type d'un être dans (de) ce qu'il y a de plus parfait parmi ces êtres ; conjecturam ex facto ipso Cic. Inv. 2, 16, tirer la conjecture du fait lui-même ; a Bruto exordium Cic. Phil. 5, 35, commencer par Brutus
— consulatum Cic. Pis. 3, gagner, obtenir le consulat ; cepi et gessi maxima imperia Cic. Fam. 3, 7, 5, j'ai obtenu et exercé les plus hautes fonctions ; honores Nep. Att. 6, 2 (Sall. J. 85, 18), obtenir les magistratures [mais lubido rei publicæ capiundæ Sall. C. 5, 6, désir de s'emparer du gouvernement] ; rursus militiam capere Tac. H. 2, 97, reprendre du service
¶3. prendre, choisir : locum castris idoneum Cæs. G. 5, 9, 1, choisir un emplacement favorable pour camper ; anfractum longiorem Nep. Eum. 9, 6, choisir (prendre) le détour plus long ; tabernaculum vitio captum Cic. Nat. 2, 11, emplacement de la tente augurale mal choisi ; Veios sedem belli capere Liv. 4, 31, 8, choisir Véies comme siège des opérations ; sedem ipsi sibi circa Halyn flumen cepere Liv. 38, 16, 13, ils choisirent eux-mêmes pour s'installer les bords du fleuve Halys
¶4. prendre, s'emparer de, s'approprier : [avec abl., question unde] signum Carthagine captum Cic. Verr. 4, 82, statue prise à Carthage (sur les Carthaginois)
— [av. prépositions] ex Macedonia Cic. Verr. 4, 129, prendre en Macédoine ; de præda hostium Cic. Verr. 4, 88, prendre sur le butin des ennemis ; capere aliquid ex hostibus Cic. Inv. 1, 85 ; Liv. 5, 20, 5 ; de hostibus Cat. Orat. fr. 47, 6 ; Liv. 26, 34, 12, prendre qqch aux ennemis (sur les ennemis) ; agros ex hostibus Cæs. C. 3, 59, 2 ; Cænonem ab Antiatibus Liv. 2, 63, 6, prendre des champs aux ennemis, Cénon aux Antiates ; (tabula picta) ab hostibus victis capta atque deportata Cic. Verr. 5, 127, (tableau) pris et enlevé aux ennemis vaincus [mais classis a prædonibus capta et incensa est Cic. Verr. 5, 137, la flotte fut prise et incendiée par les pirates] ; urbem vi copiisque capere Cic. Verr. 4, 120, prendre une ville de vive force, avec des troupes [vi, copiis, consilio, virtute Cic. Verr. 1, 56, par la force, avec une armée, en même temps que par l'habileté tactique et la valeur personnelle]
— cotidie capitur urbs nostra Liv. 29, 17, 16, c'est chaque jour comme une prise de notre ville (= on la traite en ville prise) ; sexennio post Veios captos Cic. Div. 1, 100, six ans après la prise de Véies
— prendre, capturer, faire prisonnier qqn : a prædonibus capti Cic. Verr. 5, 72, pris par les pirates ; [avec abl. question unde] Corfinio captus Cæs. C. 1, 34, 1 ; captus Tarento Cic. Br. 72, fait prisonnier à Corfinium, à Tarente
— in acie capere aliquem Cic. Off. 3, 114, faire prisonnier qqn dans la bataille
— [fig.] oppressa captaque re publica Cic. Dom. 26, en opprimant et asservissant la république, cf. Sest. 52 ; 112
— d'où le part. pris substt captus, ī, = captivus, prisonnier : Cic. Off. 2, 63 ; Cæs. C. 2, 32, 9 ; Nep. Alc. 5, 6 ; Liv. 9, 7, 10, etc.
— [prendre des oiseaux] Cic. Nat. 2, 129 ; [des poissons] Cic. Off. 3, 58 ; [les urus au moyen de fosses, de trappes] Cæs. G. 6, 28, 3
— prendre, dérober qqch : fures earum rerum quas ceperunt signa commutant Cic. Fin. 5, 74, les voleurs changent les marques des objets qu'ils ont dérobés
— [fig.] prendre qqn, le surprendre, avoir raison de lui, le battre : cum obsignes tabulas clientis tui, quibus in tabellis id sit scriptum quo ille capiatur Cic. de Or. 1, 174, du moment que tu signes des actes pour ton client, des actes où figure une clause bonne pour le faire battre ; in capiendo adversario versutus Cic. Br. 178, habile à envelopper l'adversaire
— prendre, captiver, gagner : magis specie capiebat homines quam dicendi copia Cic. Br. 224, par l'allure extérieure il avait prise sur la foule plutôt que par la richesse de son éloquence ; nomine nos capis summi viri Cic. Br. 295, c'est par le nom d'un homme éminent que tu forces notre assentiment ; aures capere Cic. Or. 170, captiver les oreilles ; sensus Cic. Nat. 2, 146, captiver les sens
¶5. qqch s'empare de qqn : [affection] qui (eo animo) esse poteris nisi te amor ipse ceperit ? Cic. Fin. 2, 78, comment pourras-tu avoir ces sentiments, si l'affection elle-même ne s'est pas d'abord emparée de toi ; [crainte] Sall. J. 85, 47 ; Liv. 10, 35, 3 ; [colère, pitié] Liv. 21, 16, 2 ; [honte] Liv. 24, 42, 9 ; [crainte religieuse] Liv. 28, 15, 11
— [l'oubli] Cic. Mil. 99 ; [le sommeil] Sall. J. 71, 2
¶6. au pass., être pris (saisi) par qqch : misericordia captus Cic. de Or. 2, 195, saisi de pitié ; pravis cupidinibus Sall. J. 1, 4, possédé par des passions mauvaises ; formidine Virg. En. 2, 384, en proie à l'effroi ; vana religione Curt. 4, 10, 7, en proie à de vaines craintes religieuses ; somno Sall. J. 99, 2, saisi par le sommeil
— être séduit, charmé : facetiis Cic. Fam. 9, 15, 2, par les plaisanteries (cf. oculis captus Cic. Verr. 4, 101, séduit par le moyen des yeux, par la vue, mais v. plus loin oculis captus, privé de la vue) ; voluptate Cic. Leg. 1, 31, par le plaisir ; dignitate hujus sententiæ capitur Cic. Tusc. 5, 31, la beauté de cette pensée le séduit
— être gagné, entraîné, abusé : eodem errore captus Cic. Phil. 12, 6, abusé par la même erreur ; hac ratione capi Cæs. G. 1, 40, 9, être abusé par ce calcul ; dolis capiebantur Sall. C. 14, 5, ils étaient gagnés par ses artifices
— [abst] : cavere, ne capiatur Cic. Ac. 2, 66, [la supériorité du sage est] de prendre garde de se laisser surprendre ; uti ne propter te fidemve tuam captus fraudatusve sim Cic. Off. 3, 70, pour que ni par toi ni par ta garantie je ne sois abusé ni fraudé
— mente captus, pris du côté de l'intelligence, aliéné, en délire : Cic. Cat. 3, 31 ; Pis. 47 ; Off. 1, 94 ; captus animi Tac. H. 3, 73, hébété ; velut mente captā vaticinari Liv. 39, 13, 12, rendre des oracles comme en proie au délire prophétique
— membris omnibus captus Cic. Rab. p. 21, pris de tous ses membres (paralysé) ; oculis et auribus Cic. Tusc. 5, 117, privé de la vue et de l'ouïe
¶7. obtenir, recueillir, recevoir : Olympionicarum præmia Cic. Inv. 2, 144, recevoir la récompense des vainqueurs aux jeux olympiques ; donum Cic. Leg. 3, 11, recevoir un présent (hereditatem Cic. Cæc. 102, un héritage) ; capit ex suis prædiis sescena sestertia Cic. Par. 49, il retire 600 000 sesterces de ses domaines ; stipendium jure belli Cæs. G. 1, 44, 2, percevoir un tribut par le droit de la guerre ; benevolentia capitur beneficiis Cic. Off. 2, 32, la bienveillance se gagne par les bienfaits ; gloriam Cic. Læ. 25, recueillir de la gloire ; lætitiam memoria rei Cic. Fin. 2, 96, trouver de la joie dans le souvenir d'une chose ; utilitatem ex belua Cic. Nat. 1, 101, tirer parti d'une bête
— dolorem Cic. Att. 11, 21, 1, éprouver de la douleur ; infamiam Cic. Verr. 5, 40, encourir le discrédit ; molestiam ex aliqua re Cic. Sull. 1, éprouver de la peine de qqch ; calamitatem Cic. Div. 1, 29, éprouver un malheur [un désastre] ; desiderium e filio Cic. CM 54, ressentir du regret de l'absence de son fils
— [jurisc.] recevoir qqch légalement, avoir la capacité juridique pour recevoir : Pætus mihi libros donavit ; cum mihi per legem Cinciam licere capere Cincius diceret, libenter dixi me accepturum Cic. Att. 1, 20, 7, Pétus m'a offert en cadeau des livres ; Cincius me déclarant que la loi Cincia me permettait de les prendre, j'ai répondu que je les recevrais avec plaisir ; [en part. pour les héritages] : Leg. 2, 48 ; 2, 49 ; 2, 51 ; 2, 52 ; [abst] capere non potes Quint. 5, 14, 16, tu n'as pas capacité d'hériter
— usu capere, v. usus.
II.
¶1. contenir, renfermer : tabulæ nomina illorum capere non potuerunt Cic. Phil. 2, 16, les registres ne purent contenir leurs noms, cf. Agr. 2, 59 ; Verr. 4, 7 ; Off. 1, 54 ; capere ejus amentiam provinciæ, regna non poterant Cic. Mil. 87, les provinces, les royaumes étrangers ne pouvaient contenir sa démence (fournir à sa démence un théâtre suffisant) ; gloriam, quæ vix cælo capi posse videatur Cic. Phil. 2, 114, une gloire telle que le ciel semble à peine pouvoir la contenir ; est ille plus quam capit Sen. Ep. 47, 2, celui-là mange au-delà de sa capacité ; itaque orientem (fortunam) tam moderate tulit, ad ultimum magnitudinem ejus non cepit Curt. 3, 12, 20, aussi, après avoir supporté avec tant de modération sa fortune naissante, à la fin il n'en put contenir la grandeur [il en fut grisé]
— nec te Troja capit Virg. En. 9, 644, Troie ne peut plus te contenir [= ne te suffit plus]; vires populi Romani, quas vix terrarum capit orbis Liv. 7, 25, 9, la puissance romaine, que l'univers suffit à peine à contenir
¶2. renfermer dans sa capacité, comporter : capit hoc natura, quod nondum ulla ætas tulit Sen. Ben. 3, 32, 6, la nature renferme dans ses possibilités ce fait, qu'aucun âge encore n'a produit ; metire ætatem tuam ; tam multa non capit Sen. Ep. 88, 41, mesure la durée de ton existence ; elle n'est pas faite pour tenir tant de choses ; dum, quicquid mortalitas capiebat, impleret Curt. 8, 3, 7, jusqu'à ce qu'il eût accompli tout ce dont un mortel était capable ; temet ipsum ad ea serva, quæ magnitudinem tuam capiunt Curt. 9, 6, 14, conserve-toi toi-même en vue des actions qui sont à la mesure de ta grandeur ; (promissa) quanta ipsius fortuna capiebat Curt. 5, 4, 12, (des promesses) aussi grandes que la position de cet homme les comportait ; ætates nondum rhetorem capientes Quint. 1, 9, 2, les âges qui ne sont pas encore faits pour l'enseignement du rhéteur
— contio capit omnem vim orationis Cic. de Or. 2, 334, l'assemblée du peuple comporte (admet) tout le déploiement de l'éloquence
¶3. embrasser, concevoir : (ista) non capiunt angustiæ pectoris tui Cic. Pis. 24, ton âme étroite n'est pas à la mesure de ces sentiments ; tam magna, ut ea vix cujusquam mens capere possit Cic. Marc. 6, de si grandes choses que l'intelligence d'un homme peut à peine les concevoir ; (docet) nostram intellegentiam capere, quæ sit et beata natura et æterna Cic. Nat. 1, 49, (il montre) que notre intelligence conçoit l'idée d'un être à la fois heureux et éternel ; majus lætiusque quam quod mente capere possent Liv. 27, 50, 7, [succès] trop important et trop réjouissant pour que l'on pût s'en faire l'idée ; qui ex regibus (senatum) constare dixit, unus veram speciem Romani senatus cepit Liv. 9, 17, 14, celui qui a dit du sénat romain que c'était une assemblée de rois en a par excellence embrassé la véritable image.
===> arch. capso = cepero Pl. Bac. 712 ; capsit = ceperit Pl. Ps. 1022 ; Acc. Tr. 454 (v. P. Fest. 57, 15) ; capsimus = ceperimus Pl. Rud. 304
— capsis est expliqué par cape si vis Cic. Or. 154 (v. Quint. 1, 5, 66)
— cepet = cepit CIL 3, 14203.
===> .

¶1. crime capital : capital facere Pl. Merc. 611, commettre un crime capital ; capitalia vindicare Cic. Leg. 3, 6, punir les crimes capitaux
— capital est avec inf., c'est un crime capital de : Liv. 24, 37, 9 ; Sen. Ben. 4, 38, 2 ; Curt. 8, 9, 34 ; Plin. 12, 63 ; 18, 12 ; [formules de lois] : si servus... fecerit, ei capital (esto) Dig. 47, 21, 3, 1, si un esclave a fait..., que ce soit pour lui un crime capital (Cic. Inv. 2, 96) ; qui non paruerit, capital esto Cic. Leg. 2, 21, pour qui n'aura pas obéi, crime capital
— căpĭtāle Tac. Agr. 2 ; Quint. 9, 2, 67 au lieu de capital
¶2. bandeau des prêtresses dans les sacrifices : Varr. L. 5, 130 ; P. Fest. 57, 6.
¶1. v. capital §{} 1 fin
¶2. oreiller : Gloss.

¶1. qui concerne la tête, capital, [c.-à-d., suivant les cas] qui entraîne la mort (peine de mort), ou seulement la mort civile : pœna capitalis Liv. 6, 4, 5, etc., peine capitale ; res capitalis Cic. Verr. 2, 68, affaire capitale ; fraus capitalis Cic. de Or. 1, 232, crime capital ; crimen capitale Cic. Verr. 5, 23, accusation capitale ; triumviri capitales Cic. Or. 156, les triumvirs (commissaires) aux affaires capitales, cf. Liv. 25, 1, 10 ; 39, 14, 10
¶2. [fig.] mortel, fatal, funeste : capitalis hostis Cic. Cat. 2, 3, ennemi mortel ; nulla capitalior pestis quam Cic. CM 39, pas de fléau plus funeste que ; capitale odium Cic. Læ. 2, haine mortelle ; capitalis oratio Cic. Off. 2, 73, discours fatal ; ira Hor. S. 1, 7, 13, colère mortelle
¶3. capital, qui tient la tête, qui est le principal : Siculus ille capitalis... pæne pusillus Thucydides Cic. Q. 2, 11, 4, quant au Sicilien [Philistus], c'est un écrivain de premier ordre... presque un Thucydide au petit pied, cf. Ov. F. 3, 839 ; Plin. 29, 18.
===> arch. caputalis res S. C. de Bacch. CIL 10, 104.
¶1. qui a une grosse tête : Cic. Nat. 1, 80
— épithète donnée aux parasites : Pl. Pers. 60
¶2. muge ou chabot [poisson de mer] : Cat. Agr. 158, 1
— poisson inconnu : Aus. Mos. 85.
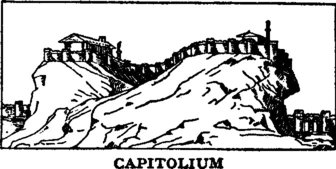
a) collecteurs d'impôts : Cass. Var. 10, 28 ;
b) officiers recruteurs : Cod. Th. 6, 35, 3.
¶1. petite tête, tête : operto capitulo bibere Pl. Curc. 293, boire la tête couverte
— homme, individu [langue de la comédie] : Pl. As. 496 ; capitulum lepidissimum Ter. Eun. 531, la plus délicieuse des créatures
¶2. [métapht] coiffure, capuchon : Isid. 19, 31, 3 ; [ou] cape : Non. 542, 30
— capitulum cepæ Col. 11, 3, 15, tête d'oignon
— [en architecture] chapiteau : Vitr. 3, 3
— poutre transversale de la baliste ou de la catapulte : Vitr. 10, 10, 1
— partie saillante arrondie : Varr. R. 3, 5, 10
— chapitre, division d'un ouvrage : Tert. Jud. 9
— article, titre d'une loi : Cod. Just. 5, 37, 28
— recrutement : Cod. Th. 11, 16, 15.
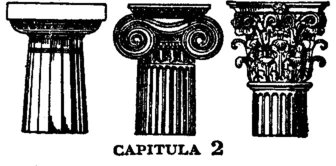
===> capitulus, m. Ps.-Cypr. Pasch. 15.
¶1. câprier [arbrisseau] : Plin. 15, 117
¶2. fruit du câprier, câpre : Pl. Curc. 90 ; Cels. 2, 18 ; Mart. 37, 7.
¶1. île de la Méditerranée, près de la Corse : Plin. 3, 81
¶2. île voisine des Baléares : Plin. 3, 78
¶3. une des îles Fortunées : Capel. 6, 702
— -rĭensis, e, de Caprarie [près des Baléares] : Plin. 34, 164.
¶1. île près de la Corse : Varr. R. 2, 3, 3, v. Capraria
¶2. nom d'une des embouchures du Pô : Plin. 3, 120.
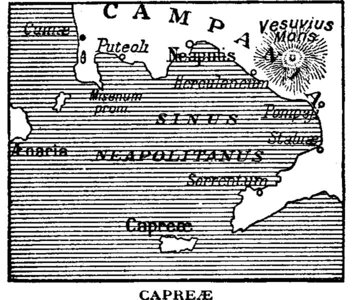
¶1. jeune chevreuil : Virg. B. 2, 41
¶2. binette [instrument de labour] : Col. 11, 3, 46
¶3. vrille de la vigne : Varr. R. 1, 31, 4
¶4. chevron, support : Cæs. C. 2, 10, 3 ; Vitr. 4, 2.
¶1. qui trait les chèvres, chevrier : Catul. 22, 10
¶2. engoulevent, oiseau nocturne qui passait pour téter les chèvres : Plin. 10, 115.

¶1. esclave qui porte la boîte de livres des enfants qui vont à l'école : Suet. Ner. 36

¶2. esclave qui garde les habits dans les bains publics : Paul. Dig. 1, 15, 5
¶3. le fabricant de capsæ : Gloss. 338.
===> .
¶1. action de prendre possession d'une chose : Gai. Inst. 4, 12 (v. Gell. 7, 10, 3)
¶2. tromperie, duperie, piège : captionis aliquid vereri Cic. Quinct. 53, appréhender quelque tromperie ; ne quid captioni mihi sit, si dederim tibi Pl. Most. 922, pour que je ne sois pas pris en quelque manière, si je te remets l'argent ; cum magna captione Gai. Dig. 29, 3, 7, en étant bien joué
— piège dans les paroles : Cic. Br. 198 ; nihil captionis habere Cic. Part. 133, ne comporter aucun piège (Gell. 18, 13, 7)
— raisonnement captieux, sophisme : in captiones se induere Cic. Div. 2, 41, se perdre dans des sophismes ; captiones discutere Cic. Ac. 2, 46 ; explicare Cic. Div. 2, 41, débrouiller des sophismes, briser les mailles d'un raisonnement captieux.
¶1. captif : captivi cives Cic. Verr. 5, 69, citoyens captifs ; naves captivæ Cæs. C. 2, 5, navires prisonniers : captivi agri Sall. Mithr. 8 ; Liv. 2, 48, 2 ; Tac. An. 12, 32, territoire conquis
— pris à la chasse : Varr. R. 3, 13 ; Ov. M. 1, 475
— [fig.] mens captiva Ov. Am. 1, 2, 30, esprit captif [de l'amour]
¶2. [poét.] de captif : captivus sanguis Virg. En. 10, 520, sang des captifs, cf. Tac. An. 14, 30 ; Liv. 31, 46, 16
¶3. subst. m., prisonnier de guerre : Cæs., Liv., etc.
¶1. chercher à saisir, à prendre, à attraper : a labris fugientia flumina Hor. S. 1, 1, 68, chercher à saisir l'eau qui fuit loin des lèvres ; laqueis feras Virg. G. 1, 139, tendre des pièges pour prendre les bêtes sauvages ; muscas Suet. Dom. 3, attraper des mouches ; patulis naribus auras Virg. G. 1, 376, humer l'air de ses naseaux largement ouverts
¶2. [fig.] sermonem alicujus Pl. Cas. 44, chercher à surprendre les paroles de qqn (Ter. Phorm. 869) ; aure admota sonitum Liv. 38, 7, 8, en appliquant l'oreille sur le sol chercher à percevoir le bruit ; solitudines Cic. Tusc. 3, 63, rechercher la solitude des déserts ; somnum Sen. Ep. 56, 7, chercher à attraper le sommeil ; benevolentiam Cic. Inv. 1, 21 ; misericordiam Cic. Inv. 2, 6, 9 ; risus Cic. Tusc. 2, 17 ; alicujus assensiones Cic. Inv. 1, 51 ; plausus Cic. Pis. 60 ; occasionem Cic. Har. 55 ; voluptatem Cic. Fin. 1, 24, chercher à gagner la bienveillance, à exciter la pitié, le rire, à recueillir l'approbation de qqn, les applaudissements, à saisir (épier) l'occasion, rechercher le plaisir ; quid nunc consili captandum censes ? Pl. Asin. 358 (Ter. And. 170 ; 404), maintenant quelle combinaison es-tu d'avis de tramer ?
— [avec inf.] Phæd. 4, 8, 6 ; 5, 3, 2 ; Col. 8, 11, 1 ; Liv. Perioch. 103
— [int. indir.] : variis ominibus captare an... Suet. Tib. 14, 2, par des présages divers chercher à savoir si
— [avec ne] chercher à éviter de : Petr. 141, 10 ; Ps. Quint. Decl. 7, 13 ; [avec ut] Ps. Quint. Decl. 2, 5
¶3. chercher à prendre (surprendre) qqn par ruse : qui te captare vult Cic. Ac. 2, 94, celui qui veut te surprendre (te prendre au piège); insidiis hostem Liv. 2, 50, 3, chercher à prendre l'ennemi dans une embuscade ; Minuci temeritatem Liv. 22, 28, 2, prendre au piège la témérité de Minucius ; inter se captantes fraude et avaritia certant Liv. 44, 24, 8, cherchant à s'attraper mutuellement, ils luttent de fourberie et de cupidité
— [abst] docte mihi captandumst cum illo Pl. Most. 1069, il faut que je dresse savamment mes batteries avec lui (contre lui); in colloquiis insidiari et captare Liv. 32, 33, 8, dans les entrevues il ne cherchait qu'à tendre des embûches et à surprendre la bonne foi
— est quiddam, quod sua vi nos adliciat ad sese, non emolumento captans aliquo, sed trahens sua dignitate Cic. Inv. 2, 157, il est certains objets, faits pour nous attirer à eux par leur propre nature, qui, loin de séduire par l'appât de quelque profit, entraînent par leur seul prestige
¶4. capter : testamenta Hor. S. 2, 5, 23, capter des testaments (Sen. Ben. 6, 33, 4) ; captare aliquem, circonvenir qqn pour capter son héritage : Plin. Ep. 2, 20, 7 ; 4, 2, 2 ; 8, 18, 2 ; Juv. 16, 56 ; [abst] captare, faire des captations d'héritage : Sen. Brev. 7, 7 ; Mart. 8, 38, 3, etc.
===> captor dépon. Aug. Serm. 109, 2 Mai.
===> .
¶1. action de prendre : captura piscium Plin. 19, 10, la pêche
¶2. la prise : venatores cum captura Plin. 35, 99, les chasseurs et leur chasse
¶3. gain, profit [que l'on réalise par qqch de bas, de vil, de honteux] : inhonesti lucri captura V.-Max. 9, 4, 1, l'appât d'un gain déshonnête
— salaire : diurnas capturas exigere V.-Max. 6, 9, 8, être payé à la journée
— gain d'un mendiant : Sen. Contr. 10, 4, 7.
¶1. faculté de prendre ; capacité [phys. ou mor.] : pro corporis captu Sen. Clem. 1, 19, eu égard à la qualité physique ; ut est captus Germanorum Cæs. G. 4, 3, 3, suivant les capacités des Germains, autant que cela est possible chez des Germains, cf. Cic. Tusc. 2, 65 ; pro æstimato captu sollertiæ Gell. 1, 9, 3, d'après l'estimation de leur capacité intellectuelle (de la portée de leur intelligence)
¶2. action de prendre, prise, acquisition : V.-Max. 3, 3, 7 ; Plin. 24, 79.
¶1. lazzo, corde, longe : Isid. 20, 16, 5 ; Gloss.
¶2. v. capulus
===> .
¶1. bière, cercueil : Serv. En. 6, 222 ; Non. 4 ; Pl. As. 892 ; Apul. M. 4, 18
¶2. manche [de charrue] : Ov. P. 1, 8, 67
— poignée, garde [d'une épée] : Pl. Cas. 909 ; Cic. Fat. 5 ; Virg. En. 2, 553.
===> capulum, n., P. Fest. 61 ; Non. 4.
¶1. tête d'homme ou d'animal : tutari caput et cervices et jugulum ac latera Cic. Sest. 90, mettre à couvert la tête, le cou, la gorge et les flancs ; belua multorum es capitum Hor. Ep. 1, 1, 76, tu es un monstre aux cent têtes
— capite operto Cic. CM 34 ; obvoluto Cic. Phil. 2, 77 ; involuto Cic. Pis. 13 ; velato Cic. Nat. 2, 10, la tête couverte, enveloppée, voilée ; caput aperuit Cic. Phil. 2, 77, il se découvrit la tête ; capite et superciliis semper rasis Cic. Amer. 20, avec la tête et les sourcils toujours rasés ; caput dolet Pl. Amph. 1059, j'ai mal à la tête ; caput quassare Virg. En. 7, 292, secouer la tête ; caput deponere Pl. Curc. 360 ; ponere Virg. En. 5, 845, laisser reposer sa tête [pour dormir]; caput efferre Virg. G. 3, 553 ; attollere Liv. 6, 18, 14, lever haut la tête, redresser la tête [mais duris caput extulit arvis Virg. G. 2, 341, éleva sa tête (apparut) sur les dures campagnes]; capite demisso Cic. Dom. 83 ; demisso capite Cic. Clu. 58, la tête baissée
— capita conferre Cic. Verr. 3, 31, rapprocher les têtes = se rapprocher pour conférer, se concerter, cf. de Or. 2, 223 ; Liv. 2, 45, 7
— caput abscidere Cic. Phil. 11, 5 ; præcidere Cic. Tusc. 5, 55, couper la tête (cædere Ov. F. 3, 339 ; decidere Curt. 7, 2, 32 ; Sen. Clem. 1, 26, 3)
— capite in terra statuerem (man. A) Ter. Ad. 316, je le planterais debout par la tête sur le sol = je lui ferais donner de la tête par terre ; (nec quisquamst) quin cadat, quin capite sistat in via de semita Pl. Curc. 287, (il n'y a personne) qui ne s'étale, qui ne donne de la tête sur la route hors de mon chemin ; [fig.] capite agere (aliquid) Sen. Ben. 6, 1, 1, chasser par la tête = jeter dehors la tête la première = rejeter sans ménagement ; pronus volvitur in caput Virg. En. 1, 116, il roule la tête en avant
— [expr. prov.] : in capite atque in cervicibus nostris restiterunt Cic. Mur. 79, ils sont restés sur nos têtes et sur nos nuques = ils sont restés pour nous une menace imminente ; ecce supra caput homo levis ac sordidus Cic. Q. 1, 2, 6, voici sur notre dos un adversaire sans importance et misérable ; dux hostium cum exercitu supra caput est Sall. C. 52, 24, le chef des ennemis avec son armée suspend sa menace sur nos têtes, cf. Virg. En. 4, 702 ; Liv. 2, 17, 2 ; nec caput nec pes sermonis apparet Pl. Asin. 729, ces propos ne laissent voir ni pied ni tête, ni commencement ni fin, cf. Cic. Fam. 7, 31, 2 ; ut nec pes nec caput uni reddatur formæ Hor. P. 8, en sorte que ni la fin ni le commencement ne se rapportent à un ensemble unique [que les parties ne forment pas un tout harmonieux] ; capita aut navia ! Macr. S. 1, 7, 22, tête ou navire ! (cf. pile ou face !) [les pièces portant d'un côté la tête d'un dieu, de l'autre un navire] ; ire præcipitem in lutum per caput pedesque Catul. 17, 9, tomber dans la boue tout du long, de la tête aux pieds
¶2. [fig.] caput jecoris Cic. Div. 2, 32, ou extorum Plin. 11, 189, ou caput seul Ov. M. 15, 795, tête du foie
— tête, extrémité, pointe : intonsa cælo attollunt capita (quercus) Virg. En. 9, 679, (les chênes) élèvent vers le ciel leurs têtes chevelues ;
— capita vitium Cat. Agr. 33, 1, ou caput vitis Cat. Agr. 41, 4 ; 95, 2, racines de la vigne (Virg. G. 2, 355) ; [racines d'arbres] Cat. Agr. 36, 1 ; [d'oliviers] Cat. Agr. 43, 2 ; [mais aussi] cep de vigne : Col. 3, 10, 1 ; Cic. CM 53
— castellis duobus ad capita positis (pontem) reliqui Planc. Fam. 10, 18, 4, j'ai laissé le pont, après avoir établi à la tête deux redoutes ; opera in capite molis posita Curt. 4, 3, 3, ouvrages construits à l'extrémité de la jetée ; capita tignorum Cæs. C. 2, 9, 1, les extrémités des poutres ; (tetendit cornu) donec curvata coirent inter se capita Virg. En. 11, 861, (elle tendit son arc) jusqu'à ce que les deux extrémités courbées se rejoignissent
— Atlantis piniferum caput Virg. En. 4, 249, la tête de l'Atlas couronnée de pins ; prensans uncis manibus capita aspera montis Virg. En. 6, 360, s'accrochant avec les ongles aux têtes rocheuses (aux aspérités proéminentes) de la rive escarpée
— ad caput amnis Virg. G. 4, 319, près de la source du fleuve, cf. Hor. O. 1, 1, 22 ; Liv. 1, 51, 9 ; [mais multis capitibus in Oceanum influit (Rhenus) Cæs. G. 4, 10, 5, (le Rhin) se jette dans l'Océan par plusieurs bouches (embouchures) ; de même Hor. S. 1, 10, 37 ; Liv. 33, 41, 7] ; [fig.] source, origine : legum fontes et capita Cic. de Or. 1, 195, source et origine des lois, cf. Planc. 28 ; de Or. 1, 42 ; Tusc. 4, 83 ; nonne his vestigiis ad caput malefici perveniri solet ? Cic. Amer. 74, n'est-ce pas en suivant ces traces qu'on arrive à la source (au point de départ) du crime ? alte et, ut oportet, a capite repetis quod quærimus Cic. Leg. 1, 18, tu reprends de haut et, comme il convient, à sa source la question que nous traitons, cf. Top. 39 ; sen. Ben. 5, 19, 4 ; cum se ad idem caput rettulerunt Cic. Tim. 33, quand ils [les astres] se sont ramenés au même point de départ
¶3. tête = la personne entière, personne, individu, homme : o lepidum caput ! Pl. Mil. 725, ô l'aimable homme ! desiderium tam cari capitis Hor. O. 1, 24, 2, le regret d'une tête si chère ; duo hæc capita nata sunt post homines natos tæterrima, Dolabella et Antonius Cic. Phil. 11, 1, ces deux têtes sont nées (ces deux individus sont nés) pour être depuis la naissance des hommes les plus infâmes qu'on connaisse, Dolabella et Antoine ; capitum Helvetiorum milia CCLXIII Cæs. G. 1, 29, 2, deux cent soixante trois mille Helvètes ; ex reliquis captivis toto exercitui capita singula distribuit Cæs. G. 7, 89, 5, il répartit le reste des captifs entre toute l'armée, à raison d'une tête (d'un) par soldat ; sesquimodios frumenti populo Romano in capita describere Cic. Verr. 3, 215, distribuer au peuple romain un boisseau et demi de blé par tête ; quot capitum vivunt, totidem studiorum milia Hor. S. 2, 1, 27, autant de milliers d'êtres vivants, autant de goûts
— eos, qui aut non plus mille quingentos æris aut omnino nihil in suum censura præter caput attulissent, proletarios nominavit Cic. Rep. 2, 40, ceux qui n'avaient déclaré au recensement comme propriété pas plus de quinze cents as ou même rien d'autre que leur personne, il les appela les prolétaires
— capite censeri, n'être recensé que pour sa personne ; les capite censi n'appartiennent à aucune des cinq classes établies par Servius Tullius ; ils ne paient pas de cens et ne font pas de service militaire ; P. Fest. 226 confond le proletarius et le capite census, mais Gell. 16, 10, 10 d'après Julius Paulus les distingue : Sall. J. 86, 2 ; V.-Max. 2, 3, 1 ; 7, 6, 1 ; Gell. 16, 10, 11 ; 16, 10, 14
— [expressions] : capiti vostro istuc quidem Pl. Pœn. 645, c'est à vous bien sûr que ton mot s'applique, cf. Truc. 819 ; Ter. Phorm. 491 ; multa mala eum dixisse ; suo capiti, ut aiunt Cic. Att. 8, 5, 1, [j'ai appris] qu'il avait tenu une foule de mauvais propos ; c'est sur lui-même qu'ils retombent, comme on dit, cf. Cæl. Fam. 8, 1, 4
¶4. tête = vie, existence : si prædonibus pactum pro capite pretium non attuleris Cic. Off. 3, 107, si tu n'apportes pas à des pirates le prix convenu pour ta vie [pour ta rançon]; capitis pœnam iis, qui non paruerint, constituit Cæs. G. 7, 71, 6, il décide que seront punis de mort ceux qui n'auront pas obéi ; eorum omnium capita regi Cotto vendidisti Cic. Pis. 44, tu as vendu leurs têtes à tous au roi Cottus
— [en justice] soit personnalité civile, soit existence même ; un jugement capital = un jugement qui entraîne suivant le chef d'accusation, soit la peine de mort, soit l'exil accompagné généralement de l'interdiction de l'eau et du feu ou encore la qualification d'homo sacer : pœna capitis Cic. Verr. 4, 85, peine de mort ; causa de ordine, de civitate, de libertate, de capite hominis Cic. de Or. 1, 182, une affaire où il s'agit du rang, du droit de cité, de la liberté, de l'existence civile tout entière d'un homme ; causa capitis Cic. Quinct. 32 ; Br. 47 ; de Or. 3, 211, etc., cause capitale ; de capite alicujus judicare Cic. Quinct. 44 ; Verr. 2, 33 ; Rab. p. 12, etc., prononcer le jugement dans une affaire capitale concernant qqn ; ut de suo capite judicium fieri patiatur Cic. Verr. 3, 135, en sorte qu'il se laisse poursuivre pour crime capital ; judicium capitis Cic. Planc. 31 ; de Or. 1, 231 ; Br. 136, etc., procès capital ; capitis aliquem arcessere Cic. Dej. 30, intenter à qqn une action capitale ; reus capitis Cic. Dej. 11, accusé d'un crime capital ; capitis absolutus pecunia multatus est Nep. Milt. 7, 6, sauvé de la peine de mort, il fut frappé d'une amende pécuniaire
— [en part., chez les juriscons.] état de la personne, comprenant trois éléments essentiels : libertas, la liberté ; civitas, la cité ; familia, la famille ; d'où il résulte que l'individu compte parmi les hommes libres, au rang des citoyens, au sein d'une famille ; capitis deminutio, v. deminutio ; virgo Vestalis sine emancipatione ac sine capitis minutione e patris potestate exit Gell. 1, 12, 9, la vierge Vestale sort de la puissance paternelle sans émancipation et sans perdre sa personnalité juridique [= ses droits de famille]
— [sens large] : caput aut existimatio alicujus Cic. Verr. 2, 173, la personnalité civile ou la considération de qqn
¶5. tête, personnage principal ; caput est omnium Græcorum concitandorum Cic. Flac. 42, il est l'âme du soulèvement de tous ces Grecs ; qui capita conjurationis fuerant Liv. 8, 19, 13, ceux qui avaient été les chefs de la conjuration ; caput partis ejus Lucanorum Liv. 25, 16, 5, à la tête de ce parti des Lucaniens
— [en part.] : qui capita rerum sunt Liv. 5, 27, 4 ; 26, 16, 5 ; 26, 40, 13, ceux qui sont à la tête des affaires, les principaux citoyens ; cum caput rerum in omni hostium equitatu Masinissam fuisse sciret Liv. 28, 35, 12, sachant que Masinissa avait joué au milieu de toute la cavalerie ennemie un rôle prépondérant ; (fama adfertur) caput rerum Antiates esse Liv. 4, 56, 5, (le bruit vient) que les Antiates sont à la tête du mouvement
¶6. [en parl. de choses] partie principale, capitale : id quod caput est Cic. Pis. 47 ; Mil. 53, etc., ce qui est le point capital, essentiel ; hoc esse vis caput defensionis tuæ, magno te decimas vendidisse Cic. Verr. 3, 148, tu veux que la partie principale de ta défense soit d'avoir vendu les dîmes à haut prix ; quod cenæ caput erat Cic. Tusc. 5, 98, ce qui était l'essentiel du repas ; caput arbitrabatur esse oratoris, ut talis.... videretur Cic. de Or. 1, 87, l'essentiel, à son avis, pour un orateur, était de se montrer tel...
— caput est, ut quæramus Cic. Inv. 2, 175 (Fam. 4, 9, 4, etc.), l'essentiel est que nous cherchions... ; caput est in omni procuratione muneris publici, ut avaritiæ pellatur etiam minima suspicio Cic. Off. 2, 75, un point capital dans toute gestion d'une fonction publique, c'est d'éloigner jusqu'au plus léger soupçon d'avidité ; caput est quam plurimum scribere Cic. de Or. 1, 150, l'exercice fondamental, c'est d'écrire le plus possible ; ad consilium de re publica dandum caput est nosse rem publicam Cic. de Or. 2, 337, pour donner un avis sur les affaires publiques, il est capital de connaître les affaires publiques
¶7. [en parl. d'écrits] point capital : quattuor sunt capita quæ concludant nihil esse quod nosci, percipi, comprehendi possit Cic. Ac. 2, 83, il y a quatre points principaux dans l'argumentation pour aboutir à la conclusion qu'on ne peut rien connaître, percevoir, saisir de façon certaine ; ex uno Epicuri capite Cic. Ac. 2, 101, à la suite d'un principe posé par Épicure
— chapitre, paragraphe : in illo capite Anniano de mulierum hereditatibus Cic. Verr. 1, 118, dans ce chapitre de l'édit relatif à Annius touchant les hérédités de femmes ; a primo capite legis usque ad extremum Cic. Agr. 2, 15, depuis le premier paragraphe de la loi jusqu'au dernier, cf. 2, 16 ; 2, 39 ; Leg. 2, 62, etc. ; quod ex quibusdam capitibus expositis nec explicatis intellegi potest Cic. Br. 164, cela peut se constater d'après certains paragraphes indiqués en sommaires, mais non développés
— paragraphe d'une lettre : Att. 9, 13, 8 ; Fam. 3, 8, 2
— chapitre d'un livre : Leg. 1, 21 ; Fam. 7, 22
¶8. lieu principal, capitale : templum consilii publici, caput urbis Cic. Mil. 90, le temple du conseil public, le chef-lieu de la ville (= la curie); (Erana) Amani caput Cic. Fam. 15, 4, 8, (Erana) capitale du mont Amanus ; (Antium) caput Volscorum Liv. 6, 9, 1, (Antium) capitale des Volsques
¶9. [en parl. d'argent] somme capitale, somme principale : Cic. Verr. 1, 11 ; 3, 77 ; etc.; de illo Tulliano capite libere loquere Cic. Att. 15, 26, 4, tu parleras hardiment de ce principal dû par Tullius ; de capite deducite, quod usuris pernumeratum est Liv. 6, 15, 10, déduisez (retranchez) du capital ce qui a été payé jusqu'ici pour les intérêts
¶10. [en gram.] forme principale d'un mot, le nominatif : Varr. L. 9, 79 ; 9, 89 ; 9, 90, etc.
— la 1re pers. du prés. indic. : Varr. L. 9, 102 ; 9, 103.
===> orth. kaput Vel. Gram. 7, 53, 7 ; CIL 14, 2112, etc. ; capud CIL 7, 897
— abl. capiti Virg. En. 7, 668 ; Catul. 68, 124.
===> .
===> abl. y Serv. En. 1, 273 ; 10, 145.
¶1. nom du héros éponyme de la Carie, qui inventa la science de tirer des augures du vol des oiseaux : Plin. 7, 203
¶2. Carien : Cic. Fl. 65 ; v. Cares.
¶1. langouste : Plin. 9, 97
¶2. canot recouvert de peaux brutes : Isid. 19, 1, 26.
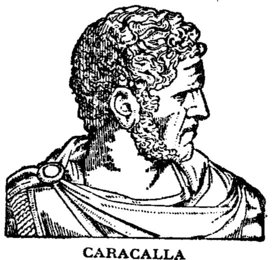
===> carbasus, m. V.-Max. 1, 1, 7 ; m. pl. Amm. 14, 8, 14
— carbasum, n. sing. Paneg. 12, 33
— adjt carbasa lina Prop. 4, 3, 64, lin fin.
¶1. petit charbon : Her. 4, 9
— [fig.] chagrin dévorant : Pl. Most. 986
¶2. [métaphore] escarboucle [pierre précieuse] : Plin. 37, 92
— carboucle [sorte de sable rougeâtre] Vitr. 2, 4
— brouissure des arbres, des fleurs : Col. 3, 2, 4
— charbon [maladie] : Cels. 5, 28, 1.
¶1. prison, cachot : in carcerem conjicere aliquem Cic. Nat. 2, 6, jeter qqn en prison ; in carcerem demissus Liv. 34, 44, 8 ; conditus Liv. 29, 22, 7, jeté, enfermé dans un cachot
— tout endroit où l'on est enfermé : e corporum vinclis tanquam e carcere evolare Cic. Rep. 6, 14, s'envoler des liens du corps comme d'une prison
— ce que renferme une prison, prisonniers : in me carcerem effudistis Cic. Pis. 16, vous avez lâché sur moi les prisons
— gibier de prison, de potence : Ter. Phorm. 373
¶2. l'enceinte, d'où partent les chars dans une course [au pl. en prose] : Cic. Br. 173
— [fig.] point de départ : ad carceres a calce revocari Cic. CM 83, être rappelé du terme au point de départ.
¶1. gardien de prison, geôlier : CIL 6, 1057, 7
¶2. prisonnier : *Don. Phorm. 373 ; Greg.-T. Franc. 10, 6.
¶1. hune d'un vaisseau : Macr. S. 5, 21, 5 ; Luc. 5, 418
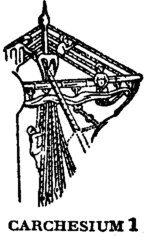
¶2. coupe à anses : Macr. S. 5, 21, 4 ; Virg. G. 4, 380
¶3. cabestan, machine à élever des fardeaux : Vitr. 10, 2, 10.
¶1. v. Carcinos
¶2. fleuve du Bruttium : Mel. 2, 68 ; Plin. 3, 96.
¶1. d'estomac : cardiacus morbus Plin. 11, 187, maladie d'estomac
— cardĭăcus, i, m., malade de l'estomac : Cic. Div. 1, 81
¶2. qui concerne le cœur : C.-Aur. Acut. 2, 30, 162
— cardĭăcus, i, m., qui a une maladie de cœur : C.-Aur. Acut. 2, 34, 180.
¶1. qui concerne les gonds : scapi cardinales Vitr. 4, 6, 4, montants des portes
¶2. principal : cardinales venti Serv. En. 1, 131, les principaux vents ; numeri Prisc. Fig. 4, 19, les nombres cardinaux.
¶1. gond, pivot : cardo stridebat Virg. En. 1, 449, le gond grinçait
— dans une machine, tenon ou mortaise : Vitr. 9, 6
— bout, extrémité : Plin. 21, 18
— pôle : Varr. R. 1, 2, 4 ; Eous cardo Luc. 5, 71, l'Orient
— point cardinal, point solstitial : cardo anni Plin. 18, 264, solstice d'été ; cardines temporum Plin. 18, 218, les quatre saisons ; cardo extremus Luc. 7, 381, le point extrême [de la vie] ; cardo convexitatis Plin. 31, 43, la partie la plus resserrée [d'un lieu]
— ligne du nord au sud [opp. decimanus] : Grom.
— ligne de démarcation : Liv. 37, 54, 23 ; 41, 1, 3
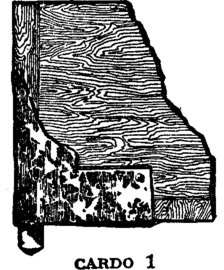
¶2. [fig.] point sur lequel tout roule, point capital : tanto cardine rerum Virg. En. 1, 672, en une conjoncture aussi critique ; ubi litium cardo vertitur Quint. 12, 8, 2, où se trouve le pivot de chaque affaire, cf. 5, 12, 3.
¶1. être exempt de, libre de, privé de, être sans, ne pas avoir [qu'il s'agisse de bonnes ou de mauvaises choses] : qui hac virtute caruerit Cic. Br. 279, celui qui n'a pas eu ce talent ; suspicione carere Cic. Amer. 144 ; crimine Cic. Lig. 18 ; reprehensione Cic. Off. 1, 144 ; dedecore Cic. Off. 2, 37 ; periculis Cic. Clu. 154 ; dolore Cic. Phil. 10, 20 ; errore Cic. Læ. 10, être à l'abri d'un soupçon, d'une accusation, d'un blâme, du déshonneur, du péril, être exempt de douleur, ne pas tomber dans l'erreur ; deus carens corpore Cic. Nat. 1, 33 ; morte Hor. O. 2, 8, 12, un dieu privé de corps, immortel
¶2. se tenir éloigné de : foro, senatu, publico Cic. Mil. 18, ne pas paraître au forum, au sénat, en public, cf. Verr. 4, 41, etc.; Nep. Epam. 3, 4
¶3. être privé de [malgré soi], sentir le manque de : quam huic erat miserum carere consuetudine amicorum Cic. Tusc. 1, 87, quelle triste chose pour lui que d'être privé de la société de ses amis, cf. Att. 3, 15, 2 ; Sest. 49 ; Mil. 63 ; Pomp. 55, etc.
¶4. [constr. rares] : [arch. avec accus.] Pl. Curc. 137 ; Pœn. 820 ; Turpil. Com. 32 ; Ter. Eun. 223
— [avec gén.] : Ter. Haut. 400 ; Læv. d. Gell. 19, 7, 7 ; Plin. 32, 59
— [avec infin.] Capel. 1, 21
— passif : vir mihi carendus Ov. H. 1, 50, mari dont je dois être privé ; [pass. imp.] carendum est Ter. Haut. 400, on doit être privé ; mihi carendum est... Cic. Att. 8, 7, 2 ; 12, 13, 2, je dois être privé...
===> part. fut. cariturus Ov. M. 2, 222, etc.; Sen. Ben. 1, 11, 1 ; Curt. 10, 2, 27
— déponent careor [arch.], d'après Prisc. 8, 26.
===> .
¶1. les deux parties creuses qui forment la coque de la noix : Plin. 15, 88 ; Pallad. 2, 15
¶2. carène d'un vaisseau [qui rappelle la moitié d'une coquille de noix] : Cæs. G. 3, 13 ; Liv. 22, 20, 2
— navire : Virg. G. 1, 303 ; Catul. 64, 10.
¶1. ville de Phrygie : Plin. 5, 145
¶2. montagne de Crète : Plin. 21, 79.
¶1. v. caryota
¶2. c. carota Gloss.
¶1. cherté [opp. vilitas], haut prix : annonæ Cic. Off. 3, 50, cherté du blé
¶2. amour, affection, tendresse : Cic. Part. 88 ; Læ. 27
— [avec gén. obj.] patriæ Cic. Off. 3, 100, l'amour de la patrie, cf. Phil. 12, 20
— [avec gén. subj.] hominum Cic. de Or. 2, 237, l'amour que témoignent les hommes, cf. Nat. 1, 122 ; Phil. 1, 12
— caritates, les personnes chères, aimées : Amm. 18, 8, 14.
===> .
¶1. chaîne du mont Carmel [en Judée] : Vulg. Jos. 19, 26
¶2. ville de Judée : Vulg. 1 Reg. 15, 12 ; [d'où] -lītes, æ, m., et -lītis, ĭdis, f., habitant, habitante de Carmel : Vulg. 1 Par. 11, 37 ; 3, 1.
¶1. chant, air, son de la voix ou des instruments : ferale Virg. En. 4, 462, chant lugubre, funèbre, cf. G. 4, 514 ; Ov. M. 11, 317
¶2. composition en vers, vers, poésie : carmina canere Cic. Br. 71, chanter des vers ; contexere Cic. Cæl. 19 ; fundere Cic. Tusc. 1, 64, écrire, composer des vers
— [en part., poésie lyrique ou épique] Hor. Ep. 2, 2, 91 ; Quint. 2, 4, 2
— division d'un poème, chant : in primo carmine Lucr. 6, 937, dans le premier chant
— inscription en vers : Virg. En. 3, 287
— réponse d'un oracle, prophétie, prédiction : Virg. B. 4, 3 ; Liv. 1, 45, 5
— paroles magiques, enchantements : carmina vel cælo possunt deducere lunam Virg. B. 9, 69, les paroles magiques peuvent même faire descendre la lune du ciel
— formule [religieuse ou judiciaire] : Cic. Rab. Perd. 13 ; Mur. 26 ; Liv. 10, 38, 10
— sentences morales [en vers] : Cic. Tusc. 4, 4 ; de Or. 1, 245.
¶1. divinité protectrice des organes du corps : Macr. S. 1, 12, 31
¶2. la même que Cardea : Ov. F. 6, 101.
a) m., carnārĭus, ĭi, gros mangeur de viande : Mart. 11, 100, 6 ;
b) carnārĭa, æ, f., boucherie : Varr. L. 8, 55 ;
c) carnārĭum, ii, n., croc à suspendre la viande : Pl. Capt. 914
— garde-manger : Pl. Curc. 324.
¶1. exécuter [un condamné] : Sisenn. d. Prisc. 8, 19
— décapiter : Liv. 24, 15, 5
¶2. couvrir de chair [cf. σαρκοῦν] : Cass.-Fel. 19, p. 29.
¶1. chair, viande : eorum victus in lacte, caseo, carne consistit Cæs. G. 6, 22, 1, ils se nourrissent de lait, de fromage et de viande
¶2. [métaph.] chair, pulpe des fruits : Plin. 15, 96
— partie tendre intérieure d'un arbre : Plin. 16, 181
¶3. [en part.] la chair [par opposition à l'esprit] : Sen. Ep. 65, 22
— charogne [en parl. de qqn] : caro putida Cic. Pis. 19, chair puante
¶4. [fig., en parl. d'un écrivain] : carnis plus habet, lacertorum minus Quint. 10, 1, 77, il a plus de chair, mais moins de muscles.

===> .
¶1. arracher, détacher, cueillir : vindemiam de palmite Virg. G. 2, 90, cueillir le raisin sur le cep de vigne ; arbore frondes Ov. Am. 2, 19, 32, détacher d'un arbre des rameaux
— alia (animalia) sugunt, alia carpunt Cic. Nat. 2, 122, parmi les animaux, les uns sucent, les autres broutent ; edico herbam carpere oves Virg. G. 3, 296, je veux que les brebis broutent l'herbage [dans les étables]
— Milesia vellera Virg. G. 4, 335, filer les laines de Milet (déchirer les flocons de laine)
— summas carpens media inter cornua setas Virg. En. 6, 245, détachant (coupant) entre les cornes l'extrémité des crins
¶2. diviser par morceaux, lacérer, déchirer : nec carpsere jecur volucres Ov. M. 10, 43, et les vautours cessèrent de déchirer le foie de Tityus
— [fig.] : sæpe carpenda membris minutioribus oratio est Cic. de Or. 3, 190, souvent il faut diviser [la phrase] en membres plus menus ; in multas partes carpere exercitum Liv. 26, 38, 2, morceler l'armée en une foule de détachements [l'émietter] ; fluvium Curt. 8, 9, 10, diviser un fleuve en canaux
¶3. [fig.] cueillir, recueillir, détacher : passim licet carpentem et colligentem undique repleri justa juris civilis scientia Cic. de Or. 1, 191, on peut en faisant la cueillette çà et là et en s'approvisionnant de tous côtés se pourvoir d'une connaissance suffisante du droit civil ; animum esse per naturam rerum omnem commeantem, ex quo nostri animi carperentur Cic. Nat. 1, 27, [Pythagore croyait que dieu] est une âme répandue à travers toute la nature et dont nos âmes se détachent
— [poét.] cueillir, prendre, goûter : carpe diem Hor. O. 1, 11, 8, cueille le jour présent [jouis-en]; molles somnos sub divo Virg. G. 3, 435, goûter le doux sommeil en plein air ; auras vitales Virg. En. 1, 388, respirer, vivre
— [poét.] parcourir : viam Virg. G. 3, 347, parcourir une route [m. à m. la prendre morceau par morceau] (iter Hor. S. 1, 5, 95) ; supremum iter Hor. O. 2, 17, 12, faire le dernier voyage ; tenuem aera Virg. G. 4, 311, gagner l'air léger ; carpitur acclivis trames Ov. M. 10, 53, ils gravissent un sentier escarpé
¶4. [fig.] déchirer par de mauvais propos : malo dente Cic. Balb. 57, déchirer d'une dent mauvaise (médisante); militum vocibus carpi Cæs. G. 3, 17, 5, être l'objet des mauvais propos des soldats ; Pompeius carpebatur a Bibulo Cic. Q. 2, 3, 2, Pompée était attaqué (malmené) par Bibulus, cf. Hor. S. 1, 3, 21 ; Liv. 7, 12, 12 ; 44, 38, 2 ; 45, 35, 5 ; Plin. Ep. 1, 9, 5, etc.
¶5. [t. milit.] par des attaques répétées tourmenter, affaiblir l'ennemi ; harceler : equitatu præmisso qui novissimum agmen carperet Cæs. C. 1, 78, 5, la cavalerie étant envoyée en avant pour harceler l'arrière-garde, cf. C. 1, 63, 2 ; Liv. 6, 32, 11 ; 22, 32, 2, etc.
— [poét.] enlever peu à peu, affaiblir : carpit vires paulatim uritque videndo femina Virg. G. 3, 215, la vue de la génisse mine insensiblement leurs forces et les consume ; carpi parvis cotidie damnis vires videbantur Liv. 9, 27, 6, ils voyaient que ces faibles pertes quotidiennes diminuaient leurs forces ; regina cæco carpitur igni Virg. En. 4, 2, la reine se consume d'un feu secret ; (invidia) carpit et carpitur una Ov. M. 2, 781, (l'envie) ronge et se ronge tout à la fois.
===> forme carpeo Apic. 4, 151
— carpio Vict. Vit. 3, 66 ; Greg. T. Glor. mart. 104.
¶1. esclave qui découpe les viandes : Juv. 9, 110
¶2. critique malveillant : subducti supercilii carptores Læv. d. Gell. 19, 7, 16, censeurs au sourcil froncé.
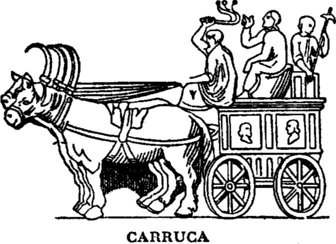
¶1. ville de la Bétique : Cic. Att. 12, 44, 4
¶2. ville de la Tarraconnaise : Liv. 21, 5
— -tēĭānus, a, um, Plin. 3, 17 et -tēĭensis, e, B. Hisp. 36, 1, de Cartéia.
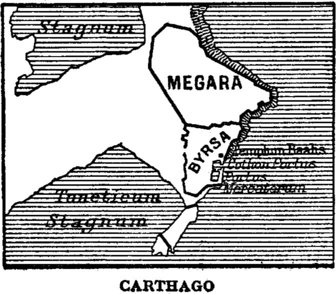
===> locatif Carthagini Pl. Cas. 71 ; Cic. Agr. 2, 90 ; Liv. 28, 26, 1.
¶1. cartilage : Cels. 8, 1
¶2. pulpe, chair des fruits : Plin. 15, 116.
¶1. cher, coûteux, précieux : Pl. Capt. 494
— -ior Cic. Div. 2, 593, -issimus Cic. Dom. 14
¶2. cher, aimé, estimé Cic. Off. 2, 29 ; carum habere aliquem Cic. Fam. 1, 7, 1, chérir quelqu'un.
¶1. poète de l'époque d'Auguste : Ov. P. 4, 16, 9
¶2. surnom du poète Lucrèce
— surnom d'un empereur romain : Vop. Car. 1.
¶1. roi breton : Cæs. G. 5, 22, 1
¶2. nom romain : Cic. de Or. 2, 61
— -lĭānus, a, um, de Carvilius : Gell. 4, 3.
¶1. prêtresses de Diane à Caryæ : Plin. 36, 38
¶2. [fig.] caryatides, statues de femmes qui supportent une corniche : Vitr. 1, 1, 5.


¶1. cannelier, laurus cassia : Plin. 12, 85 ; Pl. Curc. 103
¶2. daphné [plante] : Virg. G. 2, 213.
¶1. prince macédonien : Just. 12, 14, 1 ; -drus Nep. Eum. 13, 3
¶2. célèbre astronome : Cic. Div. 2, 88.
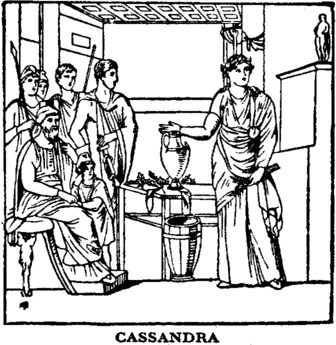
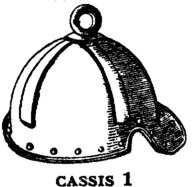
a) C. Cassius, meurtrier de César : Cic. Att. 5, 21, 2 ;
b) Cassius de Parme, poète : Hor. Ep. 1, 4, 3 ;
c) Cassius Longinus, jurisconsulte : Tac. An. 12, 12 ;
d) Cassius Severus, rhéteur : Sen. Suas. 6, 11 ; Quint. 10, 1, 116
— Cassius, a, um, de ou des Cassius : Tac. An. 12, 12
— ou Cassĭānus, a, um, v. ce mot.
¶1. vide : cassa nux Pl. Ps. 371 ; Hor. S. 2, 5, 36, noix vide
— [avec abl.] dépourvu de, privé de : virgo dote cassa Pl. Aul. 191, jeune fille sans dot ; cassum lumine corpus Lucr. 5, 719, corps privé de lumière
— [avec gén.] Cic. Arat. 369 ; Apul. Socr. 1
¶2. [fig.] vain, chimérique, inutile : omne quod honestum nos, id illi cassum quiddam esse dicunt Cic. Tusc. 5, 119, tout ce que nous, nous appelons le bien, ils disent eux, que c'est une entité creuse ; cassa vota Virg. En. 12, 780, vœux inutiles
— in cassum [loc. adv.] : in cassum frustraque Lucr. 5, 1430, vainement et sans résultat (Virg., Liv., Tac.) ; in cassum cadere Pl. Pœn. 360, n'aboutir à rien, cf. Lucr. 2, 1165.
¶1. ville de Cilicie : Plin. 5, 93
¶2. ville de Cappadoce : Plin. 6, 8.
¶1. honnêtement, vertueusement : caste vivere Cic. Fin. 4, 63, mener une vie honnête
— purement, chastement : caste tueamur eloquentiam, ut adultam virginem Cic. Br. 330, sauvegardons la pureté de l'éloquence comme la pureté d'une jeune fille
¶2. religieusement, purement : Cic. Leg. 2, 24 ; Nat. 1, 3 ; castissime Cic. Div. 2, 85 ; castius Liv. 10, 7, 5
¶3. correctement : caste pureque lingua Latina uti Gell. 17, 2, 7, parler un latin châtié et pur.
¶1. château fort, redoute : castella communire Cæs. G. 1, 8, 2, élever des redoutes
— [fig.] asile, repaire : castellum latrocinii Cic. Pis. 11, repaire de brigands
¶2. hameau, ferme dans les montagnes : castella in tumulis Virg. G. 3, 475, chalets sur les hauteurs, cf. Liv. 22, 11, 4
¶3. château d'eau, réservoir : Vitr. 8, 6.
¶1. avec réserve, retenue : Sen. Contr. 6, 8
¶2. d'une manière concise : Macr. Somn. 1, 6
— -tius Amm. 22, 3, 12, avec plus de réserve.
¶1. (castigo), blâme, réprimande : Cic. Tusc. 4, 45
¶2. châtiment : castigatio fustium Paul. Dig. 1, 15, 3, bastonnade
— mortification : Cassian. Cœn. 5, 8
¶3. taille des arbres : Plin. 17, 173
— [fig.] castigatio loquendi Macr. Sat. 2, 4, 12, application à châtier son style.
¶1. part. de castigo
¶2. adjt
a) régulier, de lignes pures : Ov. Am. 1, 5, 21 ; Stat. S. 2, 1, 43 ;
b) [fig.] contenu, strict : luxuria tanto castigatior Aug. Civ. 5, 24, le luxe d'autant plus retenu ; castigatissima disciplina Gell. 4, 20, 1, discipline très stricte.
¶1. reprendre, réprimander : castigare pueros verbis Cic. Tusc. 3, 64, redresser des enfants par des reproches, cf. Leg. 1, 62 ; Cæs. C. 1, 3 ; in hoc me ipse castigo quod Cic. Tusc. 5, 4, je m'accuse moi-même en ceci que
— punir : Liv. 7, 4, 6 ; Sen. Suas. 1, 6 ; quo sæpius monuerit, hoc rarius castigabit Quint. 2, 2, 5, plus il multipliera les avertissements, moins il punira
¶2. [fig.] amender, corriger : Cic. Tusc. 4, 66 ; castigare sua vitia Plin. Pan. 46, 6, corriger ses défauts ; castigare verba Juv. 6, 455, relever des fautes de langage, cf. Hor. P. 294
¶3. contenir, réprimer : castigare equum tenacem Liv. 39, 25, 13, reduire un cheval rétif ; castigatus animi dolor Cic. Tusc. 2, 50, chagrin réprimé, cf. 4, 66 ; Sen. Ep. 21, 11
— [poét ] insula castigatur aquis Sil. 12, 353, l'île est pressée par les flots.
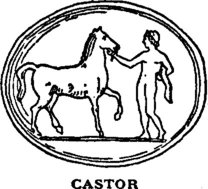
¶1. camp : castra ponere Cæs. G. 1, 22, 5, camper ; castra munire Cæs. G. 1, 49, 2, construire un camp ; castra movere Cæs. G. 1, 15, 1, lever le camp, décamper ; castra stativa Cæs. C. 3, 30, 3, camp fixe, permanent ; castra æstiva Tac. A. 1, 16, quartiers d'été ; castra navalia Cæs. G. 5, 22, 1, camp de mer, station de vaisseaux
— castra habere contra aliquem Cæs. G. 1, 44, 3, faire campagne contre qqn

¶2. [fig.] campement, journée de marche : quintis castris Gergoviam pervenit Cæs. G. 7, 36, 1, il atteignit Gergovie après cinq jours de marche
— service en campagne : qui magnum in castris usum habebant Cæs. G. 1, 39, 5, qui avaient une grande expérience de la vie des camps
— intérieur de ruche : Pall. 1, 37, 4
— caserne : Suet. Tib. 37, 1 ; Tac. An. 4, 2
— résidence impériale : Spart. Had. 13
— parti politique, école philosophique : Epicuri castra Cic. Fam. 9, 20, 1, le camp d'Épicure.
¶1. castration : Col. 6, 26
¶2. tonture, élagage : Plin. 16, 206.
¶1. Pall. 6, 7, 2, c. castrātio
¶2. action d'émonder, de cribler : Plin. 18, 86.
¶1. relatif au camp, à l'armée : Cic. Cat. 3, 17 ; Cæl. 11 ; castrensis jurisdictio Tac. Agr. 9, juridiction exercée dans le camp, justice des camps ; peculium castrense Dig. 49, 17, 11, économies faites à l'armée ; copiari verbum castrense est Gell. 17, 2, 9, copiari est un mot de la langue militaire
¶2. relatif au Palais impérial : Tert. Coron. 12 ; [d'où] castrensis, is, m., officier du Palais : Cod. Theod. 6, 31, 1 ; 12, 1, 38.
¶1. châtrer : Pl. Merc. 272 ; Suet. Dom. 7, 11
— ébrancher, élaguer : Plin. 17, 144 ; Cat. Agr. 33, 2
— rogner, amputer, enlever : castrare caudas catulorum Col. 7, 12, 14, courtauder de jeunes chiens
— filtrer, cribler, tamiser : vina castrare Plin. 19, 53, filtrer du vin ; siligo castrata Plin. 18, 86, farine tamisée
¶2. [fig.] émasculer, débiliter, affaiblir : cf. Cic. de Or. 3, 164
— expurger : castrare libellos Mart. 1, 35, 14, purger des vers de ce qu'ils ont d'obscène.
¶1. pur, intègre, vertueux, irréprochable : quis hoc adulescente castior ? Cic. Phil. 3, 15, quoi de plus honnête que ce jeune homme ? castissimum hominem ad peccandum impellere Cic. Inv. 2, 36, pousser au mal le plus vertueux des hommes ; castissima domus Cic. Cæl. 9, maison très vertueuse
— [en part.] fidèle à sa parole, loyal : fraudasse dicatur perjurum castus Cic. Com. 21, c'est l'homme esclave de sa parole qui aurait trompé l'homme sans foi ; casta Saguntum Sil. 3, 1, la fidèle Sagonte
¶2. chaste, pur : castum decet esse poetam ipsum Catul. 16, 5, il faut que le poète soit chaste dans sa personne ; casta Minerva Hor. O. 3, 3, 23, la chaste Minerve ; castus vultus Ov. M. 4, 799, air pudique
— [fig.] correct [en parl. du style] : Cæsar, sermonis castissimi Gell. 19, 8, 3, César dont la langue est si pure
¶3. pieux, religieux, saint : casti nepotes Virg. En. 3, 489, descendants pieux ; casta contio Cic. Rab. Perd. 11, assemblée sainte [dans un lieu consacré] ; castum nemus Tac. G. 40, forêt sainte ; castæ tædæ Virg. En. 7, 71, les torches sacrées ; casta poesis Varr. d. Non. 267, 14, la divine poésie
— castum, i, n., fête [religieuse] : Fest. p. 154, 25 ; Tert. Jejun. 16.
¶1. accidentel, fortuit, casuel : casualis condicio Cod. Just. 6, 51, condition éventuelle
¶2. relatif aux cas (gram.) : Varr. L. 8, 52 ; Prisc. 5, 75.
¶1. cabane : Juv. 14, 179
— [fig.] tombeau : Petr. 111, 5
¶2. vêtement de dessus : Aug. Civ. 22, 8, 9 ; [plus tard] chasuble.
¶1. chute : casus, ictus extimescere Cic. Nat. 2, 59, redouter les chutes, les coups ; nivis casus Liv. 21, 35, 6, chute de neige
— [fig.] ne quis ex nostro casu hanc vitæ viam pertimescat Cic. Sest. 140, pour que l'exemple de ma chute ne fasse craindre à personne d'aborder cette ligne de conduite politique
— chute, fin : extremæ sub casum hiemis Virg. G. 1, 340, sur la fin de l'hiver ; casus urbis Trojanæ Virg. En. 1, 623, la chute de Troie ; de casu Sabini et Cottæ Cæs. G. 5, 52, 4, sur la fin de Sabinus et de Cotta, cf. C. 1, 7, 5 ; Sall. J. 73, 1
¶2. arrivée fortuite de qqch : quarum rerum omnium nostris navibus casus erat extimescendus Cæs. G. 3, 13, 9, l'arrivée (la rencontre) de tous ces accidents était à craindre pour nos navires ; ætas illa multo plures quam nostra casus mortis habet Cic. CM 67, cet âge-là a beaucoup plus de cas (chances) de mort que le nôtre ; ad omnes casus subitorum periculorum objectus Cic. Fam. 6, 4, 3, exposé à toute sorte d'arrivées de dangers soudains (à l'arrivée de mille dangers soudains); non est sapientiæ tuæ ferre immoderatius casum incommodorum tuorum Cic. Fam. 5, 16, 5, il n'est pas digne de ta sagesse de supporter sans modération le malheur qui t'est arrivé
¶3. ce qui arrive, accident, conjoncture, circonstance, occasion : novi casus temporum Cic. Pomp. 60, nouvelles conjonctures correspondant aux circonstances ; sæpe in bello parvis momentis magni casus intercedunt Cæs. C. 1, 21, 1, souvent dans une guerre sous de petites influences surviennent de grandes vicissitudes ; communem cum reliquis belli casum sustinere Cæs. G. 5, 30, 3, supporter avec tous les autres les hasards communs de la guerre ; propter casum navigandi Cic. Att. 6, 1, 9, à cause des hasards de la navigation
— hasard : videte qui Stheni causam casus adjuverit Cic. Verr. 2, 98, voyez quelle circonstance fortuite a secondé la cause de Sthénius ; neque ad consilium casus admittitur Cic. Marc. 7, ni le hasard ne trouve accès aux côtés de la prudence, cf. Planc. 35 ; Div. 2, 85 ; Par. 52 ; virtute, non casu gesta Cic. Cat. 3, 29, choses accomplies par l'énergie personnelle et non par le hasard ; cæco casu Cic. Div. 2, 15, par un hasard aveugle
— abl. casu [employé comme adv.], par hasard, accidentellement : Cic. Nat. 2, 141 ; Div. 1, 125, etc.
— arrivée heureuse de qqch, occasion, bonne fortune, chance : casum victoriæ invenire Sall. J. 25, 9, trouver l'occasion d'une victoire ; fortunam illis præclari facinoris casum dare Sall. J. 56, 4, que la fortune leur donnait l'occasion d'un bel exploit
— heureux événement : Cæs. C. 3, 51, 5
¶4. [en part.] accident fâcheux, malheur : eumdem casum ferre Cæs. G. 3, 22, 2, supporter le même malheur ; casum amici reique publicæ lugere Cic. Sest. 29, pleurer le sort malheureux d'un ami et de l'État ; longe prospicere futuros casus rei publicæ Cic. Læ. 40, prévoir de loin les malheurs qui menacent l'État ; casu civitatis Gomphensis cognito Cæs. C. 3, 81, 8, ayant appris le sort de la ville de Gomphi
¶5. [gram.] cas : sive casus habent (verba) in exitu similes Cic. Or. 165, soit que (les mots) aient des désinences casuelles semblables ; in barbaris casibus Cic. Or. 160, dans les cas d'un mot latin
— casus rectus, nominatif : Cic. Or. 160 ; Varr. L. 5, 4 ; 7, 33 [en parl. du verbe, 1re pers. : Varr. L. 9, 103], ou casus nominandi Varr. L. 8, 42, ou nominativus Varr. L. 10, 23
— sextus casus Varr. L. 10, 62, ablatif.
===> orthogr. cassus au temps de Cic., d'après Quint. 1, 7, 20.
¶1. arbre qui produit par la greffe des fruits de différentes espèces : M. Aur. d. Front. p. 35, 5, N
¶2. pl., écrits satiriques : Spart. Hadr. 16, 2.
===> catalecton [certains mss].

¶1. catapulte : Cæs. C. 2, 9, 4 ; Liv. 26, 47, 5
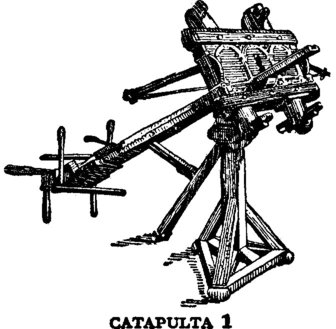
¶2. projectile lancé par une catapulte : Pl. Capt. 796 ; Curc. 398.

¶1. estrade où sont exposés les esclaves mis en vente : Tib. 2, 3, 60 ; Suet. Gram. 13 ; [fig.] mille catastæ Mart. 9, 29, 5, mille estrades = le brouhaha de mille estrades de vente
— tribune : Rutil. 1, 393
¶2. gril [instrument de torture] : Prud. Peri. 1, 56.
¶1. accusation : Hier. Ep. 82, 9
¶2. catégorie [logique] : Sid. Ep. 4, 1.
¶1. petit chien : Pl. Stich. 620
— [fig., terme de caresse] : sume, catelle Hor. S. 2, 3, 259, prends, mon chéri
¶2. jeu de mots avec catella 2 [petit chien, petite chaîne] : Pl. Curc. 691.
¶1. chaîne : catena firma Liv. 24, 34, 10, une chaîne solide ; catena vinctus Tac. An. 4, 28, enchaîné ; catenis vincire aliquem Pl. Men. 3, enchaîner quelqu'un ; catenas indere alicui Pl. Cap. 112 [injicere Cic. Verr. 5, 106], mettre des chaînes à quelqu'un ; in catenas conjicere Cæs. G. 147, jeter dans les fers ; eum in catenis Romam miserunt Liv. 29, 21, 12, ils l'envoyèrent enchaîné à Rome
— [fig.] contrainte, lien, barrière : legum catenis constrictus Cic. Sest. 16, maintenu par la contrainte des lois ; animum compesce catena Hor. Ep. 1, 2, 63, enchaîne tes passions
¶2. attache, lien : Vitr. 7, 13 ; Pall. 1, 13, 1
¶3. ceinture de femme : Plin. 33, 40
¶4. série, enchaînement : Gell. 6, 2, 1
¶5. [rhét.] gradation : Isid. 2, 21, 4.
¶1. corps de troupes, bataillon, troupe, [surtout] bande guerriere, troupe de barbares [par opp. aux légions] : catervæ Germanorum Tac. An. 1, 56, bandes de guerriers Germains ; conducticiæ catervæ Nep. Chabr. 1, 2, bandes de mercenaires, cf. Tac. An. 2, 45
— escadron : Virg. En. 8, 593
¶2. [en gén.] troupe, foule : catervæ testium Cic. Verr. 5, 113, foules de témoins, cf. Cæl. 14 ; Tusc. 1, 77 ; catervæ avium Virg. En. 11, 496, bandes d'oiseaux
— troupe d'acteurs ou de chanteurs : Cic. de Or. 3, 196
— [fig.] vilis verborum caterva Gell. 15, 2, 3, tas de mots grossiers.
¶1. chaise à dossier, siège : Hor. S. 1, 10, 91 ; Juv. 6, 91
— chaise à porteurs : Juv. 1, 65

¶2. chaire de professeur : sterilis cathedra Juv. 7, 203, chaire de maigre rapport
— chaire d'une église : Hier. Vir. 70
— [fig.] siège épiscopal : Prud. Peri. 2, 462.
¶1. relatif au fauteuil ou à la chaise à porteurs : cathedrarii servi Sid. Ep. 1, 11, porteurs de litière
¶2. relatif à la chaire de professeur : cathedrarii philosophi Sen. Brev. 10, 1, philosophes en chaire = philosophes de parade.
¶1. universel : catholica bonitas Dei Tert. Marc. 2, 17, la bonté divine qui s'étend à toutes choses
— căthŏlĭca, ōrum, n. = universalia, perpetualia [en grec d. Quint. 2, 13, 14], ensemble de règles générales, universelles, absolues ; catholica nominum Prob. Cath. 1, 1, règles générales des noms
¶2. catholique [adj. et subst.] : Prud. Peri. 11, 24 ; Hil. Matt. 26, 5.
¶1. petit plat, petite assiette : Hor. S. 2, 4, 77
¶2. partie supérieure d'une meule de moulin : Paul. Dig. 33, 7, 18.


¶1. petit chien : Cic. Nat. 2, 38 ; Fin. 3, 48
— petit d'un animal quelconque : [pourceau] Pl. Ep. 579 ; [louveteau] Virg. En. 2, 357 ; [lionceau] Virg. G. 3, 245
¶2. carcan : Lucil. d. Non. 36, 26 ; P. Fest. 45.

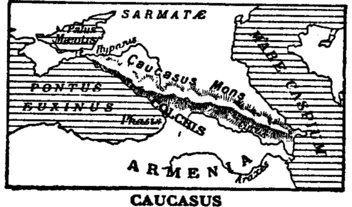
¶1. souche, tronc d'arbre : Virg. G. 2, 30 ; Plin. 16, 121
— [fig.] homme stupide, bûche : Ter. Haut. 877
¶2. c. codex : Cat. d. Front. Ep. ad M. Ant. 1, 2 ; cf. Sen. Brev. 13, 4.

¶1. cavités, ouvertures, Lucr. 3, 255, etc.
¶2. barrière d'un parc de moutons : lupus fremit ad caulas Virg. En. 9, 60, le loup hurle devant la bergerie
— enceinte d'un temple, d'un tribunal : Serv. En. 9, 60.
===> forme cupo Char. 1, 63, 10.
¶1. cabaretière : quædam anus caupona, Lucil. 128 ; Apul. M. 1, 21, une vieille cabaretière
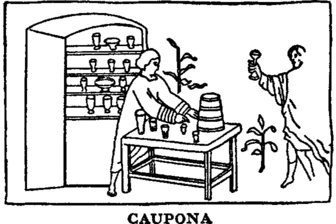
¶2. auberge, taverne : Cic. Pis. 53 ; Hor. Ep. 1, 11, 12 ; Tac. An. 14, 15.
I.
¶1. cause [v. une définition Cic. Fat. 34] : quicquid oritur, qualecumque est, causam habeat a natura necesse est..., si nullam reperies, illud tamen exploratum habeto, nihil fieri potuisse sine causa Cic. Div. 2, 60, tout ce qui naît, quelque forme qu'il affecte, a nécessairement une cause naturelle... ; si tu n'en trouves aucune, tiens néanmoins pour assuré que rien n'aurait pu se produire sans cause ; ut in seminibus est causa arborum et stirpium, sic... Cic. Phil. 2, 55, de même que dans les semences réside la cause qui produit les arbres et les racines, de même...; ejus belli hæc fuit causa Cæs. G. 3, 7, 2, voici quelle fut la cause de cette guerre ; causā morbi inventā Cic. Tusc. 3, 23, la cause de la maladie une fois trouvée, cf. Varr. R. 2, 1, 21 ; Cic. Div. 2, 62 ; Lucr. 3, 502 ; 3, 1070 ; Virg. G. 3, 440 ; is mortem attulit, qui causa mortis fuit Cic. Phil. 9, 7, il a été le meurtrier celui qui a été cause de sa mort ; hic dolor populi Romani causa civitati libertatis fuit Cic. Fin. 2, 66, ce ressentiment du peuple romain fut pour la cité la cause de son affranchissement
— [poét.] in seminibus fateare necessest esse aliam causam motibus Lucr. 2, 285, il faut reconnaître qu'il y a dans les atomes une autre cause [à] de leurs mouvements ; eam causam multis exitio esse Tac. An. 16, 14, (il savait) que cette cause est fatale à beaucoup
— [en part.] cause, influence physique : (homo) fluida materia et caduca et omnibus obnoxia causis Sen. Ep. 58, 24, (l'homme) matière sans consistance, caduque, subissant toutes les influences extérieures ; ut in affecto corpore quamvis levis causa magis quam in valido gravior sentiretur, sic Liv. 22, 8, 3, de même que dans un corps éprouvé la moindre atteinte se ressent davantage qu'une plus forte dans un corps robuste, de même (Liv. 30, 44, 8)
— raison, motif : justa Cic. Verr. 4, 145, juste raison, raison légitime ; causam rei proferre Cic. Amer. 72, produire les raisons d'une chose ; causa mittendi fuit quod... volebat Cæs. G. 3, 1, 2, le motif de cet envoi fut qu'il voulait...; prætermittendæ defensionis plures solent esse causæ Cic. Off. 1, 28, les raisons de négliger la défense d'autrui sont d'ordinaire plus nombreuses ; nec erit justior in senatum non veniendi morbi causa quam mortis Cic. Phil. 1, 28, pour ne pas venir au sénat la maladie ne sera pas un motif plus légitime que la mort ; mihi dedit causam harum litterarum Cic. Fam. 11, 27, 8, il m'a fourni la raison (l'occasion) d'écrire cette lettre ; si quis ab ineunte ætate habet causam celebritatis Cic. Off. 2, 44, si qqn dès sa jeunesse a des raisons d'avoir un nom répandu ; aliud esse causæ suspicamur Cic. Flac. 39, nous soupçonnons qu'il y a un autre motif ; iste hoc causæ dicit, quod [subj.] Cic. Verr. 5, 106, lui, il déclare que la raison est que...
— qua causa ? Pl. Bac. 249 ; Mil. 83, etc., pour quelle raison ? ea causa Pl. Aul. 464 ; Ter. Hec. 190, etc.; Sall. C. 52, 7, pour cette raison [hac causa Cic. Rep. 1, 41] ; aliis atque aliis causis Liv. 7, 39, 7, pour un motif ou pour un autre
— [avec de] eadem de causa Cic. Verr. 2, 160 ; Cæs. G. 2, 7, 2 ; isdem de causis Cic. Off. 1, 89 ; qua de causa Cic. Or. 191, etc.; Cæs. G. 1, 1, 4, etc. ; quibus de causis Cic. de Or. 1, 16, etc. ; Cæs. C. 2, 30, 1 ; quacumque de causa Cæs. G. 6, 23, 9, pour la même raison, les mêmes raisons, pour cette raison, ces raisons, pour n'importe quelle raison ; omnibus de causis existimare... Cæs. G. 3, 7, 1, avoir toute raison de croire que...; certa de causa Cic. Cat. 1, 5, pour une raison précise (certis de causis Cic. de Or. 1, 186) ; justissimis de causis Cic. Verr. 2, 2, pour les motifs les plus légitimes ; leviore de causa Cæs. G. 7, 4, 10, pour un motif moins grave
— [avec ex] qua ex causa Cic. Mur. 26 ; Rep. 2, 13 ; ex aliis causis Cic. de Or. 2, 335 ; [avec ob] ob eam causam Cic. Font. 2, etc. ; Cæs. G. 1, 17, 6, etc. ; ob eas causas Cic. Phil. 5, 46, etc. ; ob eam ipsam causam quod Cic. Fin. 2, 22, Nat. 2, 17, précisément pour la raison que...; ob eam unam causam quia Cic. Fin. 2, 45, pour la seule raison que ; ob eamdem causam Cic. Dom. 101, etc. ; aliam ob causam Cic. de Or. 2, 60, etc. ; nec ob aliam causam ullam... nisi quod... Cic. Læ. 74, et le seul motif pour lequel... c'est que... ; quam ob causam Cic. Verr. 3, 64 ; Phil. 5, 40, etc.; Cæs. C. 3, 88, 5 ; ob hanc causam Cic. Verr. 5, 118 ; Cæl. 39, etc. ; ob has causas Cic. Sest. 46 ; Cæs. G. 4, 24, 2 ; [avec per] Varr. d. Prob. Verg. Ecl. 6, 31 ; Ov. Ep. 17, 214 ; Petr. 123, 217
— [avec propter] Cic. Verr. 3, 110 ; 4, 113 ; 5, 71 ; Prov. 2 ; de Or. 1, 72 ; Br. 100, etc. ; propter hanc causam quod Cic. Verr. 2, 131 ; 3, 109, pour cette raison que...
— [avec ab] : a duobus causis punire princeps solet Sen. Clem. 1, 20, il y a deux raisons qui inspirent d'ordinaire les sanctions du prince
— cum causa Cic. Verr. 1, 21 ; Cæl. 68, avec raison ; cum justissima causa Cic. Att. 7, 1, 5, avec une raison très légitime, très légitimement
— non sine causa Cic. Verr. 5, 16, etc., non sans raison
— multæ sunt causæ, quamobrem cupiam... Ter. Eun. 145, il y a bien des raisons pour que je désire...; non est ista causa quam dicis, quamobrem velis Cic. Br. 231, ce n'est pas la raison que tu allègues qui fait que tu veux... ; satis habere causæ, quamobrem Cic. Fin. 3, 51, comporter des raisons suffisantes pour que
— [avec cur] : non justa causa, cur... Cic. Tusc. 1, 65, ce n'est pas une raison légitime pour que ; quid est causæ, cur Cic. Flac. 5, etc., quel motif y a-t-il pour que ; causa, cur mentiretur, non erat Cic. Quinct. 18, il n'avait aucun motif de mentir ; en causa, cur Cic. Dej. 17, voilà le motif pour lequel...
— [avec quare] Cic. Sest. 52 ; Cæs. G. 1, 19, 1
— [avec ut] : an vero non justa causast ut vos servem sedulo ? Pl. Capt. 257, n'ai-je pas une juste raison de vous faire garder attentivement ? ea est causa ut... Liv. 5, 55, 5, c'est là raison pour laquelle...; verecundiam multis in causa fuisse, ut Quint. 12, 5, 2, la timidité a été pour beaucoup la cause que...; vim morbi in causa esse, quo serius conficeretur (dilectus) Liv. 40, 26, 5, la violence de l'épidémie était cause du retard apporté dans l'enrôlement
— eā causā, ut = idcirco, ideo ut, pour que, afin que : Pl. Men. 893 ; Ps. 55 ; Stich. 312 ; Ter. Hec. 235
— [ne pas confondre ut conséc. (Cæs. C. 3, 47, 2 ; Cic. Fin. 5, 29) avec ut final et ne (Cic. Fin. 3, 8 ; Font. 36, etc.)]
— avec prop. inf. [poét.] : quæ causa fuit consurgere in arma Europamque Asiamque Virg. En. 10, 90, quelle raison a fait que l'Europe et l'Asie se dressent pour courir aux armes
— [expressions] nihil causæ quin Cic. Quinct. 32, pas de raison pour empêcher que ; num quid est causæ quin Cic. Tusc. 1, 78, y a-t-il une raison pour empêcher que... (quominus Cic. Inv. 2, 132 ; Sall. C. 51, 41 ; Liv. 34, 56, 9)
¶2. motif allégué, raison invoquée, excuse, prétexte : ad populum Romanum confugient ? facilis est populi causa ; legem se sociorum causa jussisse dicet Cic. Verr. 5, 126, ils auront recours au peuple romain ? la défense du peuple est facile ; il dira qu'il a porté une loi en faveur des alliés ; hanc causam habere ad injuriam Cic. Off. 3, 31, avoir ce prétexte pour commettre l'injustice ; hanc bellandi causam inferebat, quod Cic. Rep. 3, 15, il alléguait, comme prétexte de faire la guerre, que... (Romulus) muri causam opposuit Cic. Off. 3, 41, (Romulus) mit en avant pour s'excuser l'incident du mur [franchi par Rémus]; ne qua esset armorum causa Cæs. C. 1, 2, 3, pour ôter tout prétexte de guerre ; per causam equitatus cogendi Cæs. G. 7, 9, 1, sous prétexte de rassembler de la cavalerie, cf. C. 3, 24, 1 ; 3, 76, 1 ; 3, 87, 4 ; per causam inopum Cic. Dom. 13, sous prétexte de défendre les pauvres, cf. Liv. 2, 32, 1 ; 22, 61, 8 ; 24, 7, 4
— bonne raison, bonne occasion : causam moriendi nactus est Cato Cic. Tusc. 1, 74, Caton trouva une bonne occasion de mourir, cf. Pomp. 3 ; Phil. 7, 6 ; Att. 15, 14, 1 ; Cæs. C. 2, 28, 2
— causā [prép., placée après son régime au gén.] à cause de, en vue de : honoris causa, pour honorer, par honneur : vestra reique publicæ causa Cic. Verr. 5, 173, dans votre intérêt comme dans l'intérêt général
— [rarement avant gén.] Enn. An. 319 ; Ter. Eun. 202 ; Cic. Læ. 59 ; Liv. 40, 41, 11
— [qqf. = propter] Cæs. G. 6, 40, 7 ; C. 1, 33, 1 ; Cic. Leg. 2, 58 ; de Or. 3, 58.
II. affaire où sont en cause des intérêts
¶1. [en part.] affaire judiciaire, procès, cause : genera causarum Cic. Part. 70, genres de causes ; magistratus aliqui reperiebatur apud quem Alfeni causa consisteret Cic. Quinct. 71, on trouvait quelque magistrat, devant qui la cause d'Alfénus fût évoquée ; ex quo verbo lege Appuleia tota illa causa pendebat Cic. de Or. 2, 107, c'est sur l'application de ce mot [lèse-majesté] que, en vertu de la loi Appuléia, toute cette affaire roulait ; causam accipere Cic. de Or. 2, 114 ; aggredi Cic. Fin. 4, 1 ; amplecti Cic. Sest. 93 ; attingere Cic. Mur. 3 ; defendere Cic. Mur. 7, se charger d'une cause, la prendre en mains, la défendre ; causam agere, dicere, v. ces verbes ; causam amittere Cic. de Or. 2, 100, perdre un procès (en laisser échapper le succès); causam perdere Cic. Com. 10, perdre un procès (en causer l'insuccès); causa cadere Cic. de Or. 167, perdre son procès ; in optima causa mea Cic. de Or. 3, 19, alors que j'avais une cause très bonne (très forte); causas capitis aut famæ ornatius (agimus) Cic. Fam. 9, 21, 1, nous traitons les causes qui intéressent la vie ou la réputation avec plus d'ornement
— cause, objet du procès : ut aliquando ad causam crimenque veniamus Cic. Mil. 23, pour en venir enfin à l'objet du procès et au chef d'accusation, cf. Planc. 17
— [en gén.] objet de discussion, thème, v. Cic. Top. 79 ; 80 ; Quint. 3, 5, 7
¶2. [en gén.] cause, affaire, question : qui et causam et hominem probant Cæs. G. 6, 23, 7, ceux qui donnent leur assentiment à la fois à l'affaire et à l'homme ; cui senatus dederat publicam causam, ut mihi gratias ageret Cic. Verr. 3, 170, à qui leur sénat avait confié la mission officielle de me remercier ; hæc causa Cic. Cat. 4, 15, cette affaire ; causa quæ sit, videtis Cic. Pomp. 6, vous voyez quel est l'état de la question ; de mea causa omnes di atque homines judicarunt Cic. Dom. 44, sur mon affaire, tous les dieux et les hommes ont prononcé ; Tyndaritanorum causa Cic. Att. 15, 2, 4, l'affaire des Tyndaritains ; in causa hæc sunt Cic. Fam. 1, 1, 1, dans l'affaire en question voici où en sont les choses ; de Scipionis causa Liv. 29, 20, 1, sur le point concernant Scipion
— cas, situation, position : dissimilis est militum causa et tua Cic. Phil. 2, 59, le cas des soldats est tout différent du tien ; in eadem causa esse Cic. Off. 1, 112, être dans le même cas, cf. Cæs. G. 4, 4, 1 ; Cic. Sest. 87 ; Marc. 2, etc. ; eadem nostra causa est Cic. de Or. 2, 364, ma situation est la même [je puis en dire autant]; ad me causam rei publicæ periculaque rerum suarum detulerunt Cic. Pomp. 4, ils m'ont rapporté l'état de la chose publique et les dangers de leurs propres affaires ; soluta prædia meliore in causa sunt quam obligata Cic. Agr. 3, 9, les terres affranchies de charges jouissent d'une condition plus favorable que celles qui en sont grevées ; mei consilii negotiique totius suscepti causam rationemque proposui Cic. Verr. 4, 140, j'exposai l'état et l'économie de mes projets ainsi que de toute l'affaire entreprise
— situation (rapports) entre personnes, liaison : causa necessitudinis intercedit alicui cum aliquo Cic. Cæcil. 6, des rapports (des liens) d'intimité existent entre une personne et une autre, cf. Sull. 23 ; Fam. 13, 49, 1 ; Cæs. G. 1, 43, 6 ; causam amicitiæ habere cum aliquo Cæs. G. 5, 41, 1, avoir des relations d'amitié avec qqn (Cic. Fam. 13, 46)
— quicum tibi omnes causæ et necessitudines veteres intercedebant Cic. Quinct. 48, avec lequel tu avais de longue date tous les rapports et toute l'intimité possibles, cf. Fam. 10, 10, 2 ; 13, 4, 1 ; 13, 29, 1, etc.
— cause, parti : causa nobilitatis Cic. Amer. 135, la cause de la noblesse ; causam rei publicæ legumque suscipere Cic. Cæcil. 9, prendre en mains la cause de la chose publique et des lois ; cur causam populi Romani deseruisti ac prodidisti ? Cic. Verr. 1, 84, pourquoi as-tu déserté et trahi la cause du peuple romain ? Sullæ causa Cic. Phil. 5, 43, le parti de Sylla ; causam solum illa causa non habet Cic. Att. 7, 3, 5, il n'y a qu'une cause qui manque à cette cause, il ne manque à ce parti qu'une (raison justificative) bonne cause ; causæ popularis aliquid attingere Cic. Br. 160, soutenir un peu la cause démocratique
— [t. médec.] cas, maladie : utilissimum est ad omnes causas... Plin. 28, 218, il est souverain pour tous les cas de... ; origo causæ Cels. 1, proœm., l'origine du cas [de la maladie], cf. Sen. Ir. 3, 10, 3.
¶1. malade, infirme [v. causa fin] : causarium hoc corpus Sen. Nat. 1 Præf. 4, ce corps infirme ; causarii dentes Plin. 23, 75, dents malades (gâtées)
— [pris subst] : causarius faucibus Plin. 25, 61, celui qui souffre de la gorge
¶2. invalide : ex causariis scribatur exercitus Liv. 6, 6, 14, que l'on compose un corps des soldats réformés
— qui a pour cause l'invalidité : missio causaria Ulp. Dig. 3, 2, 2, congé de réforme.
¶1. prétexte : causatio ægri corporis Gell. 20, 1, 30, excuse de la maladie
— indisposition : Pall. 1, 4, 1
¶2. accusation, plainte : Aug. Manich. 6, 2.
¶1. causal, causatif : Capel. 7, 731
— subst. n., causativum litis, fondement juridique de la cause : Fortun. Rhet. 1, 2
¶2. [gram.] : casus causativus, l'accusatif : Prisc. 5, 72.
¶1. chapeau macédonien : Pl. Mil. 1178 ; V.-Max. 5, 1

¶2. mantelet [machine de guerre] : Veg. Mil. 4, 15.
===> actif causare Cassiod. *Orth. 7, 149
— sens passif Firm. Math. 8, 27 ; Tert. Marc. 2, 25.
¶1. défiance, précaution : Pl. Mil. 603 ; Apul. M. 2, 6
¶2. protection, défense : Min. Fel. 7, 6
— caution : Ulp. Dig. 3, 3, 15
— cautēlĭtās, ātis, Ennod. Ep. 8, 8.
¶1. fer à cautériser, fer chaud : Pall. 1, 41, 2
— [fig.] cauterem adigere ambitioni Tert. Pall. 5, stigmatiser l'ambition
¶2. fer à brûler (torture) : Prud. Peri. 10, 490
— brûlure faite par ce fer : Prud. Peri. 5, 229.
¶1. fer à cautériser, cautère : Veg. Mul. 1, 14, 3
— moyen de cautériser : Plin. 25, 80
¶2. réchaud employé pour la peinture à l'encaustique : Marc. Dig. 33, 7, 17.
¶1. action de se tenir sur ses gardes, précaution : mea cautio et timiditas Cic. de Or. 2, 300, mes précautions et ma circonspection ; horum una cautio est ut Cic. Læ. 78, il n'y a qu'un moyen de se prémunir là contre, c'est de ; mihi cautio est Pl. Bac. 597, il faut que je prenne garde ; mea cautio est Cic. Att. 5, 4, 4, c'est à moi de veiller à ; hoc habet multas cautiones Cic. Off. 1, 42, cela demande sur bien des points de la prudence ; cautionem non habere Cic. Fam. 11, 21, 3, ne pas comporter de prudence, être inévitable
¶2. caution, garantie : in juris scientia est cautionum præceptio Cic. Or. 131, le droit enseigne les garanties légales ; cautio chirographi mei Cic. Fam. 7, 18, 1, la garantie de ma signature
— reçu [d'un débiteur] : cautiones fiebant pecuniarum Cic. Dom. 129, on faisait signer des reçus de sommes
— engagement : hunc Pompeius omni cautione devinxerat [avec prop. inf.] Cic. Sest. 25, Pompée avait obtenu de lui toutes les promesses possibles, garantissant que...
¶1. homme de précaution : Pl. Capt. 256
¶2. celui qui garantit : cautor alieni periculi Cic. Sest. 15, celui qui garantit autrui du danger.
I. part. de caveo.
II. pris adjt
¶1. entouré de garanties, sûr, qui est en sécurité : quo mulieri esset res cautior Cic. Cæc. 11, pour que la fortune de sa femme fût plus en sûreté ; pars quæ est cautior Cic. Amer. 56, le parti qui est le plus sûr des deux ; cautus ab incursu belli Luc. 4, 409, garanti contre les assauts de la guerre
¶2. qui se tient sur ses gardes, défiant, circonspect, prudent : parum putantur cauti fuisse Cic. Amer. 117, ils passent pour avoir manqué de prévoyance ; cautus in verbis serendis Hor. P. 46, qui crée des mots avec circonspection, cf. Cic. Q. 3, 9, 3 ; ad malum propius cautior Liv. 24, 32, 3, se tenant en garde surtout contre le danger immédiat ; cautus adversus fraudem Liv. 38, 25, 7, qui se défie d'un piège ; c. assumere dignos Hor. S. 1, 6, 51, attentif à ne prendre que des gens méritants ; c. rei divinæ Macr. S. 1, 15, 8, fidèle aux prescriptions religieuses
— cautum consilium Cic. Phil. 13, 6, conseil prudent ; cautissima Tiberii senectus Tac. A. 2, 76, la vieillesse si défiante de Tibère
— cauteleux, rusé, fin : cauta vulpes Hor. Ep. 1, 1, 73, le renard matois.

¶1. part. de cavo
¶2. pris adjt, creux : rupes cavata Virg. En. 3, 229, caverne ; cavati oculi Lucr. 6, 1194, yeux caves
— cavatior Tert. Herm. 29.
¶1. cavité : Plin. 11, 3
— intérieur de la bouche : Prud. Cath. 3, 94
— orbite de l'œil : Lact. Mort. 40, 5
¶2. enceinte où sont renfermés des animaux : [cage pour les fauves] Hor. P. 473 ; Suet. Cal. 27, 3 ; [cage pour les oiseaux] Cic. Div. 2, 73 ; [ruche] Virg. G. 4, 58
— treillage dont on entoure un jeune arbre : Col. 5, 6, 21

¶3. partie du théâtre ou de l'amphithéâtre réservée aux spectateurs : qui clamores tota cavea ! Cic. Læ. 24, quelles clameurs sur tous les bancs ! servos de cavea exire jubebant Cic. Har. 26, ils mettaient les esclaves à la porte du théâtre ; cavea prima, ultima Cic. CM 48, le premier rang, le fond du théâtre
— [fig.] le théâtre, les spectateurs : Sen. Tranq. 1, 1, 8 ; Stat. Th. 1, 423.
¶1. emprisonné, enfermé : Plin. 9, 13
¶2. disposé en amphithéâtre [en parl. d'une ville] : Plin. 4, 30.
¶1. être sur ses gardes, prendre garde : illum monere, ut caveret Cic. Amer. 110, il l'avertissait de se tenir sur ses gardes
— [avec ab] : ab aliquo Cic. Sest. 133, se défier de qqn ; hortatur ab eruptionibus caveant Cæs. C. 1, 21, 4, il les exhorte à se tenir en garde contre les sorties des assiégés
— [avec cum] : mihi tecum cavendum est Pl. Most. 1142, je dois être sur mes gardes avec toi (Ps. 909)
— [avec de] : de aliqua re Cic. Inv. 2, 152 ; Pl. Men. 931, prendre garde à qqch
— [avec abl.] Pl. Bacch. 147 ; Rud. 828, etc.
— [avec acc.] se garder de, éviter : inimicitias Cic. Amer. 17, se précautionner contre les haines ; vallum cæcum fossasque Cæs. C. 1, 28, 4, se garder des trous de loup et des fossés ; caveamus Antonium Cic. Phil. 11, 10, gardons-nous d'Antoine ; cavenda est gloriæ cupiditas Cic. Off. 1, 68, il faut se défier de la passion de la gloire ; huic simile vitium in gestu caveatur Cic. Off. 1, 130, il faut se garder d'un défaut semblable dans le geste ; cave canem Varr. Men. 75, prends garde au chien
— [avec le subj.] : cave putes Cic. Rep. 1, 65, garde-toi de croire ; cave quicquam habeat momenti gratia ! Cic. Mur. 62, prends garde que le crédit n'exerce la moindre influence, cf. Lig. 14 ; cavete quisquam supersit Liv. 24, 38, 7, prenez garde de laisser échapper qqn
— [avec ne] : cavete ne spe præsentis pacis perpetuam pacem amittatis Cic. Phil. 7, 25, prenez garde que l'espoir d'une paix présente ne vous fasse perdre une paix indéfinie ; hoc, quæso, cave ne te terreat Cic. Ac. 2, 63, que cela, je t'en prie, ne t'épouvante pas ; caves ne tui consultores capiantur Cic. Mur. 22, tu prends garde que tes clients ne soient victimes d'une surprise ; nihil magis cavendum est senectuti quam ne languori se desidiæque dedat Cic. Off. 1, 123, il n'est rien dont la vieillesse doive se garder davantage que de s'abandonner à la langueur et à l'inertie
— [avec ut ne] Cic. Q., 1, 1, 38 ; Læ. 99
— [avec inf.] *Cic. Att. 3, 17, 3 ; Sall. J. 64, 2 ; Catul. 50, 21 ; Virg. B. 9, 25 ; Ov. P. 3, 1, 139 ; commisisse cavet quod mox mutare laboret Hor. P. 168, il est attentif à n'avoir rien commis qu'il s'efforce à changer ensuite
¶2. avoir soin de, veiller sur ; [avec dat.] : ipse sibi cavit loco Ter. Eun. 782, il s'est ménagé lui-même par la place qu'il a choisie ; in Oratore tuo caves tibi per Brutum Cæcin. Fam. 6, 7, 4, dans ton Orator tu te mets à couvert à la faveur de Brutus ; Roma, cave tibi Liv. 35, 21, 4, Rome, prends garde à toi
— veteranis cautum esse volumus Cic. Phil. 2, 59, nous voulons ménager les vétérans ; caves Siculis Cic. Verr. 3, 26, tu prends soin des Siciliens ; minuitur gloria ejus officii, cui diligenter cautum est Sen. Ben. 3, 13, 2, elle s'amoindrit, la gloire d'un service qu'on a entouré avec soin de garanties
— [avec ut] avoir soin que, prendre ses mesures (précautions) pour que : Cic. Off. 1, 141 ; Liv. 3, 10, 14 ; 27, 24, 8 ; caverat sibi... ut Cic. Pis. 28, il avait pris ses précautions dans son intérêt pour que
¶3. [t. de droit] prendre toutes les précautions utiles, comme jurisconsulte, au nom du client ; veiller à ses intérêts au point de vue du droit : ad respondendum et ad agendum et ad cavendum peritus Cic. de Or. 1, 212, qui sait à la fois donner des consultations, guider dans une action judiciaire, et prendre toutes sûretés en droit, cf. Cæc. 78 ; Mur. 19 ; Leg. 1, 17 ; Off. 2, 65
— prendre des sûretés pour soi-même : sibi cavere Cic. Com. 35, prendre ses sûretés ; cavere ab aliquo ut Liv. 24, 2, 5, prendre ses sûretés à l'égard de qqn en stipulant que
— [avec prop. inf.] : rogant eum, ut ab sese caveat quemadmodum velit... neminem esse acturum Cic. Verr. 2, 55, ils lui demandent de prendre à leur égard telle sûreté qu'il voudra comme garantie que personne n'intentera d'action..., cf. Brut. 18
— donner des sûretés, des garanties à autrui au moyen de qqch : prædibus et prædiis populo cautum est Cic. Verr. 1, 142, le peuple a des garanties dans les cautions et les immeubles (est à couvert grâce aux personnes qui se portent caution et grâce aux biens-fonds qui servent de garantie), cf. Att. 5, 21, 12 ; Liv. 22, 60, 4 ; Tac. An. 6, 17 ; obsidibus de pecunia cavent Cæs. G. 6, 2, 2, au sujet de la somme qu'ils doivent, ils donnent des otages en garantie, cf. Suet. Cal. 12 ; obsidibus cavere inter se Cæs. G. 7, 2, 2, échanger des otages pour se donner une garantie mutuelle
— prendre des dispositions pour qqch au moyen d'une loi [avec dat.] : his (agris) cavet Cic. Agr. 3, 12, voilà les champs qu'il protège par sa loi (auxquels il veille) ; lex altera ipsis sepulcris cavet Cic. Leg. 2, 61, la seconde loi veille sur les sépultures mêmes
— cavere ut, disposer que, stipuler que : Cic. Agr. 2, 62 ; Leg. 2, 51 ; cautum est in Scipionis legibus ne plures essent... Cic. Verr. 2, 123, il y a dans les lois de Scipion une disposition qui interdit qu'il y ait un plus grand nombre... ; [avec de] Cic. Inv. 2, 119 ; 2, 135
— [avec acc.] : non omnia scriptis, sed quædam, quæ perspicua sint, tacitis exceptionibus caveri Cic. Inv. 2, 140, [il dit] que toutes les exceptions ne figurent pas dans les textes, mais que certaines, qui sont évidentes, sont stipulées implicitement
— prendre des dispositions par un traité pour qqn, sur qqch : si Hiempsali satis est cautum fœdere Cic. Agr. 1, 10, si dans le traité il y a eu des dispositions suffisantes en faveur d'Hiempsal ; regi amico cavet (fœdus) Cic. Agr. 2, 58, (le traité) garantit les possessions d'un roi ami ; (agri) de quibus cautum est fœdere Cic. Agr. 1, 10, (les terres) comprises dans les stipulations d'un traité, cf. Balb. 37 ; Liv. 21, 18, 8 ; absurda res est caveri fœdere, ut Cic. Balb. 37, il est absurde que dans un traité il y ait un article stipulant que
— prendre des dispositions en faveur de qqn au moyen d'un testament : cavere alicui Cic. Inv. 2, 120 ; Verr. 1, 123 ; Clu. 162 ; quid ? verbis hoc satis erat cautum ? Cic. Cæc. 53, eh quoi ! cette clause était-elle exprimée de façon assez explicite ? id testamento cavebit ? Cic. Fin. 2, 102, réglera-t-il, ordonnera-t-il cela dans son testament ? testamento cavere ut Cic. Fin. 2, 103, ordonner par son testament de...
===> cavitum = cautum CIL 1, 200, 6 ; căvĕ au lieu de căvē Hor. S. 2, 3, 38, etc.
¶1. cavité, ouverture : cavernæ terræ Lucr. 6, 597, les cavernes souterraines, cf. Cic. Nat. 2, 151 ; cavernæ navium Cic. de Or. 3, 180, cales des navires ; cavernæ arboris Gell. 15, 16, 3, fentes d'un arbre
— pl., bassins, réservoirs : Curt. 5, 1, 28
— [en part.]
a) trou, tanière d'un animal : Plin. 22, 72 ;
b) orifices du corps : Plin. 8, 218
¶2. [fig.] la cavité que forme la voûte du ciel : Lucr. 4, 171 ; 4, 391 ; Cic. Arat. 252 ; Varr. Men. 270 ; cf. Serv. En. 2, 19.
¶1. plaisanterie, baliverne : aufer cavillam Pl. Aul. 638, trêve de plaisanterie
¶2. sophisme : Capel. 4, 423.
¶1. badinage, enjouement : cavillatio, genus facetiarum in omni sermone fusum Cic. de Or. 2, 218, l'enjouement est un ton plaisant répandu dans l'ensemble des propos
¶2. subtilité, sophisme : cavillatio verborum infelix Quint. 10, 7, 14, stérile chicane de mots, cf. Cic. d. Sen. Ep. 111, 1 ; Sen. Ben. 2, 17.
¶1. badin, plaisant : Pl. Mil. 642 ; Cic. Att. 1, 13, 2
¶2. sophiste : Sen. Ep. 102, 20.
¶1. plaisanter, dire en plaisantant, se moquer de : cum eo cavillor Cic. Att. 2, 1, 5, je plaisante avec lui ; cavillans vocare... Liv. 2, 58, 9, il appelait ironiquement...
— cavillari rem Cic. Q. 2, 10, 2, plaisanter sur qqch ; [avec prop. inf.] dire en plaisantant que : Cic. Nat. 3, 83
¶2. user de sophismes : cavillari tum tribuni Liv. 3, 20, 4, alors les tribuns de chercher chicane, cf. Sen. Ben. 7, 4, 8 ; Ep. 64, 3
— hæc cavillante Appio Liv. 9, 34, 1, Appius tenant ce raisonnement sophistique ; [avec prop. inf.] Plin. 11, 267.
===> .
¶1. creuser : lapidem cavare Lucr. 1, 313, creuser la pierre ; luna cavans cornua Plin. 8, 63, la lune à son déclin [qui creuse son disque]
— cavare parmam gladio Ov. M. 12, 130, percer un bouclier d'un coup d'épée
¶2. faire en creusant : naves ex arboribus Liv. 21, 26, 8, creuser des navires dans des arbres ; [poét.] arbore lintres Virg. G. 1, 262, creuser des cuves dans le bois.
¶1. creux, creusé, profond : cava ilex Virg. B. 1, 18, chêne creux ; cava manus Tib. 2, 4, 14, le creux de la main ; cava dolia Tib. 1, 3, 80, tonneaux sans fond ; cava flumina Virg. G. 1, 326, fleuves profonds
¶2. [fig.]
a) qui n'est pas plein : cavi menses Censor. 20, 3, mois creux [de 30 jours, par opp. aux mois pleins, de 31 jours] ;
b) vide, vain, sans consistance : cava imago Virg. En. 6, 293, fantôme sans consistance ; nubes cava Virg. En. 1, 516, nuage léger
— [fig.] opibus inflati cavis P.-Nol. Carm. 21, 912, enflés de leurs vaines richesses.

¶1. second fils d'Ismaël : Vulg. Gen. 25, 13
¶2. ville de l'Arabie Pétrée : Vulg. Jer. 2, 10.
I. int.
¶1. aller, marcher, s'avancer : Enn. An. 93 ; Pl. Aul. 517 ; 526 ; Cas. 446, etc. ; Hor. S. 2, 1, 65
¶2. s'en aller, se retirer : cedebas, Brute, cedebas, quoniam Stoici nostri negant fugere sapientes Cic. ad Brut. 1, 15, 5, tu te retirais, Brutus, tu te retirais, puisque nos Stoïciens prétendent que les sages ne fuient pas ; equites cedunt Cæs. G. 5, 50, 5, les cavaliers se retirent ; suis cedentibus auxilio succurrere Cæs. G. 7, 80, 3, se porter au secours des leurs quand ils pliaient ; cedit rerum novitate extrusa vetustas semper Lucr. 3, 964, le vieux chassé par le nouveau toujours cède la place
— alicui, se retirer devant qqn, céder, plier : Viriatho exercitus nostri cesserunt Cic. Off. 2, 40, nos armées ont plié devant Viriathe, cf. Font. 35 ; Mur. 53 ; Sull. 25 ; Pis. 20, etc.
— loco cedere Cæs. C. 2, 41, 4, abandonner sa position, lâcher pied ; Italia Cic. Att. 7, 12, 4, se retirer de l'Italie ; patria Cic. Mil. 68, quitter sa patrie ; ex loco Liv. 3, 63, 1 ; ex acie Liv. 2, 47, 2 ; ex civitate Cic. Mil. 81 ; e patria Cic. Phil. 10, 8, quitter, abandonner son poste, le champ de bataille, sa cité, sa patrie ; e vita Cic. Br. 4 (vita Cic. Tusc. 1, 35), quitter la vie ; [avec de] Lucr. 2, 999 ; 3, 223 ; Cic. Att. 7, 22, 2
— [avec ab] Virg. En. 3, 447 ; Ov. P. 1, 3, 75
— [fig.] céder, ne pas résister : fortunæ Cæs. G. 7, 89, 2, céder à la fortune, s'incliner devant la nécessité ; tempori Cic. Mil. 2, céder aux circonstances, cf. Fam. 4, 9, 2 ; Sest. 63 ; Cat. 1, 22 ; precibus Cic. Planc. 9, céder aux prières ; numquam istius impudentiæ cessit Cic. Flacc. 50, jamais il n'a plié devant son impudence
— céder le pas, se reconnaître inférieur : cum tibi ætas nostra jam cederet Cic. Br. 22, alors que mon âge déjà te cédait le pas ; alicui aliqua re, le céder à qqn en qqch : Cic. Or. 110 ; Nat. 2, 153 ; Cæs. C. 2, 6, 3, etc. (in aliqua re Cic. Leg. 1, 5 ; Fin. 1, 8) ; cedant arma togæ Cic. Phil. 2, 20, que les armes le cèdent à la toge
— faire cession (abandon) de, aliqua re de qqch : Cic. Off. 2, 82 ; Liv. 3, 14, 2, etc. ; alicui aliqua re, à qqn de qqch ; utrique mortem est minitatus nisi sibi hortorum possessione cessissent Cic. Mil. 75, il les menaça de mort l'un et l'autre, s'ils ne lui faisaient cession de leurs jardins, cf. Att. 13, 41, 1 ; Liv. 24, 6, 8 ; 3, 45, 2, etc.
— s'en aller, disparaître : horæ cedunt Cic. CM 69, les heures s'en vont, passent ; ut primum cessit furor Virg. En. 6, 102, aussitôt que son délire fut tombé ; non audaci cessit fiducia Turno Virg. En. 9, 126, la confiance n'abandonna pas l'audacieux Turnus ; ut... Postumum Cominium bellum gessisse cum Volscis memoria cessisset Liv. 2, 33, 9, au point qu'il fût sorti de la mémoire (on eût oublié) que Postumus Cominius avait fait la guerre contre les Volsques
¶3. aller, arriver, échoir : quæstus huic cedebat Cic. Verr. 2, 170, le bénéfice allait à Verrès ; præda ex pacto Romanis cessit Liv. 26, 26, 3, le butin d'après le traité revint aux Romains ; urbs regi, captiva corpora Romanis cessere Liv. 31, 46, 16, la ville échut en partage au roi, les captifs aux Romains ; prædæ alia militum cessere Liv. 43, 19, 12, le reste alla au butin des soldats, devint la proie des soldats ; cetera armentorum pabulo cedunt Curt. 7, 4, 26, le reste du sol revient (est affecté) aux pâturages pour les troupeaux ; aurum in paucorum prædam cessit Liv. 6, 14, 12, l'or est devenu la proie de quelques hommes, cf. Sen. Const. 5, 6 ; Curt. 7, 6, 16 ; Tac. An. 15, 45 ; in imperium Romanum cedere Liv. 1, 52, 2, passer au pouvoir des Romains ; omnes in unum cedebant Tac. An. 6, 43, tous se ralliaient au même pouvoir [à lui]
— in aliquid, se changer en qqch, tourner en : in deteriores, in meliores partes Lucr. 2, 508, tourner au pire, au mieux ; calamitates in remedium cessere Sen. Tranq. 9, 3, des malheurs sont devenus salutaires ; pœna in vicem fidei cesserat Liv. 6, 34, 2, le châtiment tenait lieu de l'acquittement de la dette [du paiement] : temeritas in gloriam cesserat Curt. 3, 6, 18, la témérité avait abouti à la gloire ; hoc quoque in tuam gloriam cedet, eos ad summa vexisse, qui et modica tolerarent Tac. An. 14, 54, cela aussi tournera à ta gloire (cela deviendra pour toi un titre de gloire d'avoir...) que tu aies amené aux sommets les plus élevés des gens capables de supporter même la médiocrité
— pro aliqua re, tenir lieu de qqch : oves quæ non pepererint binæ pro singulis in fructu cedent Cat. Agr. 150, 2, deux brebis stériles passeront pour une féconde (seront comptées pour); epulæ pro stipendio cedunt Tac. G. 14, les repas tiennent lieu de solde
— [avec un adv. de manière] aller, arriver, se passer : Catilinæ neque petitio neque insidiæ prospere cessere Sall. C. 26, 5, pour Catilina ni sa candidature ni ses embûches n'eurent un heureux résultat ; secus cedere Sall. J. 20, 5, mal tourner, échouer ; [impers.] si male cesserat Hor. S. 2, 1, 31, s'il était arrivé qqch de fâcheux ; [cedere seul = bene cedere, réussir : Virg. En. 12, 148] ; cum opinione tardius cederet (venenum) Suet. Ner. 33, comme (le poison) agissait (opérait) plus lentement qu'on ne pensait ; utcumque cessura res est Curt. 7, 1, 37, quel que doive être le résultat.
II. tr., céder, concéder : multa multis de suo jure Cic. Off. 2, 64, abandonner à beaucoup beaucoup de son droit ; ut gratiosi scribæ sint in dando et cedendo loco Cic. Br. 290, que les scribes se montrent obligeants à donner une place et céder la leur ; cedebant nocte hospitibus sævis cubilia Lucr. 5, 986, ils cédaient la nuit leurs couches à ces hôtes farouches
— [avec ut] concéder que, accorder que : Liv. 9, 42, 3 ; Tac. An. 12, 41 ; non cedere quominus Quint. 5, 7, 2, admettre que
— [av. prop. inf.] Tert. Idol. 17.
¶1. donne, montre, présente : cedo senem Ter. Phorm. 321, donne-moi le vieux, le bonhomme, cf. 936 ; Andr. 730, etc. ; Pl. Mil. 355, etc. ; Cic. Verr. 3, 96 ; cedo argentum Pl. Pers. 422, donne l'argent ; cedo mihi ipsius Verris testimonium Cic. Verr. 1, 84, montre-moi le témoignage de Verrès lui-même, cf. Verr. 2, 104 ; 3, 99 ; 3, 117 ; 5, 56, etc.
¶2. dis, parle : cedo, num barbarorum rex Romulus fuit ? Cic. Rep. 1, 58, voyons, Romulus était-il roi chez des barbares ? cedo, quid postea ? Cic. Mur. 26, voyons, qu'y a-t-il ensuite ?
— [avec interr. indir.] : cedo, cui Siculo civis Romanus cognitor factus umquam sit Cic. Verr. 2, 106, indique à quel Sicilien un citoyen romain a jamais servi de mandataire ? cf. Vat. 30 ; Div. 2, 146
— [avec acc ] : unum cedo auctorem tui facti Cic. Verr. 5, 67, cite un seul garant (précédent) de ton acte, cf. Verr. 3, 29 ; Fin. 2, 25 ; Att. 9, 18, 3
¶3. [simple exhortation] allons, voyons : cedo, nuptias adorna Pl. Aul. 157, allons, prépare les noces ; cedo, consideremus Gell. 17, 1, 3, allons, considérons
— cedo dum, donne donc, parle donc, voyons donc : Pl. Men. 265 ; Trin. 968 ; Ter. Phorm. 329.
¶1. fruit du cèdre : Plin. 24, 20
¶2. = frutex [en Phrygie] : Plin. 13, 54.
¶1. [en parl. de lieux] : très fréquenté, très peuplé : tam celebri loco Cic. Mil. 66, dans un endroit si fréquenté ; in æde Castoris, celeberrimo clarissimoque monumento Cic. Verr. 1, 129, dans le temple de Castor ce monument si fréquenté et si illustre ; Antiochiæ, celebri quondam urbe et copiosa Cic. Arch. 4, à Antioche, ville autrefois très peuplée et riche ; oraculum tam celebre et tam clarum Cic. Div. 1, 37, oracle si consulté et si célèbre
¶2. [en parlant de fêtes] : célébré [fêté] par une foule nombreuse : dies festus ludorum celeberrimus et sanctissimus Cic. Verr. 4, 151, le jour de fête célébré par des jeux qui attirait le plus la foule et était le plus vénéré ; funus magis amore civium quam cura suorum celebre Liv. 24, 4, 8, funérailles où l'affluence montrait plus l'affection des citoyens que la sollicitude de la famille ; (dies) quos in vita celeberrimos lætissimosque viderit Cic. Læ. 12, (jours) qu'au cours de sa vie il a pu voir les plus fêtés et les plus heureux ; celeberrima populi Romani gratulatio Cic. Phil. 14, 16, félicitation de la masse du peuple romain
— festos dies agunt celeberrimo virorum mulierumque conventu Cic. Verr. 4, 107, ils célèbrent des jours de fête au milieu d'un concours immense d'hommes et de femmes
¶3. cité souvent et par un grand nombre de personnes, très répandu : clara res est, tota Sicilia celeberrima atque notissima Cic. Verr. 3, 61, le fait est patent, répandu et connu au plus haut point dans toute la Sicile ; Valerius Antias auctor est rumorem celebrem Romæ fuisse... Liv. 37, 48, 1, au dire de Valérius Antias, une nouvelle s'était répandue à Rome...
— [d'où en parl. d'un nom] fêté, célébré, en vogue : Meneni celebre nomen laudibus fuit Liv. 4, 53, 12, le nom de Ménénius fut vanté à l'infini ; cum haud minus tribuni celebre nomen quam consulum esset Liv. 7, 38, 3, le nom du tribun n'étant pas moins fêté (célébré) que celui des consuls, cf. 6, 9, 8 ; 21, 39, 8 ; 27, 40, 6
¶4. [en parl. de pers.] célèbre, illustre : Liv. 26, 27, 16, etc.; Curt. 7, 4, 8, etc.; Sen. Ep. 40, 10, etc.; Plin. 3, 23, etc.
¶5. qui se rencontre fréquemment : lapis celeber trans maria Plin. 34, 2, pierre très répandue au-delà des mers.
===> la forme du masc. celebris se trouve dans Her. 2, 7 ; Mel. 1, 13, 1 ; Tac. An. 2, 88, etc.; Gell. 17, 21, 10 ; Apul. M. 2, 12.
===> .
¶1. affluence : quæ domus celebratio cotidiana ! Cic. Sull. 73, quelle affluence chez lui tous les jours !
— réunion nombreuse : hominum cœtus et celebrationes obire Cic. Off. 1, 12, aller là où les gens se rassemblent en grand nombre
¶2. célébration, solennité : celebratio ludorum Cic. Att. 15, 29, 1, célébration des jeux
¶3. estime, faveur : equestres statuæ Romanam celebrationem habent Plin. 34, 19, les statues équestres sont en grand honneur à Rome.
¶1. fréquenté : forum rerum venalium totius regni maxume celebratum Sall. J. 47, 1, marché le plus fréquenté de tout le royaume
¶2. fêté par une foule nombreuse : adventus dictatoris celebratior quam ullius umquam antea fuit Liv. 5, 23, 4, l'arrivée du dictateur rassembla plus de foule que celle d'aucun autre auparavant ; nullus celebratior illo dies Ov. M. 7, 430, pas de jour plus fêté que celui-là
¶3. cité souvent et par beaucoup de personnes, publié, répandu : scio me in rebus celebratissimis omnium sermone versari Cic. Phil. 2, 57, je sais que je m'occupe de faits qui sont l'objet général de toutes les conversations ; celebratis versibus laudata (bucula Myronis) Plin. 34, 57, (la vache de Myron) célébrée dans des vers bien connus
— avus nulla illustri laude celebratus Cic. Mur. 16, aïeul, dont aucun mérite éclatant n'a publié le nom
¶4. honoré, vanté, fameux : artifices celebratos nominare Plin. 34, 37, citer des artistes fameux ; Haterius eloquentiæ celebratæ Tac. An. 4, 61, Hatérius, d'une éloquence renommée
¶5. qui est employé souvent : celebratior usus anulorum Plin. 33, 27, l'usage plus répandu des anneaux (mode plus générale) ; verbum celebratius Gell. 17, 2, 25, mot plus usité.
===> .
¶1. fréquentation nombreuse d'un lieu : propinquitas et celebritas loci Cic. Scaur. 45, la proximité et la fréquentation du lieu ; propter viæ celebritatem Cic. Att. 3, 14, 2, parce que la route est très fréquentée ; odi celebritatem, fugio homines Cic. Att. 3, 7, 1, je hais les lieux très fréquentés, je fuis le monde
¶2. célébration solennelle (en foule) d'un jour de fête : ludorum celebritas Cic. Verr. 5, 36, la pompe des jeux (de Or. 3, 127) ; spoliatus illius supremi diei celebritate Cic. Mil. 86, privé de la solennité de ce jour suprême [des funérailles]
¶3. extension, diffusion parmi un grand nombre de personnes, fait d'être mentionné souvent par une foule : quam celebritatem sermonis hominum consequi potes ? Cic. Rep. 6, 20, à quelle diffusion peux-tu atteindre par les propos des hommes ? hac tanta celebritate famæ Cic. Arch. 5, avec une renommée à ce point répandue ; si quis habet causam celebritatis et nominis Cic. Off. 2, 44, si qqn a des raisons d'avoir un nom répandu et glorieux
— celebritas nominis Tac. H. 2, 8 ; Plin. Ep. 9, 23, 5, large diffusion d'un nom, notoriété
¶4. grande affluence : celebritas virorum ac mulierum Cic. Leg. 2, 65, affluence des hommes et des femmes (Dom. 75) ; totius Græciæ celebritate Cic. Tusc. 5, 9, au milieu du concours de la Grèce entière ; solitudo, celebritas Cic. Att. 12, 13, 1, solitude, affluence ; in maxima celebritate atque in oculis civium vivere Cic. Off. 3, 3, vivre au milieu du plus grand concours de peuple et sous les regards des citoyens
¶5. fréquence : in multitudine et celebritate judiciorum Cic. Fam. 7, 2, 4, au milieu de ces jugements nombreux et répétés ; celebritas periculorum Tac. An. 16, 29, la fréquence des dangers
¶6. célébrité, renommée, notoriété : Gell. 6, 17, 1 ; 15, 31, 1.
¶1. fréquenter en grand nombre un lieu ou une personne : ab iis si domus nostra celebratur Cic. Mur. 70, si notre maison est fréquentée par eux ; viæ multitudine legatorum celebrabantur Cic. Sest. 131, sur les routes se pressait une foule de députés ; ideo viam munivi, ut eam tu alienis viris comitata celebrares ? Cic. Cæl. 34, ai-je construit une route pour que tu y sois sans cesse avec une escorte d'hommes qui te sont étrangers ? frequentia et plausus me usque ad Capitolium celebravit Cic. Att. 4, 1, 5, la foule et les appaudissements se pressèrent autour de moi (m'accompagnèrent) jusqu'au Capitole ; senectutem alicujus celebrare et ornare Cic. de Or. 1, 199, entourer (s'empresser autour de) et honorer la vieillesse de qqn ; sic ejus adventus celebrabantur ut Cic. Arch. 4, ses arrivées attiraient la foule à tel point que...
— cujus litteris, nuntiis celebrantur aures cotidie meæ novis nominibus gentium Cic. Prov. 22, dont les lettres et les courriers font qu'à mes oreilles se pressent chaque jour de nouveaux noms de nations ; quorum studio et dignitate celebrari hoc judicium vides Cic. Sull. 4, que tu vois avec leur zèle et leur prestige assister en foule à ce jugement
¶2. assister en foule à une fête, fêter (célébrer) en grand nombre, solennellement : festos dies ludorum Cic. Arch. 13, participer à la célébration des fêtes avec jeux publics ; celebratote illos dies cum conjugibus ac liberis vestris Cic. Cat. 3, 23, fêtez en foule ces jours-là avec vos femmes et vos enfants ; nuptias Liv. 36, 11, 2, célébrer un mariage ; hujus in morte celebranda Cic. Mur. 75, dans la célébration solennelle de sa mort ; alicujus diem natalem Suet. Cl. 11 ; Tac. H. 2, 95, célébrer l'anniversaire de qqn ; alicujus exsequias Liv. 37, 22, 2, célébrer les funérailles de qqn, rendre les derniers honneurs à qqn
— celebratur omnium sermone lætitiaque convivium Cic. Verr. 1, 66, le festin se célèbre au milieu des conversations et de la gaieté générales (Liv. 40, 14, 2)
¶3. répandre parmi un grand nombre de personnes, publier, faire connaître : ad populi Romani gloriam celebrandam Cic. Arch. 19, pour répandre partout (au loin) la gloire du peuple romain ; cum jam in foro celebratum meum nomen esset Cic. Br. 314, comme déjà mon nom était répandu sur le forum ; factum esse consulem Murenam nuntii litteræque celebrassent Cic. Mur. 89, [là où] des messages et des lettres avaient publié l'élection de Muréna au consulat ; quid in Græco sermone tam tritum atque celebratum est quam...? Cic. Flacc. 65, qu'y a-t-il dans la langue grecque d'aussi rebattu, d'aussi commun que...? ; res celebrata monumentis plurimis litterarum Cic. Rep. 2, 63, fait publié par de très nombreux monuments littéraires ; Hannibalem litteris nostris videmus esse celebratum Cic. Sest. 142, nous voyons qu'Hannibal est souvent mentionné avec honneur dans nos écrits ; omni in hominum cœtu gratiis agendis et gratulationibus habendis et omni sermone celebramur Cic. Mil. 98, dans toutes les réunions, qu'on me remercie, qu'on me félicite, qu'on échange n'importe quel propos, on ne cesse de parler de moi ; his sermonibus circumstantium celebratus Liv. 30, 13, 8, faisant ainsi les frais de la conversation des assistants
— [avec 2 acc.] : ut (eum) socium laborum non modo in sermonibus, sed apud patres et populum celebraret Tac. An. 4, 2, au point que non seulement dans ses entretiens, mais au sénat et devant le peuple, il le proclamait le compagnon de ses travaux
— répandre avec éloge, glorifier, célébrer : ab eo genere celebratus auctusque erat Sall. J. 86, 3, c'est à cette catégorie de citoyens qu'il devait sa notoriété et son élévation ; Cyrum quem maxime Græci laudibus celebrant Liv. 9, 17, 6, Cyrus, que les Grecs vantent le plus ; aliquem celebrare Hor. O. 1, 12, 2, célébrer, chanter qqn
¶4. employer souvent, pratiquer : artes Cic. de Or. 1, 2, pratiquer des arts ; apud Philonem harum causarum cognitio exercitatioque celebratur Cic. de Or. 3, 110, chez Philon, l'étude et la pratique de ces causes se font couramment, cf. de Or. 3, 197 ; Div. 1, 3 ; servorum omnium vicatim celebrabatur tota urbe discriptio Cic. Dom. 129, dans toute la ville on pratiquait le classement par quartier de tous les esclaves ; postea celebratum id genus mortis Tac. H. 2, 49, dans la suite ce genre de mort se répandit (se multiplia) ; hoc ornatus genus Cato in orationibus suis celebravit Gell. 13, 25, 12, cette figure de style, Caton l'employa souvent dans ses discours ; cum his seria ac jocos celebrare Liv. 1, 4, 9, avec eux ils partageaient constamment les occupations sérieuses et les divertissements ; celebrari de integro juris dictio Liv. 6, 32, 1, on en revint de plus belle à la pratique des poursuites judiciaires
— répandre dans l'usage : tertius modus transferendi verbi, quem jucunditas celebravit Cic. de Or. 3, 155, une troisième sorte de métaphore, dont le plaisir a répandu l'usage ; Africani cognomen Liv. 30, 45, 6, mettre en usage (rendre courant) le surnom d'Africain.
===> arch. celebrassit = celebraverit Pl. d. Non. 134, 33.
¶1. prompt, rapide, leste : face te celerem Pl. Trin. 1008, depêche-toi ; Fama pedibus celeris, Virg. En. 4, 180, la Renommée aux pieds rapides ; evadit celer ripam Virg. En. 6, 425, il franchit lestement la rive ; celerrimus Cic. Tim. 31, qui a le mouvement le plus rapide ; [av. infin.] celer sequi Hor. O. 1, 15, 18, prompt à suivre ; [av. gén. gérond.] celer nandi Sil. 4, 585, rapide à la nage
¶2. [fig.] prompt, rapide, vif : mens, qua nihil est celerius Cic. Or. 200, l'esprit, que rien ne surpasse en promptitude ; oratio celeris et concitata Cic. de Or. 2, 88, style vif et rapide ; [av. infin.] celer irasci Hor. Ep. 1, 20, 25, prompt à la colère
¶3. hâtif : fata celerrima Virg. En. 12, 507, le trépas le plus prompt ; nimis celeri desperatione rerum Liv. 21, 1, 5, par l'effet d'un désespoir trop prompt
¶4. bref [en parl. de syllabes] : tres celeres Quint. 9, 4, 111, trois brèves.
===> arch. celeris, m., Cat. d. Prisc. 7, 57 ; celer, f., L. Andr. ibid. ; gén. pl. celerum [au lieu de celerium] C.-Aur. Acut. 2, 1, 1
— celerissimus Enn. d. Prisc. ibid.
===> .
¶1. tr., faire vite, accélérer, hâter, exécuter promptement : celerare fugam Virg. En. 9, 378, fuir précipitamment ; hæc celerans Virg. En. 1, 656, se hâtant d'exécuter ces ordres ; celerandæ victoriæ intentior Tac. A. 2, 5, plus occupé de hâter la victoire
¶2. int., se hâter : Tac. An. 12, 64 ; H. 3, 5
— se hâter d'aller : Catul. 63, 21
— [av. infin.] celerant in te consumere nomen Aus. Mos. 353, ils se hâtent d'absorber en toi leur nom.
¶1. cheval de course : Plin. 34, 19
¶2. bateau rapide, yacht : Plin. 7, 208.
¶1. chant en mesure [qui règle les mouvements des rameurs] : cani remigibus celeuma per symphoniacos solebat et per assam vocem Ps. Asc. Cic. Div. in Cæc. 55, la mesure était donnée aux rameurs par des musiciens et par la voix seule
¶2. chant rythmant divers travaux : Hier. Isai. 5, 10 ; Aug. Monach. 17, 20.
¶1. endroit où l'on serre qqch, grenier, magasin : cella vinaria, olearia, penaria Cic. CM 56, cellier à vin, à huile, garde-manger ; emere frumentum in cellam Cic. Verr. 3, 202, acheter du blé pour son approvisionnement personnel
— [fig.] cella penaria rei publicæ nostræ (Sicilia) Cat. d. Cic. Verr. 2, 5, la Sicile est le grenier à blé de Rome

¶2. petite chambre, chambrette : concludere se in cellam aliquam Ter. Ad. 552, s'enfermer dans quelque réduit ; cellæ servorum Cic. Phil. 2, 67, réduits des esclaves ; cella pauperis Sen. Ep. 18, 7 ; 100, 6, le réduit du pauvre [chambre misérable que les riches avaient dans leurs demeures luxueuses pour y faire une sorte de retraite par raffinement, cf. Sen. Helv. 12, 3], cf. Mart. 3, 48
¶3. salle de bains : Plin. Ep. 2, 17, 11
¶4. partie du temple où se trouvait la statue du dieu, sanctuaire : Jovis cella Liv. 5, 50, 6, le sanctuaire de Jupiter
¶5. logement des animaux : columbarum Col. 8, 8, 3, pigeonnier
¶6. alvéoles des ruches, cellules : Virg. G. 4, 164.
¶1. tenir secret, tenir caché, ne pas dévoiler, cacher : sententiam Cic. Ac. 2, 60 ; peccatum Cic. Nat. 2, 11, tenir cachée son opinion, cacher une faute ; rex id celatum voluerat Cic. Verr. 4, 64, le roi avait voulu que l'objet fût tenu caché ; cum quæ causa illius tumultus fuerit testes dixerint, ipse celarit Cic. Verr. 1, 80, les témoins ayant dit, mais lui ayant caché la raison de ces désordres ; celans quantum vulnus accepisset Nep. Dat. 6, 1, ne laissant pas voir quelle cruelle blessure il avait reçue : cupiebam animi dolorem vultu tegere et taciturnitate celare Cic. Verr. pr. 21, je désirais que mon visage masquât la peine que je ressentais et que mon silence la tînt secrète ; primo urbis magnitudo ea (mala) celavit Liv. 39, 9, 1, au début la grandeur de la ville cacha le mal
¶2. cacher à qqn, celare aliquem : si omnes deos hominesque celare possimus Cic. Off. 3, 37, quand meme nous pourrions tenir tous les dieux et les hommes dans l'ignorance ; cum familiariter me in eorum sermonem insinuarem, celabar, excludebar Cic. Agr. 2, 12, j'avais beau me mêler familièrement à leurs entretiens, on se cachait de moi, on m'évinçait ; celari videor a te Cic. Q. 2, 15, 5, je crois que je suis tenu par toi dans l'ignorance
¶3. cacher qqch à qqn, celare aliquem aliquam rem : Cic. Or. 230 ; Fam. 2, 16, 3 ; Liv. 40, 56, 11 ; indicabo tibi quod in primis te celatum volebam Cic. Q. 3, 5, 4, je te révélerai ce qu'à toi surtout je voulais cacher ; celabis homines quid iis adsit commoditatis ? Cic. Off. 3, 52, tu cacheras à tes semblables l'avantage qui est à leur portée ? quam quidem celo miseram me hoc timere Cic. Att. 11, 24, 2, et je cache à la malheureuse que j'ai ces craintes
— celare aliquem de aliqua re Cic. Verr. 4, 29, tenir qqn dans l'ignorance touchant qqch ; credo celatum esse Cassium de Sulla uno Cic. Sull. 39, j'imagine, Cassius était tenu dans l'ignorance touchant le seul Sylla ; non est profecto de illo veneno celata mater Cic. Clu. 189, cette mère n'a pas été tenue dans l'ignorance de cette préparation du poison (elle a été dans la confidence de cet empoisonnement)
— celare alicui aliquid : *B. Alex. 7, 1 ; id Alcibiadi diutius celari non potuit Nep. Alc. 5, 2, cela ne put être caché bien longtemps à Alcibiade [mss ; mais corr. Alcibiades].
===> arch. celassis = celaveris Pl. Stich. 149
— inf. passif celarier Lucr. 1, 905
— gén. plur. celatum = celatorum Pl. Trin. 241.
¶1. élevé, haut, grand : deus homines celsos et erectos constituit Cic. Nat. 2, 140, Dieu a donné à l'homme une taille élevée et droite ; celsæ turres Hor. O. 2, 10, les hautes tours
¶2. qui se redresse, fier, noble, plein d'assurance : celsus hæc corpore dicebat Liv. 30, 32, 11, il parlait ainsi en redressant sa taille ; celsus et erectus, qualem sapientem esse volumus Cic. Tusc. 5, 42, fier, noble et tel que nous nous représentons le sage
— celsior Ov. M. 1, 178 ; Quint. 1, 3, 30 ; celsissimus Col. 3, 8, 2.
¶1. médecin célèbre et écrivain encyclopédiste : Quint. 10, 1, 124
¶2. jurisconsulte sous Trajan : Plin. Ep. 6, 5, 4
¶3. Celsus Albinovanus, v. Albinovanus.
¶1. dîner [repas principal vers 15 h., les affaires étant terminées vers 14 h., cf. Hor. Ep. 1, 7, 47 et 71] : cenam coquere Pl. Aul. 365, faire cuire le dîner ; cenas facere, obire Cic. Att. 9, 13, 6, donner des dîners, assister à des dîners ; ad cenam invitare Cic. Fam. 7, 9, 3 ou vocare Cic. Att. 6, 3, 9, prier à dîner ; dare cenam alicui Cic. Fam. 9, 20, 2, offrir à dîner à qqn ; inter cenam Cic. Q. 3, 1, 19, à table ; ter super cenam bibere Suet. Aug. 77, boire à trois reprises pendant le dîner ; cena comesa venire Varr. R. 1, 2, 11, arriver après le dessert
¶2. service : cena prima, altera Mart. 11, 31, 5, le premier, le second service
¶3. salle à manger : Plin. 12, 11
¶4. réunion de convives : ingens cena sedet Juv. 2, 120, les convives sont nombreux.
¶1. salle à manger : Varr. L. 5, 162
¶2. étage supérieur [où se trouvait la salle à manger], chambres placées à cet étage : cenacula dicuntur ad quæ scalis ascenditur Fest. 54, 6, on appelle cenacula les pièces où l'on monte par des escaliers, cf. Liv. 39, 14, 2 ; Roma cenaculis sublata Cic. Agr. 2, 96, Rome où les maisons montent en étages
— [fig.] cenacula maxima cæli Enn. An. 60, les régions supérieures du ciel ; cf. Pl. Amp. 863.
===> .
¶1. qui a dîné : Pl. Aul. 368 ; Cic. Dej. 42
¶2. passé à dîner, passé à table : cenatæ noctes Pl. Truc. 279, nuits passées à dîner, cf. Suet. Aug. 70.
¶1. mère de Myrrha : Ov. M. 10, 435
¶2. île de la mer Égée : Plin. 4, 57.
¶1. f., sorte d'épervier : Plin. 10, 143
¶2. m., espèce de serpent tacheté : Plin. 20, 245 ; Luc. 9, 712.
¶1. int., dîner : apud Pompeium cenavi Cic. Fam. 1, 2, 3, j'ai dîné chez Pompée ; melius cenare Cic. Tusc. 5, 97, mieux dîner ; cum cenatum forte apud Vitellios esset Liv. 2, 4, 5, au cours d'un dîner donné par les Vitellius
¶2. tr., manger à dîner, dîner de : cenare olus omne Hor. Ep. 1, 5, 2, manger des légumes de toute sorte ; centum ostrea Juv. 8, 85, dévorer un cent d'huîtres
— [fig.] cenabis hodie magnum malum Pl. As. 936, tu en avaleras de dures aujourd'hui.
===> cenassit = cenaverit Pl. St. 192.
===> .
I. estimer, évaluer
¶1. en parl. du cens : censores populi ævitates... pecuniasque censento Cic. Leg. 3, 7, que les censeurs fassent le recensement des âges... et des fortunes du peuple ; quinto quoque anno Sicilia tota censetur Cic. Verr. 2, 139, tous les cinq ans la Sicile entière est soumise aux opérations du cens ; nullam populi partem esse censam Cic. Arch. 11, qu'il n'y a eu recensement d'aucune partie du peuple ; domini voluntate census Cic. de Or. 1, 183, [esclave] inscrit au nombre des citoyens sur les registres du cens par la volonté de son maître ; illud quæro, sintne ista prædia censui censendo Cic. Flacc. 80, je te demande si ces terres se prêtent à l'opération du cens = si elles peuvent être portées [comme étant vraiment ta propriété] sur les listes des censeurs ; legem censui censendo dicere Liv. 43, 14, 5, = formulam censendi dicere, fixer la règle, le taux pour l'application du cens ; capite censi, v. caput ; census equestrem summam nummorum Hor. P. 383, recensé pour la somme de sesterces qui correspond à la classe des chevaliers
— déclarer soi-même sa fortune en se faisant inscrire sur la liste des censeurs : in qua tribu ista prædia censuisti ? Cic. Flac. 80 [cf. prædia in censu dedicare Flac. 79, faire entrer des terres dans le dénombrement de ses biens] dans quelle tribu as-tu fait figurer ces biens pour le cens ?
¶2. [fig.] recenser, mettre au nombre de : de aliquo censeri Ov. P. 2, 5, 73 ; 3, 1, 75, être considéré comme appartenant à qqn ; nomine aliquo V.-Max. 8, 7, 2, être désigné par un nom
— évaluer, estimer : Pl. Pœn. 56 ; Rud. 1271 ; Ter. Haut. 1023 ; si censenda nobis sit atque æstimanda res Cic. Par. 48, si nous devions faire une évaluation, une appréciation de la chose ; aliqua re censeri, se faire apprécier par qqch : Tac. Agr. 45 ; Plin. Pan. 15 ; Suet. Gram. 10 ; virtus suo ære censetur Sen. Ep. 87, 17, la vertu tire toute sa valeur d'elle-même.
II. juger, être d'avis
¶1. opinion, point de vue de qqn en général : sic enim ipse censet Cic. Or. 176, car telle est son opinion à lui-même ; quid censetis ? Cic. Verr. 5, 10, quel est votre avis ?
— quid censetis fore si... ? Cic. Tull. 40, qu'arrivera-t-il, à votre avis, si... ? illos censemus in numero eloquentium reponendos Cic. de Or. 1, 58, j'estime qu'il faut les ranger au nombre des gens éloquents ; quid censes ceteros ? Cic. Att. 14, 4, 1, que feront les autres, à ton avis ? an censebas aliter ? Cic. Att. 14, 11, 1, ou bien croyais-tu qu'ils agiraient autrement ?
— [avec deux interr.] : quid censes Roscium quo studio esse ? Cic. Amer. 49, et, selon toi, quel est le goût de Roscius ? quid censes qualem illum oratorem futurum ? Cic. de Or. 1, 79, imagines-tu quel orateur ce serait ? quid censetis nullasne insidias extimescendas ? Cic. Phil. 12, 22, croyez-vous qu'il n'y ait pas d'embûches à redouter ?
— mentem solam censebant idoneam, cui crederetur Cic. Ac. 1, 30, l'intelligence, suivant eux, méritait seule la confiance ; illa num leviora censes ? Cic. Tusc. 1, 56, et ces autres preuves, les trouves-tu sans force ?
¶2. être d'avis, trouver bon, conseiller : de quo, ut de ceteris, faciam, ut tu censueris Cic. Att. 16, 15, 2, là-dessus, comme sur tout le reste, je me conformerai à tes avis (quod censueris faciam Cic. Att. 16, 10, 2) ; tibi hoc censeo Cic. Fam. 9, 2, 4, voici ce que je te conseille ; quid mihi censes ? Cic. Att. 11, 22, 2, que me conseilles-tu ?
— [dans une assemblée officielle, au sénat] quarum (sententiarum) pars deditionem, pars eruptionem censebat Cæs. G. 7, 77, 2, parmi ces avis, les uns voulaient la reddition, les autres une sortie ; non arma, neque secessionem censebo Sall. Mac. 17, je ne conseillerai pas une prise d'armes ni une retraite du peuple, cf. Plin. 18, 37 ; Tac. An. 12, 53
— censeo (voci) serviendum Cic. de Or. 3, 224, j'estime qu'il faut donner tous ses soins à la voix ; legatorum mentionem nullam censeo faciendam Cic. Phil. 5, 31, je suis d'avis de ne pas parler du tout d'ambassade ; cum legatos decerni non censuissem Cic. Phil. 8, 21, n'ayant pas été d'avis qu'on décrétât une députation ; ita censeo... senatui placere Cic. Phil. 9, 15, je suis d'avis que le sénat décrète...
— [av. inf.] Antenor censet belli præcidere causam Hor. Ep. 1, 2, 9, Anténor est d'avis de supprimer la cause de la guerre ; M. Porcius talem pestem vitare censuit Col. 1, 3, 7, M. Porcius Caton fut d'avis d'éviter un tel fléau
— [av. ut] de ea re ita censeo, uti consules dent operam uti... Cic. Phil. 3, 37, sur ce point mon avis est que les consuls prennent toutes mesures pour que...; ut celeriter perrumpant, censent Cæs. G. 6, 40, 2, ils décident de faire promptement une trouée ; censebat ut Pompeius proficisceretur Cæs. C. 1, 2, 3, il opinait pour le départ de Pompée (il réclamait le départ...) ; censeo ut eis ne sit ea res fraudi Cic. Phil. 5, 34, je suis d'avis qu'on ne leur en fasse pas un crime ; censere ne Liv. 3, 18, 2, être d'avis de ne pas, conseiller de ne pas
— censeo desistas Cic. Verr. 5, 174, je te conseille de renoncer à ton projet, cf. Clu. 135 ; Flac. 75 ; Planc. 13 ; Phil. 2, 95 ; Læ. 17, etc.
¶3. [en part. avis du sénat] décider, ordonner, prescrire : Cic. Phil. 8, 21 ; Lig. 20 ; Agr. 2, 31 ; Flacc. 78 ; quemadmodum senatus censuit populusque jussit Cic. Planc. 42, comme le sénat l'a décrété et le peuple ratifié ; cum id senatus frequens censuisset Cic. Pis. 18, le sénat en nombre ayant pris cette décision ; quæ patres censuerunt, vos jubete Liv. 31, 7, 14, ce que le sénat a décidé, vous, confirmez-le par vos ordres ; bellum Samnitibus et patres censuerunt et populus jussit Liv. 10, 12, 3, le sénat décréta la guerre contre les Samnites et le peuple ratifia ; quæ senatus vendenda censuit Cic. Agr. 2, 36, des biens dont le sénat décréta la vente ; senatus retinendum me in urbe censuit Cic. Att. 1, 19, 3, le sénat voulut que je demeurasse à Rome ; eos senatus non censuit redimendos Cic. Off. 3, 114, le sénat s'opposa à leur rachat
— censentur Ostorio triumphalia insignia Tac. An. 12, 39, on décerne à Ostorius les insignes du triomphe
— nec senatus censuit in hunc annum (Africam) provinciam esse nec populus jussit Liv. 28, 40, 4, ni le sénat n'a décrété ni le peuple n'a ordonné que l'Afrique soit dans les provinces à répartir cette année ; patres censuerunt placere consules provincias sortiri Liv. 33, 43, 2, le sénat fut d'avis de décider que les consuls tirassent au sort les provinces
— [avec ut] Cic. Cat. 3, 14 ; Phil. 8, 14, etc.; Cæs. G. 1, 35, 4 ; [avec ne] Suet. Aug. 94.
III. comme suscensere, être en colère : Varr. Men. 72 ; Non. 267, 24.
===> parf. censiit Grom. 231, 1
— inf. pass. censiri Grom. 234, 2 ; censerier Pl. Capt. 15
— part. parf. censitus Chalc. Tim. 344 ; Grom. 211, 8, etc.
— censen = censesne Pl. Merc. 461.
¶1. évaluation : Varr. L. 5, 81
— dénombrement, recensement : Gell. 10, 28, 2
¶2. action de dire censeo, opinion, avis : Pl. Rud. 1273
—
¶3. châtiment infligé par le censeur, amende : P. Fest. 54, 5
— [fig.] censio bubula Pl. Aul. 601, amende payable en coups de nerf de bœuf.
===> .
¶1. censeur : censores ab re (a censu agendo) appellati sunt Liv. 4, 8, 7, on les appela censeurs parce qu'ils étaient chargés du recensement ; cf. Cic. Leg. 3, 7
¶2. [fig.] censeur, critique : Cic. Cæl. 25 ; Hor. P. 174.
===> arch. cēsor CIL 1, 31 et cessor Varr. L. 6, 92
— fém. d. Ambr. Ep. 10, 83.
¶1. surnom de la gens Martia : Cic. Br. 311
¶2. grammairien du 3e s. ap. J.-C.
¶1. de censeur, relatif aux censeurs : censoriæ tabulæ Cic. Agr. 1, 4, et censorii libri Gell. 2, 10, 1, registres des censeurs ; leges censoriæ Cic. Verr. 1, 143, règlements, ordonnances des censeurs ; opus censorium Gell. 14, 7, 8, acte qui tombe sous la réprobation des censeurs
— homo censorius Cic. de Or. 2, 367, ancien censeur ; censoria gravitas Cic. Cæl. 35, la gravité d'un censeur
¶2. [fig.] qui blâme, qui réprouve : aliquid censoria quadam virgula notare Quint. 1, 4, 3, marquer qqch d'un trait en qq sorte censorial (réprobateur)
— digne d'un censeur : Macr. S. 2, 2, 16.
¶1. scribes qui tenaient les registres du cens. : Capit. Gord. 12, 3
¶2. registres, annales : Tert. Apol. 19.
¶1. censure, dignité de censeur : hic annus censuræ initium fuit Liv. 4, 8, 2, cette année-là fut créée la censure ; censuram petere Cic. Phil. 2, 98 ; gerere Cic. Br. 161, briguer, exercer la censure
¶2. examen, jugement, critique : vivorum difficilis censura est Vell. 2, 36, il est difficile de juger les écrivains de leur vivant ; censuram vini facere Plin. 14, 72, apprécier le vin
¶3. sévérité, mœurs sévères : Capit. Aurel. 22, 10.
¶1. cens, recensement (quinquennal des citoyens, des fortunes, qui permet de déterminer les classes, les centuries, l'impôt) : censum habere Cic. Verr. 2, 63 ; agere Liv. 29, 15, 9, faire le recensement ; censu prohibere Cic. Sest. 101 ; excludere Liv. 45, 15, 4, ne pas admettre qqn sur la liste des citoyens
— [en part.] census equitum Liv. 29, 37, 8, revue des chevaliers ; in equitum censu prodire Cic. Clu. 134, comparaître lors du recensement des chevaliers
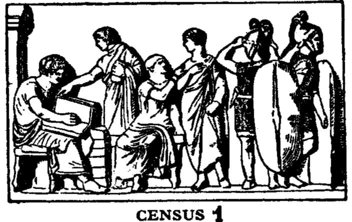
¶2. rôle, liste des censeurs ; registres du cens : Cic. Balb. 5 ; Clu. 141 ; Cæl. 78 ; Arch. 11
¶3. cens, quantité recensée, fortune, facultés : Cic. Leg. 3, 44 ; 2, 68 ; Com. 42 ; Liv. 1, 42, 5 ; homo sine censu Cic. Fl. 52, homme sans fortune.
¶1. m. Hor. Epod. 13, 11, le Centaure (Chiron)
— le Centaure [constellation] : Cic. Nat. 2, 114

¶2. f. [épithète d'un vaisseau, navis], Virg. En. 5, 122.
¶1. [distributif] cent à chacun, cent chaque fois : sestertios centenos militibus est pollicitus B. Alex. 48, il promit aux soldats cent sesterces par tête, cf. Liv. 22, 52, 2 ; centena sestertia capere Cic. Par. 49, retirer cent mille sesterces de revenu par an
¶2. cent [nombre cardinal] : centenæ manus Virg. En. 10, 566, cent mains.
¶1. centième : centesima lux Cic. Mil. 98, le centième jour
¶2. centuple : secale nascitur cum centesimo grano Plin. 18, 141, le seigle rapporte cent pour un
— cum centesimo, au centuple : Varr. R. 1, 44 ; Plin. 18, 94.
¶1. pièce d'étoffe rapiécée, morceau d'étoffe : Cat. Agr. 2, 3 ; Cæs. C. 2, 10, 7 ; 3, 44, 7
— [fig.] centones alicui sarcire Pl. Epid. 455, conter des bourdes à quelqu'un
¶2. centon, pièce de vers en pot-pourri [vers ou bribes de vers pris à divers auteurs] : Aus. Idyl. 13 ; Aug. Civ. 17, 15.
a) chiffonnier, rapetasseur : Petr. 45, 1
—
b) pompier : Inscr.
¶1. la branche fixe du compas autour de laquelle l'autre pivote : Vitr. 3, 1, 3
¶2. centre du cercle : Plin. 2, 63 ; 18, 281 ; [en grec d. Cic. Tusc. 1, 40]
¶3. nœud, nodosité [dans le bois, le marbre] : Plin. 16, 198.
¶1. m., dim. de cento, haillon, loques rapiécées : Liv. 7, 14, 7
— habit d'arlequin : Apul. Apol. 13, 7
¶2. f., cotonnière [plante] : Plin. 26, 105.
¶1. contenance de 200 arpents : Varr. R. 1, 10 ; L. 5, 35
¶2. centurie, compagnie de 200 hommes : Varr. L. 5, 88 ; Cæs. C. 1, 64, 5 ; 3, 91, 3 ; Sall. J. 91, 1
¶3. centurie, une des 193 classes dans lesquelles Servius Tullius répartit le peuple romain, cf. Liv. 1, 43, 1 ; Cic. Rep. 2, 39 ; centuria prærogativa Cic. Planc. 49, la centurie qui vote la première ; centuriæ paucæ ad consulatum defecere Cic. Br. 237, il ne lui manqua qu'un petit nombre de centuries pour devenir consul ; conficere alicui centurias Cic. Fam. 11, 16, 3, procurer à qqn les suffrages de centuries.
¶1. partagé en lots de 200 arpents : P. Fest. 53
¶2. formé par centuries : centuriati pedites Liv. 22, 38, 4, fantassins formés par centuries ; [abl. n. absolu] centuriato Varr. L. 6, 93, après formation en centuries
— [fig.] centuriati manipulares Pl. Mil. 815, soldats bien rangés
— qui appartient à une centurie militaire : Vop. Prob. 7, 7
¶3. par centuries : comitia centuriata Cic. Phil. 1, 19, comices par centuries ; centuriata lex Cic. Agr. 2, 26, loi votée dans les comices par centuries, loi centuriate.
¶1. former en centuries : centuriare seniores Liv. 6, 2, 6, former en centuries le deuxième ban
— [absolt] centuriat Capuæ Cic. Att. 16, 9, il constitue ses compagnies à Capoue
¶2. diviser par groupes de 200 arpents : Grom. 120, 3.

¶1. -natum agere Tac. An. 1, 44, passer la revue des centurions
¶2. grade de centurion : V.-Max. 3, 2, 23.
¶1. cire : cera circumlinere Cic. Tusc. 1, 108, enduire de cire
¶2. cire à cacheter : in illo testimonio ceram esse vidimus Cic. Fl. 37, nous avons constaté que cette pièce était cachetée à la cire
¶3. tablette à écrire, page : scribitur optime ceris Quint. 10, 3, 31, les tablettes sont très commodes pour écrire ; primæ duæ ceræ Suet. Ner. 17, les deux premières pages ; extrema cera Cic. Verr. 1, 92, le bas de la page
¶4. pl., statues en cire : Cic. Nat. 1, 71
— portraits en cire : ceræ veteres Juv. 8, 19, vieilles figures de cire [bustes des aïeux]
¶5. [poét.] cellules des abeilles : ceræ inanes Virg. G. 4, 241, cellules vides
¶6. peinture encaustique : Plin. 35, 49.
¶1. vipère à corne : Plin. 8, 85 ; Luc. 9, 716
—
¶2. ver qui ronge les arbres : Plin. 16, 220.
¶1. cerisier : Varr. R. 1, 39, 2 ; Virg. G. 2, 18
¶2. cerise : Prop. 4, 2, 15.
¶1. caroubier : Col. Arb. 25, 1
¶2. v. ceration.
¶1. surnom de Ptolémée II, roi de Macédoine : Nep. Reg. 3, 4
¶2. fleuve de Cappadoce : Plin. 34, 142
¶3. v. Ceraunia et ceraunium.
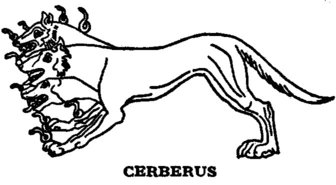
¶1. navire léger
¶2. poisson de mer : Ov. Hal. 102 ; Plin. 32, 152.
¶1. cerveau : in cerebro dixerunt esse animo sedem Cic. Tusc. 1, 19, ils ont dit que l'âme était localisée dans le cerveau ; [fig.] id his cerebrum uritur [avec prop. inf.] Pl. Pœn. 770, leur cerveau bout à l'idée que...
¶2. tête, cervelle, esprit : mihi cerebrum excutiunt tua dicta Pl. Aul. 151, tu me casses la tête avec tes discours ; cerebrum putidum Hor. S. 2, 3, 75, cervelle brouillée
— [fig.] sens : Fulg. Myth. 3, 9.
¶1. couleur de cire : Col. 10, 404
¶2. -lus, i, m., petit cierge : Hier. Vigil. 4.
¶1. Cérès [déesse de l'agriculture] : Ceres mortales vertere terram instituit Virg. G. 1, 147, Cérès apprit aux hommes le labourage ; flava Ceres Tib. 1, 1, 15, blonde Cérès ; sacerdos Cererum CIL 10, 1585, prêtre des deux Cérès [la déesse et sa fille Proserpine]

¶2. [fig.] moisson, blé, pain : Cererem pro frugibus appellare Cic. de Or. 3, 167, dire Cérès au lieu de dire blé ; Ceres medio succiditur æstu Virg. G. 1, 297, on coupe le blé au moment des grandes chaleurs ; Cererem canistris expediunt Virg. En. 1, 701, ils tirent le pain des corbeilles, cf. 8, 181.
===> gén. arch. Cererus : CIL 1, 568.
¶1. m., nom d'homme : Hor. S. 1, 2, 81
¶2. f., ville d'Eubée : Plin. 4, 64.
¶1. le jugement : Gloss.
¶2. crible : Gloss.
¶1. [au pr.] séparer : per cribrum cernere Cat. Agr. 107, 1, passer au crible, tamiser
¶2. [fig.] distinguer, discerner, reconnaître nettement avec les sens et surtout avec les yeux : ut (natura deorum) non sensu, sed mente cernatur Cic. Nat. 1, 49, de telle sorte qu'elle (la nature des dieux) se perçoit non par les sens, mais par l'intelligence ; ne nunc quidem oculis cernimus ea quæ videmus Cic. Tusc. 1, 46, maintenant même ce ne sont pas nos yeux qui distinguent ce que nous voyons (qui en prennent connaissance); ex cruce Italiam cernere Cic. Verr. 5, 169, du haut de la croix discerner l'Italie ; quæ cerni tangique possunt Cic. Top. 27, les choses qui tombent sous les sens de la vue et du toucher ; se miscet viris neque cernitur ulli Virg. En. 1, 440, il se mêle à la foule et n'est visible pour personne ; Venus nulli cernenda Ov. M. 15, 844, Vénus, invisible pour tout le monde
— Antonius descendens ex loco superiore cernebatur Cæs. C. 3, 65, 1, on apercevait Antoine descendant des hauteurs ; cum infelicis expeditionis reliquias ad castra venientes cernunt Liv. 27, 27, 10, quand on voit revenir au camp les débris de cette malheureuse expédition
— ex superioribus locis cernebatur novissimos illorum premi Cæs. C. 1, 64, 1, des hauteurs on voyait que leur arrière-garde était serrée de près ; cum ex vallo Pompeium adesse et suos fugere cernerent Cæs. C. 3, 69, 4, voyant du haut du retranchement que Pompée était là et que les leurs fuyaient
— cerne quam tenui vos parte contingat (alter cingulus) Cic. Rep. 6, 21, vois combien (cette deuxième zone) vous touche faiblement ; ipse cernit ex superiore loco in quanto discrimine præsidium esset Liv. 10, 5, 4, lui-même, il voit d'une éminence la situation critique du détachement
— en cernite Stat. Th. 5, 124 ; cerne en Stat. Th. 7, 386, [parenthèses pour attirer l'attention] voyez, vois
¶3. distinguer avec l'intelligence, voir par la pensée, comprendre : verum cernere Cic. Leg. 2, 43, discerner le vrai ; species eloquentiæ, quam cernebat animo, re ipsa non videbat Cic. Or. 18, une forme idéale de l'éloquence, qu'il se représentait bien en imagination, mais qu'il ne voyait pas dans la réalité ; cerno animo miseros atque insepultos acervos civium Cic. Cat. 4, 11, je me représente par la pensée les misérables monceaux de cadavres de nos concitoyens sans sépulture
— an non cernimus optimo cuique dominatum ab ipsa natura datum ? Cic. Rep. 3, 37, ne voyons-nous pas que la nature elle-même a donné partout la suprématie au meilleur ? nonne cernimus vix singulis ætatibus binos oratores laudabiles constitisse ? Cic. Br. 333, ne voyons-nous pas que c'est à peine si à chaque génération il s'est rencontré deux orateurs estimables ? ille cernens locum nullum sibi tutum in Græcia Nep. Alc. 9, 3, lui, voyant qu'aucun lieu n'était sûr pour lui en Grèce
— quis est quin cernat, quanta vis sit in sensibus Cic. Ac. 2, 20, qui ne voit de quoi les sens sont capables ; tum vero cerneres quanta audacia fuisset in exercitu Catilinæ Sall. C. 61, 1, alors vraiment on aurait pu reconnaître quelle audace animait l'armée de Catilina
— in aliqua re ou aliqua re cerni, être reconnu (se reconnaître) dans, à, qqch : amicus certus in re incerta cernitur Enn. d. Cic. Læ. 64, l'âmi sûr se reconnaît dans les circonstances peu sûres (critiques); hæ virtutes cernuntur in agendo Cic. Part. 78, ces vertus éclatent dans l'action ; fortis animus duabus rebus maxime cernitur Cic. Off. 1, 66, une grande âme se reconnaît à deux choses principalement ; cum eo vis oratoris cernatur Cic. de Or. 1, 219, puisque c'est par là que se reconnaît la puissance de l'orateur
¶4. trancher, décider : quodcumque senatus creverit agunto Cic. Leg. 3, 6, qu'ils exécutent les décrets du sénat ; imperia, potestates, legationes cum senatus creverit, populus jusserit... Cic. Leg. 3, 9, les commandements militaires, les gouvernements de provinces, les lieutenances, une fois que le sénat les aura décrétés et le peuple ratifiés ; priusquam id sors cerneret Liv. 43, 12, 2, avant que le sort en eût décidé
— armis cernere Acc. Tr. 326, décider par les armes (ferro, par le fer : Virg. En. 12, 709 ; Sen. Ep. 58, 3)
¶5. [droit] prononcer la formule par laquelle on déclare son intention d'accepter un héritage : Varr. L. 7, 98 ; Gai. Inst. 2, 164 ; [d'où] hereditatem cernere Cic. Agr. 2, 40 ; Att. 11, 2, 1, etc., déclarer qu'on accepte un héritage, accepter un héritage ; jeu de mots sur cernere Rhet. Her. 4, 67.
===> la forme du pf crevi ne se trouve pas avec le sens de « voir », sauf Pl. Cist. 1 et Titin. Com. 50.
¶1. qui fait une culbute : Apul. M. 9, 38
¶2. = pronus : Hier. Ruf. 1, 17.
¶1. int., tomber la tête la première, faire la culbute : Varr. d. Non. p. 21, 8 ; Apul. M. 1, 19
¶2. tr., courber : cernuare ora Prud. Symm. 1, 350, courber la tête
— cernŭor, ātus sum, āri, int., c. cernuo : Sol. 17, 7 ; 45, 13.
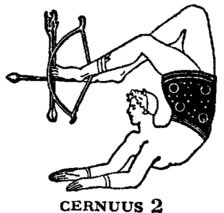
¶1. action de se mesurer avec un adversaire, lutte, joute : in certamen descendere Cic. Tusc. 2, 62, affronter la lutte ; certamen saliendi Quint. 10, 3, 6, concours de saut ; certamen quadrigarum Suet. Cl. 21, 3, course de quadriges ; certamen pedum Ov. M. 12, 304, course à pied ; certamen eloquentiæ Quint. 2, 17, 8, joute oratoire ; certamina ponere Virg. En. 5, 66, organiser des joutes
¶2. combat, bataille, engagement : prœlii certamen Cic. Rep. 2, 13, les engagements (la lutte) au cours de la bataille, cf. Mur. 33 ; Cæs. G. 3, 14, 8 ; in certamine ipso Liv. 2, 44, 11, en pleine bataille
¶3. lutte, conflit, rivalité : certamen honestum et disputatio splendida Cic. Fin. 2, 68, lutte honorable et discussion brillante ; certamen honoris Cic. Off. 1, 38, lutte pour les magistratures ; dominationis certamen Sall. J. 41, 2, conflit pour la suprématie ; certamen periculi Liv. 28, 19, 14, émulation à s'exposer au danger
¶4. [fig.] : certamen controversiæ Cic. Or. 126, point vif du débat.
¶1. certainement, de façon certaine, sûrement, sans doute : certe is est Ter. Ad. 53, c'est bien lui ; est miserum igitur, quoniam malum ? Certe Cic. Tusc. 1, 9, c'est donc un malheur, puisque c'est un mal ? Assurément
¶2. du moins, en tout cas : ut homines mortem vel optare incipiant, vel certe timere desistant Cic. Tusc. 1, 112, pour que les hommes commencent à souhaiter la mort ou du moins cessent de la craindre ; aut non potuerunt, aut noluerunt, certe reliquerunt Cic. Fin. 4, 7, ils ne l'ont pas pu, ou bien ils ne l'ont pas voulu, en tout cas ils y ont renoncé
— sed certe Cæs. G. 6, 31, 2, ce qui est certain, c'est que.
I. int., chercher à obtenir l'avantage sur qqn en luttant, lutter, combattre : armis, pugnis, dicacitate Cic. Off. 4, 87 ; Tusc. 5, 77 ; Br. 172, lutter avec les armes, les poings, faire assaut de verve ; cum aliquo de aliqua re, contre qqn sur qqch : Cic. de Or. 2, 76 ; inter se officiis certant Cic. Fam. 7, 31, 1, ils luttent entre eux (rivalisent) de bons offices
— [avec int. indir.] certabant quis gubernaret Cic. Off. 1, 87, ils luttaient pour savoir qui tiendrait le gouvernail
— [en justice] : Verr. 2, 39 ; de Or. 1, 77
— [poét., avec dat.] tenir tête à : Virg. B. 5, 8 ; G. 2, 138 ; Hor. S. 2, 5, 19
— [poét., avec inf.] lutter pour, tâcher de : Lucr., Virg., Hor. Curt. 9, 4, 33 ; Plin. Pan. 81.
II. tr., débattre une chose, rem : Volcat. d. Gell. 15, 24 ; multam Liv. 25, 3, 14, débattre le taux de l'amende.
¶1. [en parl. de choses] décidé, résolu : certumnest tibi istuc ? --- non moriri certius Pl. Cap. 732, est-ce là une chose bien arrêtée dans ton esprit ? --- aussi arrêtée que notre mort un jour ; hoc mihi certissimum est Pl. Merc. 658, j'y suis tout à fait décidé ; quando id certum atque obstinatum est Liv. 2, 15, 5, puisque c'est une résolution arrêtée et inébranlable
— certa res est avec inf., c'est une chose décidée que de : Pl. Amph. 705 ; Merc. 857 ; Mil. 267, etc. ; opponere... certa est sententia Turno Virg. En. 10, 240, Turnus est décidé à opposer...
— certum est avec prop. inf. : me parcere certumst Enn. An. 200, je suis résolu à épargner... (Pl. Stich. 141 ; Men. 1058 ; Ter. Hec. 454)
— certum est avec inf., même sens : Pl. Amph. 265 ; Cas. 294 ; Rud. 684, etc. ; certum est deliberatumque dicere Cic. Amer. 31, c'est [pour moi] une décision prise et arrêtée que de dire
— [avec dat. de pers.] : mihi certum est, je suis bien décidé à : Pl. Capt. 772 ; Ps. 90 ; Cic. Verr. pr. 53 ; mihi abjurare certius est quam Cic. Att. 1, 8, 3, je suis plus résolu à faire un faux serment qu'à...; cum diceret sibi certum esse... discedere Cic. de Or. 2, 144, alors qu'il se disait résolu à quitter...; cum illi certissimum sit exspoliare provincia Pompeium Cic. Att. 10, 1, 3, du moment qu'il est parfaitement résolu à dépouiller Pompée de sa province (Att. 7, 9, 3)
— [en parl. de pers., avec inf.] : certa mori Virg. En. 4, 564, décidée à mourir (Ov. M. 10, 428 ; 10, 394, etc.); certus procul urbe degere Tac. An. 4, 57, décidé à vivre loin de la ville
— [avec gén.] : certus eundi Virg. En. 4, 554, décidé à aller (Ov. M. 11, 440 ; Tac. H. 4, 14); relinquendæ vitæ Tac. An. 4, 34, résolu à mourir ; destinationis Tac. An. 12, 32, ferme dans sa résolution ; sceleris certa Tac. An. 12, 61, décidée au crime (Plin. Ep. 6, 16, 12)
¶2. fixé, déterminé, précis : ex certo tempore Cic. Verr. 1, 108, à partir d'une date fixée ; certo die Cic. Cat. 1, 7, à un jour fixé ; pecunia certa Cic. Com. 10, somme déterminée ; certus terminus Cic. CM 72, limite fixe, précise ; certa dies, date déterminée (= terme, délai) : Cæs. C. 1, 30, 4, etc. ; sunt pueritiæ studia certa, sunt ineuntis adulescentiæ Cic. CM 76, il y a des goûts déterminés dans l'enfance, il y en a dans le début de la jeunesse
— [n. pris substt] : certo anni Tac. H. 5, 6, à une époque fixe de l'année ; linguæ tam certa loquentes Ov. M. 5, 296, des langues qui s'expriment si nettement ; nihil certi Cic. Or. 180, rien de fixe, de précis
— est certum quod respondeam Cic. Arch. 15, j'ai une réponse précise à faire (v. Gaffiot, Subj. p. 194), ma réponse sera nette
— [sens analogue à quidam] déterminé, à part, particulier : ad certam causam tempusque Cic. de Or. 1, 69, pour une certaine cause particulière, pour une occasion déterminée (de Or. 1, 141, etc.); motus non quivis, sed certus quidam Cic. Fin. 3, 24, un mouvement non pas quelconque, mais de nature particulière ; singularum virtutum sunt certa quædam officia Cic. de Or. 2, 345, chaque vertu a des devoirs qui lui sont propres ; certi homines, certains hommes (bien connus, mais qu'on ne veut pas désigner plus explicitement) : Cic. Sest. 41 ; Marc. 16 ; Agr. 2, 6 ; Flacc. 94, etc.; Liv. 34, 61, 7
¶3. certain, sûr : certus amicus Cic. Tull. 5, ami sûr ; homo honestissimus et certissimus Cic. Verr. 2, 156, homme très honorable et très sûr ; certissimis criminibus et testibus fretus Cic. Clu. 10, appuyé sur les accusations les plus certaines et les témoins les plus sûrs ; [pl. pris substt] certi, des gens sûrs, des hommes de confiance : Nep. Dion. 9, 1 ; Sall. H. 2, 58
— integra mente certisque sensibus Cic. CM 72, l'intelligence étant intacte et les sens sûrs ; pede certo Hor. P. 158, d'un pied assuré ; certa manu Ov. Am. 3, 10, 26, d'une main sûre
— certissima populi Romani vectigalia Cic. Pomp. 6, les revenus les plus sûrs du peuple romain ; certa possessio Cic. Læ. 55, possession assurée ; quo minus certa est hominum ac minus diuturna vita, hoc magis... Cic. Pomp. 59, moins la vie humaine est sûre et durable, plus...; certus receptus Cæs. C. 3, 110, 4, refuge assuré ; via et certa neque longa Cic. Phil. 11, 4, route à la fois sûre et courte ; quæ pax potest esse certior ? Cic. Phil. 8, 5, est-il une paix plus sûre ?
— [pl. n. pris substt] : certa maris Tac. H. 4, 81, mer sûre, bon état de la mer
¶4. certain [du point de vue de la connaissance], qui n'est pas douteux, sûr, positif, réel : cum ad has suspiciones certissimæ res accederent Cæs. G. 1, 19, 1, comme à ces soupçons s'ajoutaient les faits les plus précis ; aliquid certa notione animi præsentire Cic. Nat. 2, 45, avoir, avec une claire conception de l'esprit, une idée anticipée de qqch ; quæ certissima sunt et clarissima Cic. Verr. 1, 62, les faits qui sont les plus certains et les plus patents
— certum est, c'est une chose certaine : cum certius tibi sit me esse Romæ quam mihi te Athenis Cic. Att. 1, 9, 1, car tu es plus certain de ma présence à Rome que je ne le suis de ta présence à Athènes ; certum erat Spurinnæ non venisse Cæcinam Tac. H. 2, 18, Spurinna avait la certitude que Cécina n'était pas venu ; qui publicos agros arant certum est quid e lege censoria debeant Cic. Verr. 5, 53, les cultivateurs du domaine public, on sait de façon positive ce qu'ils doivent d'après la loi des censeurs ; id utrum sua sponte fecerint, an... non tam certum est quam... Liv. 34, 62, 17, agirent-ils ainsi d'eux-mêmes ou... c'est moins certain que... (nihil certi avec int. ind., Liv. 7, 26, 15) ; mihi non tam de jure certum est quam illud ad tuam dignitatem pertinere... Cic. Fam. 1, 9, 25, je suis moins certain du point de droit que je ne le suis de l'importance qu'il y a pour ta dignité de...
— certum habeo, je tiens pour certain, j'ai la certitude : certum non habeo, ubi sis Cic. Att. 4, 16, 7, je ne sais pas positivement où tu es (Fam. 12, 5, 1 ; Liv. 22, 7, 10)
— [avec prop. inf.] : Ant. d. Att. 14, 13 a, 3 ; Liv. 4, 2, 9 ; 5, 3, 2 ; 22, 3, 1, etc.
— certum scio, je le sais de façon certaine : Ter. Phorm. 148 ; Eun. 111 ; quid actum sit scribam ad te, cum certum sciam Cic. Att. 7, 13 a, 7, je t'écrirai ce qui s'est passé, quand je le saurai de façon certaine (Att. 12, 42, 3 ; Fam. 9, 10, 3, etc.) ; [autre sens] savoir qqch de certain : de cognitione ut certum sciam Ter. Eun. 921, afin que je m'assure de la reconnaissance ; certum nescio, je ne sais rien de certain : Cic. Att. 12, 23, 2 ; Sull. 38
— certum ou certius facere ( alicui), donner la certitude à qqn sur qqch : Pl. Men. 242 ; Ps. 598, 965, etc. ; nunc fit illud Catonis certius... Cic. Rep. 2, 37, maintenant se reconnaît mieux la vérité de ce mot de Caton, savoir...
— certum affirmare, affirmer comme une chose certaine : Liv. 3, 23, 7 ; certum inveniri non poterat [avec int. ind.] Cæs. C. 1, 25, 3, on ne pouvait trouver avec certitude si ou si ; certum in Fabio ponitur natum esse eum... Cic. Fat. 12, on pose comme certain à propos de Fabius qu'il est né...; nec traditur certum Liv. 2, 8, 8, et là-dessus la tradition n'est pas certaine ; certum respondere Cic. Ac. 2, 92, répondre qqch de précis ; constituere Cic. Scaur. 34, fixer comme une chose certaine (de façon certaine)
— pro certo habeo Cic. Att. 7, 12, 5, je tiens pour certain ; ilia pro certo habenda in quibus non dissentiunt... Liv. 4, 55, 8, on doit tenir pour certain ce point sur lequel il n'y a pas entre eux désaccord, savoir... ; [avec prop. inf.] Cic. Att. 10, 6, 3, etc. ; Sall. C. 52, 17 ; Liv. 4, 35, 8, etc.
— pro certo affirmare, affirmer comme certain : Liv. 1, 3, 2 ; 27, 1, 13 ; 43, 22, 4 ; dicere Cic. Br. 10 ; negare Cic. Att. 5, 21, 5, dire non catégoriquement ; polliceri Cic. Agr. 2, 108, promettre positivement ; pro certo ponere Cæs. G. 7, 5, 6, donner comme certain ; scire Pl. Bac. 511 ; Liv. 25, 10, 2, savoir de façon certaine ; res pro certo est Cic. Div. 2, 21 ; Liv. 5, 17, 8, qqch est certain
— certum [employé adverbialt], d'une façon certaine : Hor. S. 2, 6, 27
¶5. [en parl. de pers.] qui n'est pas douteux, incontestable : ecquem tu illo certiorem nebulonem ? Cic. Att. 15, 21, 1, connais-tu vaurien plus authentique ? si tibi fortuna non dedit ut patre certo nascerere Cic. Amer. 46, si ta mauvaise fortune t'a fait naître de père inconnu ; certissimus matricida Cic. Q. 1, 2, 4, un homme qui a tué incontestablement sa mère ; deum certissima proles Virg. En. 6, 322, vrai rejeton des dieux
¶6. certain de qqch, sûr de qqch : [avec prop. inf.] certi sumus perisse omnia Cic. Att. 2, 19, 5, nous sommes sûrs que tout est perdu (Prop. 1, 3, 36 ; V.-Fl. 1, 59 ; Sil. 11, 57 ; Plin. Pan. 68) ; [avec gén.] : victoriæ certi *Quadrig. H. 13, certains de la victoire ; certus eventus Tac. An. 14, 36, assuré du succès ; triumphi Plin. Pan. 16, du triomphe ; spei Tac. H. 4, 3, assuré dans ses espérances ; posteritatis Plin. Ep. 9, 3, 1, sûr de la postérité (= de la gloire future); [avec de] Suet. Vesp. 45
— [autre sens] au courant de, instruit de : futurorum certi Ov. M. 13, 722, instruits de l'avenir (Luc. 7, 31 ; 8, 120) ; quot natent pisces æquore, certus eris Ov. Pont. 2, 7, 28, tu sauras combien de poissons nagent dans la mer
— certiorem facere aliquem, informer qqn : Cic. Verr. 2, 55 ; Cæs. G. 5, 49, 4 ; non facto certiore senatu Liv. 23, 23, 9, sans informer le sénat (45, 21, 4) ; [avec gén.] alicujus rei, informer de qqch : Cic. Att. 3, 10, 3 ; Cæl. Fam. 8, 1, 1 ; Brut. et Cass. Fam. 11, 2, 2 (certior factus Att. 8, 11 d, 1 ; 9, 2 a, 2 ; Liv. 24, 38, 4 ; Curt. 8, 10, 17) ; [avec de] : de aliqua re Cic. Att. 3, 8, 12 ; 13, 3, 2 ; Cat. 2, 26, etc.; Cæs. G. 1, 7, 3, etc. ; [avec prop. inf.] informer que : Cic. Att. 4, 14, 1 ; Verr. 4, 80 ; 5, 101, etc.; Cæs. G. 1, 11, 4, etc. ; [avec interr. ind.] : eos certiores facit quid opus esset Cic. Verr. 1, 66, il les informe de ce qu'il faut faire (Att. 6, 1, 26, etc.; Cæs. G. 7, 87, 5 ; C. 1, 15, 4 ; mais quid velit mihi certius facit Pl. Men. 763, elle m'informe de ce qu'elle, veut); [avec idée d'ordre, d'exhortation] : certiorem facere ut Cic. Att. 2, 24, 2 ; Fam. 9, 5, 3 ; ne Cæs. C. 1, 64, 3 ; [avec subj.] : milites certiores facit paulisper intermitterent prœlium Cæs. G. 3, 5, 3, il mande aux soldats d'interrompre un moment le combat (Liv. 40, 39, 3)
— certum facere aliquem, renseigner qqn : Pl. Ps. 1097 ; rei Ov. M. 6, 268, informer de qqch.
¶1. petit cou, petite nuque : cerviculam jactare Cic. Verr. 3, 49, balancer la tête
¶2. col d'une machine hydraulique : Vitr. 10, 8, 2.
¶1. nuque, cou : caput a cervice revulsum Enn. An. 472, la tête détachée du cou ; cervices securi subjicere Cic. Phil. 2, 51, présenter le cou à la hache ; cervices frangere Cic. Verr. 5, 110, briser la nuque, étrangler ; capillus cervicem obtegebat Suet. Tib. 68, 2, les cheveux lui recouvraient la nuque ; caput et cervices et jugulum tutari Cic. Sest. 90, protéger la tête, le cou, la gorge
¶2. [fig.] cou, tête, épaules : cervicibus suis rem publicam sustinere Cic. Sest. 138, porter sur ses épaules le fardeau du gouvernement ; etsi bellum ingens in cervicibus erat Liv. 22, 33, 6, bien que sous la menace d'une guerre terrible ; alta cervice vagari Claud. Ruf. 1, 53, circuler la tête haute
— hardiesse : qui tantis erunt cervicibus recuperatores, qui audeant Cic. Verr. 3, 135, où trouvera-t-on des juges qui aient le front de...?
¶3. [choses inanimées] cervix cupressi Stat. Th. 6, 855, tête d'un cyprès ; cervix Peloponnesi Plin. 4, 8, l'isthme de Corinthe.
===> sing. cervix, Varr. L. 8, 14
— gén. pl. cervicium Plin. 11, 1 ; 20, 250 ; cervicum Cic. Or. 59.
¶1. cerf : Cic. Tusc. 3, 69
¶2. chevaux de frise : Cæs. G. 7, 72, 4
¶3. échalas : Tert. Anim. 19.
¶1. premier magistrat dans qq ville inconnue, c. prytanis et sufes : Sen. Tranq. 4, 5
¶2. joueur de trompette [d'un caractère artistique] : Ter.-Maur. 531 ; Hier. Chron. a. Abr. 2084.
¶1. retard, lenteur, retardement : non datur cessatio Pl. Pœn. 925, il n'y a pas de temps à perdre
¶2. arrêt de l'activité, repos : Epicurus nihil cessatione melius existimat Cic. Nat. 1, 36, Épicure ne trouve rien de préférable au repos
¶3. arrêt, cessation : cessatio pugnæ Gell. 1, 25, 8, cessation du combat
¶4. repos donné à la terre, jachère : Col. 2, 1, 3.
¶1. tarder, se montrer lent, lambiner, ne pas avancer, ne pas agir : quid cessas ? Pl. Epid. 684, que tardes-tu ? si tabellarii non cessarint Cic. Prov. 15, si les courriers ne traînent pas en route (s'ils font diligence) ; quod si cessas aut strenuus anteis, nec tardum opperior nec præcedentibus insto Hor. Ep. 1, 2, 70, que tu tardes ou au contraire que tu partes alerte de l'avant, je n'attends pas plus le lambin que je ne cours aux trousses de ceux qui me précèdent
— [avec inf.] tarder à faire qqch : cesso huc intro rumpere ? Ter. Eun. 996, je tarde à entrer ? = il est temps que j'entre (Pl. Epid. 342, etc.) : quid mori cessas ? Hor. O. 3, 27, 58, que tardes-tu à mourir ?
— [droit] ne pas comparaître au jour dit en justice, faire défaut : nullo delectu culpane quis an aliqua necessitate cessasset Suet. Cl. 15, sans distinguer si la personne avait fait défaut par sa faute ou par nécessité, cf. Ulp. Dig. 47, 10, 17, 20
— [fig.] tarder à venir, ne pas être présent : non deterendum id bonum, si quod ingenitum est, existimo, sed augendum addendumque quod cessat Quint. 2, 8, 10, s'il ne faut pas détruire, à mon avis, les bonnes qualités naturelles du futur orateur, par contre, il faut développer et stimuler celles qui sont lentes à venir
— ne pas arriver, manquer : quod cessat ex reditu, frugalitate suppletur Plin. Ep. 2, 4, 3, ce qui manque à mes revenus, ma frugalité le supplée
¶2. suspendre son activité, s'interrompre, se reposer : et properare loco et cessare Hor. Ep. 1, 7, 57, travailler activement et se reposer à propos ; strenuum hominem et numquam cessantem ! Curt. 7, 2, 26, quel homme actif et jamais au repos ! cur in lustris tam eximia virtus tam diu cessavit ? Cic. Sen. 13, pourquoi ce mérite si éclatant s'est-il reposé si longtemps dans les bouges ? epistulæ tuæ cessant Plin. Ep. 3, 17, 1, ta correspondance se ralentit
— [avec in abl.] : neque umquam in suo studio atque opere cessavit Cic. CM 13, jamais il ne s'interrompit dans ses études et son travail ; in officio cessare Liv. 45, 23, 10, se relâcher dans l'accomplissement de ses devoirs ; in quo quisque cessasset, prodi ab se salutem omnium rebatur Liv. 30, 9, 9, chacun croyait que se ralentir dans sa tâche (s'attarder, perdre son temps), c'était trahir la cause commune
— [avec abl.] : muliebri audacia cessare Liv. 1, 46, 6, ne pas avoir en soi l'audace ordinaire aux femmes ; se nullo usquam cessaturum officio Liv. 42, 6, 8, il ne se déroberait en aucune circonstance devant un service à rendre ; prima dies cessavit Marte cruento Luc. 4, 24, le premier jour se passa sans l'ensanglantement du combat
— [avec ab] s'arrêter de : ab apparatu operum nihil cessatum Liv. 21, 8, 1, on ne discontinua en rien les travaux (4, 27, 5 ; 10, 39, 6 ; 21, 11, 5, etc.) ; nec ullum erat tempus, quod a novæ semper cladis alicujus spectaculo cessaret Liv. 5, 42, 6, il n'y avait pas un instant qui cessât d'offrir le spectacle de quelque désastre toujours nouveau
— [avec in acc.] : cessas in vota precesque ? Virg. En. 6, 51, tu tardes à offrir tes vœux et tes prières ?
— [avec inf.] : Cyrum urgere non cesso Cic. Q. 2, 2, 1, je ne cesse pas de presser Cyrus (Att. 11, 11, 2 ; Pis. 59 ; Q. 3, 5, 1)
— [fig.] se relâcher, se négliger : qui multum cessat Hor. P. 357, l'écrivain qui a beaucoup de négligences ; (imago oratoris perfecti) et nulla parte cessantis Quint. 1, 10, 4 (l'image de l'orateur parfait) et qui ne bronche sur aucun point
¶3. être oisif, ne rien faire : nisi forte cessare nunc videor, cum bella non gero Cic. CM 18, à moins que je ne paraisse être oisif maintenant que je ne fais pas la guerre ; pueri, etiam cum cessant, exercitatione aliqua ludicra delectantur Cic. Nat. 1, 102, les enfants, même dans l'oisiveté, s'exercent (s'occupent) volontiers à quelque jeu ; in militibus vestris non cessat ira deæ Liv. 29, 18, 10, sur vos soldats la colère de la déesse n'est pas inactive (elle se manifeste)
— [poét.] consacrer ses loisirs à qqch, s'adonner à, cessare alicui rei = vacare alicui rei : Prop. 1, 6, 21
— être au repos : cur hic cessat cantharus ? Pl. Stich. 705, pourquoi cette coupe est-elle au repos ? cur Berecynthiæ cessant flamina tibiæ ? Hor. O. 3, 19, 19, pourquoi cesser de souffler dans la flûte Phrygienne ? cessat terra Ov. Tr. 3, 10, 70, la terre est au repos, reste en jachère (Virg. G. 1, 71 ; Plin. 18, 191 ; Col. 2, 2, 7)
¶4. [poét., emploi trans. au passif] : cessatis in arvis Ov. F. 4, 617, dans les champs laissés au repos (M. 10, 669 ; Val.-Max. 5, 10, 3).
===> .
¶1. nom d'un préteur : Cic. Phil. 3, 26
¶2. rhéteur célèbre : Sen. Suas. 7, 12
— -tiānus, a, um, de Cestius : Sen. Contr. 1, 7, 17.

¶1. nymphe de la mer, femme de Phorcus, mère des Gorgones : Luc. 9, 646
¶2. une Néréide : Plin. 5, 69.
¶1. comme, ainsi que : ceu quondam petiere rates Virg. En. 6, 492, comme jadis ils regagnèrent leurs vaisseaux ; ceu fumus Virg. En. 5, 740, comme une fumée ; ceu cum jam portum tetigere carinæ Virg. G. 1, 303, comme lorsque le navire touche au port
¶2. comme si :
a) [sans verbe] gloriosissimas victorias ceu damnosas reipublicæ increpabat Suet. Tib. 52, 2, il lui reprochait les victoires les plus glorieuses comme si elles avaient été des revers pour la patrie ;
b) [avec subj.] ceu cetera nusquam bella forent Virg. En. 2, 438, comme s'il n'y avait pas ailleurs de combats.
¶1. peuple de Belgique : Cæs. G. 5, 39, 1
¶2. peuple de la Gaule, dans les Alpes : Cæs. G. 1, 10, 4
— Ceutronĭcæ Alpes, massif dans les Alpes : Plin. 11, 240.
¶1. statuaire : Plin. 34, 75
¶2. auteur d'un traité d'agriculture : Varr. R. 1, 1, 8.
¶1. sorte de sardine : Plin. 9, 154
¶2. sorte de lézard à peau cuivrée : Plin. 32, 30.
¶1. Chalcis [capitale de l'Eubée] : Liv. 35, 46, 1

¶2. ville de Syrie : Plin. 5, 89
¶3. ville d'Étolie : Plin. 4, 6.
¶1. minerai de cuivre
¶2. pierre précieuse : Plin. 37, 191.

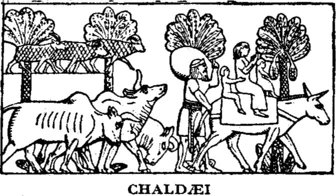
===> .
¶1. peuple du Pont, réputé pour ses mines et la fabrication de l'acier : Virg. G. 1, 58
¶2. peuple de Celtibérie : Just. 44, 3, 9.
¶1. caméléon : Gell. 10, 12, 1
¶2. m. et f., carline [plante] : Plin. 22, 45 ; 30, 30.
¶1. le chaos, masse confuse dont fut formé l'univers : a Chao Virg. G. 4, 347, à partir du Chaos [avant même la création du monde]
— le Chaos personnifié : Virg. En. 4, 510
— le vide infini, les Enfers : Ov. M. 10, 30
¶2. [fig.] profondes ténèbres : Stat. S. 3, 2, 92 ; chaos horridum Prud. Cat. 5, 3, ténèbres effrayantes.
¶1. sorte de roseau plus épais et plus solide : Plin. 16, 168
¶2. espèce d'euphorbe [plante] : Plin. 26, 62.
¶1. fer à marquer les bestiaux : Isid. Or. 20, 16, 7
— marque au fer : Col. 11, 2, 14
¶2. [fig.] caractère, particularité d'un style : Luciliano charactere libelli Varr. R. 3, 2, 17, satires dans la manière de Lucilius [en grec d. Cic. Or. 134].
¶1. rivière de Phocide : Stat. Th. 4, 46
¶2. f., ville de Syrie : Plin. 5, 79.
¶1. statuaire grec : Her. 4, 9
¶2. historien grec : Gell. 5, 2, 1
¶3. le Cher [rivière] : Fort. Carm. 7, 4, 15.
¶1. orateur athénien : Cic. Br. 286
¶2. grammairien latin : Serv. En. 9, 329.
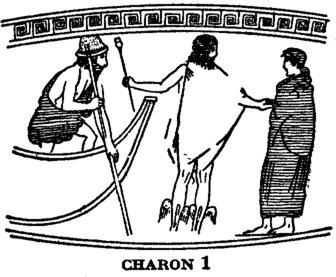
¶1. papier : charta dentata Cic. Q. 2, 14, 1, papier lustré ; chartæ scabræ bibulæve Plin. Ep. 8, 15, 2, papier raboteux ou qui boit ; scribere in charta aversa Mart. 8, 62, 1, écrire sur le verso d'un feuillet ; calamum et chartas poscere Hor. Ep. 2, 1, 11, réclamer une plume et du papier
¶2. papyrus [plante] : Plin. 13, 69
¶3. [fig.] écrit, livre : chartæ quoque, quæ pristinam severitatem continebant, obsoleverunt Cic. Cæl. 40, les livres même qui témoignaient de l'austérité des anciennes mœurs sont passés de mode ; chartæ Socraticæ Hor. P. 310, les écrits Socratiques
— volume : omne ævum tribus explicare chartis Catul. 1, 6, dérouler toute la suite des temps en trois volumes
¶4. feuille de métal : charta plumbea Suet. Ner. 20, 1, feuille de plomb.
===> chartus, i, m. Lucil. 709 ; Non. 196, 19.
¶1. petit papier, petit écrit : miror quid in illa chartula fuerit Cic. Fam. 7, 18, 2, je me demande ce qu'il pouvait y avoir sur ce bout de papier
¶2. acte, pièce : Cod. Th. 8, 2, 2
— chartulæ, ārum, f., actes des martyrs : Prud. Peri. 1, 75.
===> .
¶1. gouffre du sol : tum chasmata aperiuntur Sen. Nat. 6, 9, alors des gouffres s'ouvrent
¶2. espèce de météore : Sen. Nat. 1, 14 ; Plin. 2, 96.
¶1. pince de l'écrevisse : Ambr. Hex. 5, 8, 22 [dans le texte chelam]
— surt. au pl. chelæ, ārum, les pinces du Scorpion, la Balance : Cic. Arat. 293 ; Virg. G. 1, 33
¶2. bras de la baliste : Vitr. 10, 10, 4.
¶1. crampon [dans div. machines] : Vitr. 10, 2, 2
¶2. cyclamen [plante] : Apul. Herb. 17.
a) lyre : Ov. H. 15, 181 ; Stat. S. 1, 5, 11 ;
b) la Lyre [constell.] : Avien. Arat. 617.
¶1. sorte de coquille : Plin. 32, 147
¶2. mesure grecque pour les liquides : Carm. de Pond. 78.
¶1. monstre fabuleux : Lucr. 5, 902 ; flammam volvens ore Chimæra Tib. 3, 4, 86, la Chimère qui vomit des flammes
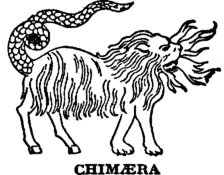
¶2. volcan de Lycie : Plin. 2, 236
¶3. un des vaisseaux d'Énée : Virg. En. 5, 118.
¶1. l'écriture, la main de quelqu'un : quo me teste convincas ? an chirographo ? Cic. Phil. 2, 8, quelle preuve aurais-tu contre moi ? mon écriture ?
¶2. ce qu'on écrit de sa propre main : Cic. Br. 277 ; Fam. 2, 13, 3
¶3. engagement signé, reçu, obligation, reconnaissance : chirographi exhibitio Gell. 14, 2, 7, l'exhibition du reçu ; cf. Sen. Contr. 6, 1 ; Sen. Ben. 2, 23, 2.

¶1. fleuve de Cilicie : Plin. 5, 91
¶2. nom d'homme : Cic. Verr. 2, 23.
¶1. fleuve de Médie : Tib. 4, 1, 140
¶2. fleuve de l'Inde : Curt. 8, 10, 22.
¶1. matériel scénique, décors : Pl. Capt. 61 ; procurator summi choragii CIL 3, 348, metteur en scène du théâtre impérial
— [fig.] appareil somptueux : Apul. M. 2, 20
¶2. ressort : Vitr. 10, 8, 4.
¶1. tripe : Petr. 66, 7
¶2. [fig.]
a) corde d'un instrument de musique : Cic. de Or. 3, 216 ; Varr. L. 10, 46 ; impellere pollice chordas Tib. 2, 5, 3, préluder sur la lyre ;
b) corde, ficelle : Pl. Most. 743.
¶1. danse en rond, en chœur : chorus et cantus Tib. 1, 7, 44, la danse et le chant ; leves nympharum chori Hor. O. 1, 1, 31, les danses légères des nymphes ; choros agitare Virg. G. 4, 533, se livrer à la danse
— mouvement harmonieux des astres : Tib. 2, 1, 88
¶2. troupe qui danse en chantant, chœur : saltatores, citharistas totumque comissationis Antonianæ chorum Cic. Phil. 5, 16, danseurs, joueurs de cithare et toute la troupe qui figure aux orgies d'Antoine ; adit Idam properante pede chorus Catul. 63, 30, la troupe dansante gravit prestement l'Ida ; chorus Dryadum Virg. G. 4, 460, le chœur des Dryades
— [en part.] le chœur dans la tragédie : Hor. P. 193
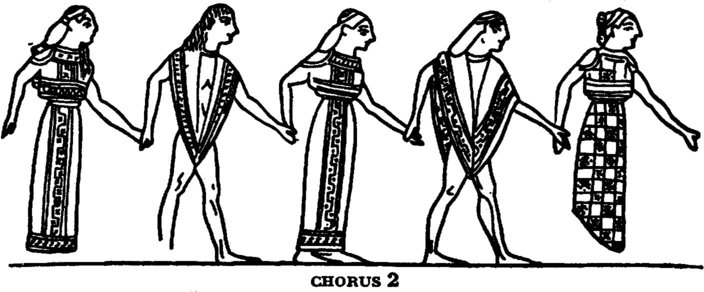
¶3. troupe [en gén.], cortège, foule : Catilina stipatus choro juventutis Cic. Mur. 49, Catilina escorté d'une foule de jeunes gens ; philosophorum chorus Cic. Fin. 1, 26, le chœur des philosophes ; scriptorum chorus Hor. Ep. 2, 2, 77, la troupe des écrivains.
¶1. nom d'homme : Cic. Fam. 2, 8, 1
¶2. le Christ : Suet. Cl. 25, 4 ; Lact. Inst. 4, 7, 5.
¶1. teint hâlé : chroma facere Porphyr. Hor. Ep. 1, 20, 24, se brunir la peau
¶2. la gamme chromatique [musique] : Vitr. 5, 4, 3.
¶1. relatif à la chronologie : chronici libri Gell. 17, 21, 1 et chrŏnĭca, ōrum, n. Plin. 35, 58, chroniques, ouvrages de chronologie
¶2. chronique [méd.] : chronici morbi Isid. 4, 7, malaises chroniques.
¶1. ville de Mysie
¶2. île près de la Crète : Plin. 4, 61
¶3. île de l'embouchure de l'Indus : Mel. 3, 7, 7.
¶1. nourriture : cibarium, vestiarium Sen. Ben. 3, 21, 2, la nourriture et le vêtement, cf. Scæv. Dig. 34, 1, 15
¶2. farine grossière : Plin. 18, 87.
¶1. qui concerne la nourriture : summa res cibaria Pl. Capt. 901, la direction du ravitaillement ; cibaria uva Plin. 14, 37, raisin de table
¶2. commun, grossier [en parl. des aliments] : panis cibarius Cic. Tusc. 5, 97, pain grossier ; vinum cibarium Varr. Men. 319, piquette
— [fig.] de la basse classe : Varr. d. Non. 2, 188.
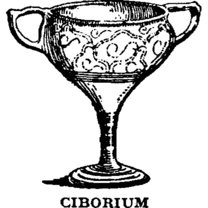
¶1. nourriture, aliment [de l'homme, des animaux ou des plantes], mets, repas : cibus gravis Cic. Nat. 2, 24, aliment indigeste ; cibus facillimus ad concoquendum Cic. Tusc. 2, 64, aliment très facile à digérer ; plurimi cibi esse Suet. Galb. 22, être gros mangeur, cf. Cic. Fam. 9, 26, 4 ; maximi cibi esse Varr. R. 2, 11, être très nourrissant ; abstinere se cibo Nep. Att. 22, s'abstenir de manger ; cibus arborum imber Plin. 17, 12, la pluie est la nourriture des arbres
— [fig.] aliment, nourriture : omnia pro cibo furoris accipit Ov. M. 6, 480, tout sert d'aliment à sa fureur
— pl. cibi = espèces de nourriture : Cic. Nat. 2, 146
¶2. suc des aliments, sève : Cic. Nat. 2, 137 ; cibus per ramos diffunditur Lucr. 1, 352, la sève se diffuse dans les rameaux
¶3. appât : cum hamos abdidit ante cibus Tib. 2, 6, 24, quand l'appât cache l'hameçon.
¶1. cicatrice, marque que laisse une plaie : luculentam plagam accepit, ut declarat cicatrix Cic. Phil. 7, 17, il a reçu un fameux coup, la cicatrice en fait foi ; cicatrices adversæ Cic. de Or. 2, 124, cicatrices de blessures reçues de face ; vulnus venit ad cicatricem Sen. Ep. 2, 2, la blessure se cicatrise ; cicatricem ducere Liv. 29, 32, 12 ; Ov. Pont. 1, 3, 15 (inducere Cels. 3, 21 ; obducere Curt. 4, 6, 24 ; glutinare Plin. 33, 105) cicatriser [une plaie] ; cicatricem trahere Plin. 30, 113, se cicatriser ; emplastrum cicatricem ducit ulceris Scrib. Comp. 214, l'emplâtre cicatrise la plaie
— [fig.] refricare obductam, reipublicæ cicatricem Cic. Agr. 3, 4, rouvrir la plaie cicatrisée de l'État
¶2. écorchure faite à un arbre : cicatrix in hac arbore non coït Plin. 17, 235, la blessure faite à cet arbre ne se ferme pas
¶3. égratignure, crevasse : cicatrices operis Plin. 34, 63, les parties mutilées d'une statue
¶4. reprise [à un soulier] : Juv. 3, 151.
===> pl. inusité.

¶1. cigogne : Hor. S. 2, 2, 49
— [geste de moquerie] : si respexeris, ciconiarum deprehendes post te colla curvari Hier. Ep. 125, 18, en te retournant tu verras qu'on singe derrière toi le cou des cigognes ; cf. Pers. 1, 58
¶2. espèce d'équerre : Col. 3, 13, 11
¶3. appareil à puiser l'eau [fait d'une longue perche montée sur pivot] : Isid. 20, 15, 3.
¶1. mettre en mouvement : naturæ ista sunt omnia cientis et agitantis motibus et mutationibus suis Cic. Nat. 3, 27, tout cela est un effet de la nature qui en se mouvant et se modifiant elle-même communique à toutes choses le branle et l'agitation ; quod est animal, id motu cietur interiore et suo Cic. Tusc. l, 54, ce qui est animé, se meut par une action intérieure qui lui est propre ; ignis vento citus Tac. An. 15, 38, flamme poussée par le vent ; [fig.] ingentem molem irarum ex alto animo Liv. 9, 7, 3, soulever du fond de l'âme une masse formidable de colères
— [au jeu d'échecs] : calcem ciere Pl. Pœn. 908, pousser un pion
— herctum ciere Cic. de Or. 1, 237 (v. herctum), partager un héritage ; hercto non cito, id est patrimonio vel hereditate non divisa Serv. En. 8, 642, le partage n'étant pas effectué, c.-à-d. le patrimoine ou la succession restant dans l'indivision
— pousser, faire aller, faire venir, appeler (au combat, aux armes) : ære ciere viros Virg. En. 6, 165, pousser au combat (animer les guerriers) aux accents de l'airain ; ad arma ceteros ciens Liv. 5, 47, 4, appelant les autres aux armes ; illi, quos cum maxime Vitellius in nos ciet Tac. H. 1, 84, ceux-là même qu'en ce moment Vitellius pousse contre nous
— faire venir, appeler [au secours] : Allecto dirarum ab sede dearum ciet Virg. En. 7, 325, elle fait venir Allecto du séjour des Furies ; non homines tantum, sed fœdera et deos ciebamus Liv. 22, 14, 7, nous invoquions non seulement les hommes, mais les traités et les dieux ; locum pugnæ testem virtutis ciens Tac. H. 5, 17, invoquant le champ de bataille comme témoin de leur valeur
— remuer, ébranler, agiter : tonitru cælum omne ciebo Virg. En. 4, 122, j'ébranlerai tout le ciel du bruit de la foudre ; imo Nereus ciet æquora fundo Virg. En. 2, 419, Nérée bouleverse les mers dans leurs profondeurs
— [t. mil.] maintenir en mouvement, animer : principes utrimque pugnam ciebant Liv. 1, 21, 2, de part et d'autre les chefs animaient le combat, (cf. 2, 47, 1 ; 3, 18, 8, etc.)
¶2. donner le branle à, provoquer, produire, exciter : motus ciere Cic. Nat. 2, 81, exciter (provoquer) des mouvements ; lacrimas Virg. En. 6, 468, donner le branle à ses larmes, verser des larmes ; fletus Virg. En. 3, 344, pousser des gémissements, cf. G. 3, 517
— bella cient Virg. En. 1, 541, ils provoquent la guerre ; hoste ab Oceano bellum ciente Liv. 5, 37, 2, un ennemi venant depuis l'Océan déchaîner la guerre ; seditiones Liv. 4, 52, 2, chercher à provoquer des séditions ; quid vanos tumultus ciemus ? Liv. 41, 24, 17, pourquoi provoquons-nous de vaines alarmes ?
— [médec.] alvum Plin. 20, 96 ; urinam Plin. 27, 48 ; menses Plin. 26, 151, faire aller à la selle, provoquer les urines, les règles
¶3. faire sortir des sons, émettre des sons : tinnitus cie Virg. G. 4, 64, fais retentir les sons de l'airain ; voces Lucr. 5, 1060, émettre des sons, pousser des cris ; mugitus Virg. En. 12, 104, pousser des mugissements
— appeler, nommer : alternis nomen utrumque ciet Ov. F. 4, 484, elle prononce alternativement les deux noms ; singulos nomine ciens Tac. An. 2, 81, les appelant chacun par leur nom ; triumphum nomine cient Liv. 45, 38, 12 (= io triumphe ! exclamant), ils font retentir le cri « triumphe ! »
— [droit] : patrem ciere Liv. 10, 8, 10, désigner son père [= prouver qu'on est de naissance légitime]; consulem patrem ciere possum Liv. 10, 8, 10, je puis désigner pour mon père un consul.
===> la forme cio, cire, qui se trouve en compos. (accio, concio, etc.), est rare : Mart. 4, 90, 4 ; Col. 6, 5, 1 ; Lucr. 1, 212 ; 5, 211.

¶1. Tillius Cimber [un des meurtriers de César] : Cic. Phil. 2, 27
¶2. un Cimbre : Quint. 8, 3, 29, v. Cimbri.
¶1. peuple de Scythie : Plin. 6, 35
¶2. peuple fabuleux enveloppé de ténèbres : Cic. Ac. 2, 61
— -ĭus, a, um, Cimmérien : Sil. 12, 132
— [fig.] où règne une profonde obscurité : Lact. 5, 3, 23.
¶1. ancienne ville de Campanie : Plin. 3, 61
¶2. ville sur le Bosphore Cimmérien : Plin. 4, 78.
¶1. celui qui a des passions contre nature, mignon : Pl., Catul., Juv. 2, 10 ; cf. Non. 5 ; Gloss. 5, 654
¶2. poisson inconnu : Plin. 32, 146.

¶1. action ou manière de se ceindre : Plin. 28, 64 ; cinctus Gabinus, manière de porter la toge comme les habitants de Gabies : Virg. En. 7, 612 et Serv. ; Liv. 5, 36, 2

¶2. ceinture d'un vêtement : Suet. Ner. 51
¶3. sorte de jupe : Porph. Hor. P. 50 ; [servait en part. aux jeunes gens dans leurs exercices : Isid. Orig. 19, 33, 1], cf. Varr. L. 5, 114
¶4. la ceinture [partie du corps] : Fulg. Myth. 3, 7.
¶1. collum resticula Cic. Scaur. 10, entourer le cou d'une cordelette ; cingens materna tempora myrto Virg. G. 1, 28, ceignant ton front du myrte consacré à ta mère ; frondes tempora cingunt Ov. F. 3, 481, le feuillage couronne les tempes ; de tenero flore caput cingere Ov. F. 3, 254, couronner sa tête de tendres fleurs
— [en parl. d'armes, passif sens réfléchi] avec abl. : cingi gladio, armis, ferro, ense, etc., se ceindre d'un glaive, d'une épée, se couvrir de ses armes : Liv. 7, 10, 5 ; 8, 5, 7, etc.; Virg. En. 2, 749, etc.; Curt. 6, 10, 21 ; Ov. F. 2, 13 ; [poét.] avec acc. : (Priamus) inutile ferrum cingitur Virg. En. 2, 511, (Priam) se ceint d'un fer inutile ; [abst] s'armer : cingitur in prœlia Turnus Virg. En. 11, 486, Turnus s'arme pour le combat ; [au fig.] aliqua re cingi, se munir de qqch : V.-Flac. 6, 477
¶2. retrousser, relever par une ceinture : puer alte cinctus Hor. S. 2, 8, 10, esclave dont la tunique est retroussée haut ; alte cincti Sen. Ep. 33, 2, les peuples à toge relevée ; [fig.] alte cinctus Sen. Ep. 92, 35, homme résolu ; cinctas resolvite vestes Ov. M. 1, 386, détachez les ceintures qui retiennent vos vêtements
¶3. entourer, environner : urbem mœnibus Cic. Nat. 3, 94, faire à une ville une ceinture de murailles ; oppidum vallo et fossa Cic. Att. 5, 20, 5, entourer une place d'un retranchement et d'un fossé ; flumen pæne totum oppidum cingit Cæs. G. 1, 38, 4, le fleuve entoure presque entièrement la ville ; flammis cincta Virg. En. 12, 811, entourée de flammes ; cinxerunt æthera nimbi Virg. En. 5, 13, les nuages ont enveloppé le ciel
— non corona consessus vester cinctus est, ut solebat Cic. Mil. 2, votre assemblée n'est pas entourée de son cercle ordinaire [d'auditeurs]; latus cingit tibi turba senatus Ov. P. 4, 9, 17, la foule des sénateurs se presse à tes côtés ; latera regis duo filii cingebant Liv. 40, 6, 4, le roi avait à ses côtés ses deux fils ; (cycni) cœtu cinxere polum Virg. En. 1, 398, (des cygnes) la bande a envahi le ciel
— [fig.] Sicilia multis undique cincta periculis Cic. Pomp. 30, la Sicile environnée de toutes parts de dangers multiples
— [t. mil.] protéger, couvrir : equitatus latera cingebat Cæs. C. 1, 83, 2, la cavalerie couvrait les flancs ; equites cornua cinxere Liv. 23, 29, 3, les cavaliers couvrirent les ailes ; murum cingere, garnir le rempart [de défenseurs] : Cæs. G. 6, 35, 9 ; 7, 72, 2 ; Liv. 4, 27, 7.
¶1. cendre : cinis exstinctus Suet. Tib. 74, cendre refroidie ; cinere multa obrutus ignis Lucr. 4, 924, feu caché sous un amas de cendre
— cendre [de ville], ruine : Cic. Cat. 2, 19 ; Sull. 19
¶2. cendres des morts, restes brûlés : obsecravit per fratris sui cinerem Cic. Quinct. 97, il le supplia par les cendres de son frère ; jura per patroni tui cineres Quint. 9, 2, 95, jure par les cendres de ton patron
— [fig.]
a) mort, défunt : dummodo absolvar cinis Phæd. 3, 9, 4, pourvu qu'on me rende justice quand je ne serai plus ;
b) la mort : post cineres Mart. 1, 1, 6, après la mort ;
c) néant : cinerem fieri Pl. Rud. 1257, être anéanti.
¶1. L. Cornelius Cinna [consul avec Marius] : Cic. Tusc. 5, 54
¶2. conspirateur gracié par Auguste : Sen. Clem. 1, 9, 1
¶3. Helvius Cinna [poète, ami de Catulle] : Catul. 10, 31.
===> .
¶1. cippe, colonne funéraire : Hor. S. 1, 8, 11 ; cf. Fest. 339 ; Pers. 1, 37 ; Gell. 16, 7, 9
— [fig.] cippes, pieux dans les trous de loups : Cæs. G. 7, 73, 4
¶2. borne d'un champ : Varr. L. 5, 143 ; Grom.
I. adv.,
¶1. autour, tout autour à l'entour : campus ante montibus circa sæptus erat Liv. 28, 33, 2, la plaine en avant était fermée tout autour par des montagnes ; montes qui circa sunt Liv. 1, 4, 6, montagnes qui sont voisines (à l'entour)
— aliquot circa urbes Liv. 10, 34, 13, plusieurs villes des environs ; urbes circa subigit Liv. 30, 9, 2, il soumet les villes voisines ; omnia contra circaque hostium plena erant Liv. 5, 37, 8, tout, en face et à l'entour, était plein d'ennemis
¶2. = utrubique : duabus circa portis Liv. 23, 16, 8, aux deux portes de part et d'autre ; binæ circa eminebant falces Liv. 37, 41, 7, des deux côtés sortaient deux faux ; quattuor legionum aquilæ per frontem, totidem circa Tac. H. 2, 89, les aigles de quatre légions sur le front, autant sur les côtés.
II. prép. avec acc.
¶1. autour de : circa urbem Liv. 7, 38, 7, autour de la ville ; quam circa lacus lucique sunt plurimi Cic. Verr. 4, 107, autour d'elle [ville d'Henna] il y a un très grand nombre de lacs et de bois sacrés ; (canes) quos iste dixerat esse circa se multos Cic. Verr. 1, 133, (des chiens) qu'il avait en grand nombre, disait-il, dans son entourage ; circa se habens duos filios Liv. 42, 52, 5, ayant ses deux fils à ses côtés
— dans le voisinage de : circa montem Amanum Cæs. C. 3, 31, 1, dans les parages du mont Amanus
— [fig.] à propos de, par rapport a, à l'égard de, au sujet de, [époque impériale] : omne tempus circa Thyestem consumere Tac. D. 3, consacrer tout son temps à Thyeste [tragédie]; circa eosdem sensus certamen Quint. 10, 5, 5, lutte (émulation) touchant les mêmes idées ; circa verba dissensio Quint. 3, 11, 5, dissentiment sur des mots ; publica circa bonas artes socordia Tac. An. 11, 15, indifférence publique pour les connaissances utiles
— vers : circa initia primi libri Quint. 1, 5, 44, vers le (au) commencement du premier livre ; circa finem Quint. 4, 3, 5, vers la fin
¶2. à la ronde, de tous côtés, d'un endroit à un autre successivement : multis circa finitimos populos legationibus missis Liv. 4, 12, 9, de nombreuses ambassades ayant été envoyées à tous les peuples voisins à la ronde ; circa domos ire Liv. 26, 13, 1, parcourir les maisons à la ronde ; litteras circa præfectos dimittere Liv. 42, 51, 1, envoyer un message à tous les commandants de garnisons ; litteris circa Latium missis Liv. 8, 11, 10, des lettres étant envoyées dans tout le Latium (de tous côtés dans le Latium)
¶3. [sens temporel] : aux environs de, vers : circa eamdem horam Liv. 42, 57, 10, vers la même heure ; circa lucis ortum Curt. 5, 3, 7, vers le lever du jour ; circa lucem Sen. Nat. 5, 8, 2, vers le point du jour
— circa captas Carthaginem et Corinthum Plin. 14, 45, vers l'époque de la prise de Carthage et de Corinthe ; circa Demetrium Phalerea Quint. 2, 4, 41, à peu près du temps de Démétrius de Phalère
¶4. [avec noms de n.] environ : oppida circa septuaginta Liv. 45, 34, 6, places fortes au nombre de soixante-dix environ ; circa quingentos Romanorum sociorumque victores ceciderunt Liv. 27, 42, 8, parmi les Romains et les alliés, environ cinq cents tombèrent victorieux.
¶1. de Circé : Circæum poculum Cic. Cæcil. 57, breuvage magique ; Circæa mœnia Hor. Epo. 1, 30, remparts Circéens (Tusculum, bâtie par le fils de Circé)
¶2. de Circeii : Circæa terra Virg. En. 7, 10, terre de Circé = promontoire de Circeii.

¶1. petit cercle : Sch. Juv. 6, 379
¶2. boudin : Apic. 2, 60.
===> formes circiensis, circuensis, circeiensis : Inscr.
¶1. compas : flumen Dubis, ut circino circumductum Cæs. G. 1, 38, le Doubs, pour ainsi dire mené tout autour à l'aide d'un compas (formant comme un cercle tracé au compas) ; circino dimetiri Vitr. 9, 7, 2, mesurer au compas
— ad circinum, au compas, [d'où] en cercle : Vitr. 3, 5, 8 ; 5, 3, 7
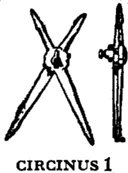
¶2. [fig.] sorte d'herpès [maladie] : Pl.-Val. 3, 33.
¶1. adv.,
a) à l'entour : lapis circiter quadratus Hemin. d. Plin. 13, 85, pierre cubique [carrée en tous sens];
b) environ, à peu près : circiter pars quarta Sall. C. 56, à peu près le quart, cf. Cic. Att. 6, 3, 5 ; Rep. 2, 60 ; Cæs. G. 1, 49, etc.
¶2. prép. av. acc.,
a) dans le voisinage de : circiter hæc loca Pl. Cist. 677, dans le voisinage ;
b) vers, environ, à peu près : circiter meridiem Cæs. G. 1, 50, 2, autour de midi ; circiter messem hordaceam Varr. R. 2, 11, vers le temps où on moissonne l'orge, cf. Cic. Verr. 2, 148 ; Att. 2, 4, 6.
¶1. nom d'une pierre précieuse : Plin. 37, 153
¶2. oiseau de proie : Gloss. 2, 100, 27.
¶1. ronde, patrouille : Liv. 3, 6, 9
— tour, pourtour, espace circulaire : Vitr. 4, 8, 2
— courbe : circumitio fluminis Amm. 24, 2, 2, courbe d'un fleuve
¶2. circonlocution, procédé détourné : circumitione quadam deos tollens Cic. Div. 2, 40, supprimant par un certain détour l'existence des dieux, cf. Div. 2, 127.
¶1. action de faire le tour, marche circulaire : circuitus solis orbium Cic. Nat. 2, 49, les révolutions du soleil autour de la terre [les 365 jours de l'année]
— détour : circuitu milium quinquaginta Cæs. G. 1, 41, 4, en faisant un détour de 50 milles
— retour périodique [d'une maladie] : tertianarum febrium certus circuitus Cels. 3, 5, la fièvre tierce revient à date fixe
¶2. circuit, tour, enceinte : vallum pedum in circuitu XV milium Cæs. G. 2, 30, 1, fossé de 15 000 pieds de tour ; minorem circuitum habere Cæs. C. 3, 44, 5, embrasser un moindre pourtour
— espace libre laissé autour d'un bâtiment : Varr. L. 5, 22
¶3. [rhét.]
a) période : Cic. Or. 204 ;
b) circonlocution, périphrase : loqui aliquid per circuitus Mart. 11, 15, employer des périphrases, cf. Quint. 8, 6, 59 ; 10, 1, 12.
¶1. cercle : Cic. Nat. 2, 47
— cercle, zone du ciel : Varr. L. 9, 18 ; circulus lacteus Plin. 18, 230, la voie lactée
— révolution d'un astre : stellæ circulos suos conficiunt Cic. Rep. 6, 15, les étoiles accomplissent leurs révolutions
¶2. objet de forme circulaire : circulus corneus Suet. Aug. 80, anneau de corne ; circulus auri obtorti Virg. En. 5, 559, collier d'or tordu en anneaux
— gâteau : Varr. L. 5, 106
¶3. cercle, assemblée, réunion : sermo in circulis est liberior Cic. Att. 2, 18, dans les cercles on a la parole plus libre, cf. Balb. 57 ; de Or. 1, 159 ; Liv. 3, 17, 10 ; circulus pullatus Quint. 2, 12, 10, réunion de pauvres diables.
I. adv.
¶1. autour, à l'entour : quæ circum essent opera tueri Cæs. C. 2, 10, 1, voir quels étaient les ouvrages construits à l'entour ; turbati circum milites Tac. An. 1, 65, tout autour les soldats en désordre ; una undique circum fundimur Virg. En. 3, 635, tous à la fois nous l'environnons de toutes parts ; circum undique Gell. 4, 5, 3, etc., de toutes parts, de tous côtés
¶2. des deux côtés : aram amicitiæ effigiesque circum Cæsaris ac Sejani censuere Tac. An. 4, 74, on décréta un autel à l'amitié, (entouré de) avec de part et d'autre les statues de Tibère et de Séjan.
II. prép. avec acc. :
¶1. autour de : terra circum axem se convertit Cic. Ac. 2, 123, la terre tourne autour de son axe
— hunc circum Arctœ duæ feruntur Cic. Nat. 2, 105, autour de lui tournent les deux Ourses
— templa quæ circum forum sunt Cic. Opt. 10, les temples qui entourent le forum (qui forment le pourtour du...)
¶2. à la ronde, dans des endroits divers, successivement : pueros circum amicos dimittit Cic. Quinct. 25, il dépêche des esclaves à tous ses amis à la ronde ; eos circum omnia provinciæ fora rapiebat Cic. Verr. 4, 76, il les entraînait successivement dans tous les centres d'assises de la province ; concursare circum tabernas Cic. Cat. 4, 17, courir de boutique en boutique, faire le tour des boutiques ; circum oram maritimam misit ut Liv. 29, 24, 9, par toute la côte il envoya l'ordre de
¶3. à proximité de, dans le voisinage de : circum hæc loca commorabor Cic. Att. 3, 17, 2, je m'arrêterai près de ces lieux (dans le voisinage) ; legiones quæ circum Aquileiam hiemabant Cæs. G. 1, 10, 3, les légions qui avaient leurs quartiers d'hiver dans les parages d'Aquilée ; urbes quæ circum Capuam sunt Cic. Agr. 1, 20, les villes qui sont dans les alentours de Capoue (qui avoisinent...)
¶4. auprès de qqn, dans l'entourage de qqn : eos qui circum illum sunt Cic. Att. 9, 9, 4, ceux qui l'accompagnent (son entourage) ; Hectora circum pugnas obibat Virg. En. 6, 166, aux côtés d'Hector, il prenait part aux combats.
¶1. mener (pousser) tout autour, faire faire le tour : impera suovetaurilia circumagi Cat. Agr. 141, 1, ordonne que les suovétaurilies fassent le tour [de la propriété]
— sulcum circumagere Varr. L. 5, 143, mener (tracer) un sillon tout autour
— [avec deux acc.] : fundum meum suovetaurilia circumagi jussi Cat. Agr. 141, 2, j'ai ordonné qu'on conduise autour de ma propriété les suovétaurilies
— se circumagere ou circumagi, se porter tout autour, effectuer un circuit : quacumque se classis circumegerat per litorum anfractus Liv. 38, 7, 3, sur quelque point que se portât la flotte après un circuit le long des sinuosités du rivage ; circumacta inde ad alterum insulæ latus Liv. 27, 6, 14, [la flotte] ayant fait le tour pour se porter de là sur l'autre côté de l'île (sur la côte opposée)
— [en parl. des esclaves] circumagi, être affranchi [parce que le maître, tenant l'esclave par la main droite, le faisait tourner sur lui-même en signe d'affranchissement] : Sen. Ep. 8, 7
¶2. faire tourner, retourner : frenis equos Liv. 1, 14, 6, tourner bride ; circumacto agmine Liv. 3, 8, 8, la colonne ayant fait demi-tour ; circumagit aciem Liv. 42, 64, 5, il fait faire volte-face à son armée ; cum superato promuntorio ad mœnia urbis circumagere classem vellent Liv. 31, 45, 14, alors que, ayant doublé le promontoire, ils voulaient tourner la flotte vers les murailles de la ville ; verticem Sen. Ep. 74, 3, tourner la tête
— se circumagere ou circumagi, se tourner, se retourner : circumagente se vento Liv. 37, 16, 4, le vent tournant ; vita in contrarium circumacta Sen. Ep. 122, 13, une existence qui se tournait en sens inverse des autres (menée à rebours) ; circumagetur hic orbis Liv. 42, 42, 6, ce cercle des événements tournera en sens inverse (les affaires changeront de face)
¶3. [fig.] se circumagere ou circumagi, accomplir une révolution : circum tribus actis annis Lucr. 5, 883, après trois ans révolus ; circumactis decem et octo mensibus Liv. 9, 33, 4, après dix-huit mois révolus, cf. 3, 8, 1 ; 26, 40, 1, etc.; in ipso conatu rerum circumegit se annus Liv. 9, 18, 14, les opérations étaient dans leur plein développement quand l'année s'est écoulée, cf. 24, 8, 8 ; prius se æstas circumegit quam Liv. 23, 39, 4, l'été se passa sans que...
— cum videamus tot varietates tam volubili orbe circumagi Plin. Ep. 4, 24, 6, quand nous voyons tant d'événements divers se dérouler dans une révolution si rapide
¶4. circumagi, être poussé de côté et d'autre, [ou] se porter de côté et d'autre : dux huc illuc clamoribus hostium circumagi Tac. H. 3, 73, le chef était porté tantôt d'un côté tantôt de l'autre par les cris des ennemis (les cris des ennemis le ballotaient...); nil opus est te circumagi Hor. S. 1, 9, 17, il n'est pas nécessaire que tu te promènes de côté et d'autre ; spiritus hoc atque illo circumagitur Sen. Nat. 6, 14, 4, l'air s'agite en tous sens
— [fig.] alieni momentis animi circumagi Liv. 39, 5, 3, se laisser aller à l'aventure sous l'impulsion d'une volonté étrangère ; rumoribus vulgi Liv. 44, 34, 4, se laisser mener par les propos de la foule.
¶1. couper autour, tailler, rogner : ars agricolarum, quæ circumcidit, amputat Cic. Fin. 5, 39, l'art du cultivateur qui élague, retranche ; circumcidere cespites gladiis Cæs. G. 5, 42, 3, découper des mottes de gazon avec l'épée ; ungues Cels. 7, 26, 2, tailler les ongles
— [en part.] circoncire : Petr. 102, 14
¶2. [fig.] supprimer, réduire, diminuer : circumcisa omni inanitate Cic. Fin. 1, 44, en supprimant toutes les idées vaines ; sumptus circumcisi aut sublati Liv. 32, 27, 4, les dépenses furent réduites ou même supprimées
— [rhét.] élaguer, retrancher : circumcidat si quid redundabit Quint. 10, 2, 27, qu'il retranche tout ce qui sera superflu.
¶1. part. de circumcido
¶2. pris adjt, abrupt, escarpé : collis ex omni parte circumcisus Cæs. G. 7, 36, 5, colline à pic de tous côtés, cf. Cic. Verr. 4, 107
— [fig.] raccourci, court, concis : quid tam circumcisum quam hominis vita longissima ? Plin. Ep. 3, 7, 11, quoi de plus court que la vie la plus longue ? orationes circumcisæ et breves Plin. Ep. 1, 20, 4, discours concis et brefs.
¶1. int., courir autour : Lucr. 4, 400
— courir de côté et d'autre, à la ronde : hac illac circumcursa Ter. Haut. 512, cours de tous les côtés
¶2. tr., courir autour de (aliquem, de qqn) : Catul. 68, 133
— parcourir à la ronde : omnia circumcursavi Pl. Rud. 223, j'ai tout parcouru.
¶1. placer autour : ligna et sarmenta Cic. Verr. 1, 69, disposer tout autour du bois et des fagots de sarment ; fossa valloque circumdatis Liv. 36, 45, 8, un fossé et une palissade ayant été établis à l'entour ; turres toto opere circumdedit Cæs. G. 7, 72, 4, sur toute l'étendue de l'ouvrage il éleva un cercle de tours
¶2. [avec dat.] rei rem circumdare : fossam latam cubiculari lecto Cic. Tusc. 5, 59, établir un large fossé autour de son lit ; murum urbi Liv. 41, 20, 6, construire un mur autour de la ville ; torquem collo circumdedit suo Liv. 7, 10, 11, il passa le collier autour de son cou ; contioni satellites armatos Liv. 34, 27, 5, disposer des satellites armés autour de l'assemblée
— cancellos quos mihi ipse circumdedi Cic. Quinct. 36, les barrières dont je me suis moi-même entouré ; circumdare principi ministeria Tac. H. 2, 59, [mettre autour du prince], constituer au prince ses services ; pavidi supremis suis secretum circumdant Tac. An. 16, 25, les craintifs entourent de mystère leurs derniers moments ; egregiam famam paci circumdedit Tac. Agr. 20, il entoura la paix d'un excellent renom
— [poét.] Sidoniam picto chlamydem circumdata limbo Virg. En. 4, 137, [Didon] s'étant revêtue d'une chlamyde tyrienne avec frange brodée
¶3. [avec abl.] aliquid (aliquem) aliqua re, entourer qqch (qqn) de qqch : oppidum vallo et fossa circumdedi Cic. Fam. 15, 4, 10, j'ai entouré la place d'une palissade et d'un fossé ; reliquos equitatu circumdederant Cæs. G. 4, 32, 5, ils avaient cerné le reste avec leur cavalerie ; aurum circumdatum argento Cic. Div. 2, 134, de l'or avec de l'argent à l'entour (pièces d'or entourées de pièces d'argent) ; provincia insulis circumdata Cic. Flacc. 27, province environnée d'îles ; urbs prope ex omnibus partibus flumine et palude circumdata Cæs. G. 7, 15, 5, ville couverte presque de tous côtés par le cours d'eau et le marais
— ubi Parius lapis circumdatur auro Virg. En. 1, 593, quand le marbre de Paros est entouré d'or ; ipse agresti duplici amiculo circumdatus Nep. Dat. 3, 2, lui-même revêtu d'un mantelet rustique à double étoffe ; circumdata tempora vittis Ov. M. 13, 643, les tempes entourées de bandelettes
— [fig.] : quoniam exiguis quibusdam finibus totum oratoris munus circumdedisti... Cic. de Or. 1, 264, puisque tu as enfermé (circonscrit) toute la fonction de l'orateur dans certaines limites bien étroites ; stimulabat Claudium Britannici pueritiam robore circumdaret Tac. An. 12, 25, il pressait Claude de mettre à côté de l'enfance de Britannicus un appui solide
— [rare] : Thasius lapis piscinas nostras circumdat Sen. Ep. 86, 6, la pierre de Thasos entoure (revêt) nos piscines, cf. Sil. 12, 506, part. pass. à sens réfléchi indirect : Venus obscuro faciem circumdata nimbo Virg. En. 12, 416, Vénus s'étant enveloppé le corps d'un nuage obscur
¶4. [av. deux acc.] duas partes terræ circumdato radices vitis Cat. Agr. 114, 1, entoure les racines de la vigne de deux tiers de terre ; [au pass.] : infula virgineos circumdata comptus Lucr. 1, 87, la bandelette mise autour de sa coiffure virginale ; collem multa opera circumdata Sall. H. 1, 122, de nombreux ouvrages militaires furent établis autour de cette colline.
¶1. conduire autour : aratrum Cic. Phil. 2, 102, mener la charrue autour d'un espace, tracer un cercle [l'enceinte d'une ville] avec la charrue ; flumen Dubis, ut circino circumductum Cæs. G. 1, 38, 4, le fleuve du Doubs, comme mené tout autour avec le compas ; portum Ostiæ exstruxit, circumducto dextra sinistraque bracchio Suet. Cl. 20, il bâtit un port à Ostie en établissant un môle à droite et à gauche sur tout le pourtour ; rei alicui aliquid, mener qqch autour de qqch ; ætas orbes habet circumductos majores minoribus Sen. Ep. 12, 6, l'existence comporte des cercles, les plus grands entourant les plus petits
¶2. entourer, faire un cercle autour : oppida quæ prius erant circumducta aratro Varr. L. 5, 143, les villes qui autrefois avaient leur enceinte tracée par la charrue ; umbra hominis lineis circumducta Plin. 35, 15, ombre humaine dont on a tracé les contours
— litteras subjicit circumducitque Suet. Aug. 87, 3, il écrit au-dessous de la ligne les lettres excédantes du mot et les entoure d'un cercle [les rattache par un cercle au mot]
¶3. conduire en cercle (par un mouvement tournant), conduire par un détour : cohortibus longiore itinere circumductis Cæs. G. 3, 26, 2, les cohortes étant menées par un assez long détour (C. 1, 28, 4) ; imperat Lælio ut per colles circumducat equites Liv. 28, 33, 11, il commande à Lælius de mener la cavalerie par un mouvement tournant le long des collines ; circumducto cornu Liv. 23, 40, 11, l'aile ayant opéré un mouvement tournant ; ad latus Samnitium circumducere alas Liv. 10, 29, 9, porter la cavalerie par un détour sur le flanc des Samnites
— [abst] præter castra hostium circumducit Liv. 34, 14, 1, il contourne le camp ennemi
— emmener par un détour, détourner : aquam Frontin. Aq. 75, détourner chez soi l'eau d'une propriété
¶4. conduire partout à la ronde : eos qua vellent circumduci jussit Liv. 30, 29, 2, il ordonna qu'on les conduisît à la ronde partout où ils voudraient, cf. 45, 44, 7 ; Tac. H. 3, 54
— [avec deux accus.] : eos Pompeius omnia sua præsidia circumduxit Cæs. C. 3, 61, 1, Pompée les promena dans tous les postes, cf. Pl. Most. 843 ; Frontin. Strat. 3, 15, 4
¶5. emplois figurés : aliquem Pl. As. 97, duper, attraper, circonvenir qqn ; aliquem aliqua re Pl. Bacch. 311 ; 1183 ; Pœn. 976, etc., escroquer qqch à qqn
— entourer qqch d'un cercle comme signe d'annulation, annuler, biffer : Dig.
— [gram.] allonger une syllabe dans la prononciation : Quint. 12, 10, 33
— [rhét.] développer qqch : si quid longius circumduxerunt Quint. 10, 2, 17, s'ils se sont étendus un peu trop longuement ; cum sensus unus longiore ambitu circumducitur Quint. 9, 4, 124, quand une seule pensée est développée en une phrase assez longue
— diem per aliquid circumducere Suet. Ner. 41, passer la journée à s'occuper de qqch.
===> impér. arch. circumduce Pl. As. 97 ; Mil. 221 ; Most. 843.
¶1. action de conduire autour : circumductiones aquarum Vitr. 8, 6, 5, conduites d'eaux
— circonférence [du cercle] : Hyg. Astr. 1, 2
¶2. [fig.] escroquerie : Pl. Capt. 1031, v. {circumduco §{} 5}
— période [rhét.] Quint. 11, 3, 39.
¶1. aller autour (en faisant un cercle), tourner autour :
a) int., ut circumit sol Plin. Ep. 5, 6, 31, selon que le soleil tourne ; ut sciamus, utrum mundus terra stante circumeat an mundo stante terra vertatur Sen. Nat. 7, 2, 3, pour que nous sachions si la terre étant immobile le monde tourne autour ou si le monde étant immobile, c'est la terre qui se meut
b) tr., equites circumitis hostium castris... Cæs. G. 3, 25, 2, les cavaliers ayant tourné autour du camp des ennemis... ; aras Ov. M. 7, 258, tourner autour de l'autel ; cum illi tantum agri decerneretur, quantum arando uno die circumire potuisset Sen. Ben. 7, 7, 5, comme on lui décernait tout le terrain qu'il pourrait embrasser (encercler) dans un jour avec la charrue ; Alexander, dum circumit muros Sen. Ep. 59, 12, Alexandre, pendant qu'il faisait le tour des murs ; Arruns Camillam circuit Virg. En. 11, 761, Aruns voltige autour de Camille
¶2.
a) int., faire un mouvement tournant, un détour : non ante apparuere quam circumiere qui ab tergo intercluderent viam Liv. 27, 27, 4, ils ne se montrèrent pas avant que n'eût été achevé le mouvement tournant de ceux qui avaient mission de couper la route par derrière ; eum parte dextra tumuli circumire, donec... jubet Liv. 27, 18, 15, il lui ordonne de faire un mouvement tournant par la droite de la hauteur jusqu'à ce que... ; si rectum limitem rupti torrentibus pontes inciderint, circumire cogemur Quint. 2, 13, 16, si la rupture des ponts du fait des torrents coupe le chemin direct, nous serons contraints de faire un détour ;
b) tr., contourner, tourner [pour prendre à revers] : cum equites nostrum cornu circumire vellent Galba Fam. 10, 30, 3, la cavalerie voulant tourner notre aile, cf. Cæs. C. 3, 93, 6 ; partem circumire exteriores munitiones jubet Cæs. G. 7, 87, 4, il ordonne à une partie de la cavalerie de contourner les fortifications faisant face à l'extérieur ; equitatus hostium ab utroque cornu circumire aciem nostram incipit Cæs. C. 2, 41, 5, la cavalerie ennemie commence à tourner notre ligne de bataille sur les deux ailes, cf. 3, 93, 3 ; 3, 94, 4, etc.; [d'où] entourer, envelopper, cerner : cohortes circumibant et ab acie excludebant Cæs. C. 2, 41, 6, ils cernaient les cohortes et les empêchaient de rejoindre le gros ; reliqui ne circumirentur veriti Cæs. G. 7, 67, 6, les autres craignant d'être enveloppés ; totius belli fluctibus circumiri Cic. Phil. 13, 20, être entouré (environné) par tous les flots de la guerre
¶3. aller à la ronde, aller successivement d'un endroit à un autre ou d'une personne à une autre :
a) int., Furnius et Lentulus una nobiscum circumierunt Cæl. Fam. 8, 11, 2, Furnius et Lentulus ont fait avec moi le tour des sénateurs [pour les solliciter] ; ipse equo circumiens unumquemque nominans appellat Sall. C. 59, 6, lui-même, circulant à cheval, il adresse la parole à chaque soldat en l'appelant par son nom ; quare circumirent, suas quisque contraheret copias Nep. Eum. 9, 2, qu'ils s'en aillent donc partout à la ronde et que chacun réunisse ses troupes ; Romulus circumibat docebatque Liv. 1, 9, 14, Romulus allait de l'une à l'autre et leur montrait... ; ne ducem circumire hostes notarent Liv. 7, 34, 15, pour que les ennemis ne remarquent pas que le chef est en reconnaissance ;
b) tr., circumire ordines Cæs. C. 2, 41, 2, parcourir les rangs des soldats ; manipulos Cæs. C. 1, 71, 1, parcourir les manipules ; omnia templa deum circumiit Liv. 38, 51, 13, il entra successivement dans tous les temples des dieux ; prædia Cic. Cæc. 94 ; populos utriusque gentis Liv. 4, 56, 5, visiter (parcourir) des propriétés, les peuples des deux nations ; circuitis omnibus hibernis Cæs. G. 5, 2, 2, ayant fait le tour (l'inspection) de tous les camps d'hiver ; reliquum anni circumeundis Italiæ urbibus consumpsit Liv. 30, 24, 4, il employa le reste de l'année à parcourir les villes de l'Italie
— [en part.] faire des démarches de sollicitation : circumire et prensare patres Liv. 1, 47, 7, aller voir à la ronde et solliciter les sénateurs
¶4. [fig.] exprimer avec des détours : quod recte dici potest, circumimus amore verborum Quint. 8, pr. 24, ce qui peut se dire directement, nous l'exprimons avec des détours par amour des mots ; res plurimæ carent appellationibus, ut eas necesse sit transferre aut circumire Quint. 12, 10, 34, un grand nombre d'idées n'ont pas de termes propres, en sorte qu'il faut les exprimer nécessairement par des métaphores ou par des périphrases ; Vespasiani nomen suspensi et vitabundi circumibant Tac. H. 3, 37, avec hésitation et précaution on tournait autour du nom de Vespasien [sans le prononcer]
— circonvenir, duper : Pl. Pseud. 899 ; Ter. Phorm. 614.
===> inf. passif circumirier Pl. Curc. 451.
¶1. int., errer autour : turba lateri circumerrat Sen. Contr. 2, 1, 7, une foule vagabonde autour de lui
¶2. tr., circuler autour de (aliquem) : Virg. En. 2, 599
— tempora quæ Saturnus circumerrat Apul. Mund. 29, temps pendant lequel s'accomplit la révolution de Saturne
¶3. [abst] circumerrant Furiæ Sil. 13, 604, les Furies courent çà et là.
¶1. porter autour, mouvoir circulairement : ter Troius heros immanem ærato circumfert tegmine silvam Virg. En. 10, 887, trois fois le héros troyen fait tourner autour de lui, avec son bouclier d'airain, la forêt formidable de traits qui y est enfoncée ; clipeum ad ictus circumferre Curt. 9, 5, 1, tourner son bouclier pour l'opposer aux coups
— [pass. sens réfléchi] circumferri, se mouvoir autour : sol ut circumferatur Cic. de Or. 3, 178, en sorte que le soleil se meut autour [de la terre] ; non defertur, quod circumfertur Sen. Nat. 7, 29, 3, ce n'est pas descendre que se mouvoir circulairement
— [relig.] purifier un champ en portant tout autour les victimes : Cat. Agr. 141 ; [d'où] purifier par aspersion circulaire : Virg. En. 6, 229
¶2. porter à la ronde, faire passer de l'un à l'autre, faire circuler : circumfer mulsum Pl. Pers. 821, fais circuler le vin miellé ; codicem Cic. Verr. 2, 104 ; tabulas Cic. Balb. 11, faire passer de main en main un registre ; humani corporis sanguinem vino permixtum in pateris Sall. C. 22, 1, faire passer à la ronde (faire circuler) dans des coupes du sang humain mélangé de vin ; caput ejus præfixum hastæ circumtulit Suet. Cæs. 85, [le peuple] promena sa tête au bout d'une pique ; infantem per omnium dearum templa circumferens Suet. Cal. 25, portant l'enfant successivement dans les temples de toutes les déesses ; nec alia ex causa principiorum libri circumferuntur quam quia... Plin. Ep. 2, 5, 12, et la seule raison pour laquelle on fait circuler les manuscrits de commencements d'ouvrages, c'est que.... ; ad singulas urbes arma circumferre Liv. 28, 3, 1, porter la guerre dans toutes les villes l'une après l'autre (1, 38, 4) ; circumferendo passim bello Liv. 9, 41, 6, en promenant la guerre de tous côtés
— [fig.] : huc atque illuc acies circumtulit Virg. En. 12, 558, il promena ses regards de tous côtés ; terrorem circumferre Tac. An. 2, 52, répandre partout la terreur
— colporter, faire connaître partout, publier en tout lieu : senatus consultum per omnes Peloponnesi urbes circumtulerunt Liv. 43, 17, 2, ils firent publier le sénatus-consulte dans toutes les villes du Péloponnèse ; Siculorum querellæ domos nobilium circumlatæ Liv. 26, 29, 5, les plaintes des Siciliens colportées dans toutes les maisons des citoyens influents ; novi aliquam quæ se circumferat esse Corinnam Ov. Am. 2, 17, 29, je connais une femme qui se fait passer partout pour Corinne.
¶1. décrire autour [en parl. des chars dans l'arène] : Virg. En. 5, 131
¶2. marquer d'un accent circonflexe, prononcer [une syllabe] longue : Gell. 4, 7, 2.
¶1. int., souffler autour : circumflantibus Austris Stat. Th. 11, 42, tandis que l'Auster souffle tout autour
¶2. [fig.] tr., circumflari ab omnibus ventis invidiæ Cic. Verr. 3, 98, être battu de tous les côtés par les vents de la malveillance.
¶1. part. de circumfluo
¶2. pris adjt,
a) surabondant : circumfluens oratio Cic. Br. 203, éloquence débordante ;
b) circulaire : Apul. M. 9, 11.
I. int.,
¶1. couler tout autour, déborder [rare] : in poculis repletis addito umore minimo circumfluere quod supersit Plin. 2, 163, [on voit] que dans les coupes pleines la moindre addition de liquide fait déborder ce qui est en trop
¶2. [fig.] être largement pourvu de, regorger de : omnibus copiis Cic. Læ. 52, regorger de richesses de toute espèce ; gloria Cic. Att. 2, 21, 3, être tout environné de gloire ; circumfluens colonorum exercitu Cic. Mur. 49, ayant en abondance des troupes de colons
— [rhét.] circumfluens oratio Cic. Br. 203, éloquence débordante.
II. tr.
¶1. entourer d'un flot (d'un courant) : utrumque latus circumfluit æquoris unda Ov. M. 13, 779, la mer baigne les deux côtés ; Cariam circumfluunt Mæander et Orsinus Plin. 5, 108, le Méandre et l'Orsinus entourent la Carie
¶2. [fig.] entourer en grand nombre : Varr. R. 2, 9, 2 ; 3, 13, 3 ; Luc. 3, 431 ; Petr. 5
— (secundæ res) quæ circumfluunt vos Curt. 10, 2, 22, la prospérité qui vous environne.
===> inf. pr. pass. circumfodiri : Col. 5, 9, 12.
¶1. [surtout au pass. réfléchi] circumfundi, se répandre autour, alicui rei, de qqch : edocent parvæ insulæ circumfusum amnem Liv. 21, 27, 4, ils lui apprennent que le fleuve entoure une petite île ; circumfusum mare urbi Liv. 30, 9, 12, la mer qui entoure la ville
— [av. acc.] caput circumfuso igni Liv. 1, 41, 3, par un feu répandu tout autour de la tête
¶2. [en parl. des pers.] se circumfundere, surtout circumfundi, se répandre tout autour : toto undique muro circumfundi Cæs. G. 7, 28, 2, se répandre de toutes parts pour garnir le pourtour des murs ; equites magna multitudine circumfusa iter impedire incipiunt Cæs. C. 1, 63, 3, les cavaliers se répandant en foule tout autour commencent à entraver sa marche
— [av. dat.] Hannoni Afrisque se circumfudere (equites) Liv. 29, 34, 14, (les cavaliers) enveloppèrent Hannon et les Africains ; circumfundebantur obviis Liv. 22, 7, 11, elles se pressaient autour des arrivants qu'elles rencontraient ; circumfusa turba lateri meo Liv. 6, 15, 9, la foule qui se presse à mes côtés
— [abst] circumfudit eques Tac. An. 3, 46, la cavalerie les enveloppa
— [av. acc.] circumfundi aliquem Bell. Afr. 78, 4 ; Liv. 22, 30, 2, se répandre autour de qqn, entourer qqn
— [en parl. d'une seule pers.] : circumfundi alicui Ov. M. 4, 360, embrasser qqn, enlacer qqn ; aliquem Lucr. 1, 39
— [fig.] : undique circumfusis molestiis Cic. Tusc. 5, 121, les chagrins venant de toutes parts fondre sur moi ; circumfusæ undique voluptates Liv. 30, 14, 6, les plaisirs qui nous environnent (nous assiègent) de toutes parts
¶3. [t. mil.] : in cornibus circumfudit decem milia equitum Liv. 21, 55, 2, sur les ailes il étendit (déploya) dix mille cavaliers
¶4. entourer : terram crassissimus circumfundit aer Cic. Nat. 2, 17, l'air le plus épais entoure la terre ; terra circumfusa undique est hac animabili spirabilique natura Cic. Nat. 2, 91, la terre est environnée complètement de cet élément qui fait vivre et qu'on respire
— aliquem cera Nep. Ages. 8, 7, entourer un mort de cire ; circumfudit me multo splendore luxuria Sen. Tranq. 1, 9, le luxe m'a enveloppé de sa splendeur éclatante
— entourer, cerner, envelopper : præfectum castrorum et legionarias cohortes circumfundunt Tac. An. 12, 38, ils enveloppent un préfet du camp et les cohortes légionnaires, cf. H. 2, 19 ; 4, 20 ; An. 13, 40
— [surtout au pass.] : illis publicorum præsidiorum copiis circumfusus Cic. Mil. 71, entouré de ce déploiement de la force publique ; ut ne magna quidem multitudine munitionum præsidia circumfundi possent Cæs. G. 7, 74, 1, pour empêcher même une grande multitude d'ennemis de cerner les défenseurs des fortifications ; circumfusus libris Cic. Fin. 3, 7, entouré de livres ; circumfusi caligine Cic. Tusc. 1, 45, enveloppés des ténèbres de l'ignorance.
¶1. être étendu autour : Cæl. d. Quint. 4, 2, 123
¶2. être placé auprès, autour : circumjacentes populi Tac. An. 2, 72, les peuples voisins ; cf. Liv. 35, 23, 9
— quæ Europæ circumjacent Liv. 37, 54, 11, [les nations] qui avoisinent l'Europe.
¶1. action d'agiter en tous sens : C. Aur. Acut. 1, 2, 31
¶2. enveloppe : Arn. 2, 43.
¶1. part. de circumjicio.
¶2. pris subst, circumjecta, ōrum, n., le pays d'alentour : Tac. An. 1, 21.
¶1. action d'envelopper, d'entourer : Cic. poet. Nat. 2, 65
¶2. enceinte, pourtour : circumjectus arduus Cic. Rep. 2, 11, enceinte élevée ; circumjectus parietum Plin. 11, 270, pourtour des murs
¶3. vêtement : Varr. L. 5, 132.
¶1. placer autour : Cæs. G. 2, 6, 2 ; circumjicere vallum Liv. 25, 36, 5 [mss. sauf P, v. circuminjicio], placer un retranchement autour ; circumjecti custodes Tac. An. 6, 19, gardes placés autour ; [av. dat.] alicui rei Liv. 38, 19, 5, placer autour de qqch ; [av. acc.] anguis vectem circumjectus Cic. Div. 2, 62, serpent enroulé autour d'un verrou de porte
¶2. envelopper : Cic. Tim. 26 ; Tac. An. 2, 11.
¶1. action de porter ou de conduire autour : Tert. Marc. 4, 12 ; Serv. En. 6, 229
¶2. action de se mouvoir en cercle : Vitr. 9, 1, 15.
===> circumlinio, īre se trouve chez Col. 6, 16, 3 ; 6, 17, 9 ; Quint. 1, 11, 6.
¶1. civitates Schol. Hor. P. 136, aller de ville en ville
¶2. faire un détour, un circuit : Tert. Pall. 1.
¶1. envoyer par un contour, faire faire un mouvement tournant : Perseum cum modica manu circummisit Liv. 40, 22, 13, il chargea Persée avec une faible troupe de tourner la ville ; jugo circummissus Veiens Liv. 2, 50, 10, les Véiens ayant contourné le versant de la montagne
¶2. envoyer à la ronde : legationes in omnes partes Cæs. G. 7, 63, 1, envoyer des ambassades de tous côtés ; scaphas circummisit Liv. 29, 25, 7, il envoya des chaloupes à tous les navires à la ronde.
¶1. embrasser : arbor quam circumplecti nemo possit Plin. 19, 63, arbre que personne ne pourrait embrasser, cf. Cic. Phil. 13, 12
¶2. ceindre, entourer : collem opere circumplecti Cæs. G. 7, 83, entourer la colline d'une ligne d'investissement
¶3. [fig.] saisir, étreindre (l'esprit) : animum meum imago quædam circumplectitur Gell. 10, 3, 8, une véritable vision frappe mon esprit.
¶1. envelopper de ses replis : si anguem vectis circumplicavisset Cic. Div. 2, 62, si c'était la barre qui se fût entortillée autour du serpent ; circumplicatus aliqua re Cic. Div. 1, 49, enlacé de (par) qqch
¶2. rouler autour, aliquid alicui rei : Gell. 17, 9, 14.
¶1. [au pr.] : orbem Cic. Fin. 5, 23, décrire un cercle ; lineas extremas umbræ Quint. 10, 2, 7, tracer les contours d'une ombre ; virgula aliquem circumscribere Cic. Phil. 8, 23, avec une baguette tracer un cercle autour de quelqu'un
¶2. [fig.] enclore, borner, limiter qqch : exiguum nobis vitæ curriculum natura circumscripsit Cic. Rab. perd. 30, il est étroit, le champ d'existence que nous a tracé la nature ; illi quibus quasi circumscriptus est habitandi locus Cic. Par. 18, ceux auxquels on a pour ainsi dire délimité un lieu d'habitation ; mente circumscribitur sententia Cic. Or. 200, l'esprit fixe le contour de la pensée ; terminis aliquid circumscribere Cic. de Or. 1, 70, entourer qqch de limites (circonscrire qqch), cf. Arch. 29 ; de Or. 2, 67 ; certi et circumscripti verborum ambibus Cic. Or. 38, périodes aux contours précis
¶3. limiter, restreindre : gulam et ventrem Sen. Ep. 108, 14, se restreindre sur la bouche et les plaisirs sensuels ; senatus, credo, prætorem eum circumscripsisset Cic. Mil. 88, le sénat, j'imagine, aurait maintenu sa préture dans les bornes, cf. Att. 7, 9, 2 ; Cæs. C. 1, 32, 6 ; parata de circumscribendo adulescente sententia consularis Cic. Phil. 13, 19, la motion d'un consulaire était toute prête pour fixer des limites au jeune homme [Octave] = pour lui interdire l'accès du territoire de la république en le déclarant hostis ; circumscriptus a senatu Antonius Cic. Phil. 2, 53, les pouvoirs d'Antoine paralysés par le sénat
¶4. envelopper, circonvenir, tromper : captiosis interrogationibus circumscripti atque decepti Cic. Ac. 2, 46, enlacés (embarrassés) et trompés par des questions captieuses
— adulescentulos circumscribere Cic. Phil. 14, 7, circonvenir des jeunes gens [les voler par abus de confiance] ; ab Roscio HS IƆƆƆ circumscriptus Cic. Com. 24, circonvenu de cinquante mille sesterces par Roscius
— détourner une loi de son vrai sens (l'interpréter faussement) : Dig. 4, 3, 18 ; [un testament] Plin. Ep. 8, 18, 4
¶5. écarter, éliminer [d'un procès, d'une discussion] : hoc omni tempore Sullano ex accusatione circumscripto Cic. Verr. 1, 43, tout ce temps de Sylla étant retranché de l'accusation ; uno genere circumscribere habetis in animo genus hoc aratorum Cic. Verr. 2, 149, vous avez l'intention par ce seul moyen juridique d'éliminer cette classe des cultivateurs, cf. Fin. 3, 31.
¶1. cercle tracé : Cic. Phil. 8, 23
¶2. espace limité, borne : circumscriptio terræ Cic. Tusc. 1, 45, l'étendue de la terre ; temporis Cic. Nat. 1, 21, espace de temps
¶3. [rhét.] encerclement de mots (περίοδος), phrase, période : Cic. Or. 204, cf. ipsa natura circumscriptione quadam verborum comprendit sententiam Cic. Br. 34, d'elle-même la nature enferme la pensée dans un cercle de mots déterminé
¶4. tromperie, duperie : Sen. Ep. 82, 22
— circumscriptio adulescentium Cic. Off. 3, 61, action de duper (d'abuser) les jeunes gens, cf. Clu. 46.
¶1. être assis autour : florentes amicorum turba circumsedet Sen. Ep. 9, 9, les amis se pressent en foule autour de l'homme florissant
¶2. entourer : Cic. Cat. 4, 3 ; Liv. 6, 6, 11
¶3. assiéger, bloquer : qui Mutinam circumsedent Cic. Phil. 7, 21, ceux qui investissent Modène
— [fig.] assiéger, circonvenir : muliebribus blanditiis circumsessus Liv. 24, 4, 4, circonvenu par des caresses de femme.
¶1. int., sauter tout autour : Cat. 3, 9
¶2. tr., assaillir de toutes parts : Juv. 10, 218.
¶1. int., s'arrêter autour, auprès : Pl. Asin. 618
— se tenir auprès, autour : Cic. Verr. 5, 142 ; Cæs. C. 2, 42
¶2. tr., entourer : eum omnes Arverni circumsistunt Cæs. G. 7, 8, 4, tous les Arvernes s'empressent autour de lui
— [en part.] entourer pour attaquer : Cæs. G. 7, 43
— [fig.] envelopper, envahir : me circumstetit horror Virg. En. 2, 559, l'épouvante s'empara de moi.
===> les formes du pf. steti confondues avec celles de circumsto.
¶1. int., retentir autour, retentir de : locus qui circumsonat ululatibus Liv. 39, 10, 7, lieu qui retentit de hurlements ; talibus aures tuas vocibus circumsonare Cic. Off. 3, 5, [il est utile] que tes oreilles retentissent de semblables propos (que de semblables propos retentissent à tes oreilles) ; circumsonantes loci Vitr. 5, 8, 1, lieux retentissants [où il y a un écho]
¶2. tr., retentir autour de, faire retentir autour de : clamor hostes circumsonat Liv. 3, 28, 3, le cri de guerre retentit autour des ennemis ; Rutulus murum circumsonat armis Virg. En. 8, 474, le Rutule fait retentir ses armes autour des murs ; Scythico circumsonor ore Ov. Tr. 3, 14, 47, l'accent Scythe retentit autour de moi.
¶1. int., regarder fréquemment autour de soi : bestiæ in pastu circumspectant Cic. Nat. 2, 126, les animaux en mangeant promènent les yeux autour d'eux
— [fig.] être attentif, hésitant : Cic. Tusc. 1, 73 ; Liv. 21, 34, 5 ; 25, 36, 5
¶2. tr., considérer, examiner avec défiance, inquiétude : Pl. Ps. 912 ; Ter. Eun. 291 ; parietes circumspectabantur Tac. An. 4, 69, on examinait les murs d'un œil inquiet, cf. Cic. Pis. 99
— guetter, épier : circumspectare defectionis tempus Liv. 21, 39, 5, chercher une occasion de trahir.
¶1. part. de circumspicio
¶2. pris adjt,
a) circonspect, prudent : circumspectus et sagax Suet. Cl. 15, 1, prudent et avisé, cf. Sen. Contr. 7, 5, 11 ;
b) discret, réservé : verba non circumspecta Ov. F. 5, 539, paroles inconsidérées ;
c) remarquable : Amm. 14, 6, 6
— circumspectior Sen. Nat. 5, 1, 5 ; circumspectissimus Suet. Tib. 21, 3.
===> .
¶1. regarder autour de soi : [abst] qui in auspicium adhibetur nec suspicit nec circumspicit Cic. Div. 2, 72, celui qui est occupé à prendre les auspices ne regarde ni en haut ni autour de lui ; circumspicedum ne... Pl. Mil. 955, regarde bien aux alentours, par crainte que... ; [fig.] non castra ponere pati, non respirare aut circumspicere Liv. 27, 12, 12, il ne les laisse ni camper, ni respirer ou regarder autour d'eux (se reconnaître)
— [av. se] se circumspicere :
a) regarder autour de soi avec précaution : Pl. Vid. 64 ; Trin. 146 ;
b) se contempler, s'observer : Cic. Par. 30
¶2. parcourir des yeux, jeter les regards circulairement sur qqch, embrasser du regard : cum sua quisque miles circumspiceret, quid secum portare posset Cæs. G. 5, 31, 4, chaque soldat passant en revue ce qu'il possédait pour décider ce qu'il pouvait emporter ; urbis situ circumspecto Liv. 9, 28, 5, après avoir examiné la position de la ville
— examiner par la pensée : circumspicite paulisper mentibus vestris hosce ipsos homines Cic. Sull. 70, considérez un moment par la pensée la vie de ces hommes mêmes ; circumspicite omnes procellas quæ impendent nisi providetis Cic. Cat. 4, 4, envisagez tous les orages qui nous menacent si vous ne prenez des mesures préventives ; civibus timidis et omnia pericula circumspicientibus Cic. Mil. 95, pour des citoyens pusillanimes et passant en revue tous les dangers
— regarder attentivement, examiner avec soin, avec circonspection : circumspiciat qui in eis artibus floruerint quamque multi Cic. de Or. 1, 8, qu'il examine ceux qui ont brillé dans ces arts et leur grand nombre ; quid deceat circumspicietur Cic. Or. 78, on regardera attentivement ce qui convient ; cum circumspicerent patres, quosnam consules facerent Liv. 27, 34, 1, comme les sénateurs cherchaient autour d'eux qui nommer consuls [avec ut, qqf ne] esse circumspiciendum diligenter, ut... videare Cic. Q. 1, 1, 10, il faut que tu veilles attentivement à ce qu'on voie bien que tu...; [av. ne] Cels. 5, 26
— [fig.] Romanus sermo magis se circumspicit Sen. Ep. 40, 11, le parler romain s'observe davantage (est plus circonspect)
¶3. chercher des yeux autour de soi : ut modo visum ab se Ambiorigem in fuga circumspicerent captivi Cæs. G. 6, 43, 4, à tel point que les prisonniers cherchaient du regard Ambiorix qu'ils venaient de voir en fuite, cf. B. Afr. 16, 3 ; Ov. M. 5, 72 ; Sen. Contr. 2, 4, 4 ; Stat. Th. 6, 430 ; tecta ac recessum circumspicere Liv. 5, 6, 2, chercher un abri et un refuge ; externa auxilia Liv. 1, 30, 6, chercher des secours au dehors ; fugam Tac. An. 14, 35, songer à la fuite ; diem bello Sall. Phil. 8, épier le jour favorable pour faire la guerre ; circumspiciendus rhetor Latinus Plin. Ep. 3, 3, 3, il faut chercher à découvrir un rhéteur latin
— [fig.] chercher à deviner : reliqua ejus consilia animo circumspiciebat Cæs. G. 6, 5, 3, il s'efforçait de percer le reste de ses projets.
===> formes syncopées au parf. circumspexti Ter. Ad. 689 ; à l'inf. parf. circumspexe Varr. Men. 490.
¶1. action d'entourer, d'être autour : Gell. 3, 7 ; Sen. Nat. 2, 7, 2
¶2. situation, circonstances : Gell. 14, 1, 14
— [rhét.] ex circumstantia (περίστασις), d'après les particularités de la cause : Quint. 5, 10, 104.
¶1. int., se tenir autour, être autour : circumstant cum ardentibus tædis Enn. d. Cic. Ac. 2, 89, ils se tiennent en cercle avec des torches allumées ; circumstant lacrimis rorantes ora Lucr. 3, 469, ils se tiennent autour le visage baigné de larmes, cf. Cic. Att. 14, 12, 2
¶2. tr., entourer : ut me circumsteterint judices Cic. Att. 1, 16, 4, [tu as appris] comme les juges s'empressèrent autour de moi ; cives qui circumstant senatum Cic. Cat. 1, 21, les citoyens qui entourent le sénat [pour le défendre] ; circumstare tribunal prætoris Cic. Cat. 1, 32, investir le tribunal du préteur
— [fig.] menacer : nos undique fata circumstant Cic. Phil. 10, 20, la mort nous menace de toutes parts.
¶1. int., faire du bruit autour : ceteri circumstrepunt, iret in castra Tac. An. 11, 31, les autres de tous côtés lui crient d'aller au camp
¶2. tr., signifier autour avec bruit, assaillir avec des cris : atrociora circumstrepere Tac. An. 3, 36, dénoncer à grand bruit des choses plus révoltantes ; tot humanam vitam circumstrepentibus minis Sen. Vit. 11, 1, quand autour de la vie humaine tant de menaces grondent ; legatus clamore seditiosorum circumstrepitur Tac. H. 2, 44, le lieutenant est assailli de tous côtés par les cris des séditieux.
===> actif circumvecto, āre Sil. 3, 291.
¶1. abst, se porter autour, faire le tour : muliones collibus circumvehi jubet Cæs. G. 7, 45, 2, il ordonne aux muletiers de faire le tour par les hauteurs ; circumvecti navibus Cæs. C. 3, 63, 6, ayant fait le tour en bateaux
¶2. av. acc., faire le tour de : Cæsar Pharon classe circumvehitur B. Alex. 14, César avec sa flotte fait le tour de Pharos, cf. Liv. 25, 11, 19, etc.
— côtoyer : Liv. 23, 38, 1, etc.
— [fig.] s'attarder autour de, s'étendre sur un sujet : Virg. Cir. 271.
===> circumvehens Nep. Timoth. 2, 1, se transportant le long de, côtoyant.
¶1. entourer : circumventi flamma Cæs. G. 6, 16, 4, entourés par les flammes ; Rhenus modicas insulas circumveniens Tac. An. 2, 6, le Rhin qui n'entoure que de petites îles ; planities locis paulo superioribus circumventa Sall. J. 68, 2, plaine environnée de points un peu plus élevés
¶2. envelopper, cerner : ex itinere nostros aggressi circumvenere Cæs. G. 1, 25, 6, ayant attaqué les nôtres sans désemparer, ils les enveloppèrent ; in medio circumventi hostes Liv. 10, 2, 11, pris des deux côtés, les ennemis furent enveloppés
— cuncta mœnia exercitu circumvenit Sall. J. 57, 2, il investit avec son armée toute l'enceinte ; vallo mœnia Sall. J. 76, 2, entourer les remparts d'un retranchement.
¶3. [fig.] assiéger qqn, tendre des filets autour de qqn ; serrer, opprimer : te non Siculi, non aratores, ut dictitas, circumveniunt Cic. Verr. 1, 93, ce ne sont pas les Siciliens, les cultivateurs qui, comme tu le répètes, t'assiègent de toutes parts ; quem per arbitrum circumvenire non posses Cic. Com. 25, celui que tu n'aurais pu accabler par le moyen de l'arbitre ; innocens pecunia circumventus Cic. Clu. 9, l'innocence opprimée par l'argent ; ei subvenire, qui potentis alicujus opibus circumveniri urguerique videatur Cic. Off. 2, 51, venir au secours de celui que l'on voit traqué, opprimé par la toute-puissance de quelque grand personnage ; falsis criminibus circumventus Sall. C. 34, 2, assiégé par la calomnie ; fenore circumventa plebs Liv. 6, 36, 12, le peuple accablé par l'usure (succombant sous)
— abuser, circonvenir : ignorantiam alicujus Dig. 17, 1, 29, abuser de l'ignorance de qqn
— éluder une loi : Dig. 30, 123, 1
— tourner, méconnaître la volonté d'un mort : Dig. 29, 4, 4.
¶1. de circumverto
¶2. de circum, verro, balayé autour : Cat. Agr. 143, 2.
¶1. cercle : Cic. Arat. 248 ; Nat. 2, 44
¶2. cirque, [en part.] le grand cirque à Rome : tunc primum circo, qui nunc maximus dicitur, designatus locus est Liv. 1, 35, 8, c'est alors qu'on fixa l'emplacement du cirque, appelé de nos jours le grand cirque, cf. Cic. Phil. 2, 110 ; Mil. 65
— [fig.] les spectateurs du cirque : Juv. 9, 144.
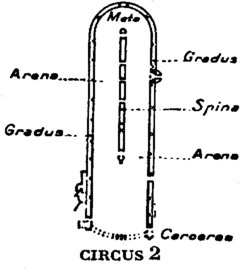
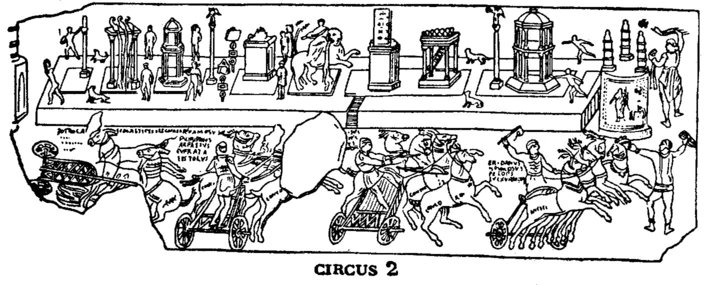

¶1. en deçà : cis Taurum Cic. Fam. 3, 8, 5, en deçà du mont Taurus ; Cæs. G. 2, 3 ; 4, 4
¶2. avant [en parl. du temps] : cis dies paucos Pl. Truc. 348, d'ici peu de jours
¶3. dans la limite de : cis naturæ leges Prisc. 14, 27, dans les limites des lois de la nature.
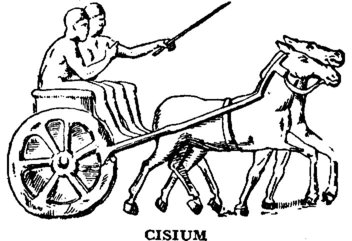
¶1. nom d'homme : Cic. Planc. 75
¶2. colline de Rome : Varr. L. 5, 50 ; Gell. 15, 1, 2.
¶1. ville de Thrace : Plin. 4, 48
¶2. île près de l'Illyrie : Plin. 3, 151.
¶1. Apul. Herb. 18, c. cyclamen
¶2. Apul. Herb. 98, sorte de lierre.
¶1. [roi de Thrace, père d'Hécube] : Serv. En. 7, 320
— Cissēis, ĭdis, f., fille de Cissée [Hécube] : Virg. En. 7, 320
¶2. un compagnon de Turnus : Virg. En. 10, 317.


===> citate Gloss. 2, 101, 22.
===> formes usitées : comp. citerior, superl. citimus.
¶1. qui est plus en deçà, citérieur [opp. à ulterior] : Gallia citerior Cic. Prov. 36, Gaule citérieure (cisalpine); Hispania Cic. Alt. 12, 37, 4, Espagne citérieure [en deçà de l'Èbre]
¶2. plus rapproché : ut ad hæc citeriora veniam et notiora nobis Cic. Leg. 3, 4, pour en venir à ces faits qui sont plus près de l'humanité et mieux connus de nous, cf. Rep. 1, 34 ; quanta animi tranquillitate humana et citeriora considerat ! Cic. Tusc. 5, 71, avec quelle tranquillité d'âme il envisage les choses humaines, les choses qui le touchent de plus près (d'ici bas) !
— [temps] : citeriora nondum audiebamus Cic. Fam. 2, 12, 1, je n'avais pas encore de nouvelles sur les faits plus récents ; consulatus citerior legitimo tempore V.-Max. 8, 15, 1, consulat devançant l'âge légal
— [degré] plus petit, moindre : V.-Max. 8, 7, 18 ; Quint. Decl. 299.
a) chant sur la cithare : Prop. 2, 10, 10 ;
b) l'art de jouer de la cithare : Virg. En. 12, 394.
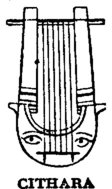
¶1. Citium [ville de Chypre] : Plin. 5, 130
— Cĭtĭēus, i, m., Cic. Tusc. 5, 34 et Cĭtĭensis, e, Gell. 17, 21, de Citium
— -ēi, ōrum, habitants de Citium Cic. Fin. 4, 56
¶2. ville de Macédoine : Liv. 42, 51, 1.
¶1. vite : cito discere Cic. de Or. 3, 146, apprendre vite ; confido cito te firmum fore Cic. Fam. 16, 20, je suis sûr que tu seras vite rétabli ; dicto citius Hor. S. 2, 2, 80, plus promptement qu'on ne pourrait le dire [en un clin d'oeil]
¶2. aisément : neque verbis aptiorem cito alium dixerim Cic. Br. 264, j'aurais de la peine à citer un orateur qui ait plus de justesse d'expression
¶3. citius, plutôt : eam citius veteratoriam quam oratoriam dixeris Cic. Br. 238, son habileté, on la dirait plutôt d'un praticien que d'un orateur
— citius quam subj. Liv. 24, 3, 12, plutôt que de
— citissime Cæs. G. 4, 33, 3.
¶1. mettre en mouvement (souvent, fortement) : hastam Sil. 4, 536, brandir une lance ; medicamentum quod umorem illuc citat Cels. 4, 6, remède qui pousse (chasse) là-bas l'humeur
— [fig.] provoquer, susciter (un mouvement de l'âme, une passion) : Cic. Tusc. 3, 24
¶2. faire venir, appeler : quid, si ego huc servos cito ? Pl. Men. 844, et, si de mon côté je fais venir ici les esclaves ? cf. Catul. 61, 42
¶3. pousser un chant, entonner à haute voix : Hor. S. 1, 3, 7 ; Cic. de Or. 1, 251
¶4. [surtout] appeler, convoquer : patres in curiam per præconem ad regem Tarquinium citari jussit Liv. 1, 47, 8, il ordonna que par la voix du héraut les sénateurs fussent convoqués à la curie auprès du roi Tarquin ; in forum citatis senatoribus Liv. 27, 24, 2, ayant convoqué les sénateurs sur la place publique
— convoquer les juges : quo die primum, judices, citati in hunc reum consedistis Cic. Verr. 1, 19, le jour où pour la première fois, juges, convoqués à l'occasion de cet accusé, vous êtes venus prendre séance ; judices citari jubet Cic. Verr. 2, 41, il donne l'ordre de convoquer les juges
— appeler les citoyens pour l'enrôlement militaire : Liv. 2, 29, 2
— citer en justice : Sthenium citari jubet Cic. Verr. 2, 97, il fait citer Sthénius ; omnes abs te rei capitis C. Rabiri nomine citantur Cic. Rab. perd. 31, tous par toi sont accusés de crime capital dans la personne de C. Rabirius
— appeler les parties [devant le tribunal] : citat reum, non respondit ; citat accusatorem... ; citatus accusator non respondit, non adfuit Cic. Verr. 2, 98, il appelle le défendeur, celui-ci ne répondit pas ; il appelle l'accusateur... ; l'accusateur ne répondit pas à l'appel, ne se présenta pas
— citer comme témoin : Cic. Verr. 2, 146, etc. ; [fig.] invoquer [comme témoin, garant, etc.] : Cic. Off. 1, 75 ; Liv. 4, 20, 8
¶5. proclamer : victorem Olympiæ citari Nep. præf. 5, être proclamé à Olympie athlète vainqueur
— appeler, faire l'appel : Col. 11, 1, 22.
===> inf. pass. citarier Catul. 61, 42.
¶1. adv., en deçà : Plin. 3, 80, etc. ; nec citra nec ultra Ov. M. 5, 186, ni d'un côté ni d'un autre
— sæpe citra licet Cic. Top. 39, on peut souvent se tenir en deçà [sans remonter à l'origine] ; tela citra cadebant Tac. H. 3, 23, les traits ne portaient pas
¶2. prép. avec acc., en deçà de : citra Rhenum Cæs. G. 6, 32, 1, en deçà du Rhin ; omnes citra flumen elicere Cæs. G. 6, 8, 2, les attirer tous en deçà du fleuve
— [poét.] sans aller jusqu'à : citra scelus Ov. Tr. 5, 8, 23, sans aller jusqu'au crime ; citra quam Ov. A. A. 3, 757, moins que
— [poét.] avant : citra Trojana tempora Ov. M. 8, 365, avant l'époque de Troie
— [époque impér.] sans : citra usum Quint. 12, 6, 4, sans la pratique ; [ou] abstraction faite de (citra personas Quint. 2, 4, 22, abstraction faite des personnes) ; citra senatus populique auctoritatem Suet. Cæs. 28, en dehors de l'avis, sans prendre l'avis du sénat et du peuple.
¶1. cédratier : Pallad. 4, 10, 11 ; Serv. G. 2, 126
¶2. thuia : Plin. 13, 91 ; Sen. Tranq. 9, 6.
¶1. part. de cieo
¶2. pris adjt prompt, rapide : vox cita, tarda Cic. de Or. 3, 216, voix rapide, lente ; citus incessus Sall. C. 15, 5, démarche rapide, précipitée ; (naves) citæ remis Tac. An. 2, 6, (navires) rapides à la rame ; citus equo Numida Tac. H. 2, 40, un Numide arrivé à cheval à vive allure ; legionibus citis Tac. An. 14, 26, avec des légions faisant marches forcées (An. 11, 1, etc.); citas cohortes rapit Tac. An. 12, 31, il entraîne ses cohortes dans une marche rapide ; ad scribendum cita (manus) Pl. Bac. 738, (main) prompte à écrire
— [rôle d'adv.] : equites parent citi Pl. Amph. 244, les cavaliers obéissent sans tarder ; solvite vela citi Virg. En. 4, 574, mettez vite à la voile ; si citi advenissent Tac. An. 12, 12, s'ils arrivaient promptement
— citior Pl. d. Fest. 61, 16 ; pas de superl.
¶1. [au pr.] : odium civilis sanguinis Cic. Fam. 15, 15, 1, l'horreur de voir répandre le sang des citoyens ; facinus civile Cic. Att. 7, 13, 1, acte d'un citoyen ; civile bellum Cic. Div. 2, 24 ; Att. 7, 13, 1, guerre civile ; civilis victoria Nep. Ep. 10, 3, victoire remportée sur des concitoyens (Pelop. 5, 4) ; ante civilem victoriam Sall. J. 95, 4, avant sa victoire dans la guerre civile [sur Marius] ; contra morem consuetudinemque civilem Cic. Off. 1, 148, contrairement aux mœurs et aux coutumes des concitoyens (du pays)
— [poét.] civilis quercus = corona civica Virg. En. 6, 772
— jus civile, [en gén.] droit civil, droit commun à tous les citoyens d'une cité : Cic. Top. 2, 9 ; de Or. 1, 188 ; Off. 3, 69, etc. ; [opposé à jus naturale] Sest. 91 ; [en part.] droit civil = droit privé : Top. 5, 28 ; Leg. 1, 17 ; Cæc. 34, etc.
— dies civilis Varr. R. 1, 28, 1, jour civil [de minuit à minuit] ; plus quam civilia agitare Tac. An. 1, 12, rouler des projets qui surpassent ceux d'un simple citoyen
¶2. qui concerne l'ensemble des citoyens, la vie politique, l'État : oratio civilis Cic. Or. 30, discours politique ; civilis scientia Cic. de Or. 3, 123, science politique ; rationes rerum civilium Cic. Rep. 1, 13, théories politiques
— vir vere civilis Quint. 1, pr. 10, le véritable homme d'État, homme politique, cf. 12, 2, 7 ; 12, 2, 22, etc. ; civilium rerum peritus Tac. H. 2, 5, habile politique
— bellica, civilia officia Cic. Off. 1, 122, les devoirs de la vie militaire, de la vie civile ; civilia munera Liv. 9, 3, 5, charges, fonctions civiles
¶3. qui convient à des citoyens, digne de citoyens : hoc civile imperium Sall. J. 85, 35, voilà le commandement qui convient à des citoyens (Liv. 6, 40, 15 ; 27, 6, 4 ; 45, 32, 5) ; quid ordinatione civilius ? Plin. Ep. 8, 24, 7, quoi de plus digne d'un vrai citoyen que le soin d'organiser ?
— civile rebatur misceri voluptatibus vulgi Tac. An. 1, 54, il croyait que c'était d'une bonne politique de se mêler aux amusements de la foule
¶4. populaire, affable, doux, bienveillant : civili animo ferre aliquid Suet. Cæs. 75, supporter qqch avec douceur ; quam civilis incessu ! Plin. Pan. 83, 7, quel air affable dans sa démarche !
¶1. qualité de citoyen : Vulg. Act. 22, 28
¶2. sociabilité, courtoisie, bonté : clementiæ civilitatisque ejus multa documenta sunt Suet. Aug. 51, 1, il y a bien des preuves de sa clémence et de sa courtoisie
¶3. la politique [trad. de ἡ πολιτική de Platon] : Quint. 2, 15, 25.
¶1. en citoyen, en bon citoyen : vivere civiliter Cic. frg. E. 9, 4, vivre en bon citoyen ; vir civiliter eruditus Gell. præf. 13, homme qui a reçu une éducation libérale, cf. Liv. 38, 56, 9
¶2. dans les formes légales : quamdiu civiliter sine armis certetur Cæl. d. Fam. 8, 14, 3, tant que le conflit se tient dans les formes légales, sans recours aux armes
¶3. avec modération, avec douceur : Ov. Tr. 3, 8, 41 ; Tac. An. 3, 76
¶4. civilement, en matière civile : actio civiliter moveri potest Dig. 47, 10, 37, on peut intenter une action civile
— civilius Plin. Pan. 29, 2 ; civilissime Eutr. 7, 8.
===> abl. ordin. cive ; mais on trouve aussi civi : Pl. Pers. 475 ; Cic. Fam. 1, 9, 16 ; Att. 7, 3, 4 ; Sest. 29, etc.
— nom. arch. ceivis CIL 1, 176, 7, etc.; gén. ceivis, dat. ceivi ; nom. acc. pl. ceiveis.
¶1. ensemble des citoyens qui constituent une ville, un État ; cité, État : conventicula hominum quæ postea civitates nominatæ sunt, domicilia conjuncta quas urbes dicimus... Cic. Sest. 91, ces petites réunions d'hommes [à leur début], qui plus tard prirent le nom de cités, les groupements de demeures que nous appelons villes ; Syracusana civitas Cic. Verr. 2, 145, la cité de Syracuse ; omnis civitas Helvetia Cæs. G. 1, 12, 4, l'État helvète dans son ensemble ; Ubiorum civitas Cæs. G. 4, 3, 3, l'État formé par les Ubiens ; de optimo civitatis statu Cic. Rep. 1, 70, sur le meilleur gouvernement d'un État ; de civitatibus instituendis Cic. de Or. 1, 86, sur l'organisation des États
— [au sens de urbs, rare] : muri civitatis Tac. H. 4, 65, les murs de la ville ; expugnare civitatem Quint. 8, 3, 67, prendre d'assaut une ville
— [au sens de Urbs = Roma] la ville [et ses habitants] : Sen. Ben. 6, 32, 1 ; Tac. H. 1, 19, 2 ; 2, 92, 4 ; 4, 2, 2
¶2. droits des citoyens, droit de cité : ortu Tusculanus, civitate Romanus Cic. Leg. 2, 5, Tusculan par la naissance, Romain par les droits de citoyen ; in civitatem aliquem recipere Cic. Arch. 22, accueillir qqn comme citoyen [romain] ; aliquem civitate donare Cic. Balb. 20, gratifier qqn du droit de cité ; dare civitatem alicui Cic. Balb. 21, accorder le droit de cité à qqn ; civitatem amittere Cic. Cæc. 100, perdre les droits de citoyen ; retinere aliquem in civitate, ex civitate aliquem exterminare Cic. Lig. 33, maintenir qqn dans ses droits de citoyen, l'exiler
— [fig.] verbum civitate donare, donner droit de cité à un mot : Sen. Ep. 120, 4 ; Nat. 5, 16, 4 ; Gell. 19, 13, 3 ; Quint. 8, 1, 3.
===> gén. plur. civitatium et civitatum ; arch. ceivitas CIL.
¶1. désastre [de toute espèce], fléau, calamité : Pl. Capt. 911 ; Lucr. 6, 1125 ; civitatis Cic. Br. 332, les malheurs abattus sur la cité ; mea clades Cic. Sest. 31, mon malheur (exil) ; clades dextræ manus Liv. 2, 13, 1, perte de la main droite ; per sex dies ea clade sævitum est Suet. Ner. 38, 2, le fléau fit rage six jours durant
— [fig.] fléau destructeur [en parl. de qqn] : hæ militum clades Cic. Prov. 13, ces fléaux de l'armée
¶2. [en part.] désastre militaire, défaite : Sall. J. 59, 3 ; Liv. 25, 22, 1 ; alicui cladem afferre Cic. Nat. 2, 7 ; inferre Liv. 29, 3, 8, faire subir un désastre à qqn ; cladem accipere Cic. Div. 1, 101, essuyer un désastre ; cladi superesse Liv. 25, 19, 16, survivre à la défaite.
===> gén. pl. cladium ; qqf cladum (Sil. 1, 41, etc. ; Amm. 29, 1, 14 ; 31, 2, 1).
¶1. adv., à la dérobée, en cachette : Cic. Agr. 2, 12 ; Clu. 55 ; Verr. 4, 134 ; clam esse Pl. Truc. 795 ; Lucr. 5, 1157 ; Liv. 5, 36, 6, demeurer secret
¶2. prép., à l'insu de :
a) avec ablat. : clam vobis Cæs. C. 2, 32, 8, à votre insu, cf. Pl. Curc. 173 ; Merc. 821 ; Lucr. 1, 476 ; Cic. *Att. 10, 12 ; 2 ;
b) avec acc. [constr. habit. de Pl., Ter.] : clam patrem Ter. Hec. 396, à l'insu de mon père.
I. int.,
¶1. crier souvent, crier fort ;
a) [av. l'exclamation au style direct] : clamitas : quousque... Cic. Planc. 75, tu cries : « jusqu'où... », cf. Liv. 2, 55, 7 ; ad arma clamitans Liv. 9, 24, 9, criant « aux armes ! » ;
b) [av. l'exclamation à l'acc.] : Cauneas clamitabat Cic. Div. 2, 84, il criait « figues de Caunes ! » ;
c) [av. prop. infin.] : clamitans liberum se esse Cæs. G. 5, 7, 8, ne cessant de crier qu'il était libre, cf. Cic. Tusc. 2, 60 ; Sen. Ep. 104, 1 ; Tac. An. 12, 7 ; [pass. impers.] : (eam) Talassio ferri clamitatum Liv. 1, 9, 12, on cria qu'on (la) portait à Talassius
¶2. demander à grands cris : clamitabat audiret... Tac. An. 11, 34, elle demandait à grands cris qu'il écoutât... ; [av. ut] Tac. An. 14, 5 ; [av. ut et prolepse] Pl. Ps. 1276
¶3. [nom de chose, sujet] crier = proclamer, montrer clairement : supercilia illa... clamitare calliditatem videntur Cic. Com. 20, ces sourcils... semblent crier la fourberie.
II. tr. [rare], crier qqch : quorum clamitant nomina Plin. Ep. 9, 6, 2, ceux dont ils crient les noms.
I. int.,
¶1. [abst] crier, pousser des cris : tumultuantur, clamant Ter. Hec. 41, on se bouscule, on crie ; in clamando video eum esse exercitum Cic. Cæcil. 48, pour crier, je vois qu'il a de l'entraînement ; anseres clamant Cic. Amer. 57, les oies crient ; unda clamat Sil. 4, 525, l'onde mugit
¶2. crier
a) [av. l'exclamation au style direct] : clamabit « bene... ! » Hor. P. 428, il criera « bien... ! », cf. S. 2, 3, 62 ; Cic. Lig. 14 ;
b) [av. acc. de l'exclamation] : clamare triumphum Ov. Am. 1, 2, 25, crier « triomphe ! », cf. Liv. 21, 62, 2 ;
c) [av. prop. inf.] : tum ipsum clamat virtus (eum) beatiorem fuisse Cic. Fin. 2, 65, la vertu crie que même alors il était plus heureux, cf. Rep. 1, 55 ; Verr. 5, 17 ; tabulæ prædam illam istius fuisse clamant Cic. Verr. 1, 150, les registres crient que c'était là le butin de Verrès, cf. 2, 104
¶3. demander à grands cris,
a) [av. interr. indir.] Ter. And. 490 ;
b) [avec ut] : clamare cœperunt, sibi ut haberet hereditatem Cic. Verr. 2, 47, ils se mirent à crier qu'il gardât l'héritage ; [av. ne] Gell. 5, 9, 2.
II. tr.,
¶1. appeler à grands cris : janitorem Pl. As. 391, appeler à grands cris le portier ; morientem nomine Virg. En. 4, 674, appeler à grands cris la mourante par son nom
¶2. proclamer : [av. deux acc.] aliquem insanum Hor. S. 2, 3, 130, crier que qqn est un fou ; [au pass.] insanus clamabitur Cic. frg. Ac. 20, on le proclamera fou.
a) cri de guerre : Liv. 4, 37, 9 ;
b) acclamation : Hortensius clamores efficiebat adulescens Cic. Br. 327, Hortensius dans sa jeunesse soulevait les acclamations ;
c) cri hostile, huée : Cic. Q. 2, 1, 3
— [fig.] bruit : ter scopuli clamorem dedere Virg. En. 3, 566, trois fois les rochers retentirent.
¶1. criard : clamosus altercator Quint. 6, 4, 15, chicaneur criard ; clamosus pater Juv. 14, 191, père grondeur
¶2. qui retentit de cris : clamosæ valles Stat. Th. 4, 448, vallées retentissantes
¶3. qui se fait avec des cris : clamosa actio Quint. 5, 13, 2, débit criard.
¶1. adv., en cachette : Pl. Amp. 523, etc. ; Ter. Eun. 589, etc.
¶2. prép. av. acc. : clanculum patres Ter. Ad. 52, à l'insu des pères.
¶1. int., crier [en parl. de certains oiseaux] : Amm. 28, 4, 34
— sonner de la trompette : Vulg. Jos. 6, 4
— retentir : Att. Tr. 573
¶2. tr., faire résonner [en parl. de la trompette] : tubæ clangunt signa Stat. Th. 4, 342, les trompettes donnent le signal.
¶1. clairement [pour les sens] : clare oculis videre Pl. Mil. 630, avoir bon œil ; clare, ut milites exaudirent Cæs. C. 3, 94, 5, distinctement, de façon à se faire entendre des soldats
¶2. clairement [pour l'esprit] : clare ostendere Quint. 2, 17, 2, montrer clairement
¶3. brillamment, avec éclat : clarius exsplendescebat Nep. Att. 1, 3, il brillait avec plus d'éclat
— clarius Cic. Verr. 3, 175 ; clarissime Plin. 10, 193.
a) briller, resplendir : viri nunc gloria claret Enn. d. Cic. CM 10, la gloire de ce héros resplendit à présent ;
b) être évident : quod in primo carmine claret Lucr. 6, 937, ce qui ressort de notre premier chant.
¶1. action de réclamer de l'ennemi ce qu'il a pris injustement, sommation solennelle [par les féciaux] : Quint. 7, 3, 13
¶2. droit de représailles : Liv. 8, 14, 6.
¶1. clarté, éclat, netteté lumineuse : claritas matutina Plin. 9, 107, la clarté du matin ; asparagi oculis claritatem afferunt Plin. 20, 108, l'asperge éclaircit la vue
— éclat, sonorité [de la voix] : claritas in voce Cic. Ac. 1, 19, clarté de la voix
¶2. [fig.]
a) clarté, éclat : pulchritudinem rerum claritas orationis illuminat Quint. 2, 16, 10, l'éclat de l'éloquence fait ressortir la beauté du sujet ;
b) illustration, célébrité : pro tua claritate Cic. Fam. 13, 68, étant donné l'éclat de ton nom, cf. Off. 1, 70 ; claritas generis Quint. 8, 6, 7, l'éclat de la naissance ; claritates ingeniorum Plin. 37, 201, les esprits les plus brillants.
¶1. rendre clair, lumineux : iter claravit limite flammæ Stat. Th. 5, 284, il marqua son trajet par un sillon lumineux, cf. Cic. poet. Div. 1, 21
¶2. [fig.]
a) éclaircir, élucider : multa nobis clarandum est Lucr. 4, 776, je dois expliquer bien des choses ;
b) illustrer : Hor. O. 4, 3, 4.
a) Apollon : Virg. En. 3, 360 ;
b) le poète de Claros (Antimaque) : Ov. Tr. 1, 6, 1.
¶1. clair, brillant, éclatant : in clarissima luce Cic. Off. 2, 44, au milieu de la plus éclatante lumière ; clarissimæ gemmæ Cic. Verr. 4, 62, pierres précieuses du plus vif éclat
— [poét.] : clarus Aquilo Virg. G. 1, 460, le clair Aquilon = qui rend le ciel clair
— [avec abl.] : (dant) claram auro gemmisque coronam Ov. M. 13, 704, (ils offrent) une couronne que l'or et les pierreries font étinceler
— clara voce Cic. Clu. 134, d'une voix éclatante, sonore ; clariore voce Cæs. G. 5, 30, 1, d'une voix plus éclatante ; clara, obtusa vox Quint. 11, 3, 15, voix claire, sourde [clara, suavis Cic. Off. 1, 133, voix claire, agréable]
¶2. [fig.] clair, net, intelligible, manifeste : luce sunt clariora nobis tua consilia Cic. Cat. 1, 6, tes projets sont pour nous plus clairs que le jour ; res erat clara Cic. Verr. 5, 101, le fait était patent ; non parum res erat clara Cic. Verr. 4, 29, la chose était assez connue, cf. 4, 27 ; 4, 41, etc.
— clarum est avec prop. inf. Plin. 7, 61, c'est un fait connu que, on sait que
— (T. Livius) in narrando clarissimi candoris Quint. 10, 1, 101, (Tite Live) dont les récits ont une limpidité si transparente
¶3. brillant, en vue, considéré, distingué, illustre,
a) [en parl. des pers.] : clari et honorati viri Cic. CM 22, hommes en vue et revêtus des charges publiques ; ex doctrina nobilis et clarus Cic. Rab. Post. 23, que sa science a fait connaître et illustré ; gloria clariores Cic. de Or. 2, 154, auxquels la gloire a donné plus de lustre ; populus luxuria superbiaque clarus Liv. 7, 31, 6, peuple connu pour son faste et sa fierté
— clarissimus artis ejus Plin. 37, 8, le plus brillant de (dans) cet art
— clarissimus, clarissime [cf. excellence, altesse, etc.] [titre donné à l'époque impériale aux gens de qualité] ;
b) [en parl. des choses] :
— dies clarissimus Cic. Læ. 12, la journée la plus brillante ; oppidum clarum Cic. Verr. 2, 86, ville illustre [urbs clarissima Cic. Pomp. 20]; clarissima victoria Cic. Off. 1, 75, la victoire la plus brillante.
¶1. de la première classe ; classicus pris subst Cat. d. Gell. 7, 13, 1, citoyen de la première classe, cf. P. Fest. 113, 12 ; [fig.] classicus scriptor Gell. 19, 8, 15, écrivain de premier ordre, exemplaire, classique
¶2. de la flotte, naval : classici milites Liv. 26, 48, 12, les soldats de la flotte
— classici, ōrum, m. pris subst : classicorum legio Tac. H. 1, 36, la légion des soldats de marine, cf. 2, 11 ; 2, 17, etc.
— les matelots : Curt. 4, 3, 18.
¶1. division du peuple romain, classe : tum classes centuriasque descripsit Liv. 1, 42, 5, alors il répartit les Romains en classes et centuries ; prima classis vocatur Cic. Phil. 2, 82, on appelle la première classe [pour voter]
— [fig.] quintæ classis esse Cic. Ac. 2, 73, être de la cinquième classe [au dernier rang]
¶2. division [en gén.], classe, groupe, catégorie : pueros in classes distribuere Quint. 1, 2, 23, répartir les enfants en classes ; tribus classibus factis pro dignitate cujusque Suet. Tib. 46, les répartissant en trois catégories d'après le rang
¶3. [arch.] armée : classis procincta Fab. Pict. d. Gell. 10, 15, 4, l'armée en tenue de combat ; Hortinæ classes Virg. En. 7, 715, les contingents d'Hortina
¶4. flotte : ædificare et ornare classes Cic. Pomp. 9, construire et équiper des flottes ; Pœnos classe devincere Cic. Or. 153, battre les Carthaginois sur mer
— [poét.] vaisseau : Virg. En. 6, 334.
¶1. nom de femme : Ov. F. 4, 305 ; Suet. Aug. 62, 1
¶2. nom de ville : Claudia Lugdunum, Lyon : CIL 12, 1782 ; Claudia Narbo, Narbonne : CIL 13, 969, etc.
— v. Claudius 2.
¶1. boiter : graviter claudicare Cic. de Or. 2, 249, boiter fortement
¶2. vaciller, être inégal : claudicat pennarum nisus Lucr. 6, 834, les oiseaux battent de l'aile ; libella claudicat Lucr. 4, 518, le niveau n'est pas d'aplomb
— qua mundi claudicat axis Lucr. 6, 1107, sur toute l'étendue où s'abaisse l'axe du monde
¶3. clocher, faiblir, être inférieur : actio vitio vocis claudicabat Cic. Br. 227, l'action clochait, la voix étant mauvaise ; tota res claudicat Cic. Nat. 1, 107, tout le système chancelle ; in comœdia maxime, claudicamus Quint. 10, 1, 99, c'est dans la comédie que nous clochons par-dessus tout
¶4. être boiteux, incomplet [en parl. d'un vers] : claudicat hic versus Claud. Epigr. 79, 3, ce vers est boiteux.
¶1. Appius Claudius Cæcus [homme d'État et écrivain] : Cic. CM 16 ; Liv. 10, 22
¶2. M. Claudius Marcellus [général célèbre] : Liv. 23, 15, 7
¶3. l'empereur Claude : Suet. Cl. 2, 1.

¶1. fermer, clore : forem cubiculi Cic. Tusc. 5, 59, fermer la porte de la chambre ; omnes aditus Cic. Phil. 1, 25, fermer toutes les issues ; portas Varroni clausit Cæs. C. 2, 19, 3, il ferma les portes de la ville à Varron ; [fig.] clausa domus contra rem, alicui rei Cic. Verr. 5, 39 ; Quinct. 93, maison fermée à qqch ; claudere pupulas Cic. Nat. 2, 142, clore les pupilles ; aures clausæ ad rem Cic. Tusc. 4, 2, oreilles fermées à qqch ; Janum Quirinum ter clusit Suet. Aug. 22, il ferma trois fois le temple de Janus
— porta castrorum ducis principumque fuga clausa erat Liv. 27, 18, 20, la porte du camp avait été obstruée par la fuite du général et des principaux chefs
¶2. fermer une route, un passage, un pays : portus custodia clausos tueri Cæs. C. 3, 23, 1, tenir l'accès des ports fermé par une garde ; sociis nostris mare clausum Cic. Pomp. 32, la mer fermée à nos alliés ; insula ea sinum ab alto claudit Liv. 30, 24, 9, cette île ferme le golfe du côté de la haute mer ; clausæ hieme Alpes Liv. 27, 36, 4, les Alpes rendues impraticables par l'hiver
¶3. finir, clore : agmen claudere, fermer la marche, v. agmen ; epistulam Ov. H. 13, 165 ; opus Ov. F. 3, 384, finir une lettre, un travail ; cum ventum est ad ipsum illud, quo veteres comœdiæ tragœdiæque cluduntur « plaudite ! » Quint. 6, 1, 52, quand on est arrivé à ce mot même par lequel finissent comédies et tragédies anciennes « applaudissez ! » ; octavum lustrum claudere Hor. O. 2, 4, 24, clore le huitième lustre
¶4. couper, barrer, arrêter : fugam Ov. M. 6, 572, couper la fuite ; sanguinem Plin. 26, 135, étancher le sang ; horum ferocia vocem Evandri clausit Liv. 44, 45, 12, leur dureté coupa la parole à Évandre ; omnes undique clausi commeatus erant Liv. 21, 57, 5, tous les approvisionnements de toutes parts étaient coupés
— enfermer : claudam vos in curia Liv. 23, 2, 9, je vous enfermerai dans la curie ; clausus domo Tac. An. 15, 53, enfermé dans sa maison ; urbem operibus clausit Nep. Milt. 7, 2, il enferma la ville dans des travaux de siège ; ne multitudine clauderentur Nep. Milt. 5, 3, pour empêcher qu'ils ne fussent enveloppés par la multitude des ennemis ; non enim portu illud oppidum clauditur Cic. Verr. 5, 96, ce n'est pas en effet le port qui enferme cette ville (qui en forme la clôture) ; habere clausa consilia de Verre Cic. Verr. 3, 63, tenir cachés ses desseins concernant Verrès
— [rhét.] : claudere numeris sententias Cic. Or. 229, enfermer la pensée dans une forme rythmique ; pedibus verba Hor. S. 2, 1, 28, enfermer les mots dans la mesure des vers ; universa comprensio et species orationis clausa et terminata est Cic. Or. 198, c'est la période prise dans son ensemble, la phrase en général qui a une fin arrondie et rythmée.
===> inf. prés. pass. claudier Ter. Andr. 573
— la forme cludere ne se trouve pas dans Cic., Cæs., Sall., Liv. ; elle est dans Varr., Lucr., Tac., Quint., Suet.
¶1. boiteux : altero pede Nep. Ages. 8, 1, boiteux d'un pied ; pes claudus Hor. O. 3, 2, 32, pied boiteux
— [navire] qui boite, désemparé : Lucr. 4, 436 ; Liv. 37, 24, 6 ; Tac. An. 2, 24
¶2. fig.
a) clauda carmina alterno versu Ov. Tr. 3, 1, 11, poèmes où chaque second vers boite, a un pied de moins que le premier, poésies composées de distiques ;
b) qui cloche, défectueux : Quint. 9, 4, 70 ; 9, 4, 116 ; Ov. P. 3, 1, 86.
===> vulg. clōdus Cyp. Test. 3, 1.
¶1. fermeture
a) d'une porte, verrous : claustra revellere Cic. Verr. 4, 52, briser les verrous (claustra portarum Liv. 5, 21, 10) ; [fig.] sub signo claustrisque rei publicæ positum vectigal Cic. Agr. 1, 21, revenu placé sous le sceau, sous les verrous de l'État ;
b) fermeture d'un port : chaîne (Curt. 4, 5, 19) ; obstruction de l'entrée (Liv. 37, 14, 6 ; 37, 15, 1)
¶2. barrière, clôture : tui versus invito te claustra sua refregerunt Plin. Ep. 2, 10, 3, tes vers ont malgré toi rompu les barrières où tu les retenais ; claustra montium Tac. H. 3, 2, la barrière formée par les montagnes ; claustra loci Cic. Verr. 5, 85, la barrière de ce lieu, cette barrière naturelle ; Corinthus erat posita in faucibus Græciæ sic ut terra claustra locorum teneret Cic. Agr. 2, 87, Corinthe était située à l'entrée même de la Grèce, en sorte que par terre elle tenait la barrière fermant la région (elle tenait la clef du pays) ; apparebat claustra Ægypti teneri Liv. 45, 11, 5, manifestement il avait en mains la clef de l'Égypte, cf. 44, 7, 9 ; 9, 32, 1 ; Tac. H. 2, 82
— [fig.] claustra nobilitatis refringere Cic. Mur. 17, briser les barrières opposées par la noblesse [pour fermer l'accès au consulat]
— contrahere claustra Tac. An. 4, 49, resserrer la ligne d'investissement [d'une ville assiégée].
===> forme clostrum Cat. Agr. 13, 2 ; 135, 2 ; Sen. Ben. 7, 21, 2 ; cf. Diom. 383, 3.
¶1. fin, conclusion : epistulæ Cic. Phil. 13, 47, fin d'une lettre ; (mimus) in quo, cum clausula non invenitur... Cæl. 65, (un mime) dans lequel, quand on ne trouve pas la scène finale (le dénoûment)...
¶2. [rhét.] clausule, fin de phrase : Cic. Or. 213 ; 215, etc.
¶3. [droit] conclusion d'une formule ; article, clause : Dig. 4, 3, 25 ; etc.
¶1. endroit fermé : sub clauso habere Col. 7, 6, 5, tenir sous clef
¶2. fermeture : clausa domorum Lucr. 1, 354, les fermetures des maisons, cf. Sall. J. 12, 5.

¶1. petite clef : Germ. Arat. 195
¶2. bonde, bouchon : Vitr. 10, 11, 8
¶3. sorte de fortification : Hyg. Castr. 55
¶4. vrille de la vigne : Cic. CM 52.
¶1. clef : esse sub clavi Varr. R. 1, 22, être sous clef ; claves tradere Dig. 18, 1, 74, confier la gestion ou la garde de sa fortune ; claves adimere Cic. Phil. 2, 69, retirer les clefs à sa femme, la répudier
— [fig.] clavis agnitionis Tert. Marc. 4, 4, 28, la clef de la science
¶2. barre de fermeture, verrou : Tib. 1, 6, 34
¶3. verge de fer pour faire tourner le trochus : Prop. 3, 14, 6
¶4. barre du pressoir : Cat. Agr. 13, 1.
===> nom. sing. claves Pomp.-Gram. 5, 175, 9
— acc. -vem, mais vim Pl. Most. 425 ; Tib. 2, 4, 31, cf. Char. 126, 4
— abl. -ve et -vi.
¶1. clou : clavis religare Cæs. C. 2, 10, 2, attacher (fixer) avec des clous ; trabali clavo figere aliquid Cic. Verr. 5, 53, fixer qqch avec un clou à poutres [= fixer solidement] ; clavo clavus ejicitur Cic. Tusc. 4, 75, un clou chasse l'autre
— ex hoc die clavum anni movebis Cic. Att. 5, 15, 1, c'est à partir de ce jour que tu compteras l'année (de mon gouvernement de province); [ancien usage de compter les années au moyen d'un clou que l'on plantait chaque année, le 13 septembre, dans le mur du temple de Jupiter : figere clavum Liv. 7, 3, 4, planter le clou]

¶2. barre, gouvernail : Virg. En. 5, 177 ; clavum imperii tenere Cic. Sest. 20, tenir le timon du pouvoir ; clavum rectum tenere Quint. 2, 17, 24, tenir droit le gouvernail = faire son devoir
¶3. bande de pourpre cousue à la tunique, large [laticlave] pour les sénateurs, étroite [angusticlave] pour les chevaliers, d'où latum clavum impetrare Plin. Ep. 2, 9, 2, obtenir la dignité (les droits) de sénateur
— clavum mutare in horas Hor. S. 2, 7, 10, d'heure en heure changer de tunique [tantôt l'angusticlave, tantôt le laticlave]
¶4. [médec.] tumeur, induration (verrue, poireau, cor) : Cels. 5, 28, 14 ; Plin. 20, 184, etc.
— maladie de l'olivier : Plin. 17, 223
¶5. sorte d'avortement des abeilles : Plin. 11, 50.
¶1. doux, clément, bon, indulgent : clementes judices et misericordes Cic. Planc. 31, juges humains et compatissants ; vir et contra audaciam fortissimus et ab innocentia clementissimus Cic. Amer. 85, un homme qui montra la plus grande énergie contre l'audace, mais au regard de l'innocence la plus grande douceur
— modéré, calme : clemens in disputando Cic. Fin. 2, 12, modéré dans la discussion
— consilium clemens Cic. Verr. 5, 101, résolution humaine ; clementi castigatione uti Cic. Off. 1, 137, réprimander modérément ; clementior sententia Liv. 8, 31, 8, une décision plus clémente
¶2. [poét., en parl. de l'air, de la température, de la mer, etc.] doux, calme, paisible : clemens flamen Catul. 64, 272, souffle clément, doux zéphyr ; clemens mare Gell. 2, 21, 1, mer calme ; clemens amnis Ov. M. 9, 106, cours d'eau paisible ; clementiore alveo Curt. 5, 3, 2, [le fleuve coule] avec (sur) un lit moins abrupt.
===> abl. usuel clementi ; mais clemente Liv. 1, 26, 8 ; Laber. d. Macr. Sat. 2, 7, 3.
¶1. clémence, bonté, douceur : nihil magno et præclaro viro dignius placabilitate et clementia Cic. Off. 1, 88, rien n'est plus digne d'une âme grande et noble que la facilité à pardonner et la douceur ; violare clementiam Nep. Alc. 10, 3, manquer à l'humanité
¶2. [poét.] : clementia cæli Luc. 8, 366, la douceur du climat ; æstatis Plin. Ep. 5, 6, 5, douceur de l'été, chaleur modérée de l'été.
¶1. l'un des sept Sages : Aug. Civ. 16, 25
¶2. écrivain grec : Col. 1, 1, 11.
¶1. général lacédémonien : Cic. Off. 1, 84
¶2. philosophe admirateur de Platon : Cic. Tusc. 1, 84.
¶1. roi de Sparte : Just. 28, 4
¶2. statuaire grec : Plin. 36, 33
¶3. nom d'un Syracusain : Cic. Verr. 2, 36.
¶1. homme d'État athénien : Cic. Br. 28
¶2. statuaire grec : Plin. 34, 87
¶3. géographe grec : Avien. Or. 48.
¶1. reine d'Égypte : Suet. Cæs. 35, 1

¶2. l'une des Danaïdes : Hyg. Fab. 170.
¶1. peintre grec : Plin. 35, 16
¶2. médecin grec : Cic. Clu. 47.
===> clepsit, futur arch. : texte de loi dans Cic. Leg. 2, 22 ; cf. Liv. 22, 10, 5.
===> gén. sing. -ūs Fort. Carm. 2, 9, 17.
===> arch. cluens ; gén. pl. cluentum Pl. Men. 575 ; abl. cluentibus Pl. Trin. 471.
¶1. état, condition de client [individu ou peuple] : esse in clientela alicujus Cic. Amer. 93, être le client de qqn ; Thaïs patri se commendavit in clientelam et fidem Ter. Eun. 1039, Thaïs s'est recommandée à notre père pour être sa cliente et sa protégée
¶2.
a) au pl., clients : Cic. Cat. 4, 23 ; Fam. 13, 64, 2 ; Cæs. C. 2, 17 ; Sall. J. 85, 4 ; vassaux Cæs. G. 6, 12 ;
b) au sing., clientèle, suite : Justin. 8, 4, 8.
¶1. inclinaison du ciel, climat [géogr.]; Apul. Ascl. p. 98, 23 ; Serv. G. 1, 246
— région : Tert. Anim. 49
¶2. mesure agraire : Col. 5, 1, 5.
===> acc. sing. -ēra : pl. -ēras.
¶1. clinicien, médecin qui visite les malades : Mart. 9, 96, 1
¶2. malade alité : Hier. Ep. 108, 5
¶3. croque-mort : Mart. 1, 30.

¶1. bouclier [ordinairement en métal] : Cic. Fin. 2, 97 ; clupeus Minervæ Cic. Tusc. 1, 34, le bouclier de Minerve ; clipeos objicere Virg. En. 2, 444, se couvrir du bouclier
— [fig.] défense, protection : Stilico, quem clipeum dedisti Claud. IV Cons. Honor. 432, Stilicon, que tu nous as donné comme un bouclier

¶2. écusson sur lequel les dieux ou les grands hommes sont représentés en buste : Plin. 35, 13 ; Liv. 25, 39, 13 ; Tac. An. 2, 83 ; Suet. Cal. 16, 4
¶3. le disque du soleil : Ov. M. 15, 192
¶4. la voûte du ciel : Enn. d. Varr. L. 5, 3
¶5. sorte de météore : Sen. Nat. 1, 1, 15
¶6. soupape en métal : Vitr. 5, 10.
===> l'orth. clypeus est moins bonne ; la plus ordin. est clipeus ; qqf. clupeus.
¶1. f., ville de la Chalcidique : Liv. 44, 11, 4
¶2. m., peuple de la Cilicie : Tac. An. 6, 41.
¶1. bât : Cic. d. Quint. 5, 13, 40 ; Hor. Ep. 1, 13, 8
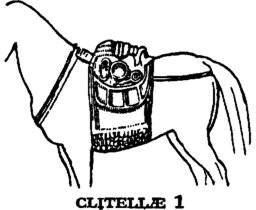
¶2. instrument de torture : P. Fest. 59, 15
— lieudit à Rome : ibid.
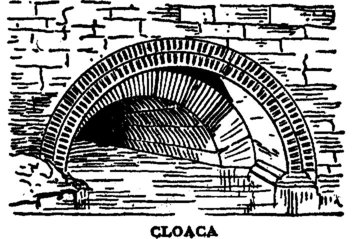
===> autres formes : clouaca, clovaca, cluaca.
===> .
===> .
¶1. s'entendre dire, avoir la réputation de : victor victorum cluet Pl. Trin. 309, il est réputé le vainqueur des vainqueurs (on dit de lui que...); cluent fecisse facinus maximum Pl. Bac. 925, ils passent pour avoir fait une action d'éclat
¶2. être illustre : facito ut Acherunti clueas gloria Pl. Capt. 589, tâche d'avoir cette gloire dans l'Achéron
¶3. être, exister : videmus inter se nota cluere Lucr. 2, 351, nous le voyons, [les animaux] se connaissent entre eux.
¶1. ville du Samnium : Liv. 9, 31
¶2. nom de femme : Juv. 2, 49.
¶1. mère de Phaéthon : Ov. M. 1, 756
— -næus, a, um, Stat. S. 1, 2, 123 et -nēius, a, um, Ov. M. 2, 19, de Clymène
— -nēis, ĭdis, f., fille de Clymène : Albin. Liv. 111
¶2. nom d'une nymphe : Virg. G. 4, 345
¶3. nom d'une Amazone : Hyg. Fab. 163.
¶1. Clytemnestre [femme d'Agamemnon] : Cic. Inv. 1, 18
¶2. [fig.] femme qui tue son mari : Juv. 6, 656
— femme impudique : Cæl. d. Quint. 8, 6, 53.

¶1. action de recueillir, encaissement : coactiones argentarias factitare Suet. Vesp. 1, 2, faire des recouvrements
¶2. abrégé, résumé : coactio causæ in breve Gai. Inst. 4, 13, exposé sommaire de la cause
¶3. courbature, forcement [des chevaux] : Veg. Mul. 2, 9, 1.
¶1. celui qui rassemble : coactores agminis Tac. H. 2, 68, l'arrière-garde [ceux qui ramassent les traînards]
¶2. collecteur d'impôts : Cic. Rab. Post. 30
— commis de recette : Cat. Agr. 150, 2 ; Cic. Clu. 180 ; Hor. S. 1, 6, 86
¶3. coactor lanarius CIL 5, 4504, 3, foulon
¶4. [fig.] celui qui force, qui contraint : Sen. Ep. 52, 4.
¶1. du même âge : Petr. 136, 1
— cŏæquāles, ium, m., f., personnes du même âge : in ludo inter coæquales discens Just. 23, 4, 9, étant à l'école avec les enfants de son âge
¶2. égal, pareil : Vulg. 2 Petr. 1, 1.
¶1. rendre égal, de même plan, égaliser : coæquare montes Sall. C. 20, 11, aplanir les montagnes ; aream Cat. Agr. 129, niveler une aire
¶2. égaler, mettre sur le même pied : aliquem cum aliquo Lact. Ir. 7, égaler un homme à un autre ; ad injurias tuas omnia coæquasti Cic. Verr. 3, 95, en conformité de tes injustices, tu as mis tout sur le même pied
¶3. comparer : maris fluctibus coæquandus est Hier. Isai. 5, 17, 4, on peut le comparer aux flots de la mer.
¶1. présure : Varr. R. 2, 11
— [fig.]
a) ce qui réunit, ce qui rassemble : hoc continet coagulum convivia Varr. d. Non. 1, 115, c'est le lien (l'âme) des festins ;
b) cause, origine : Palladius coagulum omnium ærumnarum Amm. 29, 2, 1, Palladius, la cause de tous les malheurs
¶2. lait caillé : Plin. 28, 158
¶3. coagulation : Gell. 17, 8, 15.
¶1. s'unir, se lier : saxa vides sola colescere calce Lucr. 6, 1068, tu vois que les pierres ne se lient que grâce à la chaux ; brevi spatio novi veteresque coaluere Sall. J. 87, 3, en peu de temps nouveaux et anciens soldats ne firent qu'un (se confondirent) ; coalescere cum aliqua re Liv. 2, 48, 1, se lier avec qqch ; multitudo coalescit in populi unius corpus Liv. 1, 8, 1, cette multitude se fond en un corps de nation ; animo ad obsequium coalescere Tac. An. 6, 44, avoir une volonté commune d'obéissance ; brevi tanta concordia coaluerant animi ut Liv. 23, 35, 9, en peu de temps les esprits s'étaient unis dans une concorde si étroite que
— voces e duobus quasi corporibus coalescunt ut maleficus Quint. 1, 5, 65, des mots sont formés comme de deux corps distincts qui se soudent, ainsi maleficus
— ne prius exarescat surculus quam coalescat Varr. R. 1, 41, 2, pour que le greffon ne se dessèche pas avant de prendre [faire corps et pousser avec l'arbre greffé]
— vulnus coalescit Plin. 9, 166, la plaie se referme ; vixdum coalescens foventis (ejus) regnum Liv. 29, 31, 3, pendant qu'il soigne les blessures de son royaume qui se cicatrisent à peine
¶2. se développer, prendre racine : grandis ilex coaluerat inter saxa Sall. J. 93, 4, une grande yeuse avait poussé entre les rochers ; sarmentum sic depressum citius coalescit Col. 3, 18, 5, le sarment ainsi mis en terre prend plus vite racine
— [fig.] dum Galbæ auctoritas fluxa, Pisonis nondum coaluisset Tac. H. 1, 21, tandis que l'autorité de Galba était chancelante et celle de Pison encore mal affermie ; coalita libertate Tac. H. 4, 55, la liberté étant affermie (assurée)
— in tenero, modo coalescente corpuscule Sen. Ep. 124, 10, dans un tendre embryon, seulement en train de se former.
===> le part. coalitus se trouve à partir de Tacite : An. 14, 1 ; 13, 26, etc.
— la forme colescere se trouve dans Varr. R. 1, 41, 2 ; Lucr. 2, 1061 ; 6, 1068.
===> .
¶1. montrer clairement, démontrer de façon irréfutable : alicujus errorem Cic. Ac. 1, 13, démontrer l'erreur de qqn ; Lacedæmoniorum tyrannidem Nep. Epam. 6, 4, la tyrannie des Lacédémoniens ; sin fuga laboris desidiam coarguit Cic. Mur. 9, si fuir le travail est une preuve manifeste d'indolence
— [av. prop. inf ] démontrer que : Cic. Font. 2 ; quod falsum esse pluribus coarguitur Quint. 4, 2, 4, idée dont la fausseté se démontre par un assez grand nombre d'arguments
— aliquem avaritiæ Cic. Verr. 5, 153 ; commutati indicii Cic. Sull. 44, démontrer que qqn est coupable de cupidité, d'avoir changé une dénonciation
¶2. démontrer comme faux, comme inacceptable : quam (legem) usus coarguit Liv. 34, 6, 4, (loi) que l'expérience condamne (31, 25, 9) ; quod fici coarguunt Plin. 16, 130, ce dont l'exemple du figuier démontre la fausseté ; quo decreto maxime et refelli et coargui potest Liv. 36, 28, 11, c'est ce décret précisément qui peut et le réfuter et le condamner
¶3. démontrer la culpabilité de qqn (coarguere aliquem) : Cic. Mil. 36 ; omnibus in rebus coarguitur a me, convincitur a testibus, urgetur confessione sua Cic. Verr. 4, 104, sur tous les points je démontre sa culpabilité, les témoins le convainquent, son propre aveu l'accable.
¶1. coasser : Suet. Aug. 94, 7
¶2. v. coasso.
¶1. escargot : Varr. R. 3, 14, 4 ; Cic. Div. 2, 133
— cochlea nuda Plin. 29, 112, limace
¶2. coquille d'escargot : Mart. 11, 18, 23 ; in cochleam Cels. 8, 10, 1, en spirale
¶3. tour avec escalier tournant, escalier tournant : Isid. 15, 2, 38
¶4. écaille de tortue : Stat. S. 4, 9, 32
¶5. vis de pressoir : Vitr. 6, 9
¶6. vis d'Archimède, machine à élever les eaux : Vitr. 5, 12, 5
¶7. trappe : Varr. R. 3, 5, 3.
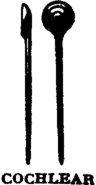
¶1. escargotière, lieu où l'on élève des escargots : Varr. R. 3, 14, 1 (59...)
¶2. c. cochlear : Plin. 20, 242.

¶1. tablette à écrire, livre, registre, écrit : Cic. Verr. 1, 119, etc. ; testamentum duobus codicibus scriptum Suet. Aug. 101, 1, testament fait en double exemplaire

¶2. code, recueil de lois : Cod. Just. ; Cod. Th.
¶3. c. caudex : Ov. M. 4, 8, 2
— [en part.] poteau de supplice : Pl. Pœn. 1153 ; Prop. 4, 7, 44.
¶1. petit tronc, tigette : Cat. Agr. 37, 2
¶2. cōdĭcilli, ōrum, m., tablettes à écrire : Cic. Phil. 8, 28
— lettre, billet : Cic. Fam. 6, 18, 1
— mémoire, requête : Tac. An. 6, 9
— diplôme, titre de nomination à un emploi : Suet. Cl. 29, 1
¶3. sing., Cod. Th. 8, 18, 7, et pl., Tac. An. 15, 64, codicille [jurispr.].
¶1. roi d'Athènes : Hor. O. 3, 19, 2
¶2. nom d'un berger : Virg. B. 5, 11
¶3. nom d'un poète : Juv. 3, 203.
¶1. achat réciproque ou commun, coemption : Cod. Th. 14, 16, 3
¶2. mariage par coemption [jurispr.] : qui nescit quibus verbis coemptio fiat Cic. de Or. 1, 237, celui qui ignore la formule de la coemption
¶3. achat, trafic : Vulg. Mach. 2, 8, 11.
I. int.,
¶1. aller ensemble, se réunir, se joindre : heri coimus in Piræo Ter. Eun. 539 (cf. Cic. Att. 7, 3, 10 in Piræum), hier nous nous réunissons au Pirée [ils y résident de par leurs fonctions de custodes publici] ; apud aram ejus dei, in cujus templo coiretur Suet. Aug. 35, à l'autel du dieu, dans le temple duquel il y aurait réunion ; coimus in porticum Liviæ Plin. Ep. 1, 5, 9, nous nous rencontrons dans le portique de Livie ; locus in quem coibatur Tac. An. 4, 69, le lieu où l'on se réunissait
¶2. se réunir, se rapprocher, former un tout [un groupe, un corps] : homines qui tum una coierunt Cæs. G. 6, 22, 2, les hommes qui alors se sont réunis en commun ; reliqui coeunt inter se Cæs. C. 1, 75, 3, le reste se groupe (se reforme); neque se conglobandi coeundique in unum datur spatium Liv. 6, 3, 6, on ne leur donne pas le temps de se rassembler et de se former en corps ; coire in populos Quint. 2, 16, 9, se réunir en corps de nation
— dispersos ignes coire globum quasi in unum Lucr. 5, 665, [on dit] que des feux épars se réunissent comme en un globe unique
— s'épaissir, se condenser : ut coeat lac Varr. R. 2, 11, 4, pour que le lait se caille ; (mihi) gelidus coit formidine sanguis Virg. En. 3, 30, mon sang glacé se fige d'effroi dans mes veines
— arteria incisa non coit Cels. 2, 10, l'artère coupée ne se ferme pas ; [fig.] male sarta gratia nequiquam coit Hor. Ep. 1, 3, 32, la bonne intelligence mal recousue cherche vainement à se ressouder
— s'accoupler, cum aliquo ou alicui avec qqn : Lucr. 4, 1055 ; Quint. 7, 3, 10, etc. ; Ov. H. 4, 129 ; Sen. Marc. 17, 5 ; Ov. M. 9, 733, etc.; [poét.] non ut placidis coeant immitia Hor. P. 12, non pas au point qu'à la douceur s'allie la cruauté
¶3. [poét.] en venir aux mains, combattre : Virg. En. 12, 709 (G. 4, 73) ; Ov. M. 3, 236 ; Luc. 2, 225
¶4. s'unir, s'associer, faire alliance : Cæsar cum eo coire per Arrium cogitat Cic. Att. 1, 17, 11, César songe à s'entendre avec lui par l'entremise d'Arrius ; cum hoc tu coire ausus es ut... Cic. Sen. 16, tu as osé te liguer avec cet homme pour... ; in societatem coire Tac. An. 12, 47, contracter une alliance ; [poét.] coeant in fœdera dextræ Virg. En. 11, 292, que vos mains s'unissent pour un traité [faites alliance]
— se marier : nuptiis, conubio Curt. 9, 1, 26 ; 8, 1, 9, s'unir par le mariage.
II. tr., coire societatem (cum aliquo) contracter (former, conclure) une alliance, une association (avec qqn) ; societatem sceleris cum aliquo Cic. Amer. 96, former avec qqn une association pour le crime ; de cognati fortunis Cic. Amer. 87, former avec qqn une association pour s'emparer des biens d'un parent ; quasi societatem coire comparandi cibi Cic. Nat. 2, 123, contracter pour ainsi dire alliance en vue de s'alimenter ; societas coitur Cic. Amer. 20, l'association se forme ; part. coitus Dig. 17, 2, 65.
===> formes sync. au pf. : coit Stat. Ach. 1, 458 ; Th. 8, 332 ; coisses Cic. Phil. 2, 24 ; coisset citation Cic. Clu. 144 ; coissent Ov. M. 4, 60 ; coisse Varr. L. 5, 148 ; Liv. 39, 14, 8 ; Ov. F. 6, 94.
I. verbe de la période archaïque : commencer : Pl. Men. 960 ; Truc. 232 ; Pers. 121 ; Ter. Ad. 397.
II. les formes employées à la période classique sont celles du pf. et du supin : cœpī, cœptum, cœpisse, j'ai commencé ; dans Cic. et Cæs. on trouve seulement cœpi avec un inf. actif ou déponent ou avec fieri, et cœptus sum avec un inf. passif
¶1. avec acc. : id quod cœpi Pl. Cas. 701, ce que j'ai commencé ; hujuscemodi orationem cœpit Tac. An. 4, 37, il commença un discours à peu près en ces termes ; cœpturi bellum Liv. 42, 47, 3, prêts à commencer la guerre
¶2. avec inf. actif : cœpi velle Cic. Fam. 7, 51, le désir m'est venu que ; cum ver esse cœperat Cic. Verr. 5, 27, quand le printemps commençait ; ut cœpi dicere Cic. Amer. 91, comme j'ai commencé à le dire ; plura fieri judicia cœperunt Cic. Br. 106, les actions judiciaires commencèrent à se multiplier (Fam. 14, 18, 1) ; primo gravari cœpit Cic. Clu. 69, il commença à faire des difficultés
— inf. s.-ent. : repete quæ cœperas Cic. Nat. 1, 17, reprends ce que tu avais commencé à dire ; istam rationem, quam cœpisti, tene Cic. Leg. 2, 69, suis le plan que tu as commencé [à suivre]
¶3. avec inf. pass. : innocentia pro malevolentia duci cœpit Sall. C. 12, 1, l'intégrité commença à passer pour malveillance ; occidi cœpere Tac. H. 3, 34, on se mit à les tuer
¶4. pf. passif : est id quidem cœptum atque temptatum Cic. Cat. 4, 17, oui, cette mesure a été entreprise et tentée ; id cœptum esse leniter ferret ? Cic. Cæl. 54, il verrait avec indifférence ce crime entrepris ? is cum satis floruisset adulescens, minor haberi cœptus est postea Cic. Br. 236, après avoir eu dans sa jeunesse assez d'éclat, il commença dans la suite à voir baisser sa réputation ; cœptum esse in Sicilia moveri aliquot locis servitium suspicor Cic. Verr. 5, 9, je soupçonne que des mouvements d'esclaves commencèrent en Sicile sur bon nombre de points ; pons institui cœptus est Cæs. G. 4, 18, 4, on se mit à construire un pont
— [rare] : loqui est cœptum Cæl. Fam. 8, 8, 2, on commença à parler ; cum cœptum (erat) in hostem progredi Gell. 1, 11, 3, quand on avait commencé l'attaque contre l'ennemi
— cœpta luce Tac. An. 1, 65, au commencement du jour ; nocte cœpta Tac. An. 2, 13, au commencement de la nuit ; cœpta hieme Tac. An. 12, 31, au début de l'hiver
¶5. [pris intranst] commencer, débuter : sic odium cœpit glandis Lucr. 5, 1416, c'est ainsi qu'on se prit de dégoût pour le gland ; ubi silentium cœpit Sall. J. 33, 3, quand le silence fut établi ; quibus ex virtute nobilitas cœpit Sall. J. 85, 17, dont la noblesse a commencé par le mérite ; civile bellum a Vitellio cœpit Tac. H. 2, 47, la guerre civile est partie de Vitellius.
===> coëpit en trois syll. dans Lucr. 4, 619 [comme souvent chez les comiques]
— forme syncopée cœpsti = cœpisti Cæc. d. Non. 134, 15.
¶1. tr., commencer, entreprendre : cœptare hostilia Tac. H. 3, 70, commencer les hostilités ; fugam Tac. H. 73, 7, 3, essayer de fuir ; quid hic cœptat ? Ter. Phorm. 626, qu'est-ce qu'il veut faire
— [av. inf.] cœptat appetere... Cic. Fin. 5, 24, il commence à se porter vers..., cf. Lucr. 1, 267 ; 4, 113 ; Tac. H. 2, 29
¶2. int., commencer, être au début : cœptante nocte Amm. 20, 4, 14, au commencement de la nuit.
¶1. enfermer, resserrer, contenir : mundus omnia complexu suo coercet et continet Cic. Nat. 2, 48, le monde enferme et enserre tout de son étreinte (2, 101)
¶2. empêcher de s'étendre librement, contenir, maintenir : amnis nullis coercitus ripis Liv. 21, 31, 11, rivière qu'aucune rive ne contient ; aqua jubetur coerceri Cic. Top. 39, ordre est donné de contenir l'eau ; quibus (operibus) intra muros coercetur hostis Liv. 5, 5, 2, (travaux) qui enferment l'ennemi dans ses murs ; [poét.] numeris verba Ov. P. 4, 8, 73, enfermer les mots dans le mètre du vers
— vitem serpentem multiplici lapsu et erratico ferro amputans coercet ars agricolarum Cic. CM 52, quand la vigne pousse en rampant ses jets multipliés et vagabonds, la science du laboureur, en la taillant avec le fer, réprime ses écarts (la ramène dans l'ordre)
¶3. [fig.] contenir, tenir en bride, réprimer : cupiditates Cic. de Or. 1, 194, réprimer les passions ; fenus Liv. 32, 27, 3, réprimer l'usure ; coercere milites et in officio tenere Cæs. C. 1, 67, 4, tenir en bride les soldats et les garder dans le devoir ; orationem rapidam Cic. Fin. 2, 3, arrêter une parole qui s'épanche (un développement dans son cours rapide)
— réprimer, châtier, corriger, faire rentrer dans le devoir : quam (civium conjunctionem) qui dirimunt, eos morte, exsilio, vinclis, damno coercent (leges) Cic. Off. 3, 23, ceux qui portent atteinte (à la société civile), les lois les punissent par la mort, par l'exil, par la prison, par des amendes, cf. Cat. 1, 3 ; Leg. 3, 6.
===> orth. cohercere Aug. Civ. 5, 26 ; 17, 9.
¶1. action d'enfermer : Arn. 6, 17
¶2. contrainte, répression : Liv. 26, 36, 12 ; Quint. 9, 2, 2 ; Tac. An. 3, 26 ; coercitio ambitus Vell. 2, 47, 3, répression de la brigue
¶3. punition, châtiment : Sen. Brev. 3, 2 ; coercitio capitalis Dig. 50, 16, 200, peine capitale ; pecuniaria Dig. 48, 1, 2, amende
¶4. droit de coercition, pouvoir coercitif : coercitio popinarum Suet. Cl. 31, police des tavernes.
===> .
¶1. jonction, assemblage, rencontre : stellarum cœtus Gell. 14, 1, 14, conjonctions de planètes ; mors dissipat cœtum ollis Lucr. 2, 1000, la mort les désagrège ; eos primo cœtu vicimus Pl. Amph. 657, nous les avons vaincus à la première rencontre
¶2. réunion d'hommes, assemblée, troupe : matronarum cœtus Cic. Fin. 2, 12, réunion de mères de famille ; sollemnes cœtus ludorum Cic. Verr. 5, 186, assemblées annuelles pour les jeux ; vixdum cœtu vestro dimisso Cic. Cat. 1, 10, quand vous veniez à peine de vous séparer ; cœtus cycnorum Virg. En. 1, 398, troupe de cygnes
— [fig.] mouvements séditieux, intrigues : miscere cœtus Tac. An. 1, 16, fomenter des cabales, cf. Suet. Cæs. 41, 3
¶3. union, accouplement : Arn. 5, 43.
¶1. acte de penser, de se représenter, pensée, imagination : cogitatio in se ipsa vertitur Cic. Off. 1, 156, la pensée se concentre en elle-même ; percipere aliquid cogitatione, non sensu Cic. Nat. 1, 105, percevoir qqch par la pensée et non par les sens ; illa vis quæ investigat occulta, quæ inventio atque cogitatio dicitur Cic. Tusc. 1, 62, cette force qui cherche à découvrir ce qui est caché et qu'on appelle intelligence inventive, faculté d'imagination ; cogitatione depingere aliquid Cic. Nat. 1, 39, se représenter qqch par l'imagination ; sive illa cogitatione informantur Cic. Ac. 2, 51, soit que ces illusions soient des produits de notre imagination
— timoris præteriti cogitatio Cic. Sest. 11, la pensée des craintes passées ; cogitatio cum officii, tum etiam periculi mei Cic. Fam. 7, 3, 1, la pensée (que tu avais) de mon devoir et surtout des dangers que je courais ; mihi occurrit multo difficilior cogitatio, multo obscurior, qualis animus in corpore sit quam qualis... Cic. Tusc. 1, 51, je me représente beaucoup plus difficilement, beaucoup moins nettement comment est l'âme dans le corps que comment elle...
¶2. acte de réfléchir, de méditer ; réflexion, méditation : tempus in acerrima atque attentissima cogitatione ponere Cic. de Or. 3, 17, passer son temps à réfléchir très sérieusement, très profondément ; (homo) solus particeps rationis et cogitationis Cic. Leg. 1, 22, (l'homme) qui a seul en partage la raison et la réflexion ; cogitationem de aliqua re suscipere Cæs. d. Att. 9, 7 c, 1, se mettre à réfléchir sur qqch ; ad cogitationem belli sese recepit Cæs. C. 3, 17, 6, il se consacra à la méditation de la guerre ; cogitatio quantum res utilitatis esset habitura Cic. Læ. 27, réflexion sur le degré d'utilité que la chose présenterait ; [av. prop. inf.] la pensée que : Cic. Tusc. 3, 74
¶3. le résultat de la pensée (de la réflexion) : mandare litteris cogitationes suas Cic. Tusc. 1, 6, consigner par écrit ses pensées ; posteriores cogitationes, ut aiunt, sapientiores solent esse Cic. Phil. 12, 5, les secondes pensées, comme on dit, sont d'ordinaire les plus sages (αἱ δεύτεραί πως φροντίδες σοφώτεραι Eur. Hipp. 439); versantur in animo meo multæ et graves cogitationes Cic. Agr. 2, 5, je roule dans mon esprit une foule de réflexions sérieuses ; cogitatio Cic. de Or. 1, 150, méditation (= discours médité)
¶4. action de projeter (méditer), idée, dessein, projet : cum ei nihil adhuc præter ipsius voluntatem cogitationemque acciderit Cic. Cat. 2, 16, comme jusqu'ici rien ne lui est arrivé de contraire à ses vœux et à ses plans ; quod si ista nobis cogitatio de triumpho injecta non esset Cic. Att. 7, 3, 2, si on ne m'avait pas donné cette idée (préoccupation) du triomphe ; cogitatione rerum novarum abstinere Tac. H. 1, 7, ne pas avoir l'idée d'une révolution ; sceleris cogitatio Tac. H. 1, 23, l'idée du crime.
¶1. pensée, réflexion : Nep. Dat. 6, 8
— [surtout au pl.] : cogitata præclare eloqui Cic. Br. 253, exprimer ses pensées de façon brillante
¶2. projet : cogitata perficere Cic. Dej. 21, exécuter le complot ; patefacere Nep. Paus. 3, 1, dévoiler ses projets.
¶1. penser, songer, se représenter par l'esprit : eloqui copiose melius est quam vel acutissime sine eloquentia cogitare Cic. Off. 1, 156, il vaut mieux savoir s'exprimer avec abondance que d'avoir même les plus fines pensées sans le don de l'expression ; homo cui vivere est cogitare Cic. Tusc. 5, 111, un homme pour qui vivre, c'est penser ; sic cogitans... audebit Cic. Off. 3, 75, ayant cette pensée (en se disant à lui-même...)... il osera
— de aliquo, de aliqua re, songer à qqn, à qqch : Cic. Br. 150 ; Font. 22 ; Prov. 33 ; Cæl. 29, etc. ; perspectus est a me toto animo de te ac de tuis commodis cogitare Cic. Fam. 1, 7, 3, j'ai vu nettement qu'il songeait de tout son cœur (qu'il s'occupait sans réserve de) à toi et à tes intérêts
— ad aliquid, songer à qqch [tour rare] : Cic. Att. 9, 6, 7
— [avec acc.] : id potestis cum animis vestris cogitare Cic. Agr. 2, 64, cela, vous pouvez l'imaginer ; qui imbecillitatem generis humani cogitat Cic. Tusc. 3, 34, celui qui songe à la faiblesse du genre humain ; Scipionem, Catonem cogitare Cic. Fin. 5, 2, évoquer par la pensée Scipion, Caton, cf. Tac. Agr. 32 ; deus nihil aliud nisi « ego beatus sum » cogitans Cic. Nat. 1, 114, un dieu qui ne fait que se dire « je suis heureux »
— [avec prop. inf.] : cogitare cœperunt nihilo minus hunc everti bonis posse Cic. Verr. 2, 54, ils se prirent à songer qu'on pouvait aussi bien le déposséder de ses biens ; cogitat deus, inquiunt, assidue beatum esse se Cic. Nat. 1, 114, dieu, disent-ils, ne cesse pas de penser qu'il est bien heureux
— [avec int. indir.] : cogitare utrum esset utilius... Cic. Verr. 4, 73, songer s'il valait mieux... ; qui, non quid efficere posset cogitavit, sed quid facere ipse deberet Cic. Phil. 1, 15, lui qui a pensé non à ce qu'il pouvait réaliser, mais à ce qu'il devait tenter lui-même
— [avec ne] prendre garde (en réfléchissant) que... ne [cf. considera, ne Cic. Fam. 15, 14, 4] : Cic. Fam. 4, 9, 4
— réfléchir, méditer : hominis mens discendo alitur et cogitando Cic. Off. 1, 105, l'esprit de l'homme se développe par l'instruction et la réflexion ; spatium sumere ad cogitandum Cic. Fin. 4, 1, prendre du temps pour réfléchir ; cum mecum ipse de immortalitate animorum cœpi cogitare Cic. Tusc. 1, 24, quand je me prends à méditer sur l'immortalité de l'âme
— sive quid mecum cogito Cic. Leg. 2, 2, soit que je médite ; consilia quieta et cogitata Cic. Off. 1, 82, projets calmes et mûrement médités ; adfero res multum et diu cogitatas Cic. CM 38, j'apporte des propositions longuement et longtemps méditées
¶2. méditer, projeter : quæ contra rem publicam jamdiu cogitarunt Cic. Agr. 1, 22, ce que depuis longtemps ils ont médité contre l'intérêt public ; proscriptiones et dictaturas Cic. Cat. 2, 20, méditer proscriptions et dictatures ; cogitatum facinus Cic. Mil. 45, crime projeté (Dej. 15) ; cogitata injuria Cic. Off. 1, 27, injustice préméditée
— [avec de] : numquam de te ipso, nisi crudelissime cogitatum est Cic. Att. 11, 6, 2, jamais sur toi-même on n'a projeté que les plus cruelles mesures ; de nostro omnium interitu cogitant Cic. Cat. 1, 9, ils méditent notre mort à tous ; de altero consulatu gerendo Cic. Vat. 11, songer à exercer un second consulat ; de imponendis, non de accipiendis legibus Cic. Phil. 12, 2, songer à imposer des lois, mais non à en recevoir ; de Homeri carminibus abolendis Suet. Cal. 34, méditer d'anéantir les poèmes d'Homère, cf. Aug. 28
— [avec inf.] : si causas dicere cogitatis Cic. Br. 287, si vous vous proposez de plaider des causes ; si liberi esse et habere rem publicam cogitaretis Cic. Sest. 81, si vous aviez en vue d'être libres et de maintenir une forme de gouvernement
— [tour elliptique] : inde cogito in Tusculanum Cic. Att. 2, 8, 2, de là je songe à me rendre à Tusculum (Att. 2, 13, 2 ; 5, 15, 3, etc.) ; postridie apud Hirtium cogitabam Cic. Att. 14, 21, 4, je compte être demain chez Hirtius ; Beneventi cogitabam hodie Cic. Att. 5, 3, 3, je serai aujourd'hui à Bénévent
— avec ut (ne), se proposer par la pensée de (de ne pas) : neque jam ut aliquid acquireret, sed ut incolumem exercitum Agedincum reduceret, cogitabat Cæs. G. 7, 59, 4, ce qu'il avait en vue, ce n'était plus d'obtenir quelque sérieux avantage, mais de ramener son armée intacte à Agedincum ; cf. Cic. Tusc. 1, 32 ; Nep. Dion 9, 2 ; ne quam occasionem rei bene gerendæ dimitteret, cogitabat Cæs. G. 5, 57, 1, il se proposait de ne pas laisser passer une occasion de remporter un succès
¶3. avoir des pensées, des intentions bonnes, mauvaises à l'égard de qqn : male de aliquo cogitare Cæl. Fam. 8, 12, 1, vouloir du mal à qqn ; si quid amice de Romanis cogitabis Nep. Han. 2, 6, si tu as des intentions amicales à l'égard des Romains ; si amabiliter in me cogitare vis Ant. d. Att. 14, 13 a, 2, si tu veux être bien intentionné à mon égard ; Carthagini male jam diu cogitanti Cic. CM 18, à Carthage qui depuis longtemps nourrit de mauvais desseins.
¶1. lien du sang, parenté de naissance : cognatio, affinitas Cic. Verr. 2, 27, parenté naturelle, parenté par alliance ; cognatione se excusare Liv. 6, 39, 4, alléguer des liens de parenté pour s'excuser
— [fig.] la parenté, les parents : vir amplissima cognatione Cic. Verr. 2, 106, homme qui a de nombreux parents
¶2. parité de race, d'espèce : cognatio equorum Plin. 8, 156, chevaux de même origine ; cognatio arborum Plin. 16, 61, arbres de même espèce
¶3. rapport, affinité, similitude : cognatio studiorum et artium Cic. Verr. 4, 81, la communauté des goûts et des talents ; animus tenetur cognatione deorum Cic. Div. 1, 64, l'âme a des affinités avec les dieux ; cognatio dierum ac noctium Plin. 6, 211, similitude sous le rapport des jours et des nuits.
¶1. uni par le sang ; subst., parent (aussi bien du côté du père que du côté de la mère) ; cognata Ter. Hec. 592, parente ; cognatæ urbes Virg. En. 3, 502, villes liées par le sang (villes sœurs)
¶2. apparenté, qui a un rapport naturel avec : nihil est tam cognatum mentibus nostris quam numeri Cic. de Or. 3, 197, il n'y a rien qui ait des rapports aussi intimes avec notre âme que le rythme ; imponens cognata vocabula rebus Hor. S. 2, 3, 280, donnant aux choses des noms qui leur sont apparentés.
¶1. action d'apprendre à connaître, de faire la connaissance de : [d'une ville] Cic. Pomp. 40 ; [d'une personne] Arch. 5 ; Fam. 13, 78, 2
¶2. action d'apprendre à connaître par l'intelligence, étude : cognitio contemplatioque naturæ Cic. Off. 1, 153, l'étude et l'observation de la nature ; cognitionis amor et scientiæ Cic. Fin. 5, 48, le désir d'apprendre et de savoir
— connaissance : causarum cognitio cognitionem eventorum facit Cic. Top. 67, la connaissance des causes entraîne la connaissance des effets ; rerum cognitionem cum orationis exercitatione conjunxit Cic. de Or. 3, 141, [Aristote] unit la connaissance des idées à la pratique du style
— connaissance acquise : quorum ego copiam magnitudinemque cognitionis atque artis admiror Cic. de Or. 1, 219, j'admire l'abondance, l'étendue de leur connaissance et de leur science
— cognitiones deorum Cic. Nat. 1, 36 (1, 44), conception, notion, idée des dieux
¶3. [droit] enquête, instruction, connaissance d'une affaire : alicujus rei Cic. Agr. 2, 60, enquête sur qqch ; (de aliqua re Cic. Verr. 2, 60) ; patrum Tac. An. 1, 75 ; prætoria Quint. 3, 6, 70, instruction faite par le sénat, par le préteur
¶4. action de reconnaître, reconnaissance : Ter. Hec. 831 ; Eun. 921.
¶1. celui qui connaît qqn, témoin d'identité, garant, répondant : Cic. Verr. 1, 13 ; 5, 167
¶2. représentant [d'un plaideur, demandeur ou défendeur, qui remplaçait complètement la partie], mandataire : Cic. Com. 32 ; 53 ; Verr. 2, 106 ; 3, 78, etc.
— [en gén.] représentant, défenseur : hoc auctore et cognitore hujusce sententiæ Cic. Cat. 4, 9, lui étant le promoteur et le défenseur de cet avis (Liv. 39, 5, 2) ; Liber dithyramborum cognitor Front. Eloq. p. 217, Bacchus, patron du dithyrambe
¶3. enquêteur, qui fait une instruction : Cod. Th. 9, 27, 5
¶4. v. cognitura c).
a) représentant d'un plaideur : Quint. 12, 9, 9 ;
b) enquêteur : Gai. Inst. 4, 124 ;
c) procureur chargé des recouvrements de l'État qui en retour lui allouait une part des sommes recouvrées : Suet. Vit. 2, 1.
¶1. surnom [ajouté à celui de la gens]; ex. Barbatus, Brutus, Calvus, Cicero
— surnom individuel ; ex. Africanus, Asiaticus, etc. ; Cn. Marcius, cui cognomen postea Coriolano fuit Liv. 2, 33, 5, Cn. Marcius, surnommé plus tard Coriolan
¶2. nom : Virg. En. 3, 163
— = épithète : Sen. Ep. 10, 29.
¶1. qui porte le même nom, homonyme : Pl. Bac. 6 ; [av. gén.] Henetorum cognomines sunt Plin. 6, 5, leur nom est le même que celui des Hénètes ; illa mea cognominis fuit Pl. d. Serv. En. 6, 383, elle portait le même nom que moi ; [av. dat.] flumini Plin. 4, 82, portant le nom d'un fleuve, cf. Liv. 5, 34, 9 ; Suet. Oth. 1
¶2. [gram.] synonyme : Gell. 13, 25, 17.
===> .
¶1. apprendre à connaître, chercher à savoir, prendre connaissance de, étudier, apprendre ; au pf. cognovi, cognovisse, connaître, savoir : ea te et litteris multorum et nuntiis cognosse arbitror Cic. Fam. 1, 5 b, 1, cela tu l'apprends, j'imagine, et par beaucoup de correspondants et par des messagers (Tusc. 5, 105) ; per exploratores Cæs. G. 1, 22, 4 ; per speculatores Cæs. G. 2, 11, 2, apprendre par des éclaireurs, par des espions ; ab aliquo Cic. Fin. 5, 11 ; de Or. 1, 67, ex aliquo Cic. Leg. 1, 56, apprendre de qqn ; id se a Gallicis armis atque insignibus cognovisse Cæs. G. 1, 22, 2, [il déclare] que cela, ce sont les armes des Gaulois et leurs ornements caractéristiques qui le lui ont appris ; ex aliqua re, ex aliquo, apprendre d'après qqch, d'après qqn : paucitatem militum ex castrorum exiguitate cognoscere Cæs. G. 4, 30, 1, déduire la faiblesse des effectifs de l'exiguïté du camp ; satis mihi videbare habere cognitum Scævolam ex eis rebus quas... Cic. Br. 147, je croyais avoir de Scévola une connaissance assez exacte d'après ce que...
— reconnaître, constater : aliquem nocentem Cic. Clu. 106, reconnaître la malfaisance de qqn, cf. Phil. 13, 13 ; aliter rem publicam se habentem... Nep. Ham. 2, 1, constater que les affaires publiques sont dans un autre état...; ut a te gratissimus esse cognoscerer Cic. Fam. 1, 5 a, 1, pour que tu reconnaisses ma profonde gratitude, cf. Clu. 47
— [avec prop. inf.] apprendre que : Cæs. G. 5, 52, 4 ; 6, 35, 7, etc. ; Metello cognitum erat genus Numidarum novarum rerum avidum esse Sall. J. 46, 3, Métellus savait déjà que les Numides étaient avides de changements
— [avec int. indir.] : cum, quanto in periculo imperator versaretur, cognovissent Cæs. G. 2, 26, 5, ayant appris quel danger courait le général (1, 21, 1, etc.)
— [abl. absolu] : hac re cognita, his rebus cognitis, à cette nouvelle ; mais his cognitis Cæs. G. 7, 40, 6, ceux-ci ayant été reconnus ; [abl. n.] cognito (= cum cognitum esset) vivere Ptolemæum Liv. 33, 41, 5, ayant appris que Ptolémée vivait encore, cf. 37, 13, 5 ; 44, 28, 4, etc.
— [av. de] : de ipsis Syracusanis cognoscite Cic. Verr. 4, 136, prenez connaissance de ce qui a trait aux Syracusains eux-mêmes ; ibi cognoscit de Clodii morte Cæs. G. 7, 1, 1, là il est informé du meurtre de Clodius ; de casu Sabini et Cottæ certius ex captivis cognoscit Cæs. G. 5, 52, 4, il tient des captifs une information plus sûre de la mort de Sabinus et de Cotta ; ab eo de periculis Ciceronis cognoscitur Cæs. G. 5, 45, 5, par lui on est informé des dangers que court Cicéron
— [supin] : id quod ei facile erit cognitu Cic. Inv. 1, 25, ce qu'il reconnaîtra facilement ; quid est tam jucundum cognitu atque auditu quam...? Cic. de Or. 1, 31, qu'y a-t-il d'aussi agréable à connaître et à entendre que...
— [en part.] prendre connaissance d'un écrit, d'un écrivain : ut Pythagoreos cognosceret Cic. Tusc. 1, 39, pour faire la connaissance des Pythagoriciens ; cognoscite publicas litteras Cic. Verr. 3, 74, prenez connaissance des registres officiels
¶2. reconnaître [qqn, qqch, que l'on connaît] : et signum et manum suam cognovit Cic. Cat. 3, 12, il reconnut et son cachet et son écriture ; quam legens te ipsum cognosces Cic. Læ. 5, en la lisant [cette dissertation] tu te reconnaîtras toi-même ; pecus quod domini cognovissent Liv. 24, 16, 5, le bétail que leurs propriétaires auraient reconnu
— attester l'idendité de qqn : Cic. Verr. 1, 14 ; 5, 72
¶3. [droit] connaître d'une affaire, l'instruire : alicujus causam Cic. Scaur. 24, instruire, étudier la cause de qqn ; de rebus ab isto cognitis judicatisque Cic. Verr. 2, 118, au sujet des affaires que cet homme a instruites et jugées ; eorum injurias cognoscebam Cic. Verr. 4, 137, j'étudiais (je relevais) les injustices commises à leur égard
— [abst] : Verres adesse jubebat, Verres cognoscebat, Verres judicabat Cic. Verr. 2, 26, Verrès faisait comparaître, Verrès instruisait l'affaire, Verrès jugeait (Liv. 29, 20, 4) ; [av. de] de hereditate cognoscere Cic. Verr. 2, 19, instruire une affaire d'héritage
¶4. connaître, avoir commerce (liaison) illicite (cf. γιγνώσκειν): Ov. H. 6, 133 ; Just. 5, 2, 5 ; 22, 1, 13 ; Tac. H. 4, 44.
===> on trouve souvent dans Cic. les formes sync., cognosti, cognostis, cognorim, cognoram, cognossem, cognoro, cognosse
— cognoscin = cognoscisne Pl. Amph. 822 ; Pœn. 1130.
===> .
¶1. assembler, réunir, rassembler : oves stabulis Virg. B. 6, 85, rassembler les brebis dans l'étable
— multitudinem ex agris Cæs. G. 1, 4, 3, assembler des campagnes une masse d'hommes ; copias in unum locum Cæs. G. 2, 5, 4, réunir les troupes sur un seul point (en faire la concentration)
— senatum Cic. Fam. 5, 2, 3, rassembler le sénat ; cogi in senatum Cic. Phil. 1, 11, être convoqué au sénat ; coguntur senatores Cic. Phil. 1, 12, les sénateurs s'assemblent
— recueillir, faire rentrer : oleam Cat. Agr. 64, 1 ; pecuniam Cic. Verr. 2, 120, récolter les olives, faire rentrer de l'argent ; navibus coactis contractisque Cæs. G. 4, 22, 3, des navires ayant été rassemblés et concentrés
— assembler en un tout, condenser, épaissir : frigore mella cogit hiems Virg. G. 4, 36, le froid de l'hiver épaissit le miel ; lac in duritiam Plin. 23, 126, faire cailler le lait ; coacta alvus Cels. 2, 8, ventre resserré, constipation
— [milit.] : cogere agmen Liv. 34, 28, 7, fermer la marche ; [fig.] Cic. Att. 15, 13, 1 ; cuneis coactis Virg. En. 12, 457, en colonnes serrées
¶2. [fig.] rassembler, concentrer, condenser, resserrer : dum hæc quæ dispersa sunt coguntur Cic. de Or. 1, 191, en attendant que ces éléments épars soient réunis ; jus civile, quod nunc diffusum et dissipatum esset in certa genera coacturum Cic. de Or. 2, 142, [il a promis] de ramasser en chapitres précis les notions du droit civil qui sont actuellement disséminées et éparpillées
— saltus in artas coactus fauces Liv. 23, 15, 11, défilé resserré en une gorge étroite
— [phil.] conclure (c. colligo) : ratio ipsa coget ex æternitate quædam esse vera Cic. Fat. 38, la raison d'elle-même conclura qu'il y a des choses vraies de toute éternité ; ex quibus id quod volumus efficitur et cogitur Cic. Leg. 2, 33, d'où se dégage la conséquence, la conclusion que nous cherchons
¶3. pousser de force qq part : vis ventorum invitis nautis in Rhodiorum portum navem coegit Cic. Inv. 2, 98, la violence du vent a poussé un navire dans le port de Rhodes malgré les efforts des matelots ; quercum cuneis coactis scindere Virg. En. 7, 508, fendre un chêne avec des coins enfoncés de force (G. 2, 62)
— [fig.] contraindre, forcer : magnitudine supplicii dubitantes cogit Cæs. G. 7, 4, 9, par la grandeur du châtiment il force les hésitants (les indécis); si res cogat Cæs. G. 7, 78, 2, si les circonstances l'exigaient
— [avec inf.] : num te emere coegit ? Cic. Off. 3, 55, t'a-t-il forcé à acheter ? ut id sua sponte facerent quod cogerentur facere legibus Cic. Rep. 1, 3, [ils arrivaient] à faire d'eux-mêmes ce que les lois les forcent à faire
— [avec acc. et inf. pass.] : di ipsi immortales cogant ab his præclarissimis virtutibus tot et tanta vitia superari Cic. Cat. 2, 25, les dieux immortels eux-mêmes assureraient de force le triomphe de ces vertus éclatantes sur tant de vices odieux, cf. Verr. 3, 36 ; Liv. 7, 11, 4 ; 21, 8, 12
— [avec ut et subj.] : Cic. Tusc. 1, 16 ; de Or. 3, 9, etc. ; Cæs. G. 1, 6, 3
— [acc. du pron. n.] aliquem aliquid : civis qui id cogit omnes... quod Cic. Rep. 1, 3, le citoyen qui oblige tout le monde à faire ce que... ; ego hoc cogor Cic. Post. 17, moi je suis forcé à cela (CM 34 ; Liv. 3, 7, 8 ; 6, 15, 3 ; 23, 10, 6)
— ad aliquid, forcer à qqch : Sall. J. 85, 3 ; Liv. 10, 11, 11, etc. ; ad depugnandum aliquem Nep. Them. 4, 4, forcer qqn à combattre
— [avec in] : in deditionem Liv. 43, 1, 1, forcer de se rendre ; cf. Quint. 3, 8, 23 ; Sen. Clem. 1, 1
— souvent coactus = contraint, forcé, sous l'empire de la contrainte.
¶1. [pr. et fig.] être lié, attaché : cum aliqua re Cic. de Or. 2, 325, être attaché à qqch ; alicui rei Curt. 4, 4, 11 ; Ov. M. 5, 125 ; Plin. 5, 21 ; [avec inter se] : collocabuntur verba, ut inter se quam aptissime cohæreant extrema cum primis Cic. Or. 149, on arrangera les mots dans la phrase de manière que les syllabes finales se lient le plus étroitement possible aux syllabes initiales ; non cohærentia inter se dicere Cic. Phil. 2, 18, tenir des propos sans liaison entre eux (sans suite)
¶2. être attaché dans toutes ses parties solidement, avoir de la cohésion, former un tout compact : mundus ita apte cohæret, ut dissolvi nullo modo queat Cic. Tim. 15, l'univers forme un tout si bien lié qu'il ne saurait être détruit (Ac. 1, 24 ; 2, 28) ; alia, quibus cohærent homines Cic. Leg. 1, 24, les autres éléments qui constituent l'homme ; qui ruunt nec cohærere possunt propter magnitudinem ægritudinis Cic. Tusc. 3, 61, ceux qui sous le poids du chagrin croulent et se désagrègent ; vix cohærebat oratio Cic. Cæl. 15, c'est à peine si son discours se tenait ; male cohærens cogitatio Quint. 10, 6, 6, une préparation de discours inconsistante [qu'on ne tient pas solidement dans sa mémoire].
===> part. cohæsus = cohærens Gell. 15, 16, 4.
===> .
===> .
¶1. contenir, renfermer : universa natura omnes naturas cohibet et continet Cic. Nat. 2, 35, la nature universelle embrasse et renferme en elle toutes les natures particulières ; bracchium toga Cic. Cæl. 11, tenir son bras sous sa toge ; auro lacertos Ov. H. 9, 59, entourer ses bras d'or [bracelets]
¶2. maintenir, retenir : aliquem in vinculis Curt. 6, 2, 11 ; intra castra Curt. 10, 3, 6, retenir qqn dans les fers, au camp ; carcere Ov. M. 14, 224, en prison ; Pirithoum cohibent catenæ Hor. O. 3, 4, 80, des chaînes retiennent captif Pirithoüs
¶3. retenir, contenir, empêcher : conatus alicujus Cic. Phil. 3, 5, arrêter les efforts de qqn ; cohibita ædificiorum altitudine Tac. An. 15, 43, en limitant (réduisant) la hauteur des maisons ; (provinciæ) quæ procuratoribus cohibentur Tac. H. 1, 11, (provinces) qui sont soumises à des procurateurs
— manus, oculos, animum ab aliqua re Cic. Pomp. 66, maintenir ses mains, ses regards, ses pensées écartés de qqch
— non cohibere (vix cohibere) quominus et subj., ne pas empêcher (empêcher à peine) que : Tac. An. 2, 10 ; 2, 24
— [avec inf.] empêcher de : Calp. Ecl. 4, 20.
===> inf. pass. cohiberier Lucr. 3, 443.
¶1. donner de l'honneur à, rehausser, rendre plus beau : cohonestare exsequias Cic. Quinct. 50, honorer de sa présence des obsèques ; cohonestare statuas Cic. Verr. 2, 168, faire valoir des statues ; cohonestare res turpes Arn. 5, 43, colorer des actions honteuses
¶2. [fig.] defluvia capitis Plin. 22, 34, remédier à la chute des cheveux, restaurer la chevelure.
===> forme sync. cōnestat Acc. Tr. 445.
¶1. enclos, cour de ferme, basse-cour : Varr. L. 5, 88 ; Col. 8, 3, 8 ; Ov. F. 4, 704
¶2. troupe [en gén.] : cohors amicorum Suet. Calig. 19, 2, cortège d'amis ; cohors illa Socratica Gell. 2, 18, 1, l'école de Socrate ; cohors canum Plin. 8, 143, meute de chiens ; cohors febrium Hor. O. 1, 3, 31, l'essaim des fièvres
¶3. [en part.]
a) la cohorte, dixième partie de la légion : cum reliquis ejus legionis cohortibus Cæs. G. 3, 1, 4, avec les autres cohortes de la légion ; cohors prætoria Cæs. G. 1, 40, 15, cohorte prétorienne ;
b) troupe auxiliaire : Sall. J. 46, 7 ;
c) [fig.] armée : Stat. Th. 5, 672 ;
d) état-major, suite d'un magistrat dans les provinces : Cic. Verr. 2, 66 ; Cat. 10, 10 ; Liv. 29, 19, 12.
===> cors Glaucia d. Cic. de Or. 2, 263 ; Col. 2, 14, 8 ; chors Varr. Men. 55 ; 383 ; Mart. 7, 54, 7
— gén. pl. -tium Cæs. G. 2, 25 ; Sall. J. 46, 7 ; Liv. 10, 19, 20.
¶1. de basse-cour, de poulailler : cohortalis ratio Col. 8, 2, 6, office de la basse-cour
¶2. relatif à la cohorte prétorienne : Cod. Th. 8, 4, 30
— cohortales, ium, m., les prétoriens : Cod. Th. 8, 4.
===> cohortatus sens pass., v. cohorto.
a) c. covum ;
b) courroie qui attache le timon : P. Fest. 34, 26 (Lindsay).
===> .
¶1. engagement, prise de contact : Ter. Phorm. 346
¶2. coalition, complot : Cic. Q. 2, 14, 4 ; 3, 1, 16 ; coitionem facere Cic. Planc. 53, faire une cabale
¶3. accouplement : Macr. S. 7, 16.
¶1. int.,
a) pleurer ensemble : Pl. d. Gell. 1, 24, 3 ;
b) fondre en larmes : Ter. Andr. 109 ; Cic. Rep. 6, 9
¶2. tr., déplorer : Cic. Sest. 123 ; Liv. 26, 14, 4.
¶1. mélangé, formé d'un mélange : Plin. 16, 69
¶2. fourni par plusieurs personnes : sepultura collaticia Ps. Quint. Decl. 6, 11, sépulture donnée à frais communs
— d'emprunt : Sen. Marc. 10, 1.
¶1. assemblage, réunion : Pl. Mil. 941
— rencontre, choc : signorum conlationes Cic. de Or. 1, 210, engagements [des armées]
¶2. contribution, souscription : Liv. 5, 25, 5
— [en part.] offrande faite aux empereurs : Plin. Pan. 41, 1
¶3. comparaison, rapprochement, confrontation : Cic. Top. 43 ; Nat. 3, 70 ; in collatione reliquarum legionum Hirt. G. 8, 8, 2, en comparaison des autres légions
— conlatio Cic. Tusc. 4, 27 et conlatio rationis Cic. Fin. 3, 33, analogie
— degré de comparaison [gram.] : Fest. 181, 28
— [rhét.] parallèle : Cic. Inv. 1, 49 ; Quint. 5, 11, 23.
¶1. payé par contribution : sacrificium collativum P. Fest. 37, 13, sacrifice offert en commun
— mis en commun : Macr. Somn. 1, 6
¶2. qui reçoit les contributions : collativus venter Pl. Curc. 231, ventre qui recueille toutes les offrandes, cf. P. Fest. 58, 17.
¶1. écot, quote-part : Cic. de Or. 2, 233
— quête : Hier. Ep. 120, 4
¶2. assemblée, réunion : Hier. Ep. 108, 19.
¶1. action de rassembler, de recueillir : conlectio membrorum fratris Cic. Pomp. 22, le fait de recueillir les membres de son frère, cf. Petr. 98, 4
¶2. [fig.] réunion, collection, rassemblement : Cod. Th. 16, 5, 36 ; Vulg. Hebr. 10, 25
— [en part.]
a) dépôt d'humeurs, abcès : Plin. 27, 131 ;
b) [rhét.] récapitulation, résumé : Cic. Br. 302 ;
c) [phil.] argumentation, raisonnement, conclusion : subtilissima collectio Sen. Ep. 45, 7, argumentation très subtile.
¶1. (cum, lego), condisciple : Aug. Conf. 1, 17
—
¶2. (colligere), celui qui amasse : Ps. Rufin. Amos. 2, 8, 1.
¶1. part. de colligo
¶2. pris adjt,
a) ramassé, réduit : astrictum et collectum dicendi genus Tac. D. 31, style serré et concis ;
b) réduit, modeste, chétif : tanto beatior quanto collectior Apul. Apol. 21, 3, d'autant plus fortuné que mon train de vie est plus modeste.
¶1. collègue [dans une magistrature] : conlega in prætura Cic. Off. 1, 144, collègue dans la préture ; destinavit se collegam consulatui ejus Tac. A. 2, 42, il voulut être son collègue dans le consulat
¶2. collègue [en gén.], compagnon, camarade, confrère : conlega sapientiæ Cic. Nat. 1, 114, confrère en philosophie
— cohéritier : Dig. 46, 3, 101
— compagnon d'esclavage : Pl. Asin. 556
— camarade : Petr. 29, 2
— membre d'une corporation : Dig. 27, 1, 41.
¶1. action d'être collègue : concors collegium Liv. 10, 22, 3, bonne entente entre consuls, cf. Serv. Fam. 4, 12, 3
¶2. collège [des magistrats, des prêtres, etc.] : conlegium prætorum Cic. Off. 3, 80, le collège des préteurs ; conlegium augurum Cic. Br. 1, le collège des augures ; tribuni pro collegio pronuntiant Liv. 4, 26, 9, les tribuns prononcent au nom de leur collège
¶3. association : collegia contra leges instituta dissolvere Tac. An. 14, 17, dissoudre les associations illégales.
===> inus. au présent ; v. collibet.
===> inus. au présent ; v. collibeo.
¶1. frapper contre : collidere manus Quint. 2, 12, 10, battre des mains ; inter se manus Sen. Nat. 2, 28, battre les mains l'une contre l'autre ; dentes colliduntur Sen. Ep. 11, 2, les dents s'entrechoquent
¶2. briser contre, briser : collidere navigia inter se Curt. 4, 3, 17, briser des vaisseaux les uns contre les autres
— écraser : Cic. Phil. 2, 73 ; Nat. 3, 31
¶3. [fig.] heurter, mettre aux prises : collidit gloria fratres Stat. Th. 6, 435, l'ambition met les frères aux prises ; consonantes si binæ collidantur Quint. 9, 4, 37, si deux mêmes consonnes viennent à se heurter ; leges colliduntur Quint. 7, 7, 2, on oppose les lois l'une à l'autre
— Græcia barbariæ cottisa Hor. Ep. 1, 2, 7, la Grèce s'étant heurtée aux pays barbares.
¶1. [pr. et fig.] attacher ensemble, réunir : manus Cic. Rab. perd. 13, lier les mains ; quæ quattuor (genera officiorum) quamquam inter se conligata atque implicata sunt Cic. Off. 1, 15, quoique ces quatre sortes de devoirs soient liées entre elles et se pénètrent ; id exspectant aures, ut verbis conligetur sententia Cic. Or. 168, ce que l'oreille demande, c'est que les mots lient bien la pensée [lui donnent une forme périodique] ; vulnera colligare Plin. 35, 181, fermer (cicatriser) les plaies
¶2. [pass.] avoir ses éléments liés ensemble : omne conligatum solvi potest Cic. Tim. 35, tout ce qui est formé par une liaison d'éléments peut être dissous
¶3. [fig.] : annorum septingentorum memoriam uno libro conligavit Cic. Or. 120, il a condensé en un seul volume l'histoire de sept cents ans
— impetum furentis (Antonii) conligavit Cic. Phil. 11, 4, il a enchaîné (entravé, enrayé) l'élan de ce dément ; ni Brutum conligassemus in Græcia Cic. Phil. 11, 26, si nous n'avions pas enchaîné Brutus en Grèce.
¶1. recueillir, réunir, ramasser, rassembler : radices palmarum Cic. Verr. 5, 87 ; sarmenta, virgulta Cæs. G. 3, 18, 7, recueillir des racines de palmiers, ramasser des ramilles et des broussailles ; sarcinas Sall. J. 97, 4, mettre en tas les bagages ; vasa Cic. Verr. 4, 40, rassembler les bagages, plier bagage (Liv. 21, 47, 2 ; 22, 30, 1)
— naufragium Cic. Sest. 15, recueillir les débris d'un naufrage ; pecuniam Hor. Ep. 1, 10, 47, ramasser de l'argent ; aěr umorem conligens Cic. Nat. 2, 101, l'air recueillant la vapeur d'eau
¶2. rassembler : milites Cic. Verr. 5, 133, rassembler des soldats ; ex urbe, ex agris ingentem numerum perditorum hominum Cic. Cat. 2, 8, rassembler de la ville, de la campagne une foule immense de scélérats [de pagis Cic. Fin. 2, 12, faire venir des bourgades] ; qui se ex ejus regno conlegerant Cic. Pomp. 2, 24, ceux qui s'étaient rassemblés en troupe venant de son royaume ; se conligere Cæs. G. 5, 17, 4, se rallier
— [pass. réfl.] : quos in paludes collectos dixeramus Cæs. G. 2, 28, 1, qui, avons-nous dit, s'étaient rassemblés dans les marais
¶3. ramasser, relever, retrousser : librum elapsum Plin. 2, 1, 5, ramasser un livre échappé des mains ; togam Mart. 7, 33, 4, retrousser sa toge
— [pass. réfl.] : nodo sinus collecta fluentes Virg. En. 1, 320, ayant relevé sur elle par un nœud les plis ondoyants de sa robe
¶4. contracter, resserrer : cogebantur breviore spatio orbem colligere Liv. 2, 50, 7, ils étaient forcés de resserrer leur cercle plus étroitement ; in spiram se colligit anguis Virg. G. 2, 154, le serpent se ramasse en spirale ; se in sua colligit arma Virg. En. 10, 412, il se ramasse derrière son bouclier ; collecta in figuram alitis Virg. En. 12, 862, s'étant ramassée sous la forme d'un oiseau ; cf. Plin. 8, 45 ; [fig.] Cæl. Fam. 8, 11, 3
— hastas protendere, colligere Tac. An. 2, 21, porter en avant, ramener les piques ; equos Ov. M. 2, 398, retenir les chevaux, les arrêter ; gressum Sil. 6, 399, gradum Sil. 7, 695, suspendre la marche
¶5. [fig.] rassembler, ramasser, réunir : [des bons mots] Cic. Off. 1, 104 ; [les fragments qui restent des Pythagoriciens] Cic. Tusc. 4, 3 ; civitatum animo calamitates Cic. Inv. 1, 1, passer en revue par la pensée les malheurs des cités
— recueillir pour soi, réunir pour soi, acquérir, gagner : benevolentiam Cic. Læ. 61, la bienveillance ; auctoritatem Cæs. G. 6, 12, 8, du prestige ; existimationem Cic. Cæcil. 72, de la considération ; ex aliqua re invidiam crudelitatis Cic. Verr. 5, 19, s'attirer par qqch une odieuse réputation de cruauté ; vires ad agendum aliquid Liv. 29, 30, 5, grouper autour de soi des forces pour tenter qq action ; sitim Virg. G. 3, 327, provoquer la soif ; frigus Hor. Ep. 1, 11, 13, souffrir du froid
— conligere se Cic. Tusc. 4, 78 ; Div. 1, 57, etc., se recueillir, recueillir ses forces, se ressaisir, reprendre ses esprits ; ex timore Cæs. C. 3, 65, 1, se remettre d'une frayeur
— [avec le même sens] : colligere animum Tac. An. 1, 12 ; animos Liv. 3, 60, 11 ; mentem Ov. M. 14, 352
¶6. embrasser numériquement : ambitus centum duos pedes colligit Plin. 36, 77, le tour est de cent deux pieds, cf. 12, 23 ; centum et viginti anni ab interitu Ciceronis in hunc diem colliguntur Tac. D. 17, de la mort de Cicéron à ce jour, c'est un total de cent vingt ans, cf. G. 37
¶7. conclure logiquement : bene conligit hæc pueris esse grata Cic. Off. 2, 57, il en infère avec raison que ces spectacles plaisent aux enfants ; ex eo conligere potes quanta occupatione distinear Cic. Att. 2, 23, 1, par là tu peux juger des occupations qui m'accaparent ; inde colligere Liv. 7, 37, 9, conclure de là ; [abl. seul] Col. 4, 3, 2 ; quo quid colligo ? Sen. Ben. 3, 31, 3, quelle conclusion tiré-je de là ?
¶1. tr., diriger en visant : conlineare sagittam aliquo Cic. Fin. 3, 22, viser un but avec une flèche
¶2. int., trouver la direction juste : Cic. Div. 2, 121.
¶1. choc, heurt : collisio armorum : Vulg. Mach. 1, 6, 41, choc d'armes
¶2. [en part.] écrasement de voyelles, élision : Pomp.-Gr. 287, 26 ; Serv. En. 3, 151.
¶1. placer, établir : omnem materiam conversam ad hostem conlocabat Cæs. G. 3, 29, 1, il faisait disposer tout le bois de manière qu'il fût tourné contre l'ennemi ; saxa in muro Cæs. G. 2, 29, 3, placer des pierres sur un mur ; suo quidque in loco Cic. de Or. 1, 162, mettre chaque objet à sa place convenable ; tabulas in bono lumine Cic. Br. 261, placer des tableaux en belle lumière (dans leur jour) ; aliquem in cubili Cic. Tusc. 2, 39, mettre qqn au lit (Rep. 1, 17) ; impedimenta in tumulo Cæs. G. 6, 8, 3, installer les bagages sur une hauteur [post legiones Cæs. G. 2, 19, 3, derrière les légions] ; comites ejus apud ceteros hospites conlocantur Cic. Verr. 1, 63, ses compagnons sont logés chez les autres hôtes ; ut ante suum fundum Miloni insidias conlocaret Cic. Mil. 27, pour dresser des embûches à Milon devant sa propriété ; qui erant in statione pro castris conlocati Cæs. G. 5, 15, 3, ceux qui montaient la garde en avant du camp ; legiones propius Armeniam Tac. An. 13, 7, établir les légions plus près de l'Arménie ; cohortes quattuor advorsum pedites hostium Sall. J. 51, 3, disposer quatre cohortes en face de l'infanterie ennemie
— certis locis cum ferro homines conlocati Cic. Cæc. 41, des hommes armés placés à des endroits déterminés ; eos eodem loco in acie conlocat Cæs. C. 2, 33, 3, il les range en bataille au même endroit ; cf. Cic. Phil. 1, 25 ; Cæl. 65 ; se Athenis conlocavit Cic. Fin. 5, 4, il se fixa (s'établit) à Athènes
— [avec in acc.] : in tabernam vasa et servos Pl. Men. 986, installer à l'auberge bagages et esclaves ; se in arborem Pl. Aul. 706, s'installer sur un arbre ; exercitum in provinciam quæ proxuma est Numidiæ hiemandi gratia conlocat Sall. J. 61, 2, il établit son armée en vue des quartiers d'hiver dans la partie de la province la plus rapprochée de la Numidie
¶2. [fig.] placer, établir : scientia rerum earum, quæ agentur aut dicentur, loco suo conlocandarum Cic. Off. 1, 142, savoir mettre toutes choses, actions ou paroles, à leur place ; vocum judicium ipsa natura in auribus nostris conlocavit Cic. Or. 173, la nature même a mis dans nos oreilles la faculté de juger les tons ; adulescentiam in voluptatibus Cic. Cæl. 39, consacrer sa jeunesse aux plaisirs ; omne suum studium in doctrina Cic. Q. 1, 1, 29, mettre toute son application à la science ; totum se in cognitione et scientia Cic. Off. 1, 158, se consacrer tout entier à l'étude et au savoir ; totum se in optimo vitæ statu exquirendo Cic. Tusc. 5, 2, s'employer entièrement à la recherche du meilleur état de la vie ; de cujus moderatione in prioribus libris satis collocavi Tac. An. 6, 27, à parler de sa modération j'ai consacré assez de développements dans les livres précédents
¶3. mettre en place, régler, arranger : vix ut rebus quas constituissent conlocandis atque administrandis tempus daretur Cæs. G. 3, 4, 1, en prenant à peine le temps de régler et d'exécuter les résolutions prises ; rem militarem Cic. Fam. 2, 13, 3, régler les affaires militaires
— [rhét.] : verba diligenter conlocata Cic. Or. 227, mots placés avec soin ; ratio collocandi Cic. Part. 11, l'art de bien disposer les mots ; simplicia, conlocata verba Cic. Or. 80, mots isolés, mots groupés
¶4. placer, mettre à un rang déterminé : aliquem in altissimo gradu dignitatis Cic. Sen. 2, placer qqn au plus haut degré de dignité (Rep. 1, 69)
— mettre en possession : aliquem in patrimonio suo Cic. Phil. 13, 12, mettre qqn en possession de ses biens
¶5. donner une fille en mariage : aliquam in matrimonium Cic. Div. 1, 104 ; aliquam nuptum Cæs. G. 1, 18, 7 ; nuptui Col. 4, 3, 6 ; eas in familiarum amplissimarum matrimoniis conlocavit Cic. Rep. 2, 12, il unit ces jeunes filles par des mariages aux plus illustres familles (Phil. 2, 44) ; Galbæ filio filiam suam conlocaverat Cic. Br. 98, il avait marié sa fille au fils de Galba (Cæs. G. 1, 18, 6)
¶6. placer de l'argent (sur qqch) : dotem in fundo Cic. Cæc. 11, placer une dot (l'asseoir) sur un fonds de terre ; pecuniam in prædiis Cic. Cæc. 16, placer de l'argent en biens-fonds ; pecunias magnas collocatas habere in ea provincia Cic. Pomp. 18, avoir des sommes considérables placées dans cette province ; collocare pecuniam Cic. Off. 2, 87, faire un placement d'argent
— bene apud aliquem munera Cic. Verr. 5, 56, bien placer sur qqn ses dons ; beneficium Cic. Off. 2, 70, bien placer sur qqn ses bienfaits (Fam. 13, 28, 3 ; Verr. 5, 37).
¶1. colloque, entrevue : venire in conloquium Cæs. G. 1, 35, 2, se rendre à une entrevue
¶2. conversation, entretien : conloquia amicorum absentium Cic. Phil. 2, 7, entretiens avec des amis absents [par correspondance].
¶1. int., s'entretenir avec : conloqui cum aliquo Cic. Br. 218, s'entretenir avec qqn [de aliqua re Cic. de Or. 1, 26, sur qqch]
— [rare, av. acc. de la chose] : de rebus quas tecum colloqui volo Nep. Them. 9, 4, sur les objets dont je désire t'entretenir ; [acc. obj. intér.] cum essent perpauca inter se conlocuti Cic. Rep. 1, 18, ayant échangé seulement quelques propos
¶2. tr., [acc. de la pers.] : te volo colloqui Pl. Amph. 898, j'ai à te parler, cf. Mil. 1008 ; Most. 783 ; Trin. 1135 ; Cic. Verr. 2, 135.
¶1. jouer avec, jouer ensemble : paribus colludere Hor. P. 159, jouer avec ceux de son âge, cf. Virg. G. 1, 369
¶2. colluder, s'entendre frauduleusement avec : nisi tecum conlusisset Cic. Verr. 2, 58, s'il n'y avait pas eu collusion entre vous.
¶1. laver, nettoyer à fond : Cat. Agr. 100 ; os de oleo Plin. 23, 77, se gargariser avec de l'huile
— [fig.] humecter, rafraîchir : Ov. M. 5, 447
¶2. couler autour, arroser : Pomp. Dig. 41, 1, 30.
¶1. compagnon de jeu : Cic. Phil. 2, 101 ; Juv. 9, 61
¶2. coupable de collusion : Cod. Th. 7, 20, 2.
¶1. éclairer vivement, illuminer : sol omnia conlustrans Cic. Nat. 2, 92, le soleil qui éclaire toutes choses ; conlustrata [pl. n.] in picturis Cic. Or. 36, les parties éclairées dans un tableau
¶2. parcourir du regard : Virg. En. 3, 651 ; cum omnia conlustrarem oculis Cic. Tusc. 5, 65, en parcourant des yeux l'ensemble ; animo Cic. Rep. 3, 7, passer en revue par la pensée.
¶1. eaux grasses, immondices, ordures : Col. 1, 5, 6 ; Plin. 24, 176
¶2. [fig.] mélange impur, confusion, chaos : in ea colluvie regnare Attic. d. Cic. Att. 9, 10, 7, régner sur ce chaos
— saleté, ordure : Aug. Civ. 2, 18
— v. colluvio.
¶1. mélange impur, confusion, trouble, chaos : Cic. CM 84 ; Liv. 4, 25 ; ex omnium scelerum conluvione natus Cic. Sest. 15, issu d'un ramassis de tous les vices ; in conluvione Drusi Cic. Vat. 23, dans l'état de confusion créé par Drusus (le bourbier de Drusus) ; colluvio verborum Gell. 1, 15, 17, un flux bourbeux de paroles
¶2. souillure : Amm. 31, 9, 5.
¶1. sorte de petit gâteau, de petit pain : Aug. Gen. 8, 5, 11
¶2. ornement de tête à l'usage des femmes : Tert. Cult. fem. 2, 7
¶3. mauve sauvage : Apul. Herb. 40
¶4. sorte de poisson : *Plin. 9, 61 ; 32, 146.
¶1. cultiver, soigner : agrum Cat. Agr. 61 ; agros Cic. Tusc. 2, 13 ; vitem Cic. Fin. 4, 38, cultiver un champ, des champs, la vigne
— [fig.] : corpora Ov. Ars. 3, 107, soigner, parer son corps ; lacertos auro Curt. 8, 9, 21, parer (orner) d'or ses bras
— soigner, traiter : aliquem arte, opulenter Sall. J. 85, 34, traiter qqn durement, royalement
— [en parl. des dieux] veiller sur, protéger : genus hominum Pl. Pœn. 1187, protéger le genre humain ; dum terras hominumque colunt genus Hor. Ep. 2, 1, 7, tandis qu'ils veillent sur les terres et sur le genre humain ; Pax arva colat Tib. 1, 10, 45, que la Paix protège nos champs
¶2. habiter : urbem Cic. Fam. 2, 12, 2, habiter la ville [Rome] ; qui has nobiscum terras colunt Cic. Nat. 2, 164, ceux qui habitent la même terre que nous
— [en parl. des dieux] : divi divæque, qui maria terrasque colitis Liv. 29, 27, 1, dieux et déesses, qui habitez les mers et les terres (Pl. Pœn. 950 ; Virg. B. 2, 62 ; 3, 61 ; Liv. 24, 39, 8 ; 31, 30, 9)
— [abst] : colunt circa utramque ripam Rhodani Liv. 21, 26, 6, ils habitent sur les deux rives du Rhône (Pl. Ps. 202 ; Liv. 24, 49, 6, etc.; Curt. 9, 9, 2) ; colunt discreti ac diversi Tac. G. 16, ils ont des habitations séparées, isolées en tous sens
¶3. cultiver, pratiquer, entretenir : nec vitam illam colere possum Cic. Att. 12, 28, 2, et je ne puis pratiquer ce genre de vie-là ; colere vitam = degere vitam Pl. Most. 731, etc., passer sa vie, vivre (Ter. Haut. 136) ; ævum vi colere Lucr. 5, 1145, vivre dans la violence ; virtutem Cic. Arch. 16 ; justitiam Cic. Off. 1, 149, pratiquer la vertu, la justice ; studium philosophiæ Cic. Br. 315, cultiver l'étude de la philosophie ; æquabile et temperatum orationis genus Cic. Off. 1, 3, cultiver un genre de style simple et tempéré
¶4. honorer : deos Cic. Nat. 1, 115, etc., honorer les dieux ; religione maxima colitur Cic. Verr. 4, 96, [ce dieu] est l'objet du plus grand culte ; Musarum delubra Cic. Arch. 27, honorer les sanctuaires des Muses ; sacrarium summa cærimonia Nep. Them. 8, 4, entourer un sanctuaire de la plus grande vénération
— honorer, pratiquer avec respect : colebantur religiones pie magis quam magnifice Liv. 3, 57, 7, on mettait dans l'exercice du culte plus de piété que de magnificence ; sacra privata colere Cic. Dom. 105, accomplir les sacrifices domestiques ; religionum colentes Cic. Planc. 80, ceux qui observent les prescriptions religieuses, les hommes religieux
— honorer qqn, l'entourer de respect, de soins, d'égards : aliquem observare et colere Cic. Off. 1, 149, entourer qqn d'égards et d'attentions (Mur. 70 ; Fam. 6, 10, 7, etc.) ; a M. Antonio absens litteris colebatur Nep. Att. 20, 4, absent, il recevait par lettres les marques d'estime d'Antoine ; aliquem colere donis Liv. 31, 43, 7, faire sa cour à qqn par des présents ; semper ego plebem Romanam colo atque colui Liv. 7, 32, 16, pour moi toujours je suis et j'ai été dévoué aux plébéiens ; amicos colere Cic. Læ. 85, cultiver ses amis.
¶1. le côlon [l'un des gros intestins] : coli dolor Scrib. 122, colique
— colique : Plin. 20, 162
¶2.
a) partie, portion d'un ouvrage, morceau : Aug. d. Don. Virg. 12 ;
b) [gram.] membre de phrase : Isid. 2, 18, 1 ;
c) partie de vers : Quint. 9, 4, 78.
¶1. propriété rurale, terre : Col. 11, 1, 23
¶2. colonie : colonias collocare in locis idoneis Cic. Agr. 2, 73, établir des colonies dans des lieux propices ; in colonias mittere Liv. 4, 49, 14, envoyer en colonie [pour fonder des colonies]
— les colons : coloniam mittere in locum aliquem Cic. Div. 1, 3, envoyer qq part une colonie ; v. deduco
— [fig.] séjour : Pl. Aul. 576.
¶1. de ferme, de métairie : Varr. R. 1, 17, 2 ; ovium genus colonicum Plin. 8, 189, brebis de ferme
¶2. de colonie : cohortes colonicæ Cæs. C. 2, 19, 3, cohortes levées dans les colonies.
¶1. cultivateur, paysan : Cic. de Or. 2, 287
— fermier, métayer : Cic. Cæc. 94
¶2. colon, habitant d'une colonie : Cic. Nat. 3, 48
— [poét.] habitant : Virg. En. 7, 63 ; G. 2, 385.
¶1. couleur : albus Cic. Leg. 2, 45, la couleur blanche, le blanc ; colorem accipere Plin. 11, 225 ; bibere Plin. 8, 193, recevoir (prendre) une couleur, l'absorber, s'en imprégner ; uva ducit colorem Virg. B. 9, 49, le raisin prend de la couleur
¶2. couleur du visage, teint : viri percocto colore Lucr. 6, 1109, hommes au teint tout brûlé ; isti color immutatus est Cic. Verr. 1, 141, votre homme changea de couleur ; color suavis Cic. Tusc. 5, 46, teint doux (frais) ; coloris bonitas Cic. Off. 1, 130, bonté du teint
— beau teint, beauté : nimium ne crede colori Virg. B. 2, 17, ne te fie pas trop à l'éclat de ton teint
¶3. [fig.] couleur, aspect extérieur : amisimus colorem et speciem pristinam civitatis Cic. Att. 4, 16, 10, nous avons perdu la couleur et la forme de l'ancienne constitution [= nous n'en avons même plus l'apparence] ; omnis Aristippum decuit color Hor. Ep. 1, 17, 23, Aristippe s'arrangeait de toutes les formes de la vie
— [en part.] couleur du style, coloris : color urbanitatis Cic. Br. 171, couleur (teint) d'urbanité, [littt, propre aux gens de la ville, aux Romains, v. coloro Cic. Br. 170], cf. de Or. 3, 95 ; 3, 199 ; Quint. 6, 3, 110, etc. ; color tragicus Hor. P. 236, couleur tragique (ton de la tragédie)
— couleur éclatante du style, éclat : Cic. Br. 298 ; de Or. 3, 100
— couleur, argument de défense [donnant aux faits une couleur favorable] : Sen. Contr. ; Quint. 4, 2, 88 ; 12, 8, 6 ; Juv. 6, 280.
===> forme colōs Pl. Men. 828 ; Mil. 1179 ; Lucr. 6, 208 ; 6, 1072 ; Sall. C. 15, 5 ; Liv. 28, 26, 14.
===> .
===> .
¶1. tamis : Cat. Agr. 11, 2 ; Virg. G. 2, 242
— colum nivarium, ii, n., passoire contenant de la neige dans laquelle on filtre le vin pour le rafraîchir : Mart. 14, 103
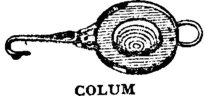
¶2. filtre de sable : Plin. 36, 174
¶3. nasse : Aus. Ep. 4, 57.
¶1. pigeonnier, colombier : Varr. R. 3, 7, 4
¶2. boulin, niche pratiquée dans un colombier pour abriter une paire de pigeons : Varr. R. 3, 7, 4
¶3. niche destinée à recevoir les urnes funéraires : CIL 2, 2002
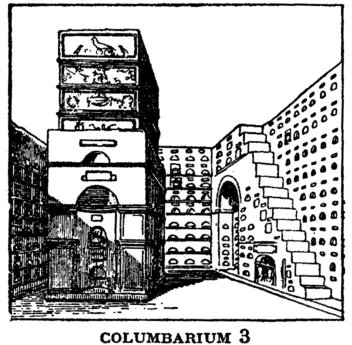
¶4. boulin, cavité d'un mur destinée à recevoir une pièce de charpente : Vitr. 4, 2, 4
¶5. ouverture pratiquée dans un navire pour le passage de la rame : Isid. 19, 2, 3 ; Fest. 169
¶6. godet [dans la roue à godets] : Vitr. 10, 4, 2.
¶1. de pigeon : Cat. Ag. 36 ; pulli columbini Cic. Fam. 9, 18, 3 et columbini Mart. 13, 66, pigeonneaux
¶2. couleur de pigeon : vitis columbina Plin. 14, 40, vigne dont les raisins sont gris cendré.
¶1. cime, sommet : Cic. poét. Div. 1, 18 ; Catul. 63, 71
— faîte, comble [d'un toit], chaperon : Cat. Agr. 15, 1 ; Varr. R. 3, 7, 1
— [fig.] : columen amicorum Antonii Cic. Phil. 13, 26, (le plus saillant) le coryphée des amis d'Antoine ; audaciæ Pl. Amph. 367, modèle d'effronterie
¶2. poutre de support du toit, poinçon : Vitr. 4, 2, 1 ; 4, 7, 5
— [fig.] pilier, soutien, colonne : Timarchides, columen familiæ vestræ Cic. Verr. 3, 176, Timarchide, soutien de votre famille ; rei publicæ Cic. Sest. 19, colonne de l'État.
¶1. colonne : Cic. Verr. 1, 134, etc. ; columnam dejicere, demoliri, reponere, jeter à bas, renverser, replacer une colonne, v. ces verbes ; columna Mænia Cic. Cæcil. 50, la colonne Mænia [au pied de laquelle on jugeait et punissait les esclaves, les voleurs et les mauvais débiteurs ; d'où] columna seul = le tribunal lui-même : Cic. Clu. 39 ; Sest. 18
— rostrata Quint. 1, 7, 12, colonne rostrale [en mémoire de la victoire navale de Duilius, ornée d'éperons de navires]
— columnæ Herculis Mel. 1, 5, 3, colonnes d'Hercule [Calpé et Abyla] ; Protei Virg. En. 11, 262, les colonnes de Protée [confins de l'Égypte]
— columnæ Hor. P. 373, les colonnes des portiques [où les libraires affichaient les nouveautés]

¶2. [fig.] colonne, appui, soutien : Hor. O. 1, 35, 14
¶3. objets en forme de colonne : [colonne d'eau] Lucr. 6, 426, etc. ; [colonne de feu] Sen. Nat. 6, 26, 4, etc.; [membre viril] Mart. 6, 49, 3 ; 11, 51, 1.

===> m. Catul. 64, 311 ; Prop. 4, 1, 72 ; 4, 9, 48.
¶1. chevelure [de l'homme] : calamistrata coma Cic. Sest. 18, cheveux frisés au fer
— toison : Acc. Tr. 211
— crinière : Gell. 5, 14, 9 ; Pallad. 4, 13
— panache, aigrette : Stat. Th. 8, 389
¶2. [fig.] chevelure, toison : comæ telluris Col. 10, 277, les fruits de la terre ; coma nemorum Hor. O. 1, 21, 5, la chevelure des bois, les frondaisons
— rayons [d'une flamme, du soleil] : Catul. 61, 77
— duvet du papier : Tib. 3, 1, 10.
¶1. part. de como 1
¶2. pris adjt, chevelu, pourvu d'une chevelure ou d'une crinière : Virg. En. 12, 86
— bien fourni [en poils, en herbe, etc.] : galea comans Virg. En. 2, 391, casque surmonté d'un panache épais ; comans humus Stat. Th. 5, 502, terre couverte d'herbe ; stella comans Ov. M. 15, 749, comète.
¶1. arbouse, fruit de l'arbousier : Plin. 15, 99
¶2. sorte de fraisier : Apul. Herb. 37.
¶1. int., boire avec d'autres : Sen. Ep. 123, 15
¶2. tr., boire, absorber, s'imbiber, se pénétrer de : combibere venenum corpore Hor. O. 1, 37, 28, faire passer le poison dans ses veines ; baca salem combibit Col. 12, 47, 10, l'olive s'imprègne de sel ; combibitur Erasinus Ov. M. 15, 175, l'Érasinus s'engouffre dans la terre
— [fig.] se pénétrer, s'imprégner de : Cic. Fin. 3, 9 ; Sil. 11, 402.
===> .
¶1. manger : Pl., Ter. ; Cic. Clu. 173 ; Nat. 2, 64 ; Br. 217
¶2. [fig.]
a) manger, dévorer, ronger : comedere oculis Mart. 9, 60, 3, dévorer des yeux ; ipsus se comest Pl. Truc. 593, il se consume de chagrin ;
b) dissiper, manger : bona comedere Cic. Sest., 110, manger son bien ; cf. Att. 6, 1, 25 ; comedere aliquem Pl. Most. 12, manger quelqu'un (le gruger) ; nobilitas comesa Juv. 1, 34, noblesse ruinée.
===> subj. arch. comedīm, īs, it, etc., Pl., Ter. ; Cic. Fam. 9, 20, 3 ; 11, 21, 2
— comestur Lact. Mort. 33, 8.
a) habitants de Côme : Liv. 33, 37, 10 ;
b) peuple de Galatie : Plin. 5, 147.
¶1. compagnon [ou] compagne de voyage ; compagnon, compagne : confugere sine comite Ter. Hec. 823, s'enfuir sans compagnon ; comes meus fuit illo tempore Cic. Fam. 13, 71, ce fut mon compagnon à cette époque ; cui it comes Virg. En. 6, 158, il l'accompagne
— [fig.] associé : me omnium rerum comitem habebis Cic. Fam. 1, 9, 22, je serai ton associé en toutes choses, cf. Læ. 37 ; Cæs. C. 3, 80 ; in aliqua re Cic. Fam. 1, 9, 2 ; pacis est comes otique socia... eloquentia Cic. Br. 45, l'éloquence est la compagne de la paix, l'associée du repos
¶2. [en part.]
a) pédagogue, gouverneur d'un enfant : Suet. Cl. 35, 2 ;
b) personne de la suite, de l'escorte : Hor. Ep. 1, 8, 2 ; Cic. Verr. 2, 27 ;
c) comte [dignité du Bas Empire] : Cod. Th. 11, 8, 1.
===> .
===> cosmis Inscr.
¶1. de cour : comitatensis fabrica Amm. 18, 4, 2, intrigue de cour
¶2. relatif à la dignité de comte : comitatensis legio Cod. Th. 12, 36, 14, légion commandée par un comte.
¶1. accompagnement, cortège, suite : magno comitatu Cic. Cat. 3, 6, avec une nombreuse escorte
¶2. troupe de voyageurs, caravane : Liv. 28, 22, 4
— suite d'un prince, cour, courtisans : Tac. An. 13, 46 ; Plin. Pan. 20, 3.
¶1. accompagner : aliquem Cæs. G. 6, 8, 8 ; Suet. Gram. 23, accompagner qqn ; ille meum comitatus iter Virg. En. 6, 112, lui qui m'accompagne dans mon voyage
— [en part.] suivre le convoi funèbre de qqn : Virg. En. 11, 52
¶2. [fig.] être lié à qqch [avec dat.] : quæ comitantur huic vitæ Cic. Tusc. 5, 100, ce qui est lié à ce genre de vie ; tardis mentibus virtus non facile comitatur Cic. Tusc. 5, 68, la vertu ne va guère avec une intelligence engourdie
— [abst] Teucrum comitantibus armis Virg. En. 4, 48, avec l'appui des armes troyennes.
¶1. passage (par où on peut aller et venir) : Pl. Mil. 142 ; 468 ; Stich. 452
¶2. permission d'aller et de venir ; [d'où] congé militaire, permission : commeatus totius æstatis Cic. Verr. 5, 62, congé de tout l'été ; commeatum sumere Liv. 3, 46, 10 ; dare Liv. 3, 46, 9, prendre, donner un congé ; in commeatu esse Liv. 33, 29, 4, être en congé ; commeatu abfuturus Suet. Tib. 72, sur le point de partir en congé ; in commeatu Syracusis remanere Cic. Verr. 5, 111, rester à Syracuse en congé
— [fig.] : (servitus) hæc est... sine intervallo, sine commeatu Sen. Nat. 3, pr. 16, cette servitude pèse sur nous sans trêve ni relâche
¶3. convoi : duobus commeatibus exercitum reportare Cæs. G. 5, 23, 2, ramener l'armée en deux convois ; prioris commeatus milites Cæs. G. 5, 23, 4, les soldats du premier convoi
¶4. approvisionnement, vivres : commeatu nostros prohibere Cæs. G. 2, 9, empêcher les nôtres de se ravitailler ; commeatum petere Cæs. G. 3, 2, 3 ; supportare Cæs. G. 1, 48, 2 ; portare Cæs. G. 2, 5, 5 ; subvehere Liv. 28, 4, 7, chercher, transporter les approvisionnements
— approvisionnements en dehors du blé : copia frumenti et reliqui commeatus Cæs. G. 7, 32, 1, l'abondance du blé et des autres approvisionnements, cf. 1, 39, 1 ; 3, 6, 4, etc.
— [plais.] in commeatum argentarium proficisci Pl. Ps. 424, partir pour se ravitailler d'argent.
¶1. int., se ressouvenir : si satis commemini Ter. Phorm. 523, si j'ai bonne mémoire, cf. Pl. Truc. 114 ; Ter. Eun. 564 ; [avec gén.] Pl. Trin. 1027
— mentionner [av. gén.] : Plato Socratis sectatorum commeminit Gell. 14, 3, 2, Platon nomme un grand nombre de disciples de Socrate
¶2. tr., se ressouvenir, se rappeler : quem hominem probe commeminisse se aiebat Cic. de Or. 1, 227, il en avait, disait-il, un souvenir fort précis ; aliquid Cic. de Or. 3, 85 ; Att. 9, 2.
¶1. se rappeler, évoquer : cotidie commemorabam te... fuisse Cic. Fam. 6, 21, 1, chaque jour je me rappelais que tu avais été... ; quid quoque die egerim, commemoro vesperi Cic. CM 38, ce que j'ai fait chaque jour, je me le rappelle le soir
¶2. rappeler à autrui : beneficia Cic. Læ. 71, rappeler les services rendus
¶3. signaler à la pensée, rappeler, mentionner : causæ quas commemorari necesse non est Cæs. C. 3, 66, 7, des motifs qu'il n'est pas nécessaire de mentionner
— [avec prop. inf.] Cic. de Or. 2, 160 ; Cæs. G. 4, 16, 2
— [avec de] parler de, faire mention de : omnes de tua virtute commemorant Cic. Q. 1, 1, 37, tous parlent de tes mérites (de Or. 3, 75 ; Verr. 4, 124, etc.).
¶1. part. de commendo
¶2. adjt,
a) recommandé : quæ res commendatior (erit) hominum memoriæ sempiternæ ? Cic. Phil. 2, 32, est-il action plus sûrement recommandée au souvenir éternel des hommes ?
— commendatissimus Fam. 2, 8, 3 ; 12, 26, 2, etc.;
b) qui se recommande, agréable, aimable : Plin. 16, 161 ; 25, 130 ; Petr. 110, 5 ; Val.-Max. 3, 8, 1.
¶1. confier, alicui rem, qqch à qqn : Cic. Fam. 15, 20, 1
— [fig.] nomen suum immortalitati Cic. Fam. 10, 12, 5, confier son nom à l'immortalité, s'immortaliser
¶2. recommander : vobis me ac meos commendavi Cic. Dom. 145, je me suis recommandé à vous, moi et les miens ; virtute populo Romano commendari Cic. Verr. 5, 180, être recommandé au peuple romain par ses talents
¶3. faire valoir : vox una maxime eloquentiam commendat Cic. de Or. 1, 252, la voix plus que tout le reste fait valoir l'éloquence ; nulla re una magis orator commendatur quam verborum splendore et copia Cic. Br. 216, pas une qualité, à elle seule, ne fait plus valoir l'orateur que l'éclat et la richesse du style ; marmora commendantur coloribus Plin. 36, 49, ce qui donne du prix au marbre, ce sont les veines nuancées.
===> d. Cic. Phil. 1, 16 ; de Or. 1, 5, incertitude du genre.
¶1. [en gén.] mémorial, recueil de notes, mémoire, aide-mémoire : non est oratio, sed orationis commentarium paulo plenius Cic. Br. 164, ce n'est pas un discours, mais un canevas assez développé ; conficiam commentarios rerum omnium Cic. Fam. 5, 12, 10, je rédigerai des notes de tous les événements ; commentarium consulatus mei Græce compositum misi ad te Cic. Att. 1, 19, 10, je t'ai envoyé le mémoire sur mon consulat rédigé en grec
¶2. [en part.]
a) recueil de notes, journal, registre, archives de magistrats : commentarium M. Sergii quæstoris Varr. L. 6, 90, le journal du questeur M. Sergius ; commentarii pontificum Cic. Br. 55, les registres des pontifes ; commentarii senatus Tac. An. 15, 74, les archives du sénat ; commentarii diurni Suet. Aug. 64, 2, = acta diurna, le journal officiel de Rome ;
b) Commentarii Cæsaris Cic. Br. 262, les Commentaires de César ;
c) brouillon, projet de discours : Quint. 10, 7, 30 ;
d) procès-verbaux d'une assemblée, d'un tribunal : Cic. Verr. 5, 54 ; Tac. An. 6, 47 ;
e) commentaire, explication d'un auteur : Gell. 2, 6, 1 ;
f) cahier de notes [d'un élève] : Quint. 3, 6, 59.
¶1. inventé, imaginé : commenticia spectacula Suet. Cl. 21, 1, spectacles inédits
¶2. imaginaire, de pure imagination : commenticia civitas Platonis Cic. de Or. 1, 230, la république idéale de Platon ; commenticii dii Cic. Nat. 2, 70, dieux imaginaires
¶3. faux, mensonger : crimen commenticium Cic. Amer. 42, accusation forgée, calomnieuse.
¶1. méditer, réfléchir à : qui multos annos nihil aliud commentaris Cic. Fam. 7, 1, 5, toi qui ne penses qu'à cela depuis plusieurs années ; futuras mecum commentabar miserias Cic. poet. Tusc. 3, 29, j'évoquais par la pensée des malheurs à venir (Pl. Pœn. 1); ut commentemur inter nos, qua ratione nobis traducendum sit hoc tempus Cic. Fam. 4, 6, 3, pour réfléchir ensemble sur la manière dont nous devons nous conduire en ce moment ; de aliqua re commentari Cic. Phil. 3, 36, méditer sur qqch
¶2. faire des exercices, étudier, s'exercer : [en parl. d'un maître de gladiateurs] Cic. de Or. 3, 86 ; cum commentandi causa convenissemus Cic. Læ. 7, nous étant réunis pour étudier des questions de science augurale (Div. 1, 90) ; commentabar declamitans sæpe cum M. Pisone... Cic. Br. 310, je faisais souvent des exercices de déclamation avec M. Pison...; satisne vobis videor in vestris auribus commentatus ? Cic. Fin. 5, 75, pensez-vous que je me sois assez exercé [à l'exposé philosophique] en votre présence ?
— [avec acc.] préparer qqch par la méditation : causam Cic. Br. 87, préparer une plaidoirie ; orationem Cic. Amer. 82, un discours (Br. 301)
— [part. sens passif] : commentata oratio Q. Cic. d. Fam. 16, 26, 1, discours préparé (médité) ; sua et commentata et scripta Cic. Br. 301, ce qu'il avait et préparé et écrit
¶3. composer, rédiger : mimos Cic. Phil. 11, 13, composer des mimes (Gell. 1, 9, 4) ; de militari disciplina Plin. pr. 30, écrire sur la discipline militaire
— commenter, expliquer : Suet. Gram. 2.
¶1. fiction, chose imaginée, imagination : ipsis commentum placet Ter. Andr. 225, ils s'applaudissent de leur invention ; opinionum commenta delet dies Cic. Nat. 2, 5, le temps fait justice des croyances chimériques ; sine aliquo commento miraculi Liv. 1, 19, 5, sans une idée de merveilleux
¶2. plan, projet : ut nefanda commenta facilius tegerentur Just. 21, 4, 3, pour mieux couvrir des projets criminels
¶3. [rhét.] enthymème : Quint. 5, 10, 1.
¶1. aller et venir, circuler : Cæs. G. 7, 36, 7 ; Liv. 5, 47, 11, etc.; Cic. Nat. 2, 84, etc.; [fig.] Tac. An. 2, 28, 5
¶2. aller souvent qq part : ad Belgas Cæs. G. 1, 1, 3, chez les Belges ; Delos, quo omnes undique cum mercibus commeabant Cic. Pomp. 55, Délos, où tous les négociants de tous les points du monde se rendaient avec leurs marchandises ; [fig.] Cic. Cæl. 38 ; Att. 8, 9, 3.
I. pr.
¶1. trafic, commerce, négoce : alicujus Liv. 28, 18, 12, commerce de qqn (fait par qqn); alicujus rei Liv. 45, 29, 13, commerce de qqch ; commercio aliquem prohibere Sall. J. 18, 6 ; Liv. 4, 52, 6, empêcher qqn de faire du commerce
¶2. possibilité (droit) de trafiquer, d'acheter : commercium in eo agro nemini est Cic. Verr. 3, 93, personne n'a le droit de faire d'achat sur ce territoire ; nisi arbitramini iis hominibus commercium istarum rerum cum Græcis hominibus non fuisse Cic. Verr. 4, 133, à moins que, selon vous, ces hommes n'aient pu faire le commerce (l'achat) de ces objets avec les Grecs ; ut denorum equorum iis commercium esset Liv. 43, 5, 9, [on concéda] qu'ils auraient le droit d'acheter chacun dix chevaux
¶3. article de commerce, de trafic, marchandises : Frontin. Strat. 2, 5, 14 ; Plin. 35, 168 ; 26, 19
¶4. lieu où se fait le commerce, place de commerce : commercia et litora peragrare Plin. 37, 45, parcourir les places de commerce et les points du littoral.
II. fig.
¶1. rapports, relations, commerce : habere commercium cum aliquo Cic. Tusc. 5, 66 (Læ. 42), avoir commerce avec qqn ; commercium plebis Liv. 5, 3, 8, relations avec la plèbe ; loquendi audiendique Tac. Agr. 2, l'échange des propos ; dandi et accipiendi beneficii V.-Max. 5, 3, (relations qui consistent à donner et recevoir des bienfaits) l'échange des bienfaits ; linguæ Liv. 9, 36, 6, possibilité de converser dans une langue ; commercio sermonum facto Liv. 5, 15, 5, des échanges de propos s'étant établis ; epistularum Sen. Ep. 38, 1, échange de lettres, commerce épistolaire ; belli commercia Tac. H. 3, 81, rapports entre belligérants
¶2. commerce charnel : Pl. Truc. 94
¶3. [droit] connivence, collusion : Cod. Th. 8, 1, 15 ; 13, 11, 4.
¶1. mesurer : Col. 5, 1, 2
— [fig.] commetiri omnes porticus Pl. Most. 910, arpenter tous les portiques
¶2. mesurer ensemble, confronter : Cic. Inv. 1, 39 ; Tim. 33.
===> commentus, a, um, avec sens pass., imaginé : Ov. M. 3, 558 ; 6, 565.
¶1. mettre en pièces, briser, broyer : statuam comminuunt Cic. Pis. 93, ils mettent en pièces la statue ; comminuere fabas molis Ov. Medic. 72, moudre des fèves ; comminuere caput Pl. Rud. 1118, casser la tête ; comminuere diem articulatim Pl. d. Gell. 3, 3, 5, découper la journée en tranches
— [fig.] Viriathum Lælius comminuit Cic. Off. 2, 40, Lælius écrasa Viriathe
¶2. diminuer : comminuere auri pondus Hor. S. 1, 1, 43, entamer un tas d'or
— [fig.] affaiblir, réduire à l'impuissance, venir à bout de : avaritia comminuit officium Cic. Quinct. 26, l'avidité ruine tout sentiment du devoir ; comminuere ingenia Quint. 1, 7, 33, énerver le talent ; lacrimis comminuere meis Ov. H. 3, 134, tu seras vaincu par mes larmes.
¶1. de près : pugnare Cæs. C. 1, 58, 4, combattre de près ; comminus, eminus petere Liv. 21, 34, 6, assaillir de près, de loin ; comminus conserere manus Liv. 28, 18, 14, combattre corps à corps ; nunc comminus agamus Cic. Div. 2, 26, maintenant venons-en aux mains sérieusement ; ad te comminus accessit Cic. Att. 2, 2, 2, toi, il t'a serré de près ; comminus arva insequi Virg. G. 1, 104, reprendre de près son champ [à la main, avec le hoyau]
¶2. = prope : viso comminus armatorum agmine Tac. H. 1, 41, ayant vu une bande armée toute proche ; comminus judicare aliquid Plin. 11, 240, juger qqch de près (sur place)
— tout droit, tout de suite : non comminus Mesopotamiam petunt Tac. An. 12, 12, ils ne vont pas tout droit en Mésopotamie.
¶1. mêler avec : commiscere amurcam cum aqua Cat. Agr. 93, délayer du marc d'huile dans de l'eau, cf. Cic. Dom. 144 ; reliquias Domitiani cineribus Juliæ commiscuit Suet. Dom. 17, 3, elle réunit les restes de Domitien aux cendres de Julie ; commixtus aliqua re, mêlé de qqch : Lucr. 6, 322 ; Virg. En. 3, 633 ; Hor. S. 1, 10, 24
¶2. [fig.] unir, allier, confondre : nunquam temeritas cum sapientia commiscetur Cic. Marc. 7, jamais l'irréflexion ne s'allie à la sagesse ; commiscere aliquid rei cum Neptuno Pl. Rud. 487, avoir affaire tant soit peu à Neptune ; commiscere jus accusationis cum jure testimonii Her. 4, 35, confondre les droits de l'accusateur avec ceux des témoins
¶3. [en part.] commixtus ex aliqua re ou aliqua re, formé de qqch, constitué par qqch : Quint. 3, 8, 55 ; Virg. En. 6, 762.
===> formes de la 3e conj. : -scis Apic. 4, 181 ; fut. -sces Veg. Mul. 1, 34, 5.
¶1. tr., avoir pitié aliquem, de qqn : Enn. Tr. 222
¶2. int. [av. gén.] Pac. Tr. 391 ; Turp. Com. 211.
¶1. tr., plaindre, déplorer : commiserari fortunam Græciæ Nep. Ages. 5, déplorer le sort de la Grèce
¶2. int., [rhét.] exciter la compassion, recourir au pathétique : quid cum commiserari cœperit ? Cic. Cæcil. 46, que sera-ce, quand il se sera mis à faire appel à la pitié ?
¶1. jointure, joint : Ambr. Hex. 2, 5, 21
¶2. action de mettre en contact, de commencer : ab ipsa commissione ludorum Cic. Att. 15, 26, 1, dès l'ouverture des jeux
— [en part.] représentation [au théâtre, au cirque] : pantomimi producti in commissione Plin. Ep. 7, 24, pantomimes qui paraissent en représentation
— pièce de concours, morceau d'apparat : Suet. Cal. 53, 2 ; Aug. 89, 3
¶3. action de commettre une faute : Arn. 4, 31.
¶1. entreprise : Cic. Sull. 72 ; Liv. 44, 4, 8 ; 44, 6, 14
¶2. faute commise, délit, crime : commissa fateri Stat. S. 5, 5, 5, avouer ses fautes ; commissa luere Virg. En. 1, 136, expier ses crimes ; per ignorantiam scripturæ multa commissa fiebant Suet. Cal. 41, 1, comme on ne connaissait pas la lettre de la loi, il y avait force délits
¶3. objet confisqué, confiscation : in commissum cadere Dig. 39, 4, 16, encourir la confiscation ; tollere onus navis commisso Dig. 19, 2, 61, confisquer la cargaison d'un navire
¶4. secret : enuntiare commissa Cic. Tusc. 2, 31, trahir des secrets ; commissum tegere Hor. Ep. 1, 18, 38, garder un secret.
¶1. joint, jointure : pl., digitorum Cic. Nat. 2, 150, jointures des doigts ; ad commissuras pluteorum atque aggeris Cæs. G. 7, 72, 4, aux points de jonction du parapet et de la levée de terre ; colorum Plin. 35, 29, art de fondre les couleurs [ne pas laisser voir la transition]
¶2. [rhét.]; commissura verborum Quint. 9, 4, 37, assemblage des mots.
¶1. unir, assembler : commissis suarum turrium malis Cæs. G. 7, 22, 5, ayant réuni entre elles les poutres verticales de leurs propres tours [par les poutres transversales] ; commissis operibus Liv. 38, 7, 10, les travaux de défense s'étant rejoints ; per nondum commissa inter se munimenta Liv. 38, 4, 8, par les endroits où les fortifications ne s'étaient pas encore rejointes ; oræ vulneris suturis inter se committendæ Cels. 7, 19, les lèvres d'une plaie doivent être réunies par des sutures ; costæ committuntur cum osse pectoris Cels. 8, 1, les côtes se rattachent à l'os pectoral (sternum) ; viam viæ committere Liv. 39, 2, 10, joindre une route à une route ; commissa dextera dextræ Ov. H. 2, 31, mains droites jointes ; moles urbem continenti committit Curt. 4, 2, 16, une digue relie la ville au continent
¶2. mettre aux prises, faire combattre ensemble : pugiles Latinos cum Græcis Suet. Aug. 45, faire combattre ensemble des athlètes de pugilat latins et grecs ; camelorum quadrigas Suet. Ner. 11, mettre aux prises dans les jeux du cirque des attelages de chameaux ; inter se omnes committere Suet. Cal. 56, les mettre tous aux prises entre eux
— confronter, comparer : sua scripta antiquæ Corinnæ Prop. 2, 3, 21, comparer ses écrits à ceux de l'antique Corinne
¶3. mettre [p. ainsi dire] qqch en chantier, donner à exécuter, [d'où] entreprendre, commencer : prœlium Cic. Div. 1, 77 ; Cæs. G. 2, 21, 3, etc., engager le combat (cum aliquo Cic. Mur. 34, avec qqn) ; committere ac profligare bellum Liv. 21, 40, 11, entreprendre une guerre et en décider l'issue ; hoc bello prospere commisso Liv. 8, 25, 6, cette guerre ayant été heureusement entreprise ; nondum commisso spectaculo Liv. 2, 36, 1, le spectacle n'étant pas encore commencé ; quo die ludi committebantur Cic. Q. 3, 4, 6, le jour où commençaient les jeux ; judicium inter sicarios committitur Cic. Amer. 11, une action pour assassinat s'engage devant la justice
— [pass. imp.] priusquam committeretur Suet. Vesp. 5, avant le commencement du combat ; [part. neutre] : audacter commissum Liv. 44, 4, 8, entreprise audacieuse (44, 4, 11 ; 44, 6, 14)
— [rare] livrer complètement une bataille : Cic. Mur. 33 ; Liv. 23, 44, 5 ; 34, 37, 7
¶4. mettre à exécution un acte coupable, commettre, se rendre coupable de : facinus Cic. Amer. 65 ; scelus Cic. Sull. 6 ; nefarias res Cic. Phil. 6, 2 ; majus delictum Cæs. G. 7, 4, 10, commettre un forfait, un crime, des crimes abominables, un délit plus grave ; si quæ culpa commissa est Cic. Fam. 16, 10, 1, si une faute a été commise ; quæ tu sine Verre commisisti Cic. Cæcil. 35, les actes dont tu t'es rendu coupable, toi, sans Verrès
— [abst] se rendre coupable, faillir : quasi committeret contra legem Cic. Br. 48, comme s'il commettait une infraction à la loi, cf. Verr. 1, 110 ; lege censoria committere Varr. R. 2, 1, 16 (Quint. 7, 1, 9), être coupable au regard de la loi censoriale ; neque commissum a se quare timeret Cæs. G. 1, 14, 2, [il disait] qu'il n'y avait pas eu de sa part une action coupable qui justifiât des craintes (il n'avait rien fait pour craindre) ; Cædicius negare se commissurum, cur sibi quisquam imperium finiret Liv. 5, 46, 6, Cédicius déclarait qu'il ne ferait rien pour qu'on lui enlevât le commandement
— committere ut [et surtout non committere ut], se mettre dans le cas que, s'exposer à ce que : commisisti ut ex isdem prædiis et Apollonide et Romæ imperatum esset tributum Cic. Flacc. 80, tu t'es exposé à ce que sur les mêmes terres un impôt fût ordonné à la fois à Apollonis et à Rome ; vide quam temere committant ut, si nulla sit divinatio, nulli sint di Cic. Div. 2, 41, vois avec quelle légèreté ils s'exposent à la conclusion que, s'il n'y a pas de divination, il n'y a pas de dieux ; sordidum est ad famam committere, ut accusator nominere Cic. Off. 2, 50, c'est une tache pour la réputation que de s'exposer au surnom d'accusateur en titre ; committendum non putabat ut dici posset... Cæs. G. 1, 46, 3, il ne pensait pas qu'il fallût s'exposer à ce qu'on pût dire...; quare ne committeret ut Cæs. G. 1, 13, 7, qu'il ne s'exposât donc pas à ce que... cf. 7, 47, 7
— [même sens avec inf.] : Ov. M. 9, 632 ; Col. 2, 4, 3
¶5. faire se produire, laisser se réaliser qqch, [d'où] se mettre dans le cas de, encourir [une peine] ; pœnam Cic. Verr. 3, 30 ; multam Cic. Clu. 103, encourir une peine, une amende,
¶6. rendre exécutoire : committere edictum, stipulationem Dig., rendre exécutoire un édit, un engagement = se mettre dans le cas que l'édit... soit exécuté = être passible d'un édit, encourir l'exécution d'un engagement
— part. passif [t. de droit] : rendu exécutoire, dévolu : hypothecæ commissæ sunt Cic. Fam. 13, 56, 2, les hypothèques sont rendues exécutoires [par expiration du délai et non-accomplissement des engagements] ; hanc fiduciam commissam tibi dicis Cic. Flac. 51, tu dis que ces nantissements te sont acquis (dévolus)
¶7. laisser aller (abandonner) qqn, qqch, risquer, hasarder : in conspectum alicujus se committere Cic. Verr. 4, 26, s'aventurer sous les regards de qqn (affronter les regards de qqn); se in conclave Cic. Amer. 64, s'aventurer dans une chambre (se in senatum Cic. Q. 3, 2, 2, au sénat); se in aciem Liv. 23, 11, 10, se hasarder dans la bataille ; auctor non sum, ut te urbi committas Cic. Att. 15, 11, 1, je ne te conseille pas de te risquer à Rome ; se populo, senatui Cic. Mil. 61, se présenter devant le peuple, au sénat (Sest. 116) ; se prœlio Liv. 4, 59, 2 ; se pugnæ Liv. 5, 32, 4, se risquer à une bataille
— confier : alicui salutem, fortunas, liberos Cic. Off. 2, 43, confier à qqn son salut, ses biens, ses enfants ; quædam domestica litteris non committere Cic. Att. 4, 1, 8, ne pas confier à une lettre certaines affaires de famille ; salutem suam Gallorum equitatui committere non audebat Cæs. G. 1, 42, 5, il n'osait pas confier sa sécurité à la cavalerie gauloise ; nihil his committendum existimavit Cæs. G. 4, 5, 1, il pensa qu'il devait ne compter sur eux en rien
— [abst] s'en remettre, alicui, à qqn : commisi Heio Cic. Verr. 4, 16, j'ai fait confiance à Héius, cf. Pl. Curc. 655 ; Cic. Agr. 2, 20 ; Cæs. C. 3, 25, 1 ; committere alicui, ut videat... Cic. Mil. 70, s'en remettre à qqn du soin de voir (confier à qqn la mission de...); alicui de existimatione sua Cic. Verr. 3, 137, s'en remettre à qqn touchant sa réputation.
¶1. [en gén.] chose prêtée, prêt : commodatum accipere Dig. 13, 6, 3, emprunter
¶2. contrat de commodat : agere commodati Dig. 13, 6, 1, exercer l'action de commodat.
¶1. dans la mesure convenable, appropriée au but ; convenablement, bien : multa breviter et commode dicta Cic. Læ. 1, maintes paroles pleines de concision et de justesse ; orationem commode scriptam esse dixit Cic. de Or. 1, 231, il déclara que le discours était habilement composé ; minus commode audire Cic. Verr. 3, 134, n'avoir pas une bien bonne réputation ; nos commodius agimus Cic. Fin. 2, 3, nous, nous faisons mieux ; non minus commode Cæs. G. 2, 20, 3, aussi bien
— commode facis quod Cic. Att. 11, 7, 7, tu es bien inspiré en ; commodius fecissent, si dixissent Cic. Agr. 3, 1, ils auraient été mieux inspirés, s'ils avaient dit (ils auraient mieux fait de dire)
¶2. dans de bonnes conditions : explorat quo commodissime itinere vallem transire possit Cæs. G. 5, 49, 8, il recherche le meilleur chemin pour passer la vallée ; magis commode quam strenue navigavi Cic. Att. 16, 6, 1, j'ai fait une traversée facile plutôt que rapide.
===> commode cum Cic. *Verr. 3, 61, c. commodum cum.
¶1. mesure convenable, juste proportion, adaptation au but, convenance : (in ædificando) commoditatis dignitatisque diligentia Cic. Off. 1, 138, (quand il s'agit de la construction d'une maison) le souci du confortable et de la dignité [de la représentation] ; commoditas prosperitasque vitæ Cic. Nat. 3, 86, le bien et la prospérité de la vie
¶2. avantage : plurimas et maximas commoditates amicitia continet Cic. Læ. 23, l'amitié renferme de très nombreux et très grands avantages (Nat. 3, 86 ; Fin. 4, 29) ; qui ex bestiis fructus, quæ commoditas percipi posset ? Cic. Off. 2, 14, quel fruit, quel avantage pourrait-on retirer des animaux ?
— commodité : ob commoditatem itineris Liv. 1, 33, 6, pour faciliter les communications
— opportunité : commoditas ad faciendum idonea Cic. Inv. 2, 40, l'opportunité d'agir
¶3. caractère accommodant, bonté, indulgence : Pl. Mil. 1383 ; Ter. Ad. 710.
¶1. disposer convenablement : trapetum Cat. Agr. 135, 7, monter un pressoir
¶2. [fig.] aliquid alicui, mettre à la disposition de qqn qqch, prêter à qqn qqch [qui sera rendu] : ut hæc a virtute donata, cetera a fortuna commodata esse videantur Cic. Marc. 19, en sorte que ces avantages apparaissent comme un don de la vertu, et le reste comme un prêt de la fortune ; aurum alicui Cic. Cæl. 31, prêter à qqn de la vaisselle d'or ; alicui aurem patientem Hor. Ep. 1, 1, 40, prêter à qqn une oreille docile
¶3. appliquer à propos, approprier : parvis peccatis veniam Tac. Agr. 19, appliquer à propos l'indulgence aux fautes vénielles ; rei publicæ tempus Liv. 23, 48, 10, accorder à l'État le temps voulu [pour payer]
¶4. [abst] se montrer complaisant, rendre service (alicui) : publice commodasti Cic. Verr. 4, 20, tu [leur] as fait des avantages officiels ; alicui omnibus in rebus Cic. Fam. 13, 32, 2 (omnibus rebus Cic. Fam. 13, 35, 2), obliger qqn en toutes choses ; nec, cum tua causa cui commodes, beneficium illud habendum est Cic. Fin. 2, 117, quand tu rends service à qqn dans ton propre intérêt, il ne faut pas considérer cela comme un bienfait.
¶1. commodité : cum erit tuum commodum Cic. Att. 12, 28, 3, quand il te sera commode [à ta commodité]; quod commodo tuo fiat Cic. Fam. 4, 2, 4, fais-le comme cela t'arrangera le mieux ; per commodum Liv. 42, 18, 3 ; ex commodo Sen. Ep. 46, 1, en toute commodité, commodément ; si commodo valetudinis tuæ fieri possit Cic. Fam. 16, 1, 2, si ta santé le permet ; mei commodi causa Cic. Fam. 5, 20, 1, pour ma commodité ; commodo rei publicæ facere aliquid Cic. Fam. 1, 1, 3, faire qqch sans préjudice pour l'État
¶2. avantage, profit : dicet pertinere hoc ad commodum senatorium Cic. Verr. 3, 223, il dira que cela touche aux intérêts des sénateurs ; officii rationem, non commodi ducere Cic. Sest. 23, faire état du devoir et non de l'intérêt
— commoda pacis Cic. de Or. 2, 335 ; vitæ Cic. Tusc. 1, 87, les avantages de la paix, de la vie ; commoda publica Cic. Verr. 2, 66, avantages dont jouit le public ; de alterius commodis detrahere Cic. Off. 3, 30, empiéter sur les avantages dont jouissent les autres
— [en part.] avantages attachés à une fonction, appointements : commoda emeritæ militiæ ad sex milium summam recidit Suet. Calig. 44, il res\-treignit la pension de retraite des vétérans à six mille sesterces (Aug. 49 ; Galba 12 ; cf. Cic. Fam. 7, 8, 1 ; Sen. 35)
¶3. [rare] objet prêté, prêt : Cic. Verr. 4, 6 ; Isid. 5, 25, 16.
¶1. convenable, approprié : commodā staturā Pl. As. 401, d'une bonne taille ; tribus aut novem miscentur cyathis pocula commodis Hor. O. 3, 19, 12, on fait le mélange des coupes avec les trois ou neuf cyathes qui conviennent ; viginti argenti commodæ minæ Pl. As. 725, les vingt mines d'argent appropriées (qu'il me faut); cum urbanas res commodiorem in statum pervenisse intellegeret Cæs. G. 7, 6, 1, comprenant que les affaires de Rome étaient arrivées à un état meilleur ; hanc sibi commodissimam belli rationem judicavit, uti... Cæs. C. 3, 85, 2, il jugea que sa meilleure tactique était de...; commodius tempus anni Cic. Att. 9, 3, 1, saison plus opportune, plus favorable
— commodum (commodius, commodissimum) est, il est convenable, commode, opportun, avantageux : eum judicem, quem commodum erat, dabat Cic. Verr. 2, 33, il désignait le juge qu'il était à son avantage de désigner ; commodissimum esse statuit, omnes naves subduci Cæs. G. 5, 11, 5, il décida que le mieux était qu'on tirât tous les navires à sec sur le rivage
¶2. accommodant, bienveillant : Cic. Mur. 66 ; Q. 1, 1, 39 ; Læ. 54
— plaisant, agréable : aliis inhumanus ac barbarus, isti uni commodus ac disertus Cic. Verr. 3, 23, [il était] pour les autres sauvage et grossier, pour lui seul agréable et disert.
¶1. mettre en mouvement : Lucr. 6, 255
¶2. inventer, machiner : Cæcil. Com. 207.
¶1. faire souvenir, rappeler : commonefacere aliquem beneficii sui Sall. J. 49, 4, rappeler à qqn le service qu'on lui a rendu ; commonefecit sanxisse Augustum Tac. An. 6, 12, il rappela l'ordonnance d'Auguste ; commonefacit quæ sint dicta Cæs. G. 1, 19, 4, il rappelle ce qui a été dit ; [avec prop. inf.] Cic. Verr. 4, 144
¶2. avertir de : commonefaciunt eum ut utatur instituto suo Cic. Verr. 2, 41, ils l'invitent à respecter sa propre règle.
¶1. faire souvenir : ut hic modo me commonuit Pisonis anulus Cic. Verr. 4, 57, c'est ainsi que l'anneau de Pison vient ici de rappeler mes souvenirs ; re ipsa modo commonitus sum Pl. Trin. 1050, c'est la réalité qui vient de m'y faire penser
— aliquem alicujus rei, faire souvenir qqn de qqch : Pl. Rud. 743 ; Her. 4, 44 ; Quint. 1, 5, 7
— quod vos lex commonet Cic. Verr. 3, 40, ce que la loi vous rappelle
— aliquem de aliqua re Cic. Verr. 5, 109, rappeler qqn au souvenir de qqch, cf. 1, 154
— [avec prop. inf.] faire souvenir que : Cic. Verr. pr. 52
— [avec int. ind.] Mur. 50
¶2. avertir : non exprobrandi causa, sed commonendi gratia dicere aliquid Cic. Amer. 46, dire qqch non pas en vue d'un reproche, mais à titre d'avis ; de peri\-culo aliquem commonere Cic. Part. 96, avertir qqn d'un danger ; de his te, si qui me forte locus admonuerit, commonebo Cic. de Or. 3, 47, là-dessus, si qq occasion m'y fait penser, je te donnerai des conseils
— [avec prop. inf.] Verr. 4, 141, avertir que
— [avec ut] avertir de, conseiller de : Ter. Andr. 280 ; Quint. 4, 1, 78.
===> inf. passif commonerier Pl. Ps. 150.
===> .
===> commonstrasso = -avero Pl. Ep. 447
— commostro Pl. Merc. 894 ; Pœn. 602 ; 1043.
===> .
¶1. action de séjourner, séjour : Cic. Fam. 6, 19, 1
¶2. retard : Cic. Q. 3, 1, 23
¶3. [rhét.] action de s'attarder sur un point important : Cic. de Or. 3, 202.
===> .
¶1. mourir avec : commori alicui Sen. Ep. 77, 13, mourir avec qqn ; mors misera non est commori cum quo velis Sen. Ag. 202, ce n'est pas un malheur de mourir avec celui qu'on veut tuer
¶2. [fig.] mourir ensemble, se neutraliser [en parl. de deux poisons] : Plin. 27, 5.
¶1. int., s'arrêter, s'attarder : Ephesi sum commoratus Cic. Fam. 3, 5, 5, je me suis arrêté à Éphèse ; cum in eo commoratus essem Cic. Clu. 53, ayant insisté sur ce point
— séjourner habiter : Vulg. Job 38, 26
¶2. tr., arrêter, retenir : me commoror Pl. Ps. 1135, je me retarde ; an te auspicium commoratum est ? Pl. Amph. 690, les auspices t'ont-ils retenu ?
===> .
===> .
===> .
¶1. action d'agiter : Pall. 11, 4, 5
— commotion, mouvement imprimé, secousse : C. Aur. Acut. 2, 9 ; commotio terræ Vulg. Isai. 24, 19, tremblement de terre
¶2. [fig.] émotion, ébranlement des sens, de l'âme : commotio jucunditatis in corpore Cic. Fin. 2, 13, une impression de plaisir dans le corps ; commotiones animorum Cic. Tusc. 4, 61, les mouvements passionnés de l'âme.
I. part. de commoveo,
II. pris adjt :
¶1. en branle, en mouvement : (genus Antonii) commotum in agendo Cic. de Or. 3, 32, (l'éloquence d'Antoine) toujours pleine de mouvement (impétueuse) au cours du plaidoyer
— vif, animé, emporté : Fimbria paulo fervidior atque commotior Cic. Br. 129, Fimbria, orateur un peu trop échauffé et emporté ; Drusus animo commotior Tac. An. 4, 3, Drusus d'un caractère un peu impétueux
¶2. ému, agité : quid ? ipsa actio potest esse vehemens... nisi est animus ipse commotior ? Cic. Div. 1, 80, eh ! l'action même peut-elle être véhémente, si l'âme de son côté n'est pas qq peu émue ?
¶1. mettre en branle, remuer, déplacer : vectibus simulacrum commovere Cic. Verr. 4, 95, remuer (déplacer) une statue au moyen de leviers ; ex loco castra Cic. Verr. 5, 96, décamper d'un endroit ; aciem commovent Liv. 2, 65, 5, ils se mettent en mouvement [mais commota pedestri acie Liv. 9, 27, 10, l'infanterie étant ébranlée (fléchissante)]
— se commovere, se mettre en mouvement, faire un mouvement : ex loco Cic. Fin. 5, 42, bouger d'un endroit, quitter un endroit
— nummus in Gallia nullus sine civium Romanorum tabulis commovetur Cic. Font. 11, pas un écu ne circule en Gaule sans être porté sur les livres des citoyens romains
— commovere sacra Virg. En. 4, 301, porter les objets sacrés en procession ; [d'où plaist] sua sacra commovere Pl. Ps. 109, mettre en œuvre ses artifices, faire jouer toutes ses batteries
— pousser : cervum commovere canes Virg. En. 7, 494, les chiens lancèrent le cerf ; hostem Liv. 9, 40, 9 ; 10, 29, 9, ébranler (pousser) l'ennemi ; [fig.], cornua disputationis Cic. Div. 2, 26, rompre les ailes de l'argumentation (l'entamer)
¶2. [fig.] agiter, remuer : commovere se non sunt ausi Nep. Ages. 6, 3, ils n'osèrent pas se mettre en mouvement [agir, mettre leur projet à exécution] ; si se commoverit Liv. 2, 54, 6, s'il se remue (s'il veut agir) ; se commovere contra rem publicam Cic. Cat. 1, 7, se mettre en mouvement (agir) contre l'État
— [au pass.] être agité, indisposé : perleviter commotus Cic. Q. 2, 5, 2, très légèrement indisposé ; commoveri nervis, capite, mente Plin. 2, 108, éprouver des troubles de nerfs, de tête, d'esprit ; d'où commotus = mente captus, fou : Hor. S. 2, 3, 209, cf. commota mens Hor. S. 2, 3, 278 ; Plin. 36, 152, esprit dérangé
¶3. émouvoir, impressionner : judices Cic. de Or. 2, 189, émouvoir les juges, aut libidine aliqua aut metu commoveri Cic. Off. 1, 102, être ému soit par quelque passion, soit par la crainte
— troubler : nihil me clamor iste commovet Cic. Rab. perd. 18, ces cris ne me troublent pas du tout (Cæs. G. 1, 40, 8 ; 3, 23, 2, etc.)
— agiter : cum esset ex ære alieno commota civitas Cic. Rep. 2, 58, comme il y avait du trouble dans la cité par suite des dettes
— engager, décider : his nuntiis commotus Cæs. G. 2, 2, 1, décidé par ces nouvelles, cf. Cic. Fam. 16, 18, 2 ; nec sane satis commoveor animo ad ea quæ vis canenda Cic. Q. 3, 5, 4, l'inspiration ne m'engage vraiment guère à chanter ce que tu veux ; primis ab his historia commota est, ut auderet uberius dicere Cic. Or. 39, c'est l'impulsion initiale de ces écrivains qui a déterminé l'histoire à oser prendre un style plus riche que par le passé
— donner le branle à, exciter, éveiller : misericordiam alicui Cic. de Or. 2, 195, exciter la pitié chez qqn ; memoriam alicujus rei Cic. de Or. 2, 20, éveiller le souvenir de qqch ; invidiam in aliquem Cic. Phil. 3, 18, provoquer la haine contre qqn ; bellum Cic. Verr. 5, 20, susciter une guerre ; Philo autem, dum nova quædam commovet... Cic. Ac. 2, 18, quant à Philon, tandis qu'il met en avant (imagine) de nouvelles théories...
===> formes syncopées : commorunt Lucr. 2, 766 ; commorit Cæl. Fam. 8, 15, 1 ; Hor. S. 2, 1, 45 ; commorat Ter. Phorm. 101 ; commossem Cic. Planc. 90 ; commosset Cic. Verr. 3, 45 ; commosse Cic. Verr. 5, 96.
¶1. ce qui est en commun, bien commun : quod jus statues communi dividundo ? Cic. Fam. 7, 12, 2, quel droit établiras-tu pour le partage d'une communauté ? privatus illis census erat brevis, commune magnum Hor. O. 2, 15, 14, le dénombrement de leurs biens personnels était court, mais la fortune publique était grande
— communia Cic. Off. 1, 20, biens communs ; [mais Hor. Ep. 1, 20, 4, lieux publics (= étalage dans les lieux publics, publicité)]
¶2. communauté, ensemble d'un pays : statuæ a communi Siciliæ datæ Cic. Verr. 2, 114, statues offertes par la communauté des Siciliens (Verr. 1, 95 ; 2, 145, etc.)
¶3. in commune, pour l'usage général :
a) in commune conferre Cic. Quinct. 12, mettre en commun ; in commune consultare Tac. H. 4, 67, délibérer en commun ; in commune vocare honores Liv. 6, 40, 18, mettre les charges en commun (à la disposition de tous);
b) en général (v. communiter) : in commune disputare Quint. 7, 1, 49, discuter en général, cf. Tac. G. 27 ; 38, etc. ;
c) [exclamation] part à deux ! partageons ! Sen. Ep. 119, 1 ; Phæd. 5, 7, 3.
¶1. mettre en commun, partager : adversas res partiens communicansque leviores (facit amicitia) Cic. Læ. 22, en divisant et mettant en commun l'adversité, l'amitié la rend plus légère (Sull. 9) ; vobiscum hostium spolia communicavit Cic. Verr. 5, 125, il a partagé avec vous les dépouilles de l'ennemi (il vous a donné une part de) ; deorum potestas communicata vobiscum Cic. Mur. 2, la puissance des dieux partagée avec vous ; causam civium cum servis fugitivis communicare Sall. C. 56, 5, associer la cause des citoyens avec celle d'esclaves fugitifs ; cum finitimis civitatibus consilia Cæs. G. 6, 2, 3, mettre leurs projets en commun (se concerter) avec les cités limitrophes ; ea quæ didicerant cum civibus suis communicare non poterant Cic. Nat. 1, 8, ils ne pouvaient faire part de leurs connaissances à leurs concitoyens, cf. Att. 1, 18, 1, etc. ; Cæs. G. 6, 20, 2, etc.
— num tibi gloriam cum M. Crasso communicatam putas ? Cic. Verr. 5, 5, penses-tu qu'il y ait pour toi un partage de gloire avec M. Crassus (être associé à la gloire de...) ? crimina quæ cum iis civitatibus C. Verri communicata sunt Cic. Cæcil. 14, accusations qui portent en commun sur ces cités et sur C. Verrès, cf. Amer. 144 ; Br. 254 ; Liv. 22, 27, 8
— communicabo te semper mensa mea Pl. Mil. 51, je te ferai toujours partager ma table
— cum de societate inter se multa communicarent Cic. Quinct. 15, échangeant de nombreuses communications sur la société (association) ; socii putandi sunt, quos inter res communicata est Cic. Verr. 3, 50, on doit regarder comme associés ceux entre qui les profits sont partagés ; communicato inter se consilio partes ad rem agendam divisere Liv. 8, 25, 9, après s'être concertés, ils se partagèrent les rôles pour l'action
— [abst] cum aliquo de aliqua re, entretenir qqn de qqch : Cic. Fam. 4, 4, 5 ; Cæs. C. 3, 18, 3 ; Pompeius qui mecum de te communicare solet Cic. Fam. 1, 7, 3, Pompée qui a l'habitude de me parler de toi
— quibus communicare de maximis rebus Pompeius consueverat (mss ; édit. quibuscum) Cæs. C. 3, 18, 3, personnages que Pompée avait l'habitude de consulter sur les questions les plus graves
— mettre en commun avec, ajouter : quantas pecunias ab uxoribus dotis nomine acceperunt, tantas ex suis bonis cum dotibus communicant Cæs. G. 6, 19, 1, autant ils ont reçu d'argent de leurs épouses au titre dotal, autant ils en apportent de leurs propres biens pour l'ajouter à la dot, cf. Cic. Fam. 12, 2, 1 ; Ac. 2, 3
¶2. recevoir en commun, prendre sa part de : cum mecum inimicitias communicasti Cic. Fam. 15, 21, 2, quand tu as partagé les haines dont j'étais l'objet, cf. Pl. Trin. 190 ; in periculis communicandis Cic. Læ. 24, quand il s'agit de partager les dangers [d'un ami]; primo labores modo et discrimina, mox et gloriam comrnunicabat Tac. Agr. 8, ce furent d'abord les fatigues et les dangers qu'il partageait, puis ce fut aussi la gloire
¶3. [décad.] entrer en relations avec qqn, communiquer avec qqn : cum aliquo Just. 36, 2, 15 ; alicui Aug. Ep. 162.
¶1. fortifier : communire tumulum Cæs. C. 1, 43, 2, fortifier une colline
¶2. construire [un fort, un ouvrage, etc.] : communit castella Cæs. G. 1, 8, 2, il construit des redoutes
— [fig.] renforcer, étayer : Cic. Com. 43.
===> pf communit Cæs. *C. 3, 43, 1 ; communisset Cæs. C. 1, 43, 2 ; Liv. 21, 32, 11 ; communisse Liv. 8, 15, 4
— fut. arch. communibo Pl. Rud. 934
— imp. communibant Amm. 18, 7, 6.
¶1. [en gén.] communauté, mise en commun [ou participation], caractère commun : inter quos est communio legis Cic. Leg. 1, 23, ceux qui obéissent aux mêmes lois ; communio vocum et litterarum Cic. Tusc. 5, 5, langue et écriture communes ; in communionem tuorum temporum Cic. Mil. 100, pour m'associer à tes épreuves
¶2. [en part.] la communion de l'Église chrétienne : imperatores nostræ communionis Aug. Psalm. 57, 15, les empereurs de notre communion ; communione sancti altaris aliquem privare Aug. Ep. 54, 6, excommunier quelqu'un.
¶1. commun, qui appartient à plusieurs ou à tous : communis libertas Cic. Sest. 1 ; salus Cic. Sest. 15, la liberté commune, le salut commun : locus communis Pl. Cas. 19, le séjour des morts (le commun séjour) [Sen. Contr. 1, 2, 5, maison publique]; loca communia Cic. Verr. 2, 112, lieux publics ; loci communes Cic. Or. 126, etc., lieux communs (v. locus) ; vita communis Cic. de Or. 1, 248, la vie de tous les jours (de tout le monde)
— commun à, en commun avec (res alicui cum aliquo communis, chose que qqn a en commun avec qqn ; res hominum communis ou res inter homines communis, chose commune aux hommes) : onus, quod mihi commune tecum est Cic. CM 2, fardeau qui nous est commun à tous deux ; cum rerum natura quid habere potest commune gallinaceum fel ? Cic. Div. 2, 29, qu'est-ce qu'un fiel de coq peut avoir de commun avec la nature universelle ?
— memoria communis est multarum artium Cic. Or. 54, la mémoire est une faculté commune à beaucoup d'arts ; communis imperatorum fortuna Cic. de Or. 2, 196, sort qui peut échoir à tous les généraux ; quorum facinus est commune, cur non sit eorum præda communis ? Cic. Phil. 2, 72, ceux qui ont partagé le crime, pourquoi ne partageraient-ils pas le butin ? multa sunt civibus inter se communia Cic. Off. 1, 53, les citoyens d'une cité ont beaucoup de choses en commun
— in commune, v. commune
— commun, ordinaire : communes mimi Cic. Fam. 7, 1, 1, des mimes ordinaires (comme on en voit dans tous les jeux publics)
— [gram.] commune verbum Gell. 15, 13, 1, verbe à forme passive qui a les deux sens, actif et passif ; commune genus, genre masculin et féminin ; communis syllaba, syllabe commune (longue ou brève)
¶2. accessible à tous, affable, ouvert, avenant : quemquamne existimas Catone communiorem fuisse ? Cic. Mur. 66, y eut-il, à ton avis, qqn d'un commerce plus agréable que Caton ? cf. Læ. 65 ; *CM 59 ; Fam. 4, 9, 2 ; Nep. Att. 3, 1.
¶1. en commun, ensemble : Cat. Orig. 58 ; communiter cum aliis Cic. Att. 11, 5, 1, en commun avec d'autres
¶2. en général : Cic. Arch. 32 ; Quint. 9, 1, 23.
¶1. action de construire un chemin : [fig.] aditus ad causam et communitio Cic. de Or. 2, 320, entrée en matière et préparation du terrain
¶2. ouvrage de fortification : Vitr. 10, 13, 1.
¶1. changeant, sujet au changement : commutabilis res publica Cic. Att. 1, 17, 8, situation politique précaire
¶2. interchangeable : exordium commutabile Cic. Inv. 1, 26, exorde que l'adversaire peut exploiter pour sa thèse.
¶1. changer entièrement : rerum signa Cic. Fin. 5, 74, changer entièrement les marques des objets ; commutatis verbis atque sententiis Cic. Arch. 18, en changeant complètement les mots et les phrases ; ad commutandos animos Cic. de Or. 2, 211, pour changer les dispositions d'esprit
— commutatur officium Cic. Off. 1, 31, le devoir change ; nihil commutantur animo Cic. Fin. 4, 7, ils ne changent en rien sous le rapport des sentiments
¶2. échanger : captivos Cic. Off. 1, 39, échanger des captifs
— rem cum aliqua re Cic. Sest. 37, échanger une chose contre une autre
— rem re : studium belli gerendi agri cultura commutare Cæs. G. 6, 22, 3, échanger le goût de faire la guerre contre la culture des champs (Cic. Clu. 129 ; de Or. 3, 167)
— inter se commutant vestem Pl. Capt. 37, ils changent entre eux de vêtements
— verba cum aliquo Ter. Andr. 410, échanger des paroles avec qqn ; tria non commutabilis verba inter vos Ter. Phorm. 638, vous n'échangerez pas trois mots.
¶1. int., être chevelu : comare jugis P. Nol. Carm. 28, 246, s'épanouir sur les sommets [en parl. d'un arbre]
¶2. se couvrir de duvet : Tert. Pall. 3.
¶1. arranger, disposer ensemble : Lucr. 3, 258 ; 4, 27
¶2. arranger, disposer ses cheveux, peigner : comere capillos Cic. Pis. 25, arranger ses cheveux ; dum comit dumque se exornat Pl. Stich. 696, pendant qu'elle se peigne et s'attife
¶3. [en gén.] mettre en ordre, parer, orner : comere muliebriter corpora Quint. 8, pr. 19, se parer comme des femmes ; comere orationem Quint. 8, 3, 42, (peigner) parer le style.
¶1. comédie, le genre comique : Cic. Off. 1, 104 ; Opt. 1
¶2. comédie, pièce de théâtre : Cic. Rep. 4, 11 ; comœdiam facere, exigere Ter. Andr. 26 ; 27, faire, repousser (mal accueillir) une comédie ; v. docere, edere, dare, agere (fabulam).
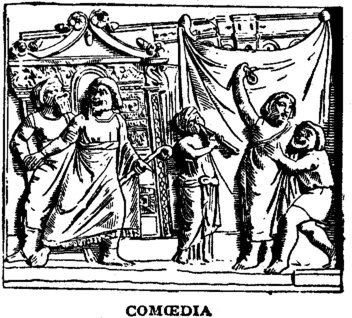
¶1. joint, réuni : compactiles trabes Vitr. 4, 7, poutres étroitement réunies
¶2. qui a le corps ramassé, trapu : Plin. 8, 46.
¶1. assemblage, liaison : Cic. Fin. 5, 33
¶2. parties liées, assemblées entre elles : Vitr. 10, 15, 3.
¶1. adj., égal, pareil : consilium consilio compar Liv. 28, 42, 20, projet pareil à un autre ; compar eorum fias Gell. 6, 11, 1, tu deviendrais leur égal
¶2. subst.
a) m. et f., compagnon, camarade : Pl. Ps. 66
— amant, amante : Catul. 68, 126 ; Hor. O. 2, 5, 2
— époux, épouse : CIL 5, 1628 ;
b) n. [rhét.], égalité des membres de la période : Her. 4, 27.
===> gén. pl. comparum Pl. Ps. 66.
===> .
¶1. (comparo 1), comparable : Tert. Valent. 13
¶2. (comparo 2) qui est fourni par contribution : Cod. Th. 7, 6, 3.
¶1. action d'accoupler, d'apparier : [attelage de bœufs] Col. 6, 2, 13
¶2. comparaison : parium Cic. Top. 71, comparaison de choses égales ; rei cum aliqua re Cic. de Or. 1, 257, comparaison d'une chose avec une autre ; ex comparatione Cic. Part. 66, par une comparaison (per comparationem Cic. Inv. 1, 99) ; cum aliquo in comparatione conjungi Cic. de Or. 3, 32, être associé à qqn en parallèle = être continuellement comparé à qqn (mis en parallèle, confronté avec qqn) ; aliquam comparationem habere Cic. Tusc. 5, 38, comporter dans une certaine mesure une comparaison ; in comparationem se demittere Suet. Rhet. 6, s'engager dans une comparaison
— provincia sine sorte, sine comparatione data Liv. 6, 30, 3, province (mission) attribuée sans tirage au sort, sans arrangement préalable, v. comparo 1, §{} 4
¶3. [rhét.] : comparatio criminis Cic. Inv. 2, 72, confrontation du chef d'accusation (du fait incriminé) avec la fin poursuivie dans l'acte incriminé
¶4. [gram.] comparatif : Quint. 1, 5, 45
¶5. [astron.] position comparative d'objets entre eux : Cic. Nat. 2, 51 ; [trad. du grec ἀναλογία] Tim. 13.
¶1. préparation : novi belli Cic. Pomp. 9, préparation d'une nouvelle guerre ; criminis Cic. Clu. 191, préparation d'une accusation (action d'en réunir les éléments)
— préparatifs [de défense] : Cic. Q. 1, 2, 16
¶2. action de se procurer, acquisition : testium Cic. Mur. 44, action de réunir des témoins.
¶1. avec le sens du comparatif : Gell. 5, 21, 14
¶2. au comparatif : Charis. 113, 1.
¶1. [rhét.] comparativa judicatio Cic. Inv. 2, 76, cause comparative [où l'on compare le fait incriminé avec la pureté de l'intention]; genus comparativum Quint. 7, 4, 3, genre comparatif
¶2. [gram.] comparativus gradus Charis. 112, 16, ou n. comparativum Prisc. 3, 11, le comparatif ; pl. n. comparativa Quint. 9, 3, 19, termes au comparatif, comparatifs
— comparativus casus, ablatif.
¶1. acquéreur, acheteur : Paul. Sent. 2, 17, 15
¶2. celui qui compare : Julian. Epit. Nov. 44, 177.
¶1. se montrer, apparaître, se manifester : Pompeius non comparet Cic. Att. 12, 2, 1, Pompée ne se montre pas ; hæc oratio vix jam comparet Cic. Br. 122, on remarque à peine ce discours ; in iis libris multa industria comparet Nep. Cat. 3, dans cet ouvrage on reconnaît une grande habileté, cf. Cic. Or. 234
¶2. être présent : signa comparent omnia Cic. Verr. 1, 132, toutes les statues sont bien là
¶3. s'effectuer, se réaliser : ut quæ imperes compareant Pl. Amp. 630, pour que tes ordres s'exécutent.
¶1. accoupler, apparier : labella cum labellis Pl. As. 668, unir les lèvres aux lèvres ; ea inter se comparare et proportione conjungere Cic. Tim. 15, apparier entre eux ces éléments [eau, air, terre, feu] et les unir dans une proportion déterminée ; priore consulatu inter se comparati Liv. 10, 15, 2, ayant été collègues dans un précédent consulat ; ambo cum simul adspicimus, non possumus non vereri ne male comparati sitis Liv. 40, 46, 4, en vous regardant tous deux ensemble, nous ne pouvons nous empêcher de craindre que vous ne soyez mal accouplés
— [d'où] accoupler pour la lutte, opposer comme antagoniste : verum ita se res habet, ut ego cum patrono disertissimo comparer Cic. Quinct. 2, mais voilà : moi, j'ai comme antagoniste le plus éloquent des orateurs (Q. 3, 4, 2) ; adversus veterem imperatorem comparabitur Liv. 24, 8, 7, il sera opposé à un vieux général ; [av. datif] aliquem alicui Suet. Cal. 35 ; Scipio et Hannibal velut ad supremum certamen comparati duces Liv. 30, 28, 8, Scipion et Hannibal, chefs opposés l'un à l'autre comme pour un combat suprême
¶2. [fig.] apparier, mettre sur le même pied, sur le même plan, assimiler : neminem tibi anteposuissem aut etiam comparassem Cic. d. Non. 256, 4, je n'aurais mis personne avant toi, que dis-je ? sur la même ligne que toi (Fam. 12, 17, 3 ; Nep. Iphic. 1, 1) ; ne se quidem ipsi cum illis virtute comparant Cæs. G. 6, 24, 6, ils ne se donnent même pas comme leurs égaux en courage
¶3. comparer : aliquem alicui, rem rei Cic. Br. 293 ; CM 14, comparer qqn à qqn, une chose à une chose
— surtout aliquem cum aliquo, rem cum re : conferte Verrem, non ut hominem cum homine comparetis Cic. Verr. 4, 121, mettez Verrès en regard, non pour comparer les deux hommes entre eux, cf. Dom. 130 ; Off. 3, 2, etc.
— aliquem ad aliquem Ter. Eun. 681, comparer qqn à qqn
— res inter se Quint. 3, 6, 87 ; 3, 8, 33, comparer des choses entre elles
— [avec int. ind.] faire voir par comparaison : comparat quanto plures deleti sint homines... Cic. Off. 2, 16, il montre par une comparaison combien plus d'hommes ont péri... (Liv. 2, 32, 12)
¶4. [en part., en parl. des magistrats] comparare inter se, régler à l'amiable, distribuer d'un commun accord : senatus consultum factum est, ut consules inter se provincias compararent sortirenturve Liv. 42, 31, 1, un sénatus-consulte ordonna que les consuls partageraient entre eux les provinces à l'amiable ou par le sort ; comparant inter se ut... se consul devoveret Liv. 8, 6, 13, ils décident d'un commun accord que le consul se dévouera...; ut consules sortirentur compararentve inter se, uter comitia haberet Liv. 24, 10, 2, [on décréta] que les consuls décideraient par le sort ou à l'amiable lequel des deux tiendrait les comices.
===> infin. pass. compararier Catul. 61, 65.
¶1. procurer (faire avoir), ménager, préparer : vestem atque alia quæ opus sunt Ter. Haut. 855, procurer des vêtements et tout ce qu'il faut en outre ; re frumentaria comparata Cæs. G. 4, 7, 1, l'approvisionnement de blé étant fait ; exercitum contra aliquem comparare Cic. Dej. 22, préparer (recruter) une armée contre qqn ; nautas gubernatoresque comparari jubet Cæs. G. 3, 9, 1, il ordonne qu'on recrute des matelots et des pilotes ; homini a civitatibus laudationes per vim comparare Cic. Verr. 4, 147, procurer à un homme des témoignages élogieux en les arrachant aux cités par la violence ; sibi remedia ad tolerandum dolorem Cic. Tusc. 5, 74, se ménager des remèdes pour supporter la douleur ; sibi auctaritatem Cæs. G. 5, 55, 4, se ménager (acquérir) de l'influence
— préparer, disposer : bellum Cic. Att. 10, 4, 3, préparer une guerre ; insidias alicui Cic. Verr. pr. 52, préparer des embûches contre qqn ; his rebus comparatis Cæs. G. 7, 8, 1, ces dispositions prises ; fuga comparata Cæs. G. 4, 18, 4, la fuite étant préparée ; exordium est oratio animum auditoris idonee comparans ad reliquam dictionem Cic. Inv. 1, 20, l'exorde est la partie du discours qui dispose favorablement l'auditeur à entendre le reste
— se comparare, se préparer : dum se uxor comparat Cic. Mil. 20, tandis que sa femme se prépare ; se comparare ad respondendum Cic. Nat. 3, 19, se disposer à répondre ; ad omnes casus Cæs. G. 7, 79, 4, se préparer à toutes les éventualités ; [avec inf.] Titin. 57 ; Turp. 99 ; Ter. Eun. 47
— pass. réfléchi : ab hoc colloquio legati in Bœotiam comparati sunt Liv. 42, 43, 4, au sortir de cette conférence les ambassadeurs se disposèrent à partir en Béotie
— [abst] faire la préparation nécessaire : tempore ad comparandum dato Nep. Thras. 2, 2, ayant le temps de se préparer (Liv. 35, 45, 5 ; 38, 12, 5 ; 42, 52, 8) ; [avec infin.] se préparer à faire qqch : Ov. Tr. 2, 267
¶2. [avec ut] disposer, régler : prætores, ut considerate fieret, comparaverunt Cic. Quinct. 51, les préteurs ont pris des mesures pour que (ont pourvu à ce que) la vente se fît en connaissance de cause
— [surtout au pass.] : ita ratio comparata est vitæ nostræ, ut alia ex alia ætas oriatur Cic. Læ. 101, les conditions de la vie veulent que les âges se succèdent (Ter. Haut. 503)
— [ou pass. impers.] : quam inique comparatum est, ii qui minus habent ut semper aliquid addant divitioribus ! Ter. Phorm. 41, comme les choses sont mal réglées ! voir ceux qui ont le moins apporter toujours un surcroît aux plus riches ! est ita natura comparatum, ut... Plin. Ep. 5, 19, 5, la nature veut que... ; ita comparatum more majorum erat ne... Liv. 39, 29, 5, la coutume des ancêtres interdisait que... ; [avec quod, ce fait que] Cic. Clu. 57.
===> arch. comparassit = comparaverit Pl. Ep. 122.
¶1. int., faire paître en commun : Cic. Top. 12 ; jus compascendi Dig. 8, 5, 20, droit de vaine pâture
¶2. tr., nourrir : Plin. 32, 61
— faire consommer : pabulum in fundo compascere Varr. R. 2, Præf. 5, faire consommer le fourrage sur place
— [fig.] compascere famem Plin. 9, 169, apaiser la faim.
¶1. souffrir avec : anima compatitur corpori Tert. Anim. 5, l'âme souffre avec le corps
¶2. compatir [av. dat.] : aliis compati Aug. Conf. 3, 2, prendre part aux souffrances d'autrui.
===> .
¶1. action d'adresser la parole : Her. 4, 22
¶2. apostrophe violente, attaque en paroles ou par écrit : Cic. Fam. 12, 25, 2 ; Phil. 3, 17.
¶1. adresser la parole à qqn, apostropher qqn (aliquem) : Enn. d. Cic. Div. 1, 41 ; Virg. En. 5, 161, etc. ; Ov. M. 14, 839
— appeler qqn par son nom : (nomine) Liv. 23, 47, 2 ; (nominatim) Tac. An. 16, 27
¶2. s'en prendre à, attaquer, gourmander : Q. Ciceronem compellat edicto Cic. Phil. 3, 17, il s'en prend dans un édit à Q. Cicéron ; (mulieres) compellatæ a consule Liv. 34, 2, 8, (femmes) apostrophées (prises à partie) par le consul, cf. Hor. S. 2, 3, 297
¶3. accuser en justice : Cic. Att. 2, 2, 3 ; Cæl. Fam. 8, 12, 3 ; Nep. Alc. 4, 1 ; Suet. Cæs. 17.
¶1. pousser ensemble (en masse, en bloc), rassembler : unum in locum homines Cic. Inv. 1, 2, pousser les hommes en un même lieu ; omni totius provinciæ pecore compulso Cic. Pis. 87, ayant rassemblé tout le bétail de la province entière
— chasser en bloc, refouler : intra oppida ac muros compelluntur Cæs. G. 7, 65, 2, ils sont refoulés à l'intérieur des places fortes et des endroits fortifiés ; (incendium belli) intra hostium mœnia Cic. Rep. 1, 1, refouler (l'incendie de la guerre) à l'intérieur des remparts ennemis ; omni bello Medulliam compulso Liv. 1, 33, 4 (2, 16, 8), toute la guerre étant ramassée (concentrée) à Médullia
— Pompeium domum suam compulistis Cic. Pis. 16, vous avez forcé Pompée à se renfermer dans sa maison
¶2. [fig.] presser, acculer, réduire : ceteras nationes conterruit, compulit, domuit Cic. Prov. 33, les autres nations, il les frappa de terreur, les poussa dans un accul (les traqua), les dompta ; angustiis rei frumentariæ compulsus Cæs. C. 3, 41, 4, réduit par la difficulté des approvisionnements
— pousser à, réduire à, forcer à : ad illa arma compulsi Cic. Marc. 13, poussés à cette guerre ; ad mortem aliquem compellere Suet. Tib. 56, forcer qqn à se donner la mort ; in hunc sensum compellor injuriis Cic. Fam. 1, 9, 21, je suis contraint à ce sentiment par les injustices ; in eumdem metum eos compulere Liv. 25, 29, 8, ils les jetèrent dans la même crainte ; [avec ut et subj.] : Tac. D. 4 ; Curt. 8, 8, 2 ; Suet. Cæs. 1, etc.; [avec inf.] : Curt. 5, 1, 35 ; Ov. F. 3, 860 ; Suet. Tib. 62, etc.
¶1. avantageux, fructueux : Col. 1, 4, 5
¶2. abrégé, raccourci, plus court : Just. 38, 9, 6 ; Apul. M. 11, 22.
¶1. gain provenant de l'épargne, profit : compendium ligni Plin. 23, 127, économie de bois ; facere compendii sui causa quod non liceat Cic. Off. 3, 63, faire dans son intérêt une chose illicite
— [fig.] aliquid facere compendi Pl. Pœn. 351, faire l'économie de qqch = s'en dispenser, cf. Bac. 183 ; Most. 60
¶2. gain provenant d'une économie de temps, accourcissement, abréviation : compendium operæ Plin. 18, 181, économie de travail ; verba confer ad compendium Pl. Mil. 774, abrège ton discours ; compendia viarum Tac. An. 1, 63, chemins de traverse ; compendia leti donare Sil. 10, 475, achever un ennemi ; compendia ad honores Plin. Pan. 95, 5, moyens rapides pour arriver aux honneurs.
===> parf. comperii Diom. 372, 6 ; comperui Gloss. 4, 320, 3.

===> gén. pl. compedium Pl. Pers. 420 ; -pedum à partir de Tert.
— m., Lact. Persec. 21, 3.
===> sup. -citum Prisc. 10, 19.
¶1. accord : Sid. Ep. 2, 9, 4
¶2. compétition en justice : Cod. Th. 2, 23, 1
¶3. candidature rivale : Ambr. Hel. 21, 79.
I. int.,
¶1. se rencontrer au même point : ubi viæ competunt Varr. L. 6, 25, au point de rencontre des deux chemins
— [fig.] coïncider : initium finemque miraculi cum Othonis exitu competisse Tac. H. 2, 50, [on dit] que le début et la fin du prodige coïncidèrent avec la mort d'Othon ; æstati, autumno competere Suet. Cæs. 40, coïncider avec l'été, avec l'automne ; in aliquem diem Plin. 16, 191, tomber un certain jour
— [impers.] si ita competit ut subj. Sen. Ep. 75, 6, si cela coïncide que, s'il se rencontre que
¶2. répondre à, s'accorder avec : tanto Othonis animo nequaquam corpus competiit Suet. Oth. 12, Othon eut un physique qui ne répondait pas du tout à sa grande âme ; si competeret ætas Suet. Aug. 31, si l'âge s'accordait
— être propre à, être en état convenable pour : ut vix ad arma capienda competeret animus Liv. 22, 5, 3, au point qu'ils avaient à peine le courage suffisant pour prendre les armes ; neque animo neque auribus aut lingua competere Sall. H. 1, 136 M, n'être pas en pleine possession ni de son esprit ni de l'ouïe ou de la parole (Tac. H. 3, 73)
— convenir à, appartenir à : actionem competere in equitem Romanum negat Quint. 3, 6, 11, il soutient que cette action judiciaire n'est pas applicable à un chevalier romain.
II. tr. [rare], chercher à atteindre ensemble, rechercher concurremment : Just. 13, 2, 1 ; Aur. Vict. Vir. 59, 2.
===> inf. pf. syncopé competisse Tac. H. 2, 50.
¶1. fabriquer par assemblage : Virg. B. 2, 36, [d'où] compactus, a, um, bien assemblé, où toutes les parties se tiennent : Cic. Fin. 3, 74
— [fig.] ex multitudine et negotio verbum unum compingere Gell. 11, 16, 4, faire un seul mot composé des mots « multitude » et « affaire »
— imaginer, inventer : Arn. 1, 57
¶2. pousser en un point, bloquer, enfermer : aliquem in carcerem Pl. Amph. 155, jeter qqn en prison ; se in Apuliam Cic. Att. 8, 8, se bloquer en Apulie ; [fig.] de Or. 1, 46.
===> v. competum, competa.
a) détruire : complanare domum Cic. Dom. 101, raser une maison ;
b) [moralt] aspera : Sen. Prov. 5, 9, aplanir les aspérités.
¶1. embrasser, entourer : aliquid manibus Cic. CM 52, étreindre qqch avec les mains ; aliquem Cic. Att. 16, 5, 2, etc., serrer qqn dans ses bras ; inter se complecti Cic. Div. 1, 58, s'embrasser mutuellement
— quatuordecim milia passuum complexus Cæs. G. 7, 74, 1, ayant embrassé [pour faire une enceinte] un espace de quatorze mille pas (G. 7, 72, 2) ; extimus (orbis cælestis) qui reliquos omnes complectitur Cic. Rep. 6, 17, le cercle extérieur qui embrasse tous les autres
— me artior somnus complexus est Cic. Rep. 6, 10, un sommeil plus profond me saisit
¶2. [fig.] saisir : (vis philosophiæ) tum valet multum cum est idoneam complexa naturam Cic. Tusc. 2, 11, (l'action de la philosophie) est surtout efficace quand elle a trouvé d'heureuses dispositions naturelles
¶3. embrasser, entourer de ses soins, de son amitié, etc. : aliquem Cic. Fam. 2, 6, 4 (2, 8, 2), faire accueil à qqn ; philosophiam Cic. Br. 322, embrasser la philosophie ; causam Cic. Phil. 5, 44, embrasser une cause (un parti)
— hunc velim omni tua comitate complectare Cic. Fam. 7, 5, 3, je voudrais que tu lui témoignes toute ta bonté ; aliquem beneficio Cic. Planc. 82, obliger qqn ; aliquem honoribus et beneficiis Cic. Prov. 38, combler qqn d'honneurs et de bienfaits
¶4. embrasser, saisir (par l'intelligence, par la pensée, par la mémoire) : aliquid cogitatione et mente Cic. Or. 8, saisir qqch par la pensée (par l'imagination) et par l'intelligence ; animo Cic. de Or. 3, 20, par l'esprit ; memoria Cic. Div. 2, 146, embrasser par la mémoire, retenir (sans memoria : Quint. 11, 2, 36)
— [rare] complecti seul = complecti mente : Cic. Ac. 2, 114 ; Tac. Agr. 46
¶5. embrasser (comprendre) dans un exposé, dans un discours, etc. : una comprehensione omnia complecti Cic. Fin. 5, 26, comprendre tout sous une même proposition (dans une formule unique) ; complectitur verbis quod vult Cic. Fin. 1, 15, il exprime pleinement sa pensée ; omnia alicujus facta oratione complecti Cic. Verr. 4, 57, présenter dans un exposé tous les actes de qqn ; libro omnem rerum memoriam breviter Cic. Br. 14, ramasser dans un livre l'histoire universelle en abrégé
— complecti sans abl., embrasser dans une définition (Cic. de Or. 3, 126 ; 1, 64) ; dans un exposé (de Or. 3, 74 ; 75) ; complecti vis amplissimos viros ad tuum scelus Cic. Pis. 75, tu veux envelopper dans ton crime (présenter comme tes complices) les citoyens les plus considérables
— causas complectar ipsa sententia Cic. Phil. 14, 29, je résumerai l'exposé des motifs en formulant mon avis lui-même
— [rhét.] conclure : Her. 2, 47 ; Cic. Inv. 1, 73
¶6. part. complexus, a, um, avec sens passif : (facinus) ejus modi, quo uno maleficio scelera omnia complexa esse videantur Cic. Amer. 37, (acte) de telle sorte que ce forfait à lui seul semble envelopper tous les crimes à la fois.
¶1. remplir : fossam Cæs. G. 5, 40, 3, combler un fossé ; oppidani complent murum Cæs. G. 7, 12, 5, les habitants assiégés garnissent le rempart [mais G. 7, 27, 3, remplir = envahir]; paginam complere Cic. Att. 13, 34, remplir la page
— aliquid aliqua re : fossas sarmentis Cæs. G. 3, 18, remplir les fossés de fascines ; Dianam floribus Cic. Verr. 4, 77, couvrir de fleurs la statue de Diane ; quæ res omnium rerum copia complevit exercitum Cæs. C. 2, 25, 7, cette mesure pourvut abondamment l'armée de tout ; multo cibo et potione completi Cic. Tusc. 5, 100, gorgés d'une quantité de nourriture et de boisson ; naves sagittariis Cæs. C. 2, 4, garnir d'archers les navires ; speculatoria navigia militibus compleri jussit Cæs. G. 4, 26, 4, il ordonna qu'on garnît de soldats les navires-éclaireurs
— aliquid alicujus rei : Lucr. 5, 1162 ; convivium vicinorum cottidie compleo quod... Cic. CM 46, chaque jour je traite des voisins dans un festin au grand complet que [nous prolongeons...]; cum completus jam mercatorum carcer esset Cic. Verr. 5, 147, la prison étant déjà pleine de marchands
¶2. compléter [un effectif] : legiones Cæs. C. 1, 25, 1, compléter les légions (leur donner l'effectif complet) ; suum numerum non compleverunt Cæs. G. 7, 75, 5, ils ne fournirent pas leur contingent au complet
¶3. remplir un espace de lumière, de bruit, etc. : sol mundum omnem sua luce complet Cic. Nat. 2, 119, le soleil remplit l'univers de sa lumière ; plangore et lamentatione forum complevimus Cic. Or. 131, nous avons rempli le forum de sanglots et de larmes
— completi sunt animi auresque vestræ me... obsistere Cic. Agr. 3, 3, on a rempli vos esprits, vos oreilles de cette accusation, que je m'opposais...
¶4. remplir d'un sentiment ; [abl.] milites bona spe Cæs. C. 2, 21, 3, remplir les soldats d'un bon espoir ; gaudio compleri Cic. Fin. 5, 69, être rempli de joie
— [gén., arch.] aliquem dementiæ complere Pl. Amph. 470, remplir qqn d'égarement (Men. 901)
¶5. remplir, achever, parfaire : centum et septem annos Cic. CM 13, vivre cent sept ans (Nep. Att. 21, 1); vix unius horæ tempus utrumque curriculum complebat Liv. 44, 9, 4, c'est à peine si ces deux courses remplissaient l'espace d'une seule heure ; ut summam mei promissi compleam Cic. Verr. 3, 116, pour remplir toute ma promesse ; hujus hanc lustrationem menstruo spatio luna complet Cic. Nat. 1, 87, ce parcours du soleil, la lune l'achève en un mois
— rendre complet : complent ea (bona) beatissimam vitam Cic. Fin. 5, 71, ces biens mettent le comble à la vie bienheureuse (3, 43 ; Tusc. 5, 47) ; ita ut ante mediam noctem compleretur (sacrum) Liv. 23, 35, 15, en sorte qu'il (le sacrifice) fût achevé avant minuit ; perfectus completusque verborum ambitus Cic. Or. 168, une période achevée et complète
¶6. aliquam complere Lucr. 4, 1249, rendre une femme enceinte, cf. Arn. 5, 21.
===> les formes syncopées complerunt, complerint, complerat, complesse, etc., se trouvent dans Cicéron.
===> .
¶1. embrassement, assemblement, assemblage, union : complexiones et copulationes et adhæsiones atomorum inter se Cic. Fin. 1, 19, assemblages, agglomérations, agrégations d'atomes entre eux
— [fig.] cumulata bonorum complexio Cic. Tusc. 5, 29, la réunion complète de tous les biens
— [en part.] : verborum complexio Cic. Phil. 2, 95, assemblage de mots ; [rhét.] période : de Or. 3, 182 ; Or. 85
¶2. exposé : brevis complexio negotii Cic. Inv. 1, 37, exposé succinct d'une affaire
¶3. [rhét.] conclusion : Her. 2, 28 ; 2, 40 ; Cic. Inv. 1, 67 ; 1, 73 ; Quint. 5, 14, 5
— dilemme : Cic. Inv. 1, 44
— complexion : Her. 4, 20
¶4. [gram.] synérèse : Quint. 1, 5, 17
¶5. complexion, tempérament : Firm. Math. 5, 9.
¶1. action d'embrasser, d'entourer, embrassement, étreinte : mundus omnia complexu suo coercet et continet Cic. Nat. 2, 58, le monde réunit et contient tout dans son étreinte
— étreinte des bras, enlacement : e complexu parentum abrepti filii Cic. Verr. 1, 7, fils arrachés des bras de leurs parents ; de matris complexu aliquem avellere Cic. Font. 46, enlever qqn des bras de sa mère
— [rare] étreinte hostile : complexus armorum Tac. Agr. 36, combat corps à corps
— étreinte charnelle : Scrib. 18
¶2. [fig.] lien affectueux : complexus gentis humanæ Cic. Fin. 5, 65, le lien qui embrasse la race humaine
— liaison, enchaînement : complexus sermonis Quint. 9, 3, 18, enchaînement des mots dans le style (loquendi 1, 5, 3).
¶1. action de se lamenter ensemble : comploratio mulierum Liv. 3, 47, 6, concert de lamentations féminines
¶2. action de se lamenter profondément : comploratio sui Liv. 2, 40, 9, action de gémir sur son propre sort ; complorationes edere Gell. 12, 5, 3, se lamenter.
¶1. int., se lamenter ensemble : comploratum publice est Flor. 2, 15, ce fut un deuil général
¶2. tr., déplorer, se lamenter sur : complorare interitum alicujus Gell. 7, 5, 6, se lamenter sur la mort de qqn ; cum vivi mortuique complorarentur Liv. 22, 55, 3, comme on pleurait les vivants aussi bien que les morts, cf. Cic. Dom. 98.
¶1. imp., il pleut : Varr. L. 5, 161
¶2. complŭo, ŭi, ūtum, ŭĕre, tr., arroser de pluie, arroser : Aug. Ps. 95, 12 ; Serm. 4, 31 ; surtout au part. complutus.
¶1. adj., assez nombreux, plusieurs : complures nostri milites, bon nombre de nos soldats : Cæs. G. 1, 52, 5 ; 4, 12, 2 ; 7, 47, 7 ; superl. complurimi Gell. 11, 1, 1
¶2. substt : complures Græcis institutionibus eruditi Cic. Nat. 1, 8, un bon nombre de personnes formées par les enseignements grecs
— [rare avec gén.] : complures hostium Hirt. G. 8, 48, 7, un bon nombre d'entre les ennemis
— [avec ex] : e vobis complures Cic. Verr. 1, 15, plusieurs d'entre vous. cf. Cæs. G. 2, 17, 2 ; 4, 35, 3 ; 4, 37, 3.
¶1. trou carré au centre du toit de l'atrium, par où passait la pluie recueillie en dessous dans l'impluvium : Varr. L. 5, 161 ; P.-Fest. 108
— [postt confusion avec impluvium] bassin intérieur auprès duquel se trouvaient des cartibula (Varr. L. 5, 125), la chapelle des pénates (Suet. Aug. 92)
¶2. dispositif de forme carrée où l'on attachait la vigne : Col. 4, 24, 14, etc.
¶1. placer ensemble : in quo loco erant ea composita, quibus rex te munerare constituerat Cic. Dej. 17, dans ce lieu se trouvaient réunis les objets que le roi te destinait pour récompense ; in acervum conponere Cat. Agr. 37, 5, disposer en tas ; amphoras in cuneum conponito Cat. Agr. 113, 2, range les amphores dans le coin du cellier ; uvas in tecto in cratibus Cat. Agr. 112, 2, dispose les raisins à l'abri sur des claies
— réunir : genus indocile ac dispersum montibus altis composuit Virg. En. 8, 322, il rassembla ce peuple indocile, épars sur les hautes montagnes ; componens oribus ora Virg. En. 8, 486, joignant les bouches aux bouches [celles des vivants sur celles des morts]
¶2. mettre ensemble = mettre aux prises, accoupler (apparier) pour le combat : aliquem cum aliquo Lucil. d. Non. 257, 18, et d. Cic. Opt. 17 ; Sen. Nat. 4, pr. 8 ; Hor. S. 1, 7, 20, mettre aux prises qqn avec qqn ; duos inter se bonos viros Quint. 2, 17, 34, mettre aux prises entre eux deux hommes de bien ; alicui se componere, ou componi Sil. 10, 70 ; 11, 212, s'affronter avec qqn
— confronter en justice : Epicharis cum indice composita Tac. An. 15, 51, Épicharis confrontée avec le délateur
¶3. mettre ensemble pour comparer ; rapprocher, mettre en parallèle : ubi Metelli dicta cum factis composuit Sall. J. 48, 1, quand il eut rapproché les paroles de Métellus de ses actes, cf. Quint. 7, 2, 22
— [av. dat.] aliquem alicui Acc. Tr. 147 ; Catul. 68, 141, comparer qqn à qqn ; si parva licet componere magnis Virg. G. 4, 176, si l'on peut comparer les petites choses aux grandes, cf. B. 1, 23 ; Ov. M. 5, 416, etc.
¶4. faire (composer) par une union de parties : exercitus compositus ex variis gentibus Sall. J. 18, 3, armée composée d'éléments de nationalités diverses ; liber ex alienis orationibus compositus Cic. Cæcil. 47, livre constitué par la réunion de discours pris à autrui ; qui cuncta composuit Cic. Tim. 47, le créateur de l'univers ; mensam gramine Sil. 15, 51, constituer une table avec du gazon
— dans Quint. composita verba = mots composés (1, 5, 3, etc.)
— [surtout] composer un livre, faire (écrire) un ouvrage : Cic. de Or. 2, 224, etc. ; artes componere Cic. Br. 48, composer des traités théoriques ; componit edictum his verbis ut... Cic. Verr. 1, 116, il rédige l'édit en termes tels que... ; carmen Cic. Mur. 26, rédiger une formule ; poema Cic. *Q. 3, 1, 11 (carmina Tac. D. 12 ; versus Hor. S. 1, 4, 8), composer un poème, des vers
— res gestas componere Hor. Ep. 2, 1, 251, écrire l'histoire, cf. Tac. An. 4, 32, etc. ; alicujus vitam Tac. D. 14, écrire la vie de qqn
¶5. serrer, carguer les voiles : Liv. 26, 39, 8, etc.
— mettre en tas de côté, déposer [les armes] : Hor. O. 4, 14, 52
— serrer en réserve [des provisions] : Virg. En. 8, 317 ; Tib. 1, 1, 77 ; Cat. Agr. 162, 12 ; Col. 12, 9, 1, etc.
— recueillir les cendres, les ossements d'un mort : Ov. F. 3, 547 ; Prop. 2, 24, 35 ; [d'où] mettre le mort dans le tombeau, ensevelir : Ov. M. 4, 157 ; Hor. S. 1, 9, 28 ; Tac. H. 1, 47
— serrer, arranger ses membres pour dormir : Virg. G. 4, 437 ; se regina aurea composuit sponda Virg. En. 1, 698, la reine s'est installée sur un lit d'or ; cf. componere togam Hor. S. 2, 3, 77, arranger sa toge = s'installer (pour écouter); [en parl. d'un mort] alto compositus lecto Pers. 3, 104, installé sur un lit élevé
— ubi thalamis se composuere Virg. G. 4, 189, quand les abeilles se sont renfermées dans leurs cellules
¶6. mettre en accord, régler, terminer [un différend] : si possum hoc inter vos componere Pl. Curc. 701, si je puis arranger cette affaire entre vous (Phorm. 622) ; controversias regum Cæs. C. 3, 109, régler le différend entre les rois (1, 9, 6) ; bellum Poll. Fam. 10, 33, 3 (Sall. J. 97, 2 ; Nep. Hann. 6, 2, etc.), terminer une guerre par un traité, conclure la paix
— pass. impers. : fieri non potuit, ut componeretur Cic. Amer. 136, il était impossible qu'il y eût un accord (Cæs. C. 3, 16, 4)
— mettre en accord, apaiser : Campaniam Tac. H. 4, 3, pacifier la Campanie (3, 53 ; An. 2, 4) ; comitia prætorum Tac. An. 14, 28, ramener le calme dans les élections des préteurs ; aversos amicos Hor. S. 1, 5, 29, faire l'accord entre des amis brouillés
¶7. mettre en place, mettre en ordre, disposer, arranger : signa Cic. Att. 4, 9, 1, mettre en place des statues
— [rhét.] : verba Cic. Br. 68, bien ranger les mots, bien les agencer (de Or. 171 ; Or. 149) ; [d'où] orator compositus Cic. Or. 232, orateur au style soigné
— compositi numero in turmas Virg. En. 11, 599, disposés par nombre égal en escadrons ; compositi suis quisque ordinibus Liv. 44, 38, 11, placés en ordre chacun à leur rang
— composito et delibuto capillo Cic. Amer. 135, avec les cheveux bien arrangés et parfumés
¶8. arranger [= donner une forme déterminée, disposer d'une façon particulière, en vue d'un but déterminé] : itinera sic composueram ut... Cic. Att. 15, 26, 3, j'ai réglé mon voyage de manière à ; in consideranda componendaque causa totum diem ponere Cic. Br. 87, consacrer un jour entier à étudier et à disposer une plaidoirie (Or. 143) ; auspicia ad utilitatem rei publicæ composita Cic. Leg. 2, 32, auspices appropriés à l'intérêt de l'État ; aliquem in aliquid componere Quint. 9, 4, 114, préparer qqn à qqch ; se componere Sen. Tranq. 17, 1, se composer (composer son personnage); vultu composito Tac. An. 1, 7, en composant son visage
— [part. ayant sens réfléchi] : in mæstitiam compositus Tac. H. 2, 9, se donnant un air affligé (ad mæstitiam Tac. An. 13, 20) ; in securitatem Tac. An. 3, 44, affectant la sécurité
¶9. arranger avec qqn (entre plusieurs), concerter : compositis inter se rebus constituunt Sall. J. 66, 2, les choses étant réglées entre eux, ils fixent l'exécution de leur projet ; proditionem componere Tac. H. 2, 100, concerter une trahison ; crimen non ab inimicis Romæ compositum Cic. Verr. 3, 141, accusation qui est loin d'avoir été concertée à Rome par des ennemis
— [av. int. indir.] cum summa concordia quos dimitterent composuerunt Liv. 40, 40, 14, ils décidèrent ensemble avec un accord parfait quels soldats ils congédieraient ; [av. infin.] componunt Gallos concire Tac. An. 3, 40, ils conviennent de soulever les Gaulois
— pass. imp. : ut compositum cum Marcio erat Liv. 2, 37, 1, selon le plan concerté avec Coriolan ; [avec ut] compositum inter eos, ut Latiaris strueret dolum Tac. An. 4, 68, il fut convenu entre eux que Latiaris tendrait le piège
— [d'où] : composito Ter. Phorm. 756 ; Nep. Dat. 6, 6 ; ex composito Sall. H. 2, 12 ; Liv. 1, 9, 10 ; 30, 29, 8, etc. ; de composito Apul. Apol. 1, selon ce qui a été convenu (concerté), selon les conventions
— [en part.] : componere pacem (cum aliquo), régler, arranger, conclure la paix (avec qqn) : pacem componi volo meo patri cum matre Pl. Merc. 953, je veux que la paix se règle entre mon père et ma mère (Liv. 30, 40, 13)
¶10. combiner, inventer : mendacia Pl. Amph. 366, fabriquer des mensonges ; si hæc fabulosa nimis et composita videntur Tac. D. 12, si tu trouves là-dedans trop de légende et de combinaison fictive.
===> inf. componier Catul. 68, 141
— parf. composeiverunt CIL 5, 7749, 2
— part. sync. compostus Lucil. d. Cic. de Or. 3, 171 ; Varr. Atac. d. Sen. Ep. 56, 6 ; Virg. En. 1, 249.
¶1. qui est maître de : compos animi Ter. Ad. 310, maître de soi ; tu mentis compos ? Cic. Phil. 2, 97, es-tu dans ton bon sens ? compos sui Liv. 8, 18, 12, qui se possède ; vix præ gaudio compotes Liv. 4, 40, 3, presque fous de joie
¶2. qui a obtenu, qui est en possession [d'un bien moral ou matériel] : compos libertatis Pl. Capt. 41, qui a recouvré la liberté ; qui me hujus urbis compotem fecerunt Cic. Sest. 146, ceux à qui je dois d'être à Rome, cf. Att. 3, 15, 4 ; compos voti Ov. A. A. 1, 486, dont le vœu s'est réalisé ; [rare, avec abl.] præda ingenti compos exercitus Liv. 3, 70, 13, armée qui a fait un prodigieux butin
— [qqf en mauvaise part] compos miseriarum Pl. Epid. 559, malheureux ; compos culpæ Pl. Truc. 835, coupable.
===> .
¶1. action d'apparier (de mettre aux prises des gladiateurs) : Cic. Fam. 2, 8, 1
¶2. préparation, composition : [de parfums] Cic. Nat. 2, 146 ; [de remèdes] Sen. Ben. 4, 28, 4
— [d'où, en médec.] préparation, mixture : Cels. 6, 6, 16, etc.
¶3. composition d'un ouvrage : Cic. Leg. 2, 55
¶4. accommodement d'un différend, réconciliation, accord : Cic. Phil. 2, 24 ; Cæs. C. 1, 26, 5, etc.
¶5. disposition, arrangement : membrorum Cic. Nat. 1, 47, l'heureuse disposition des membres dans le corps humain ; varia compositio sonorum Cic. Tusc. 1, 41, combinaison variée des sons ; magistratuum Cic. Leg. 3, 12, organisation des magistratures ; admirabilis compositio disciplinæ Cic. Fin. 3, 74, l'économie admirable de ce système
¶6. [rhét.] arrangement, agencement des mots dans la phrase : Cic. Or. 182 ; Br. 303, etc.
¶1. celui qui met en ordre : compositor Cic. Or. 61, celui qui sait disposer les idées, les arguments
¶2. qui compose : compositor operum Ov. Tr. 2, 356, écrivain.
¶1. liaison des parties : oculorum composituræ Lucr. 4, 326, l'agencement de l'œil
¶2. construction [gram.] : Capit. d. Gell. 5, 20, 2.
I. part. de compono,
II. pris adjt
¶1. disposé convenablement, préparé, apprêté : perficiam ut nemo paratior, vigilantior, compositior ad judicium venisse videatur Cic. Verr. pr. 32, je montrerai que nul ne s'est présenté à une action judiciaire mieux préparé, plus sur ses gardes, en meilleure forme pour la lutte
— composita oratio Sall. J. 85, 26, discours fait avec art ; composita verba Sall. J. 85, 31, paroles apprêtées [mais v. dans Quint., {compono §{} 4}] ; compositus orator, v. {compono §{} 7}
— litterulæ compositissimæ et clarissimæ Cic. Att. 6, 9, 1, lettres [caractères] très régulièrement et très nettement formées
¶2. en bon ordre : composito agmine Tac. H. 2, 89, les troupes étant en bon ordre de marche ; composita oratio Cic. de Or. 1, 50, discours bien agencé ; composita et constituta re publica Cic. Leg. 3, 42, dans un État bien ordonné et réglé (Tac. D. 36)
¶3. disposé pour : compositus ad carmen Quint. 2, 8, 7, disposé pour la poésie ; in ostentationem virtutum Liv. 26, 19, 3, préparé à faire valoir ses talents ; natura atque arte compositus adliciendis etiam Muciani moribus Tac. H. 2, 5, préparé par sa nature et par son savoir-faire à séduire même un Mucien
¶4. disposé, arrangé dans une forme déterminée, [d'où] calme : compositus ac probus vultus Sen. Ep. 66, 5, une physionomie calme et honnête ; composito voltu Plin. Ep. 3, 16, 5, avec un visage calme (qui ne laisse voir aucune émotion)
— in adrogantiam compositus Tac. Agr. 42, prenant un air hautain, v. {compono §{}} 8.
===> .
¶1. prier : comprecare deos ut Ter. Ad. 699, prie les dieux de ; comprecari Jovi ture Pl. Amp. 740, invoquer Jupiter en lui offrant de l'encens ; mortem comprecari sibi Sen. Ep. 99, 16, invoquer pour soi la mort
¶2. prier, faire sa prière : abi intro et comprecare Pl. Mil. 394, entre et fais ta prière.
¶1. saisir ensemble :
a) unir, lier : naves velut uno inter se vinculo comprendit Liv. 30, 10, 5, il maintient ensemble les vaisseaux comme attachés entre eux par un lien unique ; oras vulneris suturæ comprehendunt Cels. 7, 4, 3, les sutures maintiennent unies les lèvres de la blessure ; medicamentum melle Scrib. 70 ; 88, envelopper de miel un médicament ;
b) embrasser, enfermer : nuces modio comprehendere Varr. R. 1, 7, 3, enfermer des noix dans un boisseau ; circuitus rupis triginta et duo stadia comprehendit Curt. 6, 6, 23, le pourtour du rocher embrasse un espace de trente-deux stades ; loca vallo Frontin. Strat. 2, 11, 7, entourer d'un retranchement ; quantum valet comprehendere lancea Sil. 4, 102, de la portée d'un trait
— ignis robora comprehendit Virg. G. 2, 305, le feu embrasse le tronc ; comprehensa postea privata ædificia Liv. 26, 27, 3, [le feu] gagna ensuite (enveloppa) des maisons particulières
— mais casæ celeriter ignem comprehenderunt Cæs. G. 5, 43, 2, les cabanes prirent feu promptement ; flammā comprensā Cæs. C. 3, 101, 4, le feu ayant pris, la flamme s'étant communiquée ;
c) [abst] c. concipere, concevoir, devenir enceinte : Cels. 5, 21, 13
— prendre, s'enraciner [en parl. de plantes] : cum comprehendit ramus Varr. R. 1, 40, quand la greffe a bien pris ; cf. Col. 3, 12
¶2. saisir, prendre : quid manibus opus est, si nihil comprehendendum est ? Cic. Nat. 1, 92, à quoi bon des mains, s'il n'y a rien à saisir ?
— prendre par la main [en suppliant] : comprehendunt utrumque et orant ne... Cæs. G. 5, 31, 1, ils prennent les mains des deux généraux et les prient de ne pas...
— prendre, appréhender, se saisir de : tam capitalem hostem Cic. Cat. 2, 3, se saisir d'un ennemi si redoutable (Cat. 3, 16 ; Cæs. G. 4, 27, 3, etc.)
— prendre, s'emparer de : redis equisque comprehensis Cæs. G. 6, 30, 2, les chars et les chevaux ayant été saisis ; aliis comprehensis collibus Cæs. C. 3, 46, 6, s'étant emparés d'autres collines
— [arrestation d'une pers.] Liv. 3, 48
— surprendre, prendre sur le fait : nefandum adulterium Cic. Mil. 72, surprendre un adultère criminel (Clu. 47) ; in furto comprehensus Cæs. G. 6, 16, 5, surpris à voler
¶3. [fig.] entourer de (manifestations d'amitié, de bonté, etc.) : mihi gratum feceris, si hunc humanitate tua comprehenderis Cic. Fam. 13, 15, 3, tu m'obligeras, si tu le traites avec toute ta bonté ; omnibus officiis per se, per patrem totam Atinatem præfecturam comprehendit Cic. Planc. 47, il a entouré la préfecture entière d'Atina de toute sorte de bons offices par lui-même, par son père
— mais comprehendere aliquem amicitia Cic. Cæl. 13, se faire un ami
¶4. embrasser [par des mots, dans une formule, etc.] : rem verbis pluribus Cic. Att. 12, 21, 1, exprimer une chose en plus de mots ; breviter comprehensis sententiis Cic. Fin. 2, 20, en pensées brièvement exprimées
— veterum rerum memoriam comprehendere Cic. Br. 19, embrasser l'histoire du passé ; quæ (adversa) si comprehendere coner Ov. Tr. 5, 2, 27, si j'essayais de les (ces malheurs) raconter tous
— numero aliquid comprehendere Virg. G. 2, 104, exprimer qqch par des chiffres, supputer
¶5. saisir par l'intelligence, embrasser par la pensée : aliquid animo Cic. de Or. 2, 136 ; mente Cic. Nat. 3, 21 ; cogitatione Cic. Tusc. 1, 50
— si opinionem jam vestris mentibus comprehendistis Cic. Clu. 6, si vous avez déjà embrassé (adopté) une opinion dans vos esprits ; aliquid memoria Cic. Tusc. 5, 121, enfermer qqch dans sa mémoire, retenir qqch
— animo hæc tenemus comprehensa, non sensibus Cic. Ac. 2, 21, c'est par l'esprit que nous avons la compréhension de ces objets, non par les sens.
¶1. qui peut être saisi [en parl. d'un corps] : Lact. Inst. 7, 12, 2
¶2. perceptible aux yeux : Sen. Nat. 6, 24, 1
¶3. compréhensible, concevable : *Cic. Ac. 1, 41.
¶1. action de saisir ensemble : consequentium rerum cum primis conjunctio et comprehensio Cic. Nat. 2, 147, la faculté de relier et d'unir les idées, celles qui suivent avec celles qui précèdent
¶2. action de saisir avec la main : Cic. Nat. 1, 94
— de s'emparer de, arrestation : Cic. Phil. 2, 18
¶3. [rhét.] phrase, période : Cic. Br. 34 ; Or. 149, etc.
¶4. [phil.] = κατάληψις, compréhension : Cic. Ac. 2, 145, etc.
¶1. compression, action de comprimer : Vitr. 7, 8, 4 ; Gell. 16, 3
— embrassement, étreinte : Pl. Ps. 66
— union charnelle : Hyg. Fab. 187
¶2. action de réprimer, répression : Oros. 7, 6
— resserrement (de l'expression, du style) : Cic. Br. 29.
¶1. part. de comprimo
¶2. pris adjt :
a) étroit, serré : os compressius Cels. 2, 11, ouverture plus étroite ;
b) [médec.] constipé : compressus venter Cels. 1, 3, ventre constipé ; compressi morbi Cels. Præf. maladies qu'entraîne la constipation.
¶1. action de comprimer, pression : Cic. CM 51
— étreinte : Ter. Ad. 475
¶2. action de serrer, replier (les ailes) : Plin. 11, 98.
¶1. comprimer, serrer, presser : digitos comprimere et pugnum facere Cic. Ac. 2, 145, serrer les doigts et faire le poing ; compressa in pugnum manus Quint. 2, 20, 7, main serrée pour faire le poing ; compressis labris Hor. S. 1, 4, 138, ayant les lèvres fermées ; compressis ordinibus Liv. 8, 8, 12, serrant les rangs ; compressis, quod aiunt, manibus Liv. 7, 13, 7, ayant, comme on dit, les bras croisés
— animam compressi Ter. Phorm. 868, j'ai retenu mon souffle ; tibi istas posthac comprimito manus Ter. Haut. 590, une autre fois retiens tes mains
— [médec.] resserrer [le ventre, etc.] : Cels. 1, 10 ; 6, 18, etc.
— mulierem Pl. Aul. 30 ; Ter. Phorm. 1018, etc., déshonorer une femme
¶2. [fig.] tenir enfermé : frumentum Cic. Att. 5, 21, 8 (Dom. 14) ; annonam Liv. 38, 35, 5, accaparer le blé
— tenir caché : orationem Cic. Att. 3, 12, 2, tenir caché un discours ; famam captæ Carthaginis compresserunt Liv. 26, 41, 11, ils étouffèrent la nouvelle de la prise de Carthage
¶3. arrêter : gressum Virg. En. 6, 388, arrêter sa marche ; plausum Cic. Dej. 34, arrêter les applaudissements ; ejus adventus Pompeianos compressit Cæs. C. 3, 65, 2, son arrivée arrêta les Pompéiens ; vix comprimor quin involem... Pl. Most. 203, c'est à peine si je me retiens de me jeter sur...
— comprimer, arrêter : conatum atque audaciam alicujus Cic. Phil. 10, 11, arrêter les entreprises et l'audace de qqn ; animi conscientiam Cic. Fin. 2, 54, étouffer (faire taire) sa conscience ; hæc cogitatio animum comprimit Cic. Tusc. 2, 53, cette pensée comprime (apaise) les mouvements de l'âme.
¶1. approuver entièrement, reconnaître pour vrai, pour juste : tuam sententiam comprobo Cic. Pomp. 69, j'approuve pleinement ta proposition ; consensu eruditorum comprobaretur Quint. 10, 1, 130, il aurait pour lui l'assentiment de tous les lettrés : has comproba tabulas Cic. Cæc. 72, reconnais ces pièces pour authentiques
¶2. confirmer, faire reconnaître pour vrai, pour valable : comprobare dictum patris Carbo d. Cic. Or. 214, justifier la parole de son père ; hoc vita et factis et moribus comprobavit Cic. Fin. 1, 65, cette idée, il l'a confirmée par sa vie, par ses actes, par son caractère ; comprobat consilium fortuna Cæs. G. 5, 58, 6, la chance justifie l'entreprise.
¶1. part. de como 2
¶2. pris adjt, orné, paré, séduisant : fuit forma comptus Spart. Hadr. 26, 1, il était bien fait
— [en part.] soigné, orné, élégant [en parl. du style ou de l'écrivain] : compta oratio Cic. CM 28, langage soigné ; Isocrates nitidus et comptus Quint. 10, 1, 79, Isocrate est brillant et fleuri
— comptior Tac. H. 1, 19 ; comptissimus Aug. Quant. An. 33, 73.
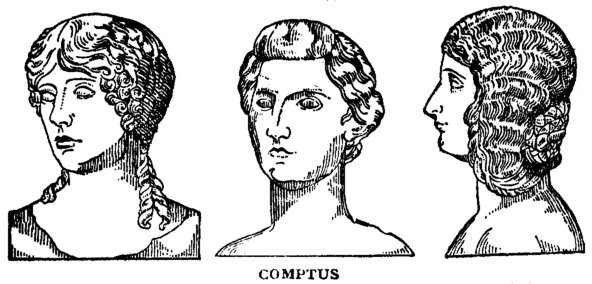
¶1. int., se battre ensemble : compugnantes philosophus et dolor Gell. 12, 5, 3, un philosophe aux prises avec la souffrance
¶2. tr., combattre : Veg. Mul. 1, 13, 6.
¶1. tr., pousser fort : Apul. M. 7, 21
¶2. int., se heurter contre : regnis regna compulsant Tert. Apol. 20, les royaumes se heurtent aux royaumes.
¶1. celui qui pousse devant soi : compulsor (pecoris) Pall. 7, 2, 3, pâtre
¶2. celui qui exige qqch indûment : Cod. Th. 8, 8, 7
— collecteur, percepteur des impôts : Amm. 22, 6, 1.
¶1. piqûre : Ambr. Ps. 118, 3, 8
¶2. [fig.] componction : Salv. Gub. 6, 5
— douleur, amertume : Vulg. Ps. 59, 5.
¶1. piquer fort ou de toutes parts, piquer : aculeis urticæ compungi Col. 8, 14, 8, être piqué par des orties ; compunctus notis Thræciis Cic. Off. 2, 25, tatoué à la manière des Thraces
— [fig.] dialectici se suis acuminibus compungunt Cic. de Or. 2, 158, les dialecticiens se déchirent à leurs propres piquants
¶2. blesser, offenser : colores qui compungunt aciem Lucr. 2, 420, couleurs qui blessent la vue, cf. 2, 432
¶3. [au pass.] être touché de componction : Vulg. Ps. 4, 5
— être affligé : Vulg. Act. 2, 37.
¶1. calcul, compte, supputation : Sen. Ep. 84, 7 ; Ben. 7, 10, 4 ; Romana computatione Plin. 2, 247, en comptant à la romaine ; ad computationem vocare aliquem Plin. Pan. 38, 3, demander des comptes à qqn
¶2. [fig.] manie de calculer, parcimonie : Sen. Ben. 4, 11, 2.
¶1. calculer, compter, supputer : computare suos annos Juv. 10, 245, compter ses années ; computare quantum... Plin. 9, 118, compter combien...; computare quid studia referant Quint. 1, 12, 17, calculer ce que les études peuvent rapporter
— [abst] faire le compte : computarat Cic. Phil. 2, 94, il avait fait le compte ; copo, computemus CIL 9, 2689, 3, cabaretier, l'addition !
— [fig.] calculer, être avare : Sen. Ep. 14, 9
¶2. faire entrer en compte, compter pour : computare aliquid fructibus Dig. 23, 3, 10 (in fructum Dig. 24, 3, 7), faire entrer en compte dans les revenus
— regarder comme [av. deux acc.] : Lact. 1, 18, 17 ; 5, 17, 24.
¶1. devenir calleux : Cic. Nat. 3, 25
¶2. [fig.] devenir habile : Cic. Nat. 3, 25
— devenir insensible, s'émousser : Cic. Att. 4, 18, 2.
¶1. commerce charnel : Tert. Monog. 9
¶2. incarnation : Cypr. Test. 2, 2.
¶1. part. de concateno
¶2. pris adjt, formé de chaînes : concatenatæ loricæ Vulg. Mach. 1, 6, 35, cottes de mailles
— [fig.] enchaîné, lié : sunt concatenatæ virtutes Ambr. Luc. 5, 63, les vertus sont inséparables.
¶1. part. de concavo
¶2. adjt, concave : Col. 8, 5, 11.
I. int.,
¶1. s'en aller, se retirer, s'éloigner : ab eorum oculis aliquo concederes Cic. Cat. 1, 17, tu te serais retiré quelque part loin de leurs regards, cf. Pl. Men. 158 ; Pers. 50 ; Ter. Phorm. 741 ; ex prætorio in tabernaculum suum concessit Liv. 30, 15, 2, il se retira de la tente du général dans la sienne propre ; docere unde fulmen venerit, quo concesserit Cic. Div. 2, 45, montrer d'où vient la foudre, où elle s'en va
— part. n. pris subst : post Hasdrubalis exercitum deletum cedendoque in angulum Bruttium cetera Italia concessum Liv. 28, 12, 6, depuis la destruction de l'armée d'Hasdrubal, depuis l'abandon du reste de l'Italie, résultat de la retraite dans un coin du Bruttium
— Samnium, quo jam tamquam trans Hiberum agro Pœnis concessum sit Liv. 22, 25, 7, le Samnium, territoire dont on s'est retiré au profit des Carthaginois comme on s'était retiré de celui qui est au-delà de l'Èbre
— concedere vita Tac. An. 1, 3, quitter la vie, mourir, décéder, ou abst concedere Tac. An. 4, 38 ; 13, 30
¶2. [fig.] venir à : prope in voluntariam deditionem Liv. 28, 7, 9, en venir à une reddition presque volontaire
— postquam res publica in paucorum potentium jus atque dicionem concessit Sall. C. 20, 7, depuis que le gouvernement est tombé sous l'autorité et la domination de quelques puissants ; in sententiam alicujus Liv. 32, 23, 12, se ranger à l'avis de qqn ; in partes Tac. H. 2, 1, embrasser un parti ; [pass. imp.] concessumque in condiciones, ut Liv. 2, 33, 1, on adopta des conditions portant que
— victi omnes in gentem nomenque imperantium concessere Sall. J. 18, 12, tous les vaincus passèrent dans la nation et prirent le nom de leurs maîtres
¶3. [avec dat.] se retirer devant, céder la place à, céder à : magnitudini medicinæ doloris magnitudo concedit Cic. Tusc. 4, 63, la force de la douleur cède à la force du remède (Pis. 73 ; Fin. 3, 1 ; Leg. 2, 7) ; concedere naturæ Sall. J. 14, 15 ; fato Tac. An. 2, 71, céder à la nature, au destin = mourir d'une mort naturelle
— déférer à, se ranger à l'avis de, adhérer à : alicujus postulationi Cic. Mur. 47, déférer à la demande de qqn ; non concedo Epicuro Cic. Ac. 2, 101, je ne me range pas à l'avis d'Épicure ; (levitas Asiæ) de qua nos et libenter et facile concedimus Cic. Flacc. 37, (la légèreté des Asiatiques) dont nous convenons et volontiers et facilement
— le céder à, s'incliner devant : concedere nemini studio Cic. Dej. 28, ne le céder à personne en dévouement ; sese unis Suebis concedere Cæs. G. 4, 7, 5, [ils déclarent] que c'est aux Suèves seuls qu'ils se reconnaissent inférieurs ; magistro de arte concedere Cic. Amer. 118, céder au maître la possession de l'art [littt se retirer de l'art au profit de] (Verr. 2, 108 ; Att. 12, 47, 2 ; Liv. 3, 60, 4, etc.) ; [avec abl.] concedere alicui summo nomine Tac. An. 15, 2, céder à qqn le titre souverain
— céder à, concéder à, faire une concession à : temere dicto concedi non potes Cic. Amer. 3, il ne peut être fait de concession à une parole téméraire (on ne peut excuser...); poetæ non ignoscit, nobis concedit Cic. de Or. 3, 198, il ne pardonne pas au poète, mais pour nous, il passe condamnation ; alicui gementi Cic. Tusc. 2, 19, excuser les gémissements de qqn ; iis forsitan concedendum sit rem publicam non capessentibus qui... Cic. Off. 1, 71, peut-être faut-il concéder l'abandon de la politique à ceux qui...; tibi concedetur, qui... remisisti ? Cic. Verr. 3, 82, on te pardonnera (on t'excusera), toi qui as fait une remise... ?
II. tr.,
¶1. abandonner (aliquid alicui) qqch à qqn, accorder : alteram partem vici Gallis ad hiemandum concessit Cæs. G. 3, 1, 6, il abandonna une partie du bourg aux Gaulois pour hiverner ; libertatem Cæs. G. 4, 15, 5 ; Cic. Phil. 12, 8 ; victoriam Cic. Phil. 12, 13, accorder la liberté, la victoire ; ea præda militibus concessa Cæs. G. 6, 3, 2, ce butin ayant été laissé aux soldats ; crimen gratiæ Cic. Com. 19, accorder une accusation à la complaisance = se faire accusateur par complaisance
— ei bona diripienda concessit Cic. Verr. 1, 38, il lui laissa la faculté de piller des biens
¶2. [avec inf. ou ut et subj.] mihi concedant homines oportet... non exquirere Cic. Prov. 46, il faut qu'on me concède de ne pas rechercher...; de re publica nisi per concilium loqui non conceditur Cæs. G. 6, 20, 3, on ne permet de parler des affaires publiques que dans une assemblée régulière, cf. Cic. Quinct. 50 ; Or. 152 ; Tusc. 5, 31 ; concessum est = licet Cic. Agr. 2, 54 ; Br. 42 ; Tusc. 2, 55, etc. ; fatis numquam concessa moveri Camarina Virg. En. 3, 700, Camarina à laquelle les destins interdisent de jamais toucher
— concedo tibi ut... prætereas Cic. Amer. 54, je te permets de laisser de côté... (Verr. 1, 32 ; 3, 190, etc.)
— [abst] : consules neque concedebant neque valde repugnabant Cic. Fam. 1, 2, 2, les consuls ni ne cédaient ni ne faisaient une forte opposition, cf. Cæs. G. 1, 28, 5 ; G. 1, 7, 4 ; Nep. Them. 10, 5 ; te reviset cum Zephyris, si concedes Hor. Ep. 1, 7, 13, il reviendra te voir avec les Zéphyrs, si tu le permets
¶3. concéder : alicui primas in dicendo partes Cic. Cæcil. 49, reconnaître à qqn le premier rang dans l'éloquence ; Atheniensibus imperii maritimi principatum Nep. Timoth. 2, 2, concéder aux Athéniens la suprématie maritime
¶4. admettre [une opinion], convenir de : da mihi hoc ; concede, quod facile est Cic. Cæcil. 23, accorde-moi cela ; fais-moi cette concession, qui ne souffre aucune difficulté (Verr. 2, 141 ; 5, 151 ; Div. 2, 107, etc.)
— [avec prop. inf.] : concedes multo hoc esse gravius Cic. Cæcil. 54, tu conviendras que ce cas-ci est beaucoup plus grave (Tusc. 1, 25 ; Verr. 3, 218 ; de Or. 1, 36, etc.) ; hæc conceduntur esse facta Cic. Cæcin. 44, l'on reconnaît que tout cela s'est produit
¶5. renoncer à, faire abandon, sacrifier : dolorem atque inimicitias suas rei publicæ Cic. Prov. 44, faire à l'État le sacrifice de son ressentiment et de ses inimitiés
— aliquem alicui, renoncer à punir qqn, lui pardonner pour l'amour de qqn : Marcellum senatui concessisti Cic. Marc. 3, tu as épargné Marcellus par égard pour le sénat (Att. 5, 10, 5 ; Nep. Att. 7, 3) ; aliquem alicujus precibus Tac. An. 2, 55, accorder aux prières de qqn la grâce d'une personne ; Montanus patri concessus est Tac. An. 16, 33, la grâce de Montanus fut accordée à son père
¶6. pardonner, excuser : omnibus omnia peccata Cic. Verr. 1, 128, pardonner à tous tous les méfaits (Inv. 2, 107 ; Verr. 5, 22, etc.)
— peccata liberum parentum misericordiæ Cic. Clu. 195, accorder à la pitié pour les parents le pardon des fautes des enfants = pardonner les fautes des enfants par pitié pour les parents.
¶1. fréquenter, assister en grand nombre à : variæ volucres concelebrant loca Lucr. 2, 345, des oiseaux variés peuplent les lieux
— Venus, quæ mare..., terras concelebras Lucr. 1, 4, Vénus, qui ne cesses pas d'être présente en tout endroit de la mer..., des terres...; concelebrare convivia Q. Cic. Pet. 44, être assidu aux banquets
— [fig.] pratiquer avec ardeur, cultiver assidûment : concelebrata studia Cic. Inv. 1, 4, études assidûment cultivées
¶2. célébrer, fêter, honorer [avec idée d'empressement, de foule, etc.] : Pl. Ps. 165 ; Cic. Pomp. 61 ; Liv. 8, 7, 22
¶3. divulguer, répandre [par les écrits ou par la parole] : Cic. Inv. 2, 70 ; Q. Cic. Pet. 50 ; per orbem terrarum fama ac litteris victoriam concelebrabant Cæs. C. 3, 72, 4, par transmission orale et écrite, ils annonçaient au monde entier une victoire.
¶1. accord de voix ou d'instruments, concert : concentus avium Virg. G. 1, 422, concert d'oiseaux ; concentus lyræ et vocis Ov. M. 11, 11, accord de la voix et de la lyre ; concentus efficere Cic. Rep. 6, 18, produire des accords
— [en part.] concert d'acclamations : Plin. Pan. 2, 6
¶2. [fig.] accord, union, harmonie : melior actionum quam sonorum concentus Cic. Off. 1, 145, l'accord dans les actions est supérieur à l'accord dans les sons ; omnium quasi consensus doctrinarum concentusque Cic. de Or. 3, 21, une sorte d'accord et de concert de toutes les sciences ; concentum nostrum dividere Hor. Ep. 1, 14, 31, troubler notre harmonie
— harmonie des couleurs : Plin. 37, 91.
¶1. action de contenir, de renfermer : mundi conceptio tota Vitr. 6, 1, l'ensemble, le système du monde
— [en part.] prise d'eau : conceptio aquæ Frontin. Aq. 66, contenu d'un réservoir
¶2. action de recevoir : Cic. Div. 2, 50
— conception : Vitr. 8, 3, 14
¶3. [fig.] : conceptio rei Gell. 11, 13, 9, expression de l'idée
— [en part.]
a) expression : Arn. 5, 36 ;
b) rédaction, formule [jurispr.] : Cic. Inv. 2, 58 ; Dig. 24, 3, 56 ;
c) [gram.] syllabe : Charis. 11, 11 ;
d) [rhét.] syllepse : Prisc. 17, 155.
¶1. action de contenir : novenorum conceptu dierum navigabilis Plin. 3, 53, navigable après que ses eaux ont été amassées chaque fois pendant 9 jours
— ce qui est contenu : conceptus aquarum inertium Sen. Nat. 5, 15, 1, étendues d'eaux dormantes
¶2. action de recevoir : ex conceptu camini Suet. Vit. 8, 2, le feu ayant pris par la cheminée
— [en part.]
a) conception : Cic. Div. 1, 93 ;
b) germination : Plin. 17, 91 ;
c) fruit, fœtus : Plin. 28, 248 ;
d) conception, pensée : Firm. Math. 5, 12.
¶1. rival : Tac. An. 14, 29
¶2. compagnon de lutte : Aug. Serm. 297, 4, 6.
¶1. combattre : concertare prœlio Cæs. G. 6, 5, livrer bataille ; concertare nandi velocitate Col. 8, 15, 4, rivaliser de vitesse à la nage
¶2. se quereller : concertare cum ero Ter. Ad. 211, avoir maille à partir avec le maître, cf. Cic. Att. 13, 12, 2
— être en conflit, lutter (cum aliquo de aliqua re) : Cic. Pomp. 28 ; Nat. 3, 42
— quæ etiamsi concertata... non sunt Cic. Part. 99, ces moyens, même s'ils n'ont pas été débattus [pass. de l'objet intér.].
¶1. coquillage : conchas legere Cic. de Or. 2, 22, ramasser des coquillages
¶2. [en part.]
a) huître perlière : Plin. 9, 107 ;
b) coquillage d'où l'on tire la pourpre : Lucr. 2, 501
— [fig.]
a) perle : Tib. 2, 4, 30 ;
b) pourpre : Ov. M. 10, 267
¶3. coquille : Ov. F. 6, 174 ; Col. 10, 324
¶4. petit vase en forme de coquillage : Hor. S. 1, 3, 12
¶5. conque marine, trompette des Tritons : Virg. En. 6, 171.

===> conca Cat. Agr. 13, 2 ; 66, 1.
a) huître : Cic. Pis. 67 ;
b) le pourpre, coquillage d'où l'on tire la pourpre : Lucr. 6, 1074
— [fig.] pourpre [teinture] : Cic. Verr. 4, 59
— conchȳlĭa, ōrum, n., Juv. 3, 81, vêtements teints en pourpre.
===> conquilium Gloss. 5, 350, 22.
¶1. tomber, s'écrouler, s'effondrer : conclave concidit Cic. de Or. 2, 353, la salle s'écroula ; funibus abscisis antemnæ concidebant Cæs. G. 3, 14, 7, les câbles une fois coupés, les vergues s'abattaient ; si quo afflictæ casu conciderunt (alces) Cæs. G. 6, 27, 2, si (les élans) s'abattent, renversés par quelque accident
— tomber, succomber : nonnulli in ipsa victoria conciderunt Cic. Phil. 14, 31, quelques-uns sont tombés au sein même de la victoire, cf. Tusc. 1, 89 ; Cæs. G. 6, 40, 7, etc. ; vulneribus concidere Cic. Tusc. 3, 66, tomber sous les coups, succomber sous les blessures
— [en parl. des victimes immolées] : Lucr. 1, 99 ; 2, 353 ; Tib. 1, 2, 62 ; Ov. H. 6, 76, etc.
— [moralement] être renversé, être démonté, démoralisé : Cic. Phil. 2, 107 ; Cat. 2, 5, etc. ; mente concidit Cic. Phil. 3, 24, il perdit contenance ; hostes concidunt animis Hirt. G. 8, 19, 6, les ennemis perdent courage, sont démoralisés
¶2. [fig.] tomber, s'écrouler (= perdre sa force, son autorité, sa considération, etc.) : victoria Lysandri, qua Athenienses conciderunt Cic. Div. 1, 75, la victoire de Lysandre qui fit s'écrouler la puissance d'Athènes (Mil. 19 ; Dom. 96 ; Liv. 30, 44, 7, etc.) ; neque umquam Catilina sine totius Italiæ vastitate concidisset Cic. Sest. 12, et jamais Catilina n'aurait été abattu sans entraîner la dévastation de toute l'Italie
— fides concidit Cic. Pomp. 19, le crédit tomba, fut ruiné (Ac. 2, 146 ; Att. 1, 16, 7 ; Cat. 3, 16, etc.).
¶1. couper en morceaux, tailler en pièces, couper : nervos Cic. Flacc. 73, couper les nerfs ; sarmenta minute Cat. Agr. 37, 3, couper les sarments en menus morceaux ; scrobibus concidere montes Virg. G. 2, 260, couper de fossés les coteaux ; itinera concisa æstuariis Cæs. G. 3, 9, 4, chemins coupés de flaques d'eau laissée par la mer
— [fig.] couper, hacher, morceler : sententias Cic. Or. 231, morceler la pensée (Or. 230 ; Ac. 2, 42 ; Sen. Ep. 65, 16 ; 89, 2)
— [sens obscène] Lampr. Heliog. 10, 5 ; cf. Cic. Verr. 3, 155
¶2. tailler en pièces, massacrer : exercitum Cic. Div. 1, 77 ; cohortes Cic. Prov. 9, tailler en pièces une armée, des cohortes (Att. 5, 16, 4 ; Fam. 11, 14, 1 ; Cæs. G. 1, 12, 3, etc.)
¶3. abattre, terrasser : decretis vestris Antonium concidistis Cic. Phil. 5, 28, vous avez terrassé Antoine par vos décrets (Phil. 12, 11 ; Nat. 1, 93, etc.)
— [droit] casser, annuler (un testament) : Ulp. Dig. 28, 4, 1
¶4. rompre (rouer, déchirer) de coups : aliquem virgis Cic. Verr. 1, 122, déchirer qqn à coups de verges ; pugnis et calcibus concisus Cic. Verr. 3, 56, roué de coups de poings et de pieds.
¶1. assembler : ad se multitudinem Liv. 1, 8, 5, réunir autour de soi la multitude ; aliquantum voluntariorum ex agris concivit Liv. 29, 19, 13, il rassembla des campagnes une assez grande quantité de volontaires
¶2. mettre en mouvement, exciter, soulever : amnis concitus imbribus Ov. M. 3, 79, fleuve au cours précipité par les pluies ; freta concita Virg. En. 3, 129, mer agitée
— lancer dans un mouvement rapide : murali concita tormento saxa Virg. En. 12, 921, rochers lancés par une machine de siège [baliste] ; concita nervo sagitta Ov. M. 6, 243, flèche lancée par la corde de l'arc
¶3. [fig.] mettre en branle, exciter, soulever, ameuter, passionner : uni contionibus data nunc detinenda, nunc concienda plebs Liv. 4, 55, 3, l'un [des tribuns] a la mission tantôt de maîtriser, tantôt de soulever le peuple par ses discours (8, 29, 3 ; 9, 37, 1, etc.) ; Samnium fama erat conciri ad bellum Liv. 8, 17, 2, le bruit courait qu'on poussait le Samnium à la guerre ; adlatum erat Etruriam concitam in arma Liv. 10, 21, 2, la nouvelle était venue que l'Étrurie avait été poussée à prendre les armes (ad arma Liv. 31, 3, 5) ; immani concitus ira Virg. En. 9, 694, transporté d'une formidable colère
— donner le branle à qqch, provoquer, soulever ; seditionem Liv. 4, 48, 12 ; bellum Liv. 10, 18, 1, soulever une sédition, une guerre ; (simultates) quas sibi ipse cædibus rapinisque conciverat Liv. 1, 60, 2, (haines) qu'il avait soulevées contre lui-même par ses meurtres et ses rapines.
===> impf. conciebant Pac. Tr. 141 ; concibant Tac. H. 5, 19
— part. concĭtus, mais concītus Lucr. 2, 267 ; Luc. 5, 597 ; V. Flacc. 2, 460 ; 5, 576.
¶1. association, union : communis generis hominum conciliatio Cic. Off. 1, 149, le lien commun du genre humain, cf. Nat. 2, 78
¶2. bienveillance, action de se concilier la faveur : conciliationis causa Cic. de Or. 2, 216, pour se concilier la bienveillance
— appel à la bienveillance des juges : Cic. de Or. 3, 205
¶3. inclination, penchant : naturæ conciliationes Cic. Fin. 3, 22, inclinations naturelles, instincts ; prima est conciliatio hominis ad ea... Cic. Fin. 3, 21, le premier penchant de l'homme le porte vers..., cf. Ac. 2, 131
¶4. action de se procurer ; acquisition : ad conciliationem gratiæ Cic. Clu. 84, pour ménager une réconciliation.
¶1. qui gagne les bonnes grâces : v. concilio §{} 2 : blanda conciliatrix Cic. Nat. 1, 77, amadoueuse
— entremetteuse : Pl. Mil. 1410
¶2. qui procure, v. concilio §{} 4 : Cic. Læ. 37 ; Leg. 1, 27.
¶1. dans les bonnes grâces de qqn (alicui), aimé de qqn, cher à qqn : Liv. 21, 2, 4 ; 27, 15, 11 ; Curt. 7, 9, 19 ; Quint. 3, 8, 6
¶2. favorable, bien disposé : ut judex fiat conciliatior Quint. 4, 2, 24, pour que le juge devienne mieux disposé
— porté (par l'instinct) à : voluptati Gell. 12, 5, 8, incliné vers le plaisir.
¶1. [au pr.] assembler, unir, associer : Lucr. 1, 611 ; 2, 551, etc.; Plin. 17, 211
¶2. [fig.] concilier, unir par les sentiments, gagner, rendre bienveillant : conciliare homines Cic. de Or. 2, 128, rendre les hommes (auditeurs) bienveillants (2, 310 ; Or. 122) ; homines inter se Cic. Off. 1, 50, rapprocher les hommes entre eux ; ad conciliandos novos (socios) Liv. 21, 32, 4, pour gagner de nouveaux (alliés) ; aliquem aliqua re Cic. Mil. 95, gagner qqn par qqch
— ut conciliemus nobis eos qui audiunt Cic. de Or. 2, 115, pour nous concilier l'auditoire ; legiones sibi pecunia Cic. Fam. 12, 23, 2, se concilier les légions par de l'argent ; hos Cingetorigi conciliavit Cæs. G. 5, 4, 3, il les gagna à la cause de Cingétorix
— conciliare animos Cic. de Or. 3, 104, se concilier les esprits (2, 121 ; 3, 204 ; Liv. 28, 18, 8 ; Quint. 4, 1, 59, etc.) ; animos hominum Cic. Off. 2, 17, se concilier les esprits ; animos eorum, apud quos agetur, conciliari ad benevolentiam Cic. de Or. 2, 182, (il est utile) que les esprits de ceux devant qui l'on plaidera soient gagnés à la bienveillance
— rapprocher [par un penchant instinctif] : natura hominem conciliat homini Cic. Off. 1, 12, la nature fait sympathiser l'homme avec l'homme ; primum sibi ipsum conciliatur animal Sen. Ep. 121, 17, avant tout l'animal s'attache à lui-même ; frui rebus iis, quas primas homini natura conciliet Cic. Ac. 2, 131, jouir des biens que la nature approprie avant tous les autres à l'instinct de l'homme ; v. conciliatio §{} 3
¶3. se ménager, se procurer : pecuniæ conciliandæ causa Cic. Verr. 2, 137, pour se procurer de l'argent (2, 142 ; 3, 71 ; 3, 194 ; Att. 6, 1, 21); servus male conciliatus Pl. Ps. 133, esclave qui est une mauvaise acquisition, cf. Ter. Eun. 669 ; pulchre conciliare Pl. Ep. 472, faire un bon marché, acheter dans de bonnes conditions ; aliquid de aliquo Pl. Trin. 856, acheter qqch à qqn
¶4. ménager, procurer : filiam suam alicui Suet. Cæs. 50, procurer sa fille à qqn
— benevolentiam alicujus alicui Cic. Clu. 7, ménager à qqn la bienveillance de qqn ; amicitiam alicui cum aliquo Cic. Dej. 39, ménager à qqn une amitié avec qqn (lier qqn d'amitié avec qqn) ; sibi amorem ab aliquo Cic. Arch. 17, se concilier l'affection de qqn (se faire aimer de qqn) ; pacem inter cives Cic. Fam. 10, 27, 1, ménager la paix entre les citoyens ; alicui regnum Cæs. G. 1, 3, 7, ménager [procurer] le trône à qqn ; societas generis humani quam conciliavit natura Cic. Læ. 20, la société du genre humain, établie par la nature.
¶1. union, réunion, assemblage [des atomes] : Lucr. 1, 484 ; 1, 1082, etc.
— accouplement : Arn. 2, 16
¶2. réunion, assemblée : deorum Cic. Tusc. 1, 72 ; pastorum Cic. Off. 3, 38, assemblée des dieux, des bergers ; voluptatem in virtutum concilium adducere Cic. Fin. 2, 12, introduire la volupté dans le cercle des vertus
— [en part.] assemblée délibérante, conseil : concilium advocare Cic. Vat. 15 ; convocare Cic. Vat. 18, convoquer une assemblée (Cæs. G. 7, 29, 1, un conseil de guerre chez les Gaulois); concilio coacto Cæs. G. 7, 77, 1, l'assemblée ayant été réunie ; concilio habito Cæs. G. 4, 19, 2, ayant tenu un conseil ; dare concilium legatis Liv. 43, 17, 7 (præbere 42, 44, 7) donner audience aux députés ; adire concilium Liv. 10, 12, 3, se. rendre dans une assemblée
— [l. officielle] concilium plebis = comices tributes ; concilium populi = comices curiates ou centuriates.
===> confusion fréquente dans les mss avec consilium.
¶1. préparation, apprêt : Cat. Agr. 106
¶2. composition [livre, lettre] : Aus. 396 ; 407
¶3. combinaison [métr.] : Mar. Vict. Gram. 100, 9.
¶1. artistement, avec un agencement élégant : concinne ornata Pl. Epid. 222, parée avec goût
— [fig.] de façon bien agencée, appropriée, avenante : Cic. Com. 49 ; de Or. 1, 280
¶2. avec une construction symétrique, avec un plan bien construit : Cic. de Or. 2, 81
— avec des expressions symétriques, avec parallélisme dans le style : Cic. Nat. 2, 69
— concinnius Front. 162, 6.
¶1. [rhét.] symétrie, arrangement symétrique [des mots, des membres de phrase] ; employé abst (Cic. Br. 38 ; 287 ; Or. 81, etc.) ou avec sententiarum (Br. 325 ; 327 ; Or. 38), verborum (Or. 149 ; 202)
— concinnitates colorum Gell. 2, 26, 4, harmonies de couleurs
¶2. [sens péj.] ajustement recherché (étudié) : Sen. Ep. 115, 2.
¶1. ajuster, agencer : aream Pl. As. 216, agencer une aire [d'oiseleur] ; Corinthia Sen. Brev. 12, 2, disposer artistement des vases de Corinthe
— varius concinnat id aer Lucr. 6, 1116, c'est la diversité de l'air qui produit cette corrélation [des maladies avec les contrées]
— [fig.] donner une forme convenable : ingenium Sen. Ep. 7, 6, former le caractère
¶2. préparer, produire : alicui multum negotii Sen. Ep. 117, 1, attirer (susciter) beaucoup d'embarras à qqn ; consuetudo concinnat amorem Lucr. 4, 1283, l'habitude prépare (fait naître) l'amour
— [avec 2 accus.] = efficere : aliquem insanum Pl. Capt. 601, rendre fou qqn (Amph. 529 ; 728 ; Capt. 818, etc.).
¶1. bien proportionné, régulier, joli, charmant : virgo concinna facie Pl. Pers. 547, jeune fille d'une jolie figure ; folia concinniora Plin. 16, 148, feuilles plus régulières
¶2. disposé symétriquement, avec parallélisme : Cic. Or. 65 ; 20
— paulo concinnior versus Hor. Ep. 2, 1, 74, vers assez bien balancé ;
— agencé par rapport à qqch, à qqn ; approprié, ajusté ; concinnus in brevitate respondendi Nep. Epam. 5, 1, plein d'à propos dans les courtes répliques ; concinnior Lucr. 4, 1276, plus en concordance ; non inconcinnus Hor. Ep. 1, 17, 29, toujours approprié, sans discordance ; ut tibi concinnum est Pl. Mil. 1024, comme il te convient.
I. int.,
¶1. chanter, ou jouer ensemble, former un ensemble de sons [voix, instruments] : neque frustra institutum est, ut signa undique concinerent Cæs. C. 3, 92, 5, et il n'est pas sans fondement, l'usage que les trompettes sonnent à la fois de toutes parts (Liv. 9, 32, 6 ; 30, 5, 2)
— tragœdo pronuntianti concinere Suet. Cal. 54, accompagner l'acteur qui déclame
¶2. [fig.] être d'accord, s'accorder : omnibus inter se concinentibus mundi partibus Cic. Nat. 2, 19, toutes les parties du monde formant un ensemble harmonieux ; videsne ut hæc concinant ? Cic. Fin. 5, 83, vois-tu comme tout cela est bien à l'unisson ? re cum aliquo concinere Cic. Fin. 4, 60, être d'accord avec qqn pour le fond.
II. tr.,
¶1. produire des sons ensemble, chanter, jouer dans un chœur : nuptialia concinens carmina Catul. 61, 12, chantant l'hymne nuptial ; hæc cum pressis et flebilibus modis concinuntur Cic. Tusc. 1, 106, quand ces mots sont chantés sur un mode grave et plaintif
— tristia omina Ov. Am. 3, 12, 2, faire entendre des chants de triste présage
¶2. chanter, célébrer : Cæsarem Hor. O. 4, 2, 33, chanter César.
I. [pr.]
¶1. prendre entièrement, contenir : (nuces) vix sesquimodio Varr. R. 1, 7, 3, avoir de la peine à renfermer (des noix) dans un boisseau
— [t. technique] capter (prendre) l'eau [par une canalisation] : in agro Frontin. Aq. 5, dans un champ ; ex lacu Frontin. Aq. 11, dans un lac
¶2. prendre sur soi, absorber : concipit Iris aquas Ov. M. 1, 271, Iris absorbe les eaux (Lucr. 6, 503 ; Ov. M. 6, 397)
— flammam Cæs. C. 2, 14, 2 ; ignem Cic. de Or. 2, 190, prendre feu, s'enflammer ; trullis ferreis multum conceptum ignem (portare) Liv. 37, 11, 13, (porter) dans des vases de fer de gros feux allumés
— pars (animæ) concipitur cordis parte quadam Cic. Nat. 2, 138, une partie de l'air est absorbée par une certaine partie du cœur
— [en parl. de la terre] : concipere fruges Cic. Rep. 4, 1 ; semina Cic. Nat. 2, 26, recevoir dans son sein les céréales, les semences
— [en part.] recevoir la fécondation, concevoir : cum concepit mula Cic. Div. 2, 49, quand la mule a conçu (Div. 2, 145 ; Nat. 2, 128) ; neminem eodem tempore ipso et conceptum et natum quo Africanum Cic. Div. 2, 95, [penser] que personne n'a été ni conçu ni mis au jour juste au même moment que l'Africain ; conceptus ex aliquo Cic. Clu. 31, conçu de qqn ; de lupo concepta Ov. M. 3, 214, conçue d'un loup ; anguis immanis concubitu conceptus Liv. 26, 19, 7, fruit de l'accouplement d'un serpent monstrueux
¶3. pass. concipi, se former, naître : torrens ex alio fonte conceptus Curt. 6, 4, 5, torrent venu d'une autre source ; in ea parte nivem concipi Sen. Nat. 4, 12, 1, [on croit] que la neige se forme là ; ex calore concepta pestis Col. 7, 5, 2, le fléau issu de la chaleur
¶4. [droit] : conceptum furtum Gell. 11, 18, 9 ; Gai. Inst. 3, 186, vol découvert chez qqn devant témoins.
II. [fig.]
¶1. admettre (recevoir) dans sa pensée, concevoir : quantalibet magnitudo hominis concipiatur animo Liv. 9, 18, 8, on peut se former de la grandeur d'Alexandre l'idée que l'on voudra ; quod nunc ego mente concipio Liv. 1, 36, 4, ce qu'en ce moment je conçois par la pensée ; quid mirum, si in auspiciis animi imbecilli superstitiosa ista concipiant ? Cic. Div. 2, 81, quoi d'étonnant, si à propos des auspices les esprits faibles se forment ces idées superstitieuses ? hæc flagitia concipere animo Cic. Nat. 1, 66, avoir dans l'esprit ces opinions honteuses ; concipere animo potes quam simus fatigati Plin. Ep. 3, 9, 24, tu peux imaginer combien nous sommes fatigués
— saisir par l'intelligence, comprendre : habere bene cognitam voluptatem et satis firme conceptam animo atque comprehensam Cic. Fin. 2, 6, avoir du plaisir une connaissance exacte et une idée assez nettement saisie et embrassée par la pensée ; mens concipit id fieri oportere Cic. Off. 3, 107, l'intelligence comprend que cela doit être fait
¶2. prendre sur soi, se charger de, contracter : sunt graviora ea quæ concipiuntur animo, quam illa, quæ corpore Cic. Phil. 11, 9, les maux qui atteignent l'âme sont plus pénibles que ceux qui atteignent le corps ; auribus cupiditatem concepisti Cic. Verr. 4, 101, c'est par les oreilles que le désir a pénétré en toi ; furor biennio ante conceptus Cic. Sull. 67, folie contractée deux ans auparavant ; inimicitiæ ex ædilitate conceptæ Cæs. C. 3, 16, 3, inimitié contractée depuis l'exercice de l'édilité ; spem regni concipere Liv. 4, 15, 4, concevoir l'espoir de régner ; macula bello superiore concepta Cic. Pomp. 7, souillure contractée dans la guerre précédente ; dedecus concipere Cic. Off. 1, 123, se couvrir de discrédit ; vitia Cic. Leg. 3, 32, contracter des vices
— scelus in se concipere Cic. Verr. 1, 9, se rendre coupable d'un crime (Cæs. C. 1, 74, 3) ; hoc nefario scelere concepto Cic. Verr. 4, 72, ce crime odieux ayant été commis ; flagitium concipere Cic. Sull. 16, se rendre coupable d'un acte scandaleux
¶3. concevoir l'idée (la résolution) de : quid mali aut sceleris fingi aut cogitari potest, quod non ille conceperit ? Cic. Cat. 2, 7, peut-on imaginer ou évoquer une espèce de méfait ou de crime dont cet homme n'ait eu l'idée ? (Phil. 11, 9 ; Liv. 4, 15, 8)
— aliquid spe concipere Liv. 33, 33, 8, tendre ses espérances vers qqch, avoir telle ou telle visée ; concipit æthera mente Ov. M. 1, 777, il ambitionne le ciel
— Agrippam ferre ad exercitus non servili animo concepit Tac. An. 2, 39, il conçut le projet, qui n'était pas d'une âme d'esclave, de transporter Agrippa aux armées
¶4. assembler les mots en formule (verba concepta, cf. Serv. En. 12, 13) : verbis conceptis jurare Pl. Cist. 98, etc., prononcer un serment en forme (solennel) ; paucis verbis concipiendi juris jurandi mutatis Liv. 1, 32, 8, en changeant seulement quelques mots à la formule du serment ; sicut verbis concipitur more nostro Cic. Off. 3, 108, [jurer] selon la formule en usage chez nous ; vadimonium concipere Cic. Q. 2, 13, 3, rédiger une assignation suivant les formes (fœdus Virg. En. 12, 13, un traité)
— concipere verba Cat. Agr. 139, prononcer une formule ; nisi in quæ ipse concepisset verba juraret Liv. 7, 5, 5, s'il ne jurait dans les termes qu'il aurait lui-même formulés ; cum cetera juris jurandi verba conciperent Tac. H. 4, 31, en prononçant le reste de la formule du serment
— [religion] annoncer par de certaines formules, d'une manière solennelle : Latinas non rite concepisse Liv. 5, 17, 2, n'avoir pas annoncé les féries latines dans les formes prescrites ; v. conceptivus.
¶1. part. de concido 2
¶2. adjt, coupé, saccadé : vox concisior Vulg. Jos. 6, 5, son plus saccadé
— concis, court, serré : distincte concisa brevitas Cic. de Or. 3, 202, brièveté où la concision s'allie à la clarté ; angustæ et concisæ disputationes Cic. de Or. 2, 61, discussions sèches et subtiles (serrées dans la pensée) ; brevis et concisa actio Quint. 6, 4, 2, plaidoirie courte et serrée
— concīsa, ōrum, n., courts membres de phrase : Quint. 11, 3, 170.
¶1. mouvement rapide : Liv. 44, 28, 10
¶2. mouvement violent, excitation de l'âme : concitatio animi quam perturbationem voco Cic. Tusc. 5, 48, l'excitation de l'âme que j'appelle passion
¶3. sédition, soulèvement : Cic. Br. 56 ; Cæs. C. 3, 106, 5.
¶1. prompt, rapide : (stelliferi cursus) conversio concitatior Cic. Rep. 6, 18, révolution (des étoiles) plus rapide
— concitatissimus Liv. 35, 5, 8
¶2. emporté, irrité : concitatum populum flectere Cic. Mur. 24, apaiser le peuple soulevé
¶3. emporté, véhément : adfectus concitati Quint. 6, 2, 9, sentiments violents ; concitatior clamor Liv. 10, 5, 2, cris plus retentissants ; oratio concitata Quint. 3, 8, 58, éloquence animée, passionnée.
¶1. pousser vivement, lancer d'un mouvement rapide : concitata nave remis Liv. 37, 11, 10, le navire étant lancé à force de rames ; cum procursu, quo plurimum concitantur (tela) Liv. 34, 39, 3, avec un élan en avant, qui donne au jet (des traits) sa plus grande force ; equum calcaribus Liv. 2, 6, 8, presser un cheval de l'éperon ; aciem Liv. 2, 64, 6, lancer les troupes en avant ; equitatum in pugnam Liv. 10, 29, 10, lancer la cavalerie dans le combat, faire donner la cavalerie
— se concitare Virg. En. 7, 476 ; Liv. 7, 33, 14 ; 22, 17, 6, se lancer, s'élancer ; magno cursu concitati Cæs. C. 1, 70, 4, s'étant lancés à vive allure
¶2. [fig.] exciter, soulever, enflammer : sive ut concitet (homines) sive ut reflectat Cic. de Or. 3, 23, soit pour soulever (l'auditoire), soit pour le ramener ; animi quodam impetu concitatus Cic. Mur. 65, emporté (soulevé) par certaine ardeur naturelle ; omni motu animi concitari Cic. de Or. 2, 191, être agité par toute espèce d'émotion ; in aliquem concitari Cic. Verr. 3, 6, être soulevé contre qqn ; ad philosophiam studio Cic. Br. 306, être poussé par son goût vers la philosophie ; ad maturandum Nep. Dion. 8, 5, être poussé à se hâter
¶3. [fig.] exciter, susciter : tempestates Cic. Mur. 36, soulever des tempêtes ; bellum Cic. Font. 33, susciter la guerre ; invidiam Cic. Verr. 5, 21, exciter la haine ; misericordiam Cic. de Or. 1, 227, exciter la pitié ; motus in judicum mentibus Cic. de Or. 1, 220, soulever des passions dans le cœur des juges
— exciter à [avec infin.] : Ov. 13, 226.
¶1. rapide : concito gradu Prop. 3, 2, 11, d'une allure rapide ; concitus Mavors Virg. En. 12, 331, Mars impétueux, déchaîné
¶2. excité, ému, troublé : pars cæca et concita Virg. En. 11, 889, une partie [des cavaliers] aveuglée et affolée.
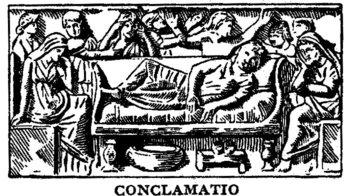
I. int.
¶1. crier ensemble [avec acc. de l'objet de l'exclamation] : victoriam conclamant Cæs. G. 5, 37, 3, ils crient « victoire ! » ; Italiam primus conclamat Achates Virg. En. 3, 523, « l'Italie ! » crie Achate le premier ; ad arma conclamant Cæs. G. 7, 70, 6, ils crient aux armes ; conclamare vasa Cæs. C. 1, 66, 1, donner le signal de décamper (de plier bagage) ; [verbe seul au pass. impers.] conclamari jussit Cæs. C. 3, 75, 2, il fit donner le signal de décamper (C. 1, 67, 2)
— approuver à grands cris : quod Mithridates se velle dixit, id conclamarunt Cic. Flacc. 17, ce que Mithridate déclara vouloir, ils l'approuvèrent à grands cris
— [avec prop. inf.] : a me conservatam esse rem publicam conclamastis Cic. Phil. 6, 2, vous avez proclamé que l'État me devait son salut (Cæs. G. 3, 18, 5 ; C. 1, 7, 8)
— [avec ut] demander à grands cris que : Cæs. G. 5, 26, 4 ; Liv. 3, 50, 16 ; [avec subj. seul] Cæs. C. 3, 6, 1 ; Curt. 4, 1, 29
¶2. [en parl. d'une seule pers.] crier à haute voix : Cæs. G. 1, 47, 6 ; Virg. En. 3, 523 ; Tac. H. 3, 29.
II. tr.,
¶1. crier le nom d'un mort, lui dire le dernier adieu : suos conclamare Liv. 4, 40, 3, dire aux siens le dernier adieu ; conclamatus es Apul. M. 1, 6, tu as reçu le dernier adieu, cf. Luc. 2, 23
— desine ; jam conclamatumst Ter. Eun. 348, tais-toi ; c'est maintenant une affaire réglée (on a crié le dernier adieu)
¶2. appeler à grands cris des personnes (homines) : Virg. En. 7, 504 ; Ov. M. 13, 73
— acclamer : Sen. Ep. 52, 13
¶3. crier contre qqch, [d'où pass.] recevoir les cris de qqn : conclamata querelis saxa senis Mart. 9, 45, 5, rochers retentissant des plaintes du vieillard.
¶1. [en gén.] chambre, pièce fermant à clef : Ter. Haut. 902 ; virgo in conclavi sedet Ter. Eun. 583, la jeune fille est dans sa chambre
¶2. [en part.]
a) chambre à coucher : Cic. Amer. 64 ;
b) salle à manger : Cic. de Or. 2, 353 ;
c) enclos pour les animaux, étable, volière : Col. 8, 1, 3.
¶1. enfermer, enclore, fermer : bestias Cic. Fin. 5, 56, enfermer des bêtes ; conclusa aqua Cic. Nat. 2, 20, eau enfermée (stagnante) ; in concluso mari Cæs. G. 3, 9, 7, dans une mer enclose [Méditerranée]
— in cellam Ter. Ad. 552 ; in angustum locum Cic. Leg. 1, 17, enfermer dans un réduit, dans un lieu étroit
— [au pass.] : in cavea conclusi Pl. Curc. 450, enfermés dans une cage (Ter. Phorm. 744) ; conclusæ follibus auræ Hor. S. 1, 4, 19, air enfermé dans un soufflet
¶2. [fig.] enfermer, resserrer : omnia fere quæ sunt conclusa nunc artibus, dispersa fuerunt Cic. de Or. 1, 187, presque tout ce qui, réuni en corps, constitue maintenant les différents arts, se trouvait dispersé ; uno volumine vitam excellentium virorum complurium concludere Nep. Epam. 4, 5, enfermer en un seul volume la vie de bon nombre d'hommes éminents ; in formulam sponsionis aliquem Cic. Com. 12, enfermer qqn dans la formule de l'engagement réciproque ; orator concludatur in ea quæ sunt... Cic. de Or. 1, 260, que l'orateur se cantonne dans les sujets qui sont...
¶3. clore, finir : epistulam Cic. Att. 9, 10, 5 ; crimen Cic. Verr. 3, 63, finir une lettre, l'exposé d'un chef d'accusation ; si casus exitu notabili concluduntur Cic. Fam. 5, 12, 5, si les aventures s'achèvent sur un dénouement remarquable, cf. Verr. 2, 82 ; Clu. 50 ; Att. 13, 42, 1, etc.
— conclure, donner une conclusion à : ea concludamus aliquando Cic. Læ. 100, arrivons enfin à la conclusion de ce sujet ; concludere ac perorare Cic. de Or. 2, 80, conclure et faire la péroraison
— donner en conclusion : perorationem inflammantem concludere Cic. Or. 122, donner pour finir une péroraison qui enflamme
¶4. [rhét.] enfermer dans une phrase bien arrondie, [ou] donner une fin harmonieuse à la phrase : sententias Cic. Or. 230, enfermer les pensées dans une forme périodique ; oratio conclusa Cic. Or. 20, style aux phrases bien arrondies ; quæ valde laudantur apud illos, ea fere, quia sunt conclusa, laudantur Cic. Or. 170, les parties qu'on loue chez eux, on les loue en général, parce qu'elles ont un tour périodique
— [abst] : hi tres pedes male concludunt Cic. Or. 217, ces trois pieds font une mauvaise fin de période
— concludere versum Hor. S. 1, 4, 40, faire un vers régulier
— [terminaison d'un mot] verba similiter conclusa Cic. Or. 84, mots de même terminaison
¶5. [philos.] conclure logiquement, terminer par une conclusion en forme : argumentum Cic. Ac. 2, 44 ; argumentationes Cic. Or. 122, conclure un argument, des argumentations
— [avec prop. inf.] : concludebas summum malum esse dolorem Cic. Fin. 2, 63, tu concluais que la douleur est le plus grand mal ; [abst] tirer une conclusion, conclure : Cic. Part. 47 ; Div. 2, 103 ; ex aliqua re Cic. de Or. 2, 177, tirer une conclusion de qqch
— [abl. abs. n.] : perfecto et concluso amicitiis nusquam locum esse Cic. Fin. 2, 85, étant acquis et démontré qu'il n'y a place nulle part pour l'amitié.
===> part. conclausus Col. 3, 12, 2.
¶1. action de fermer, d'où [t. mil.] blocus : Cæs. C. 2, 22, 1 ; Nep. Eum. 5, 7
¶2. achèvement, fin : Cic. Q. 1, 1, 46
¶3. [rhét.] fin du discours : Inv. 1, 19 ; de Or. 2, 80, etc.
¶4. art d'enfermer l'idée dans une période, dans une phrase bien arrondie : conclusio sententiarum Cic. Or. 169, art d'enfermer la pensée en une période bien arrondie (bien cadencée)
— art de terminer la phrase : verborum quasi structura et quædam ad numerum conclusio nulla erat Cic. Br. 33, on ne savait pas du tout au moyen des mots faire une phrase comme une maçonnerie ni la terminer d'une façon spéciale, suivant un rythme ; conclusiones Cic. Or. 212 (conclusiones verborum Or. 178), fins de phrase (clausules) ; mais artificiosa verborum conclusio Cic. de Or. 2, 34 = une période artistement faite (3, 174)
¶5. [phil.] conclusion [d'un syllogisme, d'un raisonnement] : Top. 54, etc. ; Ac. 2, 96, etc.
¶1. de même couleur : sus cum fetu concolor Virg. En. 8, 82, truie de même couleur que ses petits
— [avec dat.] Ov. M. 11, 500 ; Plin. 8, 121
— [fig.] semblable, de même teinte : error concolor Prud. Symm. 2, 872, erreur pareille
¶2. dont la couleur est uniforme : Plin. 10, 67.
¶1. faire cuire ensemble : Sen. Ep. 95, 28 ; concoctus et dat. Plin. 31, 122, cuit avec
¶2. digérer, élaborer : Cic. Nat. 2, 24 ; 124 ; cibus facillimus ad concoquendum Cic. Fin. 2, 64, nourriture très digestible
— [abst] faire la digestion : quamvis non concoxerim Sen. Ben. 4, 39, 3, bien que ma digestion ne soit pas faite
¶3. [médec.] résoudre, mûrir : juniperus tusses concoquit Plin. 24, 54, le genièvre réduit le rhume ; concoquere suppurationes Plin. 21, 127, mûrir des abcès
¶4. [fig.]
a) digérer [une disgrâce], endurer, supporter : quem senatorem concoquere civitas vix posset Liv. 4, 15, 7, que l'État avait de la peine à supporter comme sénateur ; odia concoquere Cic. Q. 3, 9, 5, être insensible aux haines, cf. Fam. 9, 4 ;
b) méditer mûrement, approfondir : Cic. Com. 45 ; Har. 55 ; concoquamus illa Sen. Ep. 84, 7, assimilons-nous ces enseignements.
¶1. int., s'accorder, vivre en bonne intelligence : si concordabis cum illa Ter. Phorm. 433, si tu t'accordes bien avec elle
— [fig.] être d'accord [en parl. des choses] : ejus judicia opinionesque concordant Cic. Tusc. 4, 30, ses jugements et opinions sont en parfait équilibre ; concordant carmina nervis Ov. M. 1, 518, les chants s'accordent aux sons de la lyre ; cum gestu concordare Quint. 11, 3, 69, s'accorder avec le geste
¶2. tr., mettre d'accord : Aug. Ep. 210, 2.
¶1. incorporer : cum melle concorporatur Plin. 22, 113, il s'incorpore avec le miel
— [fig.] réunir à [dat.] : concorporatus Ecclesiæ Tert. Pud. 15, devenu membre de l'Église
¶2. résorber [méd.] : concorporare vitiligines Plin. 27, 112, résorber les taches de rousseur.
===> abl. sing. concordi, mais -de Prisc. 7, 64
— pl. n. concordia Virg. En. 3, 542 ; Sil. 13, 650.
¶1. int., faire du bruit, bruire : foris concrepuit Pl. Mil. 154, la porte a fait du bruit ; (multitudo) armis concrepat Cæs. G. 7, 21, (la multitude) fait retentir ses armes ; exercitus gladiis ad scuta concrepuit Liv. 28, 29, 9, les soldats firent résonner les épées contre les boucliers ; concrepare digitis Cic. Off. 3, 75, faire claquer ses doigts [en part. pour appeler un serviteur et lui donner un ordre]; simul ac decemviri concrepuerint Cic. Agr. 2, 82, sur un geste des décemvirs
¶2. tr., faire retentir : concrepare digitos Petr. 27, 5, faire claquer ses doigts ; concrepare æra Ov. F. 5, 441, faire retentir des cymbales, cf. Prop. 3, 18, 6
— annoncer à son de trompe : Hier. Ep. 52, 10.
¶1. croître ensemble par agglomération (agrégation), s'accroître : valles quæ fluminum alluvie concreverunt Col. 3, 11, 8, les vallées formées par les alluvions
— emploi fréquent du part. concretus, a, um : [avec ex] Cic. Nat. 3, 30, 34 ; Tusc. 1, 62 ; [avec abl.] Ac. 2, 121 ; Tusc. 1, 60, formé de
¶2. se former par condensation, s'épaissir, se durcir : Cat. Ag. 88, 2 ; Lucr. 6, 495 ; neque aqua concresceret nive Cic. Nat. 2, 26, et l'eau ne se condenserait pas en neige ; concrevit frigore sanguis Virg. En. 12, 905, mon sang se figea ; cum lac concrevit Col. 7, 8, 3, quand le lait est caillé ; radix concreta Virg. G. 2, 318, racine durcie par le froid.
===> concresse, sync. pour concrevisse : Ov. M. 7, 416.
¶1. agrégation, assemblage : concretio individuorum corporum Cic. Nat. 1, 71, l'assemblage des atomes
¶2. ce qui est formé par agrégation (agglomération), la matière : mens segregata ab omni concretione mortali Cic. Tusc. 1, 66, l'esprit qui est indépendant de tout agrégat périssable.
¶1. friser, faire onduler : humores se concrispantes Vitr. 8, 1, 1, vapeurs qui ondulent (moutonnent) dans l'air
¶2. brandir : concrispans telum Amm. 16, 12, 36, brandissant un javelot.
¶1. place sur le lit de table : Prop. 4, 8, 36
¶2. union de l'homme et de la femme : Cic. Nat. 1, 42
— accouplement des animaux : Virg. G. 4, 198
— [fig.] entrechoquement des dents : C. Aur. Acut. 3, 2, 16.
¶1. union charnelle [c. concubitus §{} 2] : Gell. 9, 10, 4
¶2. concubium noctis Pl. Trin. 886, c. concubia nox.
¶1. fouler avec les pieds, écraser : Cat. Agr. 25 ; Varr. R. 2, 2, 15 ; Lucr. 5, 1140 ; Cic. Pis. 61
¶2. [fig.] fouler aux pieds, opprimer, maltraiter, tenir pour rien, mépriser : [l'Italie] Cic. Sest. 81 ; Att. 8, 11, 4 ; [qqn] Cic. Dom. 110 ; [les lois] Cic. Vat. 23 ; [les biens] Sen. Ep. 23, 6.
===> formes contractes : concupistis Liv. 3, 67, 7 ; concupisset Cic. Phil. 5, 22.
¶1. courir de manière à se rassembler sur un point : Agrigentini concurrunt Cic. Verr. 4, 95, les Agrigentins accourent en masse ; de contione concurrere Cic. Verr. 1, 80, accourir en masse de l'assemblée ; ad fanum ex urbe tota concurritur Cic. Verr. 4, 95, on accourt en masse au temple de tous les points de la ville ; ad arma Cæs. G. 3, 22, courir aux armes ; ad me restituendum Romam concurrere Cic. Mil. 39, se porter en foule à Rome pour me rappeler d'exil ; gratulatum Romam Cic. Mur. 89, se porter en foule à Rome pour féliciter [qqn]
— confestim verba concurrunt Cic. Or. 200, aussitôt les mots accourent, affluent [à la pensée]
¶2. se rencontrer, se joindre : concurrunt labra Sen. Ep. 11, 2, les lèvres se joignent (restent collées l'une à l'autre), ou os concurrit Sen. Ir. 3, 15, 1 ; Ben. 2, 1, 3 ; Quint. 10, 7, 8 ; litteræ obscænius concurrunt Cic. Or. 154, les lettres en se rapprochant donnent un sens qq peu indécent (cf. de Or. 3, 172, rencontre désagréable de mots)
— res concurrent contrariæ Cic. Fin. 5, 28, ce sera la rencontre de choses contraires ; quæ ut concurrant omnia, optabile est Cic. Off. 1, 45, que toutes ces conditions se trouvent remplies à la fois, c'est souhaitable
— ut non concurrerent nomina Cic. Att. 16, 3, 5, [s'il arrivait] que les sommes dues (par moi et à moi) ne vinssent pas à concurrence (si elles ne se contrebalançaient pas) [ou] si les paiements (qui doivent être faits par moi et à moi) ne tombaient pas ensemble = si les rentrées ne coïncidaient pas avec les sorties
¶3. se rencontrer, se heurter, s'entrechoquer : ne proræ concurrerent Liv. 37, 30, 4, pour éviter l'entrechoquement des proues ; concurrunt equites inter se Cæs. C. 2, 25, 5, les cavaliers se heurtent (Liv. 26, 51, 4 ; 29, 18, 10)
— cum aliquo Nep. Eum. 4, 1, en venir aux mains avec qqn (Liv. 8, 8, 15)
— adversus fessos Liv. 35, 1, 6, se porter contre (attaquer) des soldats fatigués
— [avec dat.] : viris Virg. En. 1, 493, lutter contre des hommes, cf. En. 10, 8 ; Ov. M. 5, 89, etc. ; *Liv. 24, 15, 7
— [abst] : cum infestis signis concurrunt Sall. C. 60, 2, enseignes déployées ils se heurtent (ils en viennent aux mains) ; simul concurreritis Liv. 6, 7, 6, aussitôt que vous serez aux prises
— [pass. impers.] : utrimque concurritur Sall. J. 53, 2, on s'attaque de part et d'autre, cf. Liv. 10, 40, 13 ; Hor. S. 1, 1, 7.
¶1. action d'accourir ensemble, affluence : cum multa concursatione Cic. Br. 242, au milieu d'une grande affluence
¶2. course ici et là, allées et venues : quid hujus lacrimas et concursationes proferam ? Cic. Verr. 1, 75, qu'ai-je besoin de rappeler ses larmes, ses allées et venues ? cf. Agr. 2, 94 ; Dom. 14 ; Fam. 1, 1, 3 ; mulierum concursatio incerta nunc hos nunc illos sequentium Liv. 5, 40, 3, la course incertaine des femmes qui suivaient tantôt ceux-ci, tantôt ceux-là ; [fig.] concursatio exagitatæ mentis Sen. Ep. 3, 5, agitation d'un esprit inquiet
— course à la ronde : concursatio decemviralis Cic. Agr. 1, 3, 8, tournée des décemvirs dans la province
— pêle-mêle : Liv. 41, 2, 6
¶3. attaque d'escarmouche, harcèlement : Liv. 30, 34, 2 ; Curt. 8, 14, 24.
¶1. rencontre : atomorum Cic. Ac. 1, 6 ; vocum Cic. Or. 151 ; fortuitorum Cic. Top. 76, rencontre d'atomes, de voyelles, concours de choses fortuites
¶2. [rhét.] = συμπλοκή, répétition fréquente de mêmes mots : Cic. de Or. 3, 206 ; cf. Quint. 9, 1, 33.
¶1. int., courir çà et là : Titurius trepidare et concursare Cæs. G. 5, 33, 1, Titurius s'agitait, courait çà et là (Cic. Att. 1, 14, 5 ; Amer. 81) ; [pass. imp.] : concursari jubet Cæs. G. 5, 50, il ordonne qu'on se démène
— circum tabernas Cic. Cat. 4, 17, courir les tavernes à la ronde
— voyager à la ronde, faire une tournée : cum concursant ceteri prætores Cic. Verr. 5, 29, quand les autres préteurs font des tournées (Fam. 7, 1, 5)
— courir sur un point et sur un autre, escarmoucher : Liv. 5, 8, 8 ; 28, 2, 7 ; in novissimum agmen Liv. 21, 35, 2, harceler l'arrière-garde
¶2. tr., visiter à la ronde : omnes fere domos Cic. Mur. 44, parcourir presque toutes les maisons (Div. 2, 129).
¶1. course en masse vers un point [sing. ou pl.] : concursus fit in prætorium Cæs. C. 1, 76, 2 ; {concursus [pl.] ad Afranium fiebant} Cæs. C. 1, 53, 2, on accourt au prétoire, on accourait vers Afranius
— concursus quinque amnium in unum confluens Plin. 6, 75, réunion de cinq rivières en un seul confluent
— [fig.] honestissimorum studiorum Cic. Fin. 2, 111, concours (réunion) des plus nobles occupations
¶2. rencontre, assemblage : corpusculorum Cic. Nat. 1, 66, rencontre d'atomes ; lunæ et solis Cels. 1, 4, conjonction de la lune et du soleil ; asper verborum concursus Cic. de Or. 3, 171, rencontre désagréable de mots
— rencontre, choc : navium Cæs. C. 2, 6, 5, choc des vaisseaux ; [choc des nuages] Lucr. 6, 161
¶3. rencontre, choc des troupes dans la bataille : Cæs. C. 3, 92, 1 ; Nep. Cim. 2, 3, etc.
— [fig.] concursum omnium philosophorum sustinere Cic. Ac. 2, 70, soutenir l'assaut de tous les philosophes
¶4. [droit] prétentions rivales, concurrence : concursu, per concursum, concurremment, en concurrence : Dig. 39, 2, 15, etc.
¶1. agitation, secousse : concussio quæ duas suppressit urbes Sen. Nat. 6, 25, 4, tremblement de terre qui a englouti deux villes
¶2. concussion, extorsion : Dig. 47, 13
¶3. [fig.] trouble, agitation : Tert. Anim. 10, 1 ; Amm. 29, 5, 30.
¶1. agiter, secouer : caput Ov. M. 2, 50 ; quercum Virg. G. 1, 159, secouer la tête, un chêne ; arma manu Ov. M. 1, 143, agiter des armes de sa main ; terra ingenti motu concussa est Liv. 3, 10, 6, la terre fut agitée par une violente secousse
— [fig.] : se concutere Hor. S. 1, 3, 35, se secouer en tous sens [comme un vase dont on explore l'intérieur] = s'examiner ; fecundum concute pectus Virg. En. 7, 338, scrute ton génie fécond [fais sortir ce qu'il renferme
— [droit] concutere aliquem, extorquer de l'argent à qqn [cf. expression populaire « faire cracher qqn », « faire cracher de l'argent à qqn »] : Dig. 1, 18, 7 ; Paul. Sent. 5, 25, 12 ; Cod. Th. 9, 27, 6 ; v. {concussio §{} 2}
¶2. [fig.] faire chanceler, ébranler : concusso jam et pæne fracto Hannibale Liv. 28, 44, 11, Hannibal étant déjà ébranlé et presque brisé ; concussa fide Tac. H. 5, 25, la fidélité étant ébranlée ; in hoc concussi orbis motu Tac. H. 1, 16, dans cette secousse qui a ébranlé le monde
— disloquer, renverser, ruiner : rem publicam Cic. Phil. 2, 109, bouleverser le gouvernement ; opes Lacedæmoniorum Nep. Epam. 6, 4, abattre la puissance des Lacédémoniens
¶3. ébranler l'âme, troubler : terrorem metum concutientem definiunt Cic. Tusc. 4, 19, on définit la terreur, une crainte qui bouleverse ; quod factum populares conjurationis concusserat Sall. C. 24, 1, cet acte avait ébranlé les conjurés (leur avait porté un coup) ; [poét.] casa animum concussus amici Virg. En. 5, 869, navré en son cœur du sort de son ami (12, 468)
— non concuti Sen. Tranq. 2, 3, ne pas se troubler (s'affecter), être impassible
¶4. exciter, soulever ; tu concute plebem Petr. 124, 288, toi, soulève la plèbe ; se concussere ambæ Juv. 10, 328, toutes deux se mirent en branle [pour la vengeance]
¶5. entrechoquer : manus concutiuntur Sen. Nat. 2, 28, 1, les mains s'entrechoquent.
¶1. condamner : aliquem lege aliqua Cic. Vat. 41, etc., condamner qqn en vertu d'une loi ; omnibus sententiis Cic. Verr. 4, 100, à l'unanimité des suffrages ; hunc sibi condemnat Cic. Verr. 2, 22, il le condamne à son profit [il se fait verser l'amende]
— [le délit au gén.] : aliquem ambitus Cic. Clu. 98 ; injuriarum Cic. Verr. 2, 22 ; pecuniæ publicæ Cic. Flac. 43 ; sponsionis Cic. Cæc. 91, condamner qqn pour brigue, pour injustices, pour concussion, pour engagement violé
— [à l'abl. avec de] : de pecuniis repetundis Cic. Verr. 3, 222 ; de vi Cic. Phil. 2, 4, pour concussion, pour violence
— [la peine au gén.] : capitis Cic. Rab. perd. 12, condamner à mort (de Or. 1, 233) ; dupli, quadrupli Cat. Agr. præf. 1, condamner à une amende du double, du quadruple ; sponsionis Cic. Cæc. 91, condamner à exécuter un engagement
— [à l'abl.] : capitali pœna Suet. Dom. 14, condamner à la peine capitale ; quadruplo Cic. Verr. 3, 34, à une amende du quadruple
— [à l'acc. avec ad, in] : ad metalla, ad bestias Suet. Cal. 27 ; in antliam Suet. Tib. 51, condamner aux mines, aux bêtes, à tirer de l'eau
— [à l'acc. seul chez les juristes] : certam pecuniam aliquem Gai. Inst. 4, 51, condamner qqn à verser une somme déterminée
— condemnari arbitrium pro socio Cic. Quinct. 13, être condamné devant l'arbitre dans une action en matière de société
¶2. [fig.] déclarer coupable : aliquem inertiæ Cic. de Or. 1, 172, déclarer qqn coupable de paresse (Div. 1, 36 ; Cat. 1, 4, etc.)
— [en part.] condemnatus voti Titin. Com. 153 ; Turpil. Com. 128, c. damnatus voti ; v. damno
— condamner qqch : suo silentio audaciam alicujus Cic. Pis. 39, par son silence condamner l'audace de qqn ; exempla quæ condemnat populus Romanus Cic. Verr. 3, 210, les exemples que condamne le peuple romain
¶3. faire condamner : istum omnium mortalium sententiis condemnavi Cic. Verr. 5, 177, je l'ai fait condamner par les suffrages de tous les mortels ; aliquem furti Cic. Clu. 120, faire condamner qqn pour vol ; aliquem per judicem Cic. Com. 25, faire condamner qqn par l'intermédiaire du juge.
¶1. rendre compact : Col. 7, 8, 4
¶2. serrer : oves se congregant ac condensant Varr. R. 2, 3, 9, les brebis se rattroupent et se pressent.
¶1. dont les éléments sont serrés, compact, dense : condensa acies Liv. 26, 5, 13, formation de combat serrée
¶2. garni, couvert de : vallis condensa arboribus Liv. 25, 39, 1, vallée couverte d'arbres, cf. B. Afr. 50
— condensa saltus [gén.] Hier. Isai. 10, 34 et abst condensa, ōrum, n., endroits fourrés, taillis épais : Ambr. Ep. 63, 67.
¶1. condition, situation, état, sort, qualité, manière d'être [d'une pers. ou d'une chose] : liberorum populorum Cic. Planc. 11 ; servorum Cic. Off. 1, 41 ; humana Cic. Tusc. 1, 15, la condition des peuples libres, des esclaves, la condition humaine
— nascendi condicio Cic. Cat. 3, 2, la situation qui nous est dévolue à notre naissance, notre destinée, cf. eadem condicione nasci Cic. Div. 2, 93, naître avec la même destinée ; pro mortali condicione vitæ immortalitatem estis consecuti Cic. Phil. 14, 33, en échange d'une condition de vie mortelle, vous avez obtenu l'immortalité ; condicio externæ victoriæ Cic. Cat. 4, 22, la condition de vainqueur dans une guerre étrangère ; o condicionem miseram administrandæ rei publicæ Cic. Cat. 2, 14, le triste lot que celui de tenir les rênes du gouvernement ; est (senex) meliore condicione quam adulescens Cic. CM 68, la condition du vieillard est meilleure que celle du jeune homme ; iniqua pugnandi condicio Cæs. G. 6, 10, 2, conditions de combat désavantageuses ; cum esset hæc ei proposita condicio, ut aut... aut... Cic. Clu. 42, cette alternative lui étant proposée de... ou de...; ea videtur condicio impendere legum, judiciorum, temporum, ut... Cic. Fam. 5, 18, 1, nous sommes menacés d'avoir des lois, des tribunaux, des moments d'une nature telle que...
¶2. condition, disposition, stipulation, engagement, clause : mihi si hæc condicio consulatus data est, ut Cic. Cat. 4, 1, si les conditions de mon consulat sont que...; iniqua condicio pacis Cic. Phil. 2, 37, mauvaises conditions de paix ; deditionis nullam esse condicionem nisi armis traditis Cæs. G. 2, 32, 1, [il répondit] qu'il ne pouvait y avoir aucune stipulation de paix, si les armes n'étaient pas livrées ; solduriorum hæc est condicio ut... Cæs. G. 3, 22, 2, les soldures sont liés par les engagements suivants... ; condiciones dedendæ urbis Liv. 25, 28, 2, les conditions (les clauses) de la reddition de la ville ; condicionibus hunc producit Cic. Quinct. 30, il l'amuse en lui faisant des propositions (Verr. 3, 138 ; Agr. 2, 68, etc.)
— his condicionibus Cic. Verr. 3, 70 ; ista condicione Cic. de Or. 1, 101, avec de telles conditions, à cette condition-là ; nulla condicione Cic. Verr. 1, 137, à aucune condition (Verr. 4, 17 ; Fin. 5, 55, etc.)
— ea condicione ut subj., à condition que : Cic. Sest. 38 ; 39 ; Dom. 145 ; Liv. 5, 32, 5, etc.
— sub condicione Liv. 6, 40, 8, sous condition, conditionnellement
— sub condicionibus iis Liv. 21, 12, 4, sous ces conditions (Ov. F. 4, 320 ; Sen. Ben. 7, 12, 4)
— sub ea condicione, ne quid postea scriberet Cic. Arch. 25 (mss), sous la condition qu'il n'écrivît plus rien désormais (Plin. Ep. 4, 13, 11) ; sub ea condicione, si... Plin. Ep. 8, 18, 4, à la condition que...
— per condiciones Sall. J. 61, 5 ; Liv. 6, 3, 10 ; 25, 25, 1, par stipulation, selon des clauses, par une capitulation ; in eas condiciones Liv. 29, 12, 14, conformément à ces clauses
¶3. [en parl. de mariage] parti : contentio uxoriæ condicionis Cic. Læ. 34, rivalité au sujet d'un mariage ; aliam condicionem filio suo invenire Pl. Truc. 849, trouver un autre parti pour son fils (Cic. Phil. 2, 99) ; condicionem filiæ quærere Liv. 3, 45, 11, chercher un parti pour sa fille ; alicui condicionem ferre Pl. Trin. 488 ; Ter. Phorm. 579, présenter un parti à qqn
— [en mauv. part] bonne fortune, maîtresse : Cic. Cæl. 36 ; Suet. Aug. 69.
¶1. fixer en accord, convenir de : tempus et locum coeundi condicunt Just. 15, 2, 16, ils conviennent du jour et du lieu d'un rendez-vous, cf. Pl. Curc. 5 ; Gell. 16, 4, 4 ; quædam etiam si non condicantur Dig. 18, 1, 66, quand même on ne conviendrait pas de certains points
— convenir avec soi-même : cum hanc operam condicerem Plin. Præf. 6, comme je décidais ce travail
¶2. notifier : in diem tertium Gell. 10, 24, 9, assigner au troisième jour
— [en part.] s'annoncer, s'inviter à dîner chez qqn : (alicui ad cenam) Pl. Stich. 447 ; Men. 124 ; seni cenam condixit Suet. Tib. 42, 2, il prévint le vieillard qu'il irait dîner chez lui ; cum mihi condixisset Cic. Fam. 1, 9, 20, m'ayant annoncé qu'il dînerait chez moi
¶3. [droit] demander par condiction, réclamer en justice avec entente sur le jour : Dig. 12, 1, 11
— [avec gén.] alicujus rei alicui Liv. 1, 32, 11, à propos de qqch faire une réclamation à qqn avec entente sur la date d'exécution
¶4. s'accorder à dire : alicui Tert. Marc. 2, 2, avec qqn ; [av. prop. inf.] Tert. Anim. 8.
¶1. fixation d'un jour pour une affaire : P. Fest. 66, 4
— pour une fête religieuse : Serv. En. 3, 117
¶2. condiction, exercice de l'action personnelle [par opposition à l'action réelle] : Gai. Inst. 4, 18 ; Inst. Just. 4, 6, 15 ; etc.
¶1. [avec abl.] d'une manière tout à fait digne : condigne te Pl. Cas. 131, d'une manière digne de toi, cf. Apul. M. 11, 25
¶2. [abst] dignement, convenablement : Pl. Men. 906, etc. ; Gell. 1, 6, 4.
¶1. confire, mariner : oleas Cat. Agr. 117, confire des olives
— embaumer : condiunt Ægypti mortuos Cic. Tusc. 1, 108, les Égyptiens embaument les cadavres
¶2. assaisonner, accommoder, aromatiser : condire fungos Cic. Fam. 7, 6, 22, accommoder des champignons
¶3. [fig.] relever, assaisonner, rendre agréable : orationem Cic. Or. 185, relever le style ; comitate condita gravitas Cic. CM 10, gravité tempérée de bienveillance ; hilaritate tristitiam temporum Cic. Att. 12, 40, 3, adoucir par la gaîté le malheur des temps.
¶1. int., apprendre avec qqn : qui mihi Athenis condidicerunt Apul. Flor. 18, 42, mes condisciples d'Athènes
¶2. tr., apprendre à fond (de manière à posséder pleinement) : modos Hor. O. 4, 11, 34, apprendre des mélodies ; genera plausuum Suet. Ner. 20, 3, différentes manières d'applaudir ; merum condidicit bibere Pl. Curc. 161, elle a parfaitement appris à boire le vin pur, cf. Cic. Planc. 13 ; Quinct. 12
— [fig., en parl. des choses] Plin. 21, 24 ; Col. 3, 10, 6.
¶1. fondateur : oppidi Sall. J. 89, 4 ; templi Liv. 8, 10 ; urbis Liv. 10, 23, 12, fondateur d'une ville, d'un temple, d'une ville
— auteur de, créateur de, etc. : Romanæ libertatis Liv. 8, 34, 3, fondateur de la liberté romaine ; omnium Sen. Prov. 5, 8, le créateur de toutes choses ; legum Pl. Epid. 523, législateur ; tantis sim conditor actis Tib. 4, 1, 4, que je chante de si grands exploits ; Romani conditor anni Ov. F. 6, 21, chantre de l'année romaine (des Fastes)
— organisateur : Cic. Clu. 71 [avec jeu de mots sur les deux conditor], cf. Cic. Sen. 15 ; Liv. 1, 42, 4 ; 3, 58, 2 ; Plin. 10, 29, 1
¶2. celui qui conserve ;
a) dépositaire ; gardien des équipages d'une des factions du cirque : CIL 6, 10046, 6 ; 10072 ;
b) Conditor [opp. à Promitor], le dieu des greniers [qui préside à la mise en réserve des récoltes] : Serv. G. 1, 21.
¶1. fondation [d'une ville] : Apul. Apol. 25, 8
¶2. action de serrer, de cacher : Aus. Prof. 15, 17.
¶1. placer ensemble, établir en un tout ; [d'où] fonder, établir : urbem Cic. Cat. 3, 2, etc., fonder une ville ; post Romam conditam Cic. Tusc. 1, 3, après la fondation de Rome ; jam a condita urbe Cic. Phil. 3, 9, depuis la fondation de la ville
— civitates Cic. Rep. 1, 12, fonder des cités (des états) ; in ea republica, quam Romulus condidit Cic. Rep. 2, 51, dans la forme de gouvernement fondée par Romulus ; condere lustrum, v. lustrum ; Romanam gentem Virg. En. 1, 33, fonder la nation romaine ; aurea sæcula Virg. En. 6, 791, établir l'âge d'or
— rédiger, composer : nova jura Liv. 3, 33, 6, rédiger un nouveau code ; leges Liv. 3, 34, 1, rédiger des lois ; carmen Cic. Rep. 4, 12 (Tusc. 4, 4), composer une poésie ; Græcum poema condidit Cic. Att. 1, 16, 15, il a achevé un poème grec ; qui de moribus eorum memorias condiderunt Gell. 11, 18, 17, ceux qui ont assemblé (rédigé) des souvenirs historiques sur leurs mœurs ; præcepta medendi Plin. 26, 10, rédiger des préceptes de médecine
— décrire, chanter : Cæsaris acta Ov. Tr. 2, 336, chanter les actes de César ; tristia bella Virg. B. 6, 7, raconter les tristes guerres ; [abst] Homero condente Plin. 13, 38, au temps des poèmes d'Homère
¶2. mettre de côté, garder en sûreté, mettre en réserve : fructus Cic. Nat. 2, 156, serrer des fruits ; pecuniam Cic. Clu. 72, tenir caché de l'argent ; mustum in dolium Varr. R. 1, 65, 1 ; cineres in urnas Suet. Cal. 15, renfermer le moût dans un tonneau, les cendres dans des urnes ; aliquid proprio horreo Hor. O. 1, 1, 9, serrer qqch dans son propre grenier ; ex illa olea arcam esse factam eoque conditas sortes Cic. Div. 2, 86, [on dit] que de cet olivier fut fait un coffret et qu'on y renferma les sorts ; litteras publicas in ærario sanctiore conditas habere Cic. Verr. 4, 140, tenir les registres publics enfermés dans la partie la plus secrète des archives ; id domi nostræ conditum putabamus Cic. Verr. 2, 5, nous considérions que ces productions étaient serrées chez nous (Mur. 49)
— nec ex novis fructibus est unde tibi reddam quod accepi nec ex conditis Cic. Br. 16, je n'ai pas de quoi te rendre ce que j'ai reçu ni en prenant sur la récolte nouvelle ni en prenant sur celle qui est en réserve
— remettre au fourreau : condere gladium Sen. Ir. 1, 18, 4, rengainer son glaive (Ben. 5, 16, 5 ; Curt. 10, 9, 5 ; Tac. H. 4, 56, etc.)
— enfermer qqn : in carcerem Cic. Verr. 5, 76 ; Liv. 26, 16, 6 ; etc., en prison ; aliquem vivum in arcam Liv. 27, 37, 6, enfermer qqn vivant dans un coffre ; in vincula Liv. 23, 38, 7, jeter qqn dans les fers
— [fig., poét.] : in altitudinem conditus (Domitianus) Tac. H. 4, 86, (Domitien) profondément enfoui au fond de lui-même (avec une dissimulation profonde)
— ensevelir : in sepulcro conditus Cic. Leg. 2, 51, enfermé dans un tombeau ; sepulcro animam condere Virg. En. 3, 68, enfermer l'âme dans le tombeau (ossa terra Virg. En. 5, 48, les ossements dans la terre) ; siti dicuntur ii qui conditi sunt Cic. Leg. 2, 57, « déposés » ne peut se dire que de ceux qui sont ensevelis ; Persæ cera circumlitos (mortuos) condunt Cic. Tusc. 1, 108, les Perses ensevelissent les morts après les avoir enduits de cire
— [fig.] renfermer : omne bonum in visceribus Cic. Tusc. 5, 27, renfermer le souverain bien dans les entrailles, cf. Cat. 3, 26 ; Div. 1, 128 ; meo in pectore conditumst consilium Pl. Ps. 575, le conseil est enfermé dans mon cœur ; (signa) condita mente teneto Virg. En. 3, 388, (ces signes) tiens-les enfermés dans ton esprit
— [poét.] condita præcordia Hor. S. 1, 4, 89, cœurs fermés (qui ne s'ouvrent pas, qui ne laissent pas voir leurs sentiments)
¶3. éloigner des regards, cacher : turmas medio in saltu Liv. 27, 26, 8, cacher des escadrons au milieu des bois ; caput inter nubila Virg. En. 4, 177, cacher sa tête au milieu des nues ; se condere silvis Virg. B. 8, 97, sa cacher dans les forêts ; in tenebras se condere Sen. Marc. 22, 6, s'ensevelir dans les ténèbres
— sol se condit in undas Virg. G. 2, 438, le soleil se cache dans les ondes ; (sol) cum referet diem condetque relatum Virg. G. 1, 458, quand le soleil ramènera la lumière, puis, une fois ramenée, la cachera ; nubes condidit lunam Hor. O. 2, 16, 3, un nuage a caché la lune ; in mare conditur Ufens Virg. En. 7, 802, l'Ufens se perd dans la mer
— enfoncer une épée : alicui in pectore ensem Virg. En. 9, 348, enfoncer son épée dans la poitrine de qqn (in pectus Ov. M. 13, 392 ; pectore Ov. M. 13, 459)
— achever un certain laps de temps : longos cantando condere soles Virg. B. 9, 52, passer de longs jours à chanter ; condit quisque diem collibus in suis Hor. O. 4, 5, 28, chacun achève le jour sur ses coteaux ; longissimus dies cito conditur Plin. Ep. 9, 36, 4, la journée la plus longue est vite écoulée
— [fig.] iram condere Tac. An. 2, 28, cacher sa colère ; condito odio Tac. H. 2, 30, tenant leur haine cachée ; detegant nequiquam conditas insidias Liv. 10, 4, 10, qu'ils dévoilent leur embuscade dissimulée en vain
— [poét.] cacher un lieu à la vue = le perdre de vue, le laisser derrière soi : V.-Fl. 2, 443 ; 4, 636 ; 5, 106.
¶1. prendre mal, éprouver un malaise, une souffrance : si dens condoluit Cic. Tusc. 2, 52, s'il nous a pris une rage de dents ; de vento mihi caput condoluit Pl. Truc. 632, le vent m'a donné mal à la tête ; latus ei dicenti condoluit Cic. de Or. 3, 6, il fut saisi en parlant d'une douleur de côté ; (is) cujus latus alieno labore condoluit Sen. Ir. 2, 25, 1, celui à qui le travail d'autrui a fait éprouver une douleur de côté (a donné un point de côté)
— [moralement] Cic. Ac. 1, 38
¶2. souffrir avec [dat.] : animus corpori condolescit Tert. Anim. 5, l'âme souffre avec le corps.
¶1. donner sans réserve, faire donation, faire cadeau : hanc pateram tibi condono Pl. Amp. 536, je te fais présent de cette coupe ; ego illam non condonavi Pl. Men. 657, je ne t'en ai pas fait cadeau, cf. Cic. Verr. 3, 85 ; Agr. 2, 15 ; Phil. 2, 67
— [en part.] abandonner, livrer (à la merci); adjuger : vitam alicujus crudelitati alicujus Cic. Clu. 195, sacrifier la vie de qqn à la cruauté de qqn ; hereditatem alicui Cic. Verr. 1, 105, adjuger à qqn un héritage
¶2. immoler, sacrifier [par renonciation] ; faire l'abandon de : condonare se reipublicæ Sall. J. 79, 9, se sacrifier à l'État ; suum dolorem alicujus precibus Cæs. G. 1, 20, 5, faire l'abandon de son ressentiment aux prières de qqn
¶3. faire remise à qqn de qqch :
a) pecunias debitoribus Cic. Off. 2, 78, remettre des créances à ses débiteurs ;
b) crimen alicui Cic. Mil. 6, faire remise à un accusé de ce dont on l'accuse ; scelus alicui Sall. J. 27, 2, faire remise à qqn de son crime, le lui pardonner ;
c) alicui aliquid
— qqch en considération de qqn : Cæs. G. 1, 20, 6 ; supplicium alicujus alicui Vatinius Fam. 5, 10, 2, faire grâce du supplice à qqn pour l'amour de qqn ;
d) alicui aliquem Cic. Fam. 13, 75, 2, faire grâce à qqn en faveur de qqn, cf. Planc. 75 ; Clu. 109
¶4. [arch. avec deux acc.] aliquem aliquam rem, gratifier qqn par rapport à qqch, de qqch : alia multa quæ nunc condonabitur Ter. Eun. 17, bien d'autres choses dont il sera gratifié pour le moment = dont on lui fera grâce ; si quam (rem) debes, te condono ; tibi habe, numquam abs te petam Pl. Bac. 1143, si tu me dois qqch, je t'en gratifie ; garde-le, jamais je ne te le réclamerai ; cf. Rud. 1354 ; Pers. 813 ; Ter. Phorm. 947 ; Afran. Com. 173.
¶1. qui rassemble : C.-Aur. Chron. 2, 13, 164
¶2. utile : Pl. Epid. 260 ; Trin. 36
— conducibilius Her. 2, 21.
I. tr.,
¶1. conduire ensemble (en masse, en bloc), rassembler : omnes clientes obæratosque suos eodem conduxit Cæs. G. 1, 4, 2, il rassembla au même endroit tous ses clients et débiteurs insolvables ; nuntiaverunt exercitum in unum locum conduci Cæs. G. 2, 2, 4, ils annoncèrent qu'on concentrait l'armée sur un même point
— vineas Cic. Phil. 8, 17, faire avancer les baraques de siège ; Peneus nubila conducit Ov. M. 1, 572, le Pénée forme des nuages (amoncelle des nuages)
— réunir en rapprochant : partes in unum Lucr. 1, 397, etc., rassembler ses éléments en un même point (les concentrer) ; cortice ramos Ov. M. 4, 375, réunir deux rameaux sous la même écorce ; vulnera cera V.-Fl. 1, 479, fermer les blessures d'un navire avec de la cire ; [fig.] propositionem et assumptionem in unum Cic. Inv. 1, 73, réunir la majeure et la mineure d'un syllogisme
— resserrer, contracter : ignis coria conducit in unum Lucr. 6, 967, le feu contracte le cuir ; interiores nervi conducunt membra Plin. 11, 218, les nerfs intérieurs resserrent les membres ; conduci Col. 7, 8, 1, se coaguler [lait]
¶2. prendre à bail (à louage, à solde), louer : domum Cic. Cæl. 18, louer une maison ; conductum de Cæsennia fundum habere Cic. Cæc. 94, avoir une terre louée de Césennia ; conduxi domum a te Sen. Ben. 7, 5, 2, je t'ai loué une maison
— conductis nummis Hor. S. 1, 2, 9, avec des écus pris à bail (empruntés); conducta pecunia Juv. 11, 46, argent emprunté
— pictorem magno pretio Cic. Inv. 2, 1, engager un peintre à grands frais ; homines Cæs. G. 2, 1, 4, prendre des hommes à solde, les soudoyer, cf. G. 5, 27, 8 ; 7, 31, 5 ; qui conducebantur, ut aliquem occiderent Cic. Amer. 93, ceux qui étaient embauchés pour tuer qqn ; coctum ego huc, non vapulatum conductus fui Pl. Aul. 457, j'ai été engagé pour faire la cuisine, non pour recevoir des coups
— d'où conducti, ōrum, m., gens à gages (Hor. P. 431), mercenaires (Nep. Dat. 8, 2) ; [poét.] : bella conducta Sil. 5, 196, guerres de mercenaires
¶3. [opposé à locare] se charger d'une construction (d'une entreprise) contre rémunération, prendre à ferme, prendre en adjudication : qui columnam illam de Cotta conduxerat faciendam Cic. Div. 2, 47, celui qui avait fait marché avec Cotta pour construire cette colonne ; conducere præbenda quæ ad exercitum opus sunt Liv. 23, 48, 11, prendre en adjudication la fourniture des choses nécessaires à l'armée ; Asiam de censoribus Cic. Att. 1, 17, 9, faire marché avec les censeurs pour la ferme des revenus d'Asie.
II. int., contribuer utilement à qqch, être utile, être avantageux : ea maxime conducunt quæ sunt rectissima Cic. Fam. 5, 19, 2, le plus utile, c'est le plus juste ; conducere arbitror talibus aures tuas vocibus circumsonare Cic. Off. 3, 5, il est avantageux, je pense, que ces propos retentissent sans cesse à tes oreilles ; nemini injuste facta conducunt Cic. Fin. 1, 52, les actes injustes ne sont avantageux pour personne ; hoc maxime rei publicæ conducit, Syriam Macedoniamque decerni Cic. Prov. 1, c'est au plus haut point l'intérêt de l'État que l'on décrète l'attribution des provinces de Syrie et de Macédoine ; ad rem conducere Cic. Off. 1, 9 ; in rem Pl. Cist. 634 ; Tac. An. 2, 38, être utile pour qqch.
===> inf. pass. conducier Pl. Merc. 663.
¶1. [rhét.] réunion d'arguments, récapitulation : Cic. Inv. 1, 74
¶2. [médec.] contraction, convulsion : nervorum (σπασμός) C. Aur. Acut. 3, 18, 177, spasme
¶3. location, fermage, bail : Cic. Cæc. 94.
¶1. locataire, fermier : Pl. Trin. 856 ; conductores agrorum idonei Plin. Ep. 7, 30, 3, fermiers qui conviennent ; conductores (histrionum) Pl. Asin. 3, ceux qui engagent les histrions = les édiles
¶2. entrepreneur : conductor operis Cic. Q. 3, 1, 5, adjudicataire d'un travail.
¶1. doublement, [plaist] = embrassade : Pl. Pœn. 1297
¶2. [rhét.] répétition d'un mot : Her. 4, 38.
¶1. jointure, articulation des doigts de la main : Capel. 1, 88
¶2. nœud de roseau, [d'où] flûte : Mart. 5, 78, 30.
¶1. attacher (lier) ensemble [pr. et fig.] : palliolum conexum in umero lævo Pl. Mil. 1180, un petit manteau attaché sur l'épaule gauche ; conexi crines Prop. 2, 5, 23, cheveux attachés ensemble ; naves validis utrimque trabibus conexæ Tac. H. 2, 34, bateaux reliés entre eux des deux côtés par de solides poutres ; verba, quæ quasi articuli conectunt membra orationis Cic. de Or. 2, 359, des mots qui, comme des espèces d'articulations, lient entre eux les membres du discours ; dissipata conectere Cic. Or. 235, ajuster ensemble des fragments épars ; videre tam omnia inter se conexa et apta Cic. Nat. 2, 97, voir toutes les choses si bien liées et ajustées entre elles ; amicitia cum voluptate conectitur Cic. Fin. 1, 67, l'amitié est unie au plaisir ; conexum sit principium consequenti orationi Cic. de Or. 2, 325, que l'exorde soit lié à la suite du discours ; persequere conexos his funeribus dies Cic. *Pis. 11, passe en revue les jours qui ont suivi ces funérailles ; conectebantur, ut conscii ejus, Cn. Domitius, Vibius Marsus... Tac. An. 6, 47, on adjoignait, comme ses complices, Cn. Domitius, Vibius Marsus ; discrimini patris filiam conectebat Tac. An. 16, 30, il associait la fille au danger de son père
— conectere verba Hor. Ep. 2, 2, 86, lier des mots entre eux, faire des vers ; sermonem Quint. 10, 3, 20, faire un discours qui se tient
— [ce qui est en connexion logique] : si quid ita conexum est Cic. Ac. 2, 143, si des propositions sont liées logiquement de la manière suivante ; quod ipsum ex se conexum est Cic. Ac. 2, 98, ce qui est lié de soi-même logiquement [l'antécédent et le conséquent étant identiques ; ex., s'il fait jour, il fait jour]
¶2. former par liaison : illud ex pluribus continuatis (verbis) conectitur Cic. de Or. 3, 166, cette autre figure [l'allégorie] découle d'une suite de mots qui se tiennent (Div. 2, 111 ; Gell. 1, 25, 16) ; conectere amicitias Plin. Ep. 4, 15, 2, former des amitiés solides ; alvus sine vinculo ferri conexa Tac. H. 3, 47, coque de bateau faite d'un assemblage sans attache de fer.
¶1. int., converser, s'entretenir : Pl. Merc. 188 ; 571 ; Ter. Hec. 182
¶2. tr., rem magnam confabulari tecum volo Pl. Cist. 743, je veux t'entretenir d'une question importante.
¶1. marier par confarréation : Serv. En. 4, 374 ; confarreati parentes Tac. A. 4, 16, parents mariés par confarréation
¶2. célébrer un mariage par confarréation : Apul. M. 10, 29.
¶1. action de faire entièrement, confection ; achèvement, terminaison : confectio libri Cic. CM 2, composition d'un ouvrage ; annalium Cic. de Or. 2, 52, rédaction d'annales ; memoriæ Cic. Part. 26, la formation de la mémoire, l'art de former la mémoire ; medicamenti Cels. 4, 14, préparation d'un médicament ; hujus belli Cic. Phil. 14, 1, achèvement de cette guerre
— chose préparée, préparation [médec.] : Pall. 11, 17, 2
¶2. action d'effectuer, de réaliser : confectio tributi Cic. Flacc. 20, recouvrement de l'impôt
¶3. action de réduire : confectio escarum Cic. Nat. 2, 134, la réduction des aliments (dans la mastication)
— [fig.] confectio valetudinis Cic. frg. F. 5, 82, affaiblissement de la santé.
¶1. celui qui fait jusqu'au bout, qui achève : confector coriorum Firm. Math. 3, 9, 7, corroyeur ; negotiorum Cic. Verr. 2, 108, homme d'affaires, fondé de pouvoir ; belli Cic. Fam. 10, 20, 3, celui qui met fin à la guerre
¶2. destructeur : confectores cardinum Lucil. 773 enfonceurs de portes ; confector omnium ignis Cic. Nat. 2, 41, le feu qui détruit tout ; confectores ferarum Suet. Aug. 43, 2, bestiaires.
¶1. apporter ensemble, apporter de tous côtés, amasser, réunir : urbis ornamenta domum suam Cic. Verr. 4, 121, amasser chez lui les ornements de la ville ; frumentum conferri, comportari dicere Cæs. G. 1, 16, 4, ils disaient qu'on réunissait le blé, qu'on en faisait le transport ; arma conferre Cæs. G. 1, 27, 4, etc., apporter en un même point (livrer) les armes ; jubet sarcinas conferri Cæs. G. 7, 18, 4 (ou in unum locum conferri G. 1, 24, 3), il ordonne de réunir [en un seul endroit] les bagages ; collatis militaribus signis Cæs. G. 7, 2, 2, les étendards étant réunis
— in unum conferre vires suas Liv. 3, 8, 11, rallier ses troupes, les concentrer (29, 39, 3 ; 32, 30, 2, etc.)
— in pauca conferre Cic. Cæc. 17 ; Off. 3, 118, résumer en peu de mots
¶2. apporter comme contribution : in commune aliquid Cic. Quinct. 12, verser une somme à la communauté [= à l'actif de l'association] ; ad honores alicujus pecunias Cic. Verr. 2, 152 ; in statuas Cic. Verr. 2, 145, contribuer de son argent à rendre des honneurs à qqn, à lui élever des statues ; tributum conferre in rem Liv. 40, 60, 5, payer une taxe (un impôt) comme contribution pour qqch (Cic. Off. 2, 74) ; auctor conferendi Liv. 29, 16, 2, qui prend l'initiative de proposer une contribution volontaire
— [fig.] : pater Tiberi plurimum ad victoriam contulit Suet. Tib. 4, 1, le père de Tibère contribua beaucoup à la victoire ; aliquid iram ad magnitudinem animi conferre Sen. Ir. 1, 20, 1, [croire] que la colère contribue à la grandeur d'âme
— d'où conferre = être utile (cf. συμφέρει) : multum veteres etiam Latini conferunt Quint. 1, 8, 8, même les anciens écrivains latins sont d'un grand profit (2, 5, 16 ; 4, 2, 123, etc.)
¶3. rapprocher, placer tout près : capita Cic. Verr. 3, 31 ; Liv. 2, 45, 7, rapprocher les têtes pour conférer, s'entretenir à l'écart, tenir une conférence
— [idée d'hostilité] : castra castris conlata Cic. Div. 2, 114, camp rapproché du camp ennemi (deux armées en présence) ; castris Scipionis castra conlata habere Cæs. C. 3, 79, 3, camper à proximité de Scipion (le serrer de près), cf. Hirt. 8, 9, 2 ; Liv. 8, 23, 9, etc. ; exercitus cum quo castra conlata habuerit Liv. 27, 47, 6, l'armée à côté de laquelle il avait campé (26, 12, 14)
— surtout arma, manum, gradum, pedem, signa conferre = en venir aux mains, engager le combat : arma cum hominibus necessariis Cæs. C. 1, 74, 2, se battre contre des amis ; manum cum hoste Liv. 9, 5, 10 (Cic. Font. 12 ; Dom. 53), en venir aux mains avec l'ennemi ; gradum cum aliquo Liv. 7, 33, 11, se rencontrer avec qqn, l'avoir pour adversaire ; conlato gradu Tac. H. 2, 42, dans un corps à corps ; pedem conferre Cic. Planc. 48, se mesurer de près avec qqn ; collatum pedem non ferre Liv. 6, 13, 2, ne pas soutenir une lutte corps à corps ; pes cum pede collatus Liv. 28, 2, 6, se battant pied contre pied ; signa conferre Cic. Mur. 20, faire s'affronter les enseignes, en venir aux prises ; signis collatis Cic. Pomp. 66, etc., en bataille rangée (Liv. 29, 18, 10, etc.) ; signa conferre cum Alexandrinis Cic. Pis. 49 (Liv. 1, 33, 4, etc.), livrer bataille aux Alexandrins ; vires conferre Liv. 21, 50, 1, en venir aux prises (4, 27, 5 ; 42, 47, 8) ; se viro vir contulit Virg. En. 10, 734, il l'affronta dans un combat d'homme à homme ; [abst] : mecum confer Ov. M. 10, 603, mesure-toi avec moi
¶4. mettre en commun des propos, échanger des propos : conferunt sermones inter sese Pl. Curc. 290, ils échangent des propos entre eux ; sermonem cum aliquo Cic. Inv. 2, 14 ; Off. 1, 136, etc. (sermones Cic. Off. 2, 39 ; Phil. 2, 38), s'entretenir avec qqn ; inter nos conferre sollicitudines nostras Cic. Fam. 6, 21, 2, nous communiquer nos inquiétudes ; coram conferre quæ volumus licebit Cic. Att. 2, 25, 2, nous pourrons échanger de vive voix les idées que nous voulons ; id coram inter nos conferemus Cic. Att. 1, 20, 1, nous en parlerons ensemble ; inter se conferre injurias Tac. Agr. 15, se faire part des injustices subies ; [abst] : nisi contulerimus inter nos quid sit ipsum bonum Cic. Fin. 2, 4, sans avoir examiné en commun ce que nous entendons par le bien lui-même (4, 74 ; Div. 2, 28)
¶5. mettre ensemble pour comparer, rapprocher, mettre en parallèle : conferte Verrem, non ut hominem cum homine comparetis Cic. Verr. 4, 121, mettez Verrès à côté, non pour faire une comparaison des deux personnages ; vitam inter se utriusque conferte Cic. Com. 20, mettez la vie de l'un et de l'autre en parallèle ; pacem cum bello Cic. Verr. 4, 121, rapprocher l'état de paix de l'état de guerre ; cum Lycurgo et Solone nostras leges Cic. de Or. 1, 197 (= cum legibus Lycurgi), comparer nos lois à celles de Lycurgue et de Solon ; aliquem cum aliquo aliqua re Cic. Br. 272, comparer qqn à qqn sous le rapport de qqch
— [avec dat.] : parva magnis Cic. Br. 213, comparer de petites choses aux grandes (Or. 14 ; Rep. 3, 34, etc.) ; ne minima quidem ex parte Lycurgi legibus et disciplinæ conferendi sunt (Pausanias et Lysander) Cic. Off. 1, 76 (= eorum res gestæ), leurs exploits ne peuvent en aucune façon être mis en parallèle avec les lois et la discipline établies par Lycurgue
— bos ad bovem collatus Varr. L. 9, 28, un bœuf comparé à un bœuf (10, 37 ; 10, 45, etc.)
— collationner : Cic. Verr. 2, 190
¶6. porter en un point, transporter : suas rationes et copias in illam provinciam contulerunt Cic. Pomp. 17, ils [les publicains] ont porté dans cette province leurs spéculations et leurs fonds ; nihil umquam domum suam contulit Nep. Ag. 7, 3, il ne transporta jamais rien [aucun cadeau] chez lui ; iter Brundisium versus contuli Cic. Att. 3, 4, j'ai dirigé ma route sur Brindes
— se conferre,
a) se transporter, se réfugier : se suaque omnia in oppidum contulerunt Cæs. G. 2, 13, 2, ils se transportèrent, eux et tous leurs biens, dans la ville ; cum se Rhodum contulisset Cic. de Or. 3, 213, s'étant réfugié à Rhodes ; se ad inimicos tuos contulit Cic. Verr. 1, 77, il s'est joint à tes ennemis ;
b) se porter (se tourner) vers une chose, se consacrer à : ad historiam Cic. de Or. 2, 57 ; ad poetas, ad geometras, ad musicos Cic. de Or. 3, 58, se consacrer à l'histoire, à la poésie, à la géométrie, à la musique ; ad amicitiam alicujus Cic. Br. 281, rechercher l'amitié de qqn ; ad salutem rei publicæ defendendam Cic. Fam. 11, 7, 2, se porter au secours de l'État ; in salutem rei publicæ Cic. Phil. 12, 7, se dévouer au salut de l'État
¶7. porter (reporter) à une date déterminée : aliquid in longiorem diem Cæs. G. 1, 40, 14, reporter qqch à une date plus éloignée ; cædem optimatium in ante diem quintum Kalendas Novembres Cic. Cat. 1, 7, fixer au cinquième jour avant les Kalendes de novembre le massacre des citoyens les meilleurs
— supplicia ad tuum, non ad rei publicæ tempus conferes Cic. Verr. 5, 77, ces châtiments, tu les différeras jusqu'au moment opportun pour toi, non pour l'État
¶8. porter (faire passer) dans un ouvrage : dierum quinque scholas in totidem libros contuli Cic. Tusc. 1, 8, les conférences ayant duré cinq jours, je les ai rédigées en autant de livres (Fam. 6, 18, 3 ; Att. 13, 13, 1)
¶9. conférer ;
a) [officiellt] confier (des honneurs) à qqn : in aliquem honores maximos Cic. Phil. 13, 9, conférer à qqn les plus grands honneurs (Rep. 3, 27) ; curam restituendi Capitoli in Lucium Vestinum confert Tac. H. 4, 53, il confie à Lucius Vestinus la charge de rebâtir le Capitole (H. 1, 1 ; An. 3, 71, etc.) ;
b) soumettre au jugement de qqn : ad arbitrium alicujus aliquid Cic. Fam. 1, 9, 23
¶10. consacrer, employer, appliquer à : prædam in monumenta deorum immortalium Cic. Agr. 2, 61, consacrer le butin à des monuments aux dieux immortels ; aliquid in rem publicam conservandam Cic. Pomp. 49, consacrer qqch au salut de l'État ; quicquid habuit virium, id in eorum libertatem defendendam contulit Cic. Phil. 10, 16, tout ce qu'il avait de forces, il l'employa à défendre leur liberté ; omnia mea studia in istum unum confero Cic. Q. 2, 13, 2, je concentre sur lui toutes les marques de mon dévouement ; omne reliquum tempus non ad oblivionem veteris belli, sed ad comparationem novi contulit Cic. Pomp. 9, il employa tout le reste du temps non pas à oublier l'ancienne guerre, mais à en préparer une nouvelle ; ad hominum utilitatem suam prudentiam conferunt Cic. Off. 1, 156, ils font servir leur sagesse (clairvoyance) à l'intérêt de leurs semblables ; ad philosophiam suam operam conferre Cic. Fam. 4, 3, 4, donner tous ses soins à la philosophie ; ad populi Romani gloriam celebrandam omne ingenium conferre Cic. Arch. 19, consacrer tout son talent à répandre la gloire du peuple romain
¶11. faire porter sur, imputer à : in aliquem culpam Cic. Or. 137, rejeter la faute sur qqn ; crimina in aliquem Cic. Cæl. 30, faire porter des accusations sur qqn ; (rei) causam in aliquem Cic. Verr. 1, 83 ; in tempus Cic. de Or. 3, 228, faire retomber la responsabilité (de qqch) sur qqn, sur le temps (le manque de temps) ; permulta in Plancium, quæ ab eo numquam dicta sunt, conferuntur Cic. Planc. 35, on impute à Plancius un très grand nombre de propos qu'il n'a jamais tenus (Mil. 70 ; de Or. 2, 182 ; Sest. 40 ; Q. 1, 3, 8 ; Fam. 5, 5, 2)
— qui suum timorem in rei frumentariæ simulationem angustiasque itineris conferrent Cæs. G. 1, 40, 10, ceux qui mettaient leur frayeur sous le couvert d'une prétendue difficulté d'approvisionnement..., ceux qui pour cacher leur frayeur mettaient en avant les prétendues difficultés de l'approvisionnement et même les difficultés de la route
¶12. faire porter (placer) sur qqn des bienfaits, des faveurs, etc. : hæc beneficia tum in rem publicam, tum in singulos cives conferuntur Cic. Off. 2, 65, ces bienfaits se dispensent tantôt à l'ensemble de l'État, tantôt à des citoyens individuellement ; mores ejus in quem beneficium conferetur Cic. Off. 1, 45, les mœurs de celui qui sera l'objet du bienfait ; beneficia, quæ in me contulistis Cic. Mil. 100, les faveurs que vous m'avez prodiguées ; officia meminisse debet is in quem conlata sunt, non commemorare qui contulit Cic. Læ. 71, c'est le devoir pour celui à qui on a rendu des services de s'en souvenir, pour celui qui les a rendus de ne pas les rappeler.
¶1. entassé, serré : conferta moles Tac. An. 4, 62, édifice abst plein, bondé ; conferti milites Cæs. G. 2, 25, 1, soldats en rangs serrés ; conferta legio Cæs. G. 4, 32, 3, légion en formation compacte ; confertissima acie Cæs. G. 1, 24, 5, en formation de combat très serrée
¶2. plein, absolument plein : liber confertus voluptatibus Cic. Tusc. 3, 44, ouvrage rempli de maximes voluptueuses ; confertus cibo Cic. Cat. 2, 10, gorgé de nourriture
— confertior Liv. 9, 27, 9.
¶1. conferve [plante aquatique] : Plin. 27, 69
¶2. grande consoude [plante] : Apul. Herb. 59.
¶1. bouillir ensemble : Pall. 1, 36, 13
¶2. se consolider [médec.] : tempus quo quodque os confervet Cels. 8, 10, 1, temps nécessaire à la consolidation des os.
¶1. s'échauffer en totalité : Vitr. 5, 3 ; [fig.] s'enflammer : mea cum conferbuit ira Hor. S. 1, 2, 71, quand la colère s'est allumée en moi
¶2. commencer à fermenter, entrer en fermentation : Col. 12, 23
¶3. commencer à germer : Plin. 18, 302.
¶1. aveu, confession : alicujus rei Cic. Div. 1, 33, etc., aveu de qqch ; alicujus Cic. Verr. 5, 103, l'aveu de qqn ; urgetur confessione sua Cic. Verr. 4, 104, il est accablé par son propre aveu ; confessio de aliqua re Cæl. Fam. 8, 8, 2 ; Plin. 9, 18, aveu au sujet de qqch
— [fig. de rhét.] : Quint. 9, 2, 17 ; 12, 1, 33
¶2. action de convenir de, reconnaissance : ea erat confessio, caput rerum Romam esse Liv. 1, 45, 3, c'était reconnaître que Rome était la capitale (2, 7, 7 ; 42, 47, 8) ; confessionem cedentis ac detrectantis certamen pro victoria habui Liv. 21, 40, 2, j'ai considéré comme une victoire l'aveu qu'il faisait en se retirant et en refusant le combat.
¶1. qui avoue [sa faute, sa culpabilité] : de confessis sicuti de manufestis supplicium sumere Sall. C. 52, 36, châtier ceux qui ont avoué comme s'ils avaient été pris en flagrant délit ; a nobis ut a confessis res repetuntur Liv. 21, 18, 5, on nous demande satisfaction comme à des gens qui ont avoué
¶2. [sens passif] avoué : æs confessum xii Tab. d. Gell. 15, 13, 11 ; 20, 1, 45, dette reconnue ; ut omnes intellegant quam improbam, quam manifestam, quam confessam rem pecunia redimere conentur Cic. Verr. 3, 130, pour faire comprendre à tous quel crime infâme, manifeste, avoué, on veut racheter à prix d'argent
— n. pris subst : in confessum venire Plin. Ep. 10, 81, 7, venir [à l'état de chose manifeste] à la connaissance de tous ; in confesso esse Sen. Ben. 3, 11, 2, être incontesté (5, 17, 5 ; Nat. 2, 21, 1, etc.) ; dum modo in confesso sit eminentiorem illorum temporum eloquentiam fuisse Tac. D. 25, pourvu qu'on reconnaisse que l'éloquence d'autrefois était supérieure ; ex confesso Sen. Ep. 76, 12, etc., manifestement, incontestablement
— pl. n. confessa, choses évidentes, incontestables : Sen. Nat. 2, 21, 1 ; Plin. 2, 55 ; 30, 97, etc.; Quint. 5, 10, 95 ; 5, 14, 14, etc.
¶1. faire intégralement, faire : anulum, pallium, soccos se sua manu confecisse Cic. de Or. 3, 127, [il disait] qu'il avait fait de sa main l'anneau, le manteau, les chaussures qu'il portait ; tabulæ litteris Græcis confectæ Cæs. G. 1, 29, registres rédigés avec l'alphabet grec ; tabulas Cic. Verr. 1, 60, tenir les livres de comptes ; orationes Nep. Cat. 3, 3, faire des discours ; sacra per mulieres confici solent Cic. Verr. 4, 99, les sacrifices sont célébrés par les femmes ; facinus Cic. Amer. 76, perpétrer un crime ; in ipsa oratione quasi quendam numerum versumque conficiunt Cic. de Or. 3, 53, dans la prose même ils parfont comme une sorte de rythme et de vers
— achever : duobus bellis confectis Cæs. G. 1, 54, 2, deux guerres étant achevées ; prœlio confecto Cæs. C. 3, 91, 2, le combat achevé ; confecta frumentatione Cæs. G. 6, 39, 1, les approvisionnements de blé étant terminés ; confecta victoria Cic. Phil. 14, 1, victoire consommée ; confectorum ludorum nuntii Cic. Att. 16, 4, 4, nouvelles de l'achèvement des jeux ; annuum munus Cic. Fam. 2, 12, 1 ; jurisdictionem Cic. Fam. 2, 13, 3, achever son année de charge (de gouvernement), l'exercice de ses fonctions [de proconsul]; negotium Cic. Att. 7, 5, 5, mener une affaire à bonne fin ; hoc negotio confecto Cæs. G. 7, 62, 10, cette affaire (entreprise) étant terminée ; provincia confecta Liv. 26, 21, 2, ayant achevé sa mission [la guerre dont il avait été chargé], cf. Cic. Pomp. 28
— [abst] : conficere cum aliquo (de aliqua re), terminer avec qqn [au sujet de qqch], régler avec qqn (une affaire) : Cic. Fam. 7, 2, 1 ; Att. 12, 19, 1, etc.
— cursus annuos Cic. Nat. 1, 87, achever ses révolutions annuelles ; eadem spatia Cic. de Or. 3, 178, parcourir le même espace ; viam Cic. CM 6, parcourir une route ; iter reliquum Cic. de Or. 2, 290, effectuer le reste du trajet ; prope centum confecit annos Cic. Or. 176, il a presque achevé les cent ans, = vécu cent ans (Tusc. 1, 92) ; cursum vitæ Cic. Tusc. 3, 2, achever le cours de son existence
— jam prope hieme confecta Cæs. G. 7, 32, 2, l'hiver étant déjà presque à sa fin ; biennio confecto Cic. Quinct. 40, un espace de deux ans s'étant écoulé ; ante primam confectam vigiliam Cæs. G. 7, 3, 3, avant l'achèvement de la première veille ; confecto annorum numero Tac. An. 6, 28, le nombre d'années étant révolu
¶2. venir à bout de, réaliser, constituer : potestas innumerabilis pecuniæ conficiendæ Cic. Agr. 2, 33, la faculté de réaliser des sommes immenses (faire de l'argent infiniment) ; permagnam ex illa re pecuniam confici posse Cic. Verr. 1, 138, on pouvait retirer de cette affaire beaucoup d'argent ; filiæ dotem Cic. Quinct. 98, constituer une dot à sa fille ; bibliothecam Cic. Att. 1, 7, composer (constituer) une bibliothèque ; frumentum Liv. 43, 6, 2, réunir (constituer) une quantité de blé déterminée ; hortos alicui Cic. Att. 12, 37, 2, procurer à qqn des jardins ; exercitum Cic. Pomp. 61, mettre sur pied (constituer) une armée ; armata milia centum Cæs. G. 2, 4, 5, mettre sur pied (réunir) cent mille hommes armés (C. 1, 24, 2 ; 1, 25, 1, etc.) ; exercitum invictum ex paternis militibus Cic. Phil. 4, 3, former une armée invincible des soldats de son père
— conficere necessariis suis suam tribum Cic. Planc. 45, procurer les voix de leur tribu à leurs amis ; ut is nobis eas centurias conficiat Cic. Fam. 11, 15, 2, pour qu'il me procure les suffrages de ces centuries
— effectuer : illa tria justitia conficit et benevolentiam et fidem et admirationem Cic. Off. 2, 38, ces trois conditions [de la gloire] sont réalisées par la justice, savoir la bienveillance, la confiance, l'admiration ; ad motus animorum conficiendos Cic. de Or. 2, 324, pour provoquer des émotions ; suavitas vocis bene loquendi famam confecerat Cic. Br. 259, le charme de sa voix lui avait ménagé le renom de bien parler ; animum auditoris misericordem conficere Cic. Inv. 1, 106, rendre pitoyable le cœur de l'auditeur ; auditorem benevolum Cic. Inv. 1, 20, rendre l'auditeur bienveillant
— [abst] produire un effet, être efficient : Cic. Part. 93, v. conficiens
— [surtout au pass.] effectuer par le raisonnement, montrer par le raisonnement, tirer une conclusion : Socrates ex eo, quod sibi ille dederat quicum disputabat, aliquid conficere malebat Cic. Inv. 1, 53, Socrate préférait tirer des conclusions de ce que lui avait concédé son interlocuteur ; tantum conficietur ex testimoniis civitatum Cic. Verr. 2, 141, tel est le total qui se dégagera des témoignages des cités ; ex quo conficitur ut Cic. Inv. 2, 145, d'où il s'ensuit que ; ex eo hoc conficitur... esse Cic. Inv. 1, 63, d'où cette conclusion qu'il y a...
¶3. réduire, élaborer, façonner : conficere ligna ad fornacem Cat. Agr. 16, réduire le bois [le fendre] pour le fourneau ; frumenta molere et conficere Plin. 7, 191, [Cérès enseigna] à moudre et à élaborer le grain ; (dentes escas) conficiunt Cic. Nat. 2, 134, il y a des dents qui broient les aliments (cibum Liv. 2, 32, 10)
— absorber, engloutir : ibes maximam vim serpentium conficiunt Cic. Nat. 1, 101, les ibis absorbent une grande quantité de serpents [v. la suite : volucres angues consumunt] ; cf. 2, 125 ; Fam. 9, 18, 3
— élaborer : confectus coctusque cibus Cic. Nat. 2, 137, l'aliment élaboré et digéré (Tim. 18)
— [fig.] réduire, consommer : patrimonium Cic. Flacc. 90, dissiper son patrimoine ; nihil est manu factum quod non conficiat et consumat vetustas Cic. Marc. 11, il n'y a pas de travail humain que l'âge ne détruise et consume
¶4. venir à bout de qqn, le faire périr : hæc sica me pæne confecit Cic. Mil. 37, ce poignard a failli me tuer (me donner le coup de la mort) ; alterum Curiatium conficit Liv. 1, 25, 10, il tue le second Curiace ; ut mortui ægros, ægri validos tabe ac pestifero odore corporum confecerent Liv. 25, 26, 10, au point que les morts faisaient périr les malades, les malades les bien portants par suite de la putréfaction et de l'odeur pestilentielle des corps
— venir à bout de, réduire, subjuguer : confecta Britannia Cic. Att. 4, 18, 5, la Bretagne étant réduite (provincia Liv. 28, 24, 7 ; 40, 35, 13)
¶5. affaiblir, accabler, épuiser [physiqt et moralt] : meus me mæror cotidianus lacerat et conficit Cic. Att. 3, 8, 2, mon chagrin journellement me déchire et m'accable (11, 4, 2 ; 11, 15, 3 ; Tusc. 3, 27) ; luctus mærore se conficientis Cic. Tusc. 3, 26, lamentations d'un homme qui se ronge de chagrin
— [souvent au pass.] : confici angore Cic. Fin. 1, 60 ; curis Cic. Fam. 4, 13, 2, être accablé par l'angoisse, par les soucis ; lassitudine Cæs. C. 3, 92, 3, être épuisé par la fatigue ; cum corporis morbo, tum animi dolore confectus Cic. Mur. 85, épuisé à la fois par la maladie et par la douleur ; plagis Cic. Verr. 5, 140 ; vulneribus Cic. Tusc. 2, 41, épuisé par les coups, par les blessures
— nemo filium nisi lacrimantem confectumque vidit Cic. Dom. 59, personne n'a vu mon fils autrement qu'en pleurs et abattu de chagrin ; gladiatori illi confecto et saucio Cic. Cat. 2, 24, à ce spadassin affaibli et blessé.
===> v. à confio, les autres formes passives.
¶1. part. de confido
¶2. pris adjt
a) hardi, résolu : decet innocentem servum confidentem esse Pl. Capt. 666, un esclave qui n'a rien à se reprocher doit avoir de l'assurance ;
b) audacieux, insolent, outrecuidant : Ter. Phorm. 123, cf. Cic. Tusc. 3, 14
— -tior Pl. Amp. 153 ; -tissimus Virg. G. 4, 445.
¶1. hardiment, résolument, sans crainte : Pl. Amp. 339 ; -tius Cic. Cæl. 44
¶2. audacieusement, effrontément : Ter. Haut. 1008
— -tissime Her. 2, 8.
¶1. confiance, ferme espérance : Pl. Most. 350 ; Cæl. Fam. 8, 8, 9
— confidentia est avec prop. inf. = confido Pl. Mil. 239 ; Ps. 763
¶2. assurance, confiance en soi : confidentiam et vocem defuisse Cic. Rep. 3, 43 ; il lui manqua l'assurance et la voix
¶3. audace, effronterie, outrecuidance : videte qua confidentia dicant Cic. Fl. 10, voyez sur quel ton effronté ils parlent ; cf. Phil. 2, 104 ; Pl. Mil. 189, etc.
¶1. clouer ensemble : Cat. Agr. 21, 3 ; Cæs. G. 3, 13
¶2. enclouer, mettre des clous dans : Col. 7, 3, 5
¶3. percer : configere fures sagittis Pl. Aul. 395, percer de flèches les voleurs ; cornicum oculos configere Cic. Mur. 25, crever les yeux aux corneilles [prov.] ; confixi ceciderunt Nep. Dat. 9, 5, ils tombèrent percés de coups
— [fig.] confixus senatus consultis Cic. Har. 8, accablé par des sénatus-consultes.
===> part. arch. confictus Scaurus d. Diom. 377, 12.
¶1. partie qui avoisine, voisinage : Luc. 6, 649 ; V. Fl. 6, 374
¶2. = homœoteleuton : Carm. Fig. 100, p. 67.
¶1. façonner, fabriquer : nidos Plin. 10, 91, bâtir des nids ; verbum Varr. L. 5, 7, créer un mot
¶2. forger de toutes pièces, imaginer, feindre : dolum inter se Pl. Capt. 35, concerter une ruse ; aliquid criminis Cic. Verr. 2, 90, forger un délit ; id vos a viro optimo cogitatum esse confingitis Cic. Dej. 16, vous prêtez pareille idée au plus honnête des hommes.
¶1. qui confine, contigu, voisin : in agrum confinem Liv. 4, 49, 4, sur le territoire voisin ; confines hi erant Senonibus Cæs. G. 6, 3, 5, ceux-ci étaient les voisins des Sénons
¶2. [fig.] qui a du rapport avec, qui touche à : sunt virtutibus vitia confinia Sen. Ep. 120, 8, il y a des vices qui avoisinent des vertus ; officia virtutum confinia Gell. 1, 2, 4, les devoirs qui se rattachent aux vertus
— confinis, is, m., voisin de propriété : Mart. 2, 32 ; Dig. 18, 1, 35
— v. confine.
¶1. limite commune à des champs, à des territoires : arbores in confinio natæ Varr. L. 5, 10, arbres qui ont poussé sur la limite, cf. Cæs. G. 5, 24
¶2. proximité, voisinage : confinium patuit artis et falsi Tac. An. 4, 58, on vit que la science et l'erreur sont limitrophes ; in exitii confinio esse Vell. 2, 124, être à deux doigts de sa perte
— [fig.] confinia lucis et noctis Ov. M. 7, 706, les confins du jour et de la nuit.
¶1. être fait, se produire, avoir lieu : Lucr. 4, 291 ; 5, 891, etc.; Virg. En. 4, 116 ; Balb. Att. 9, 7 a, 1 ; Sulp. Ruf. Fam. 4, 5, 1 ; Tac. An. 15, 59 ; *Cæs. G. 7, 58, 2
¶2. être épuisé, consumé : Pl. Trin. 408
¶3. être constitué [somme d'argent] : Liv. 5, 50, 7.
¶1. action de consolider, d'étayer : ad confirmationem perpetuæ libertatis Cic. Fam. 12, 8, 1, pour assurer à jamais la liberté
¶2. action d'affermir, de redresser, d'encourager : confirmatione animi Cæs. C. 1, 21, 1, par des encouragements ; neque confirmatione nostra egebat virtus tua Cic. Fam. 6, 3, 1, et ton courage n'avait pas besoin d'être raffermi par nous
¶3. affirmation : confirmatio perfugæ Cæs. G. 3, 18, 6, les affirmations du transfuge
¶4. [rhét.] confirmation [partie du discours] : Cic. Part. 27 ; Quint. 4, 4, 9.
¶1. encouragé, affermi, ferme, solide : confirmatiorem efficere exercitum Cæs. C. 3, 84, 2, raffermir des troupes
¶2. confirmé, assuré : litteræ in quibus erat confirmatius illud idem Cic. Att. 10, 15, 1, lettre où cette même nouvelle était donnée avec plus d'assurance
— confirmatissimus Porph. Hor. S. 1, 5, 27.
¶1. affermir : confirmandi et stabiliendi causa Cæs. G. 7, 73, 7, pour l'affermissement et la consolidation [des pieux]
— [la santé, le corps, etc.] : hoc nervos confirmari putant Cæs. G. 6, 21, 4, ils pensent que par ce moyen les muscles s'affermissent ; confirmato corpore Cic. Fam. 16, 1, 1, étant rétabli physiquement ; numquam te confirmare potuisti Cic. Fam. 16, 4, 3, tu n'as jamais pu te rétablir entièrement ; plane confirmatus Cic. Fam. 16, 4, 1, tout à fait rétabli, solide
— affermir [le courage, les esprits, etc.] : Gallorum animos verbis confirmavit Cæs. G. 2, 33, 1, il réconforta les Gaulois par des paroles ; suos ad dimicandum animo confirmat Cæs. G. 5, 49, 4 (C. 2, 4, 5), il encourage les siens en vue du combat ; ipsi sese confirmaverant Cæs. G. 2, 19, 6, ils s'étaient réconfortés mutuellement
— eos multa pollicendo confirmat uti Romam pergerent Sall. J. 23, 2, à force de promesses il les détermine à aller jusqu'à Rome ; alius alium confirmare ne nomina darent Liv. 2, 24, 2, ils s'encouragent les uhs les autres à ne point se faire inscrire
— affermir dans le devoir (dans la fidélité) : Cæs. C. 1, 15, 4 ; Vell. 2, 120 ; insulas bene animatas Nep. Cim. 2, 4, affermir dans leurs bons sentiments les îles bien disposées
— [fig.] affermir, fortifier, consolider : suam manum Cic. Pomp. 24, ses troupes ; pacem et amicitiam cum proximis civitatibus Cæs. G. 1, 3, 1, les relations pacifiques et amicales avec les États voisins ; sese transmarinis auxiliis Cæs. C. 1, 29, 1, affermir ses forces au moyen de troupes venues d'outre-mer ; opinionem Cic. Tusc. 1, 30, confirmer une opinion ; meum judicium confirmo judicio tuo Cic. Br. 156, je trouve dans ton jugement la confirmation du mien ; bellum commotum a Scapula, postea confirmatum est a Pompeio Cic. Fam. 9, 13, 1, la guerre a été excitée par Scapula, puis encouragée par Pompée ; acta Cæsaris confirmata sunt a senatu Cic. Phil. 2, 100, les actes de César ont été ratifiés par le sénat
¶2. confirmer, corroborer, prouver : confirmare nostra argumentis et rationibus, deinde contraria refutare Cic. de Or. 2, 80, établir nos prétentions par des preuves et des raisonnements, puis réfuter celles de l'adversaire ; divinationem Cic. Div. 1, 71, établir la vérité de la divination ; exemplis confirmare, quantum auctoritas valeat in bello Cic. Pomp. 44, prouver par des exemples quelle est la puissance du prestige personnel dans la guerre ; quorum omnium testimoniis de hac Dionis pecunia confirmatum est Cic. Verr. 2, 23, d'après leurs témoignages à tous, la preuve est faite sur l'argent versé par Dion
— [avec prop. inf.] démontrer que, faire la preuve que : Lucr. 2, 185 ; confirmer que : Cæs. C. 3, 67, 1
¶3. affirmer, assurer, garantir : qualis amicus, ut confirmare possum, nemo certe fuit Cic. Læ. 10, un ami comme, je puis l'affirmer, il n'en a certes pas existé ; difficile est hoc de omnibus confirmare Cic. Arch. 15, il est difficile de garantir cela à propos de tous
— [avec prop. inf.] : talem exsistere eloquentiam non potuisse confirmo Cic. de Or. 2, 6, je certifie qu'une telle éloquence n'aurait pu exister ; se suo exercitu illis regna conciliaturum confirmat Cæs. G. 1, 3, 7, il assure qu'avec son armée il leur ménagera le trône ; illud se polliceri et jurejurando confirmare tutum iter per fines daturum Cæs. G. 5, 27, 10, il fait la promesse et donne sous serment l'assurance qu'il leur offrira un passage sans danger à travers son territoire
— [avec ne et subj.] : sanctissimo jurejurando confirmari oportere ne tecto recipiatur qui non bis per agmen hostium perequitasset Cæs. G. 7, 66, 7, [ils déclarent] qu'il faut sous le plus sacré des serments prendre l'engagement de ne pas donner un abri au cavalier qui n'aurait pas percé deux fois les rangs des ennemis.
¶1. garder dans une caisse : pecuniam confiscatam habere Suet. Aug. 101, garder de l'argent en réserve dans sa cassette
— aliquid in confiscato habere Tert. Fug. 12, avoir qqch en réserve, à sa disposition
¶2. faire entrer dans la cassette impériale, confisquer : Suet. Cal. 16
— frapper qqn de confiscation : Suet. Aug. 15.
¶1. avouer : quid confitetur, atque ita libenter confitetur, ut non solum fateri, sed etiam profiteri videatur ? Cic. Cæc. 24, qu'avoue-t-il, et même qu'avoue-t-il si volontiers, qu'il paraît non seulement le reconnaître, mais le proclamer hautement ? peccatum suum Cic. Nat. 2, 11, avouer sa faute ; habes confitentem reum Cic. Lig. 2, tu as un accusé qui avoue ; ut confitear vobis Cic. Phil. 6, 16, pour que je vous fasse des aveux ; confessæ manus Ov. M. 5, 215, des mains qui avouent la défaite
— se victos confiteri Cæs. C. 1, 84, 5, s'avouer vaincus ; se miseros Cic. Tusc. 3, 73, s'avouer malheureux ; se hostem Cic. Phil. 3, 21, s'avouer ennemi de son pays
— [avec prop. inf.] : ego me fecisse confiteor Pl. Trin. 184, j'avoue que j'ai fait cela ; scaphia utrum empta esse dicis an confiteris erepta ? Cic. Verr. 4, 37, les coupes, déclares-tu que tu les as achetées ou avoues-tu que tu les as dérobées ? esse igitur deos confitendum est Cic. Nat. 1, 44, il faut donc reconnaître qu'il y a des dieux ; me abs te cupisse laudari aperte atque ingenue confitebar Cic. Fam. 5, 2, 2, j'avouais sans détour et naïvement que j'avais ambitionné tes éloges ; hoc confiteatur necesse est nullo modo illam multam cum Cluenti causa posse conjungi Cic. Clu. 103, il doit convenir que cette amende ne peut avoir de rapport avec la cause de Cluentius ; quo facto utrumque confessus est et se desiderare et... Cic. Sen. 4, par là il a fait un double aveu, à la fois qu'il regrettait... et que...
— aliquid de aliqua re, convenir de qqch touchant qqch : Verr. 2, 149 ; Clu. 183 ; de Or. 2, 107
— confiteri de aliqua re, faire un aveu touchant qqch : ut de me confitear Cic. Verr. pr. 3, pour faire un aveu personnel (Pomp. 37 ; Sull. 39) ; qui de meo facto confiteri non dubitem Cic. Lig. 8, moi qui n'hésite pas à faire des aveux sur ma conduite ; de meo quodam amore gloriæ vobis confitebor Cic. Arch. 28, sur l'amour particulier que j'ai de la gloire, je vous ferai des aveux
¶2. [poét.] faire connaître, révéler, manifester : confessa vultibus iram Ov. M. 6, 35, laissant voir sur ses traits sa colère ; (Venus) confessa deam Virg. En. 2, 591, (Vénus) laissant voir sa qualité de déesse ; motum animi suis lacrimis Quint. 6, 1, 23, trahir son émotion par ses larmes (8, 3, 3 ; 9, 4, 39, etc.)
— agitato corpore vivere se confitetur Plin. Ep. 3, 14, 3, par les mouvements de son corps il laisse voir qu'il est en vie.
===> inf. prés. arch. confiterier Pl. Cist. 170.
¶1. int., être tout en feu, se consumer par le feu : classis prædonum incendio conflagrabat Cic. Verr. 5, 92, la flotte incendiée par les pirates se consumait
— [fig.] : amoris flamma Cic. Verr. 5, 92 ; être brûlé des feux de l'amour, invidiæ incendio Cic. Cat. 1, 29, être la proie des flammes de la haine (allumer la haine contre soi) (ou invidia conflagrare Cic. Verr. 1, 157)
¶2. tr. [t. rare] urbs incendio confiagrata Her. 4, 12, ville consumée par l'incendie (Vitr. 10, 16, 9 ; Apul. Mund. 34).
¶1. action de heurter contre, choc : membra conflictationibus debilitare Apul. Apol. 43, 9, se meurtrir de heurts les membres
— choc de deux armées : Gell. 15, 18, 3
— querelle, dispute : Quint. 3, 8, 29
¶2. action de lutter contre : Tert. Pudic. 13, etc.
¶1. choc, heurt : Quint. 3, 6, 6
¶2. lutte : Gell. 7, 3
— débat, conflit : Cic. Inv. 1, 10 ; Part. 102.
¶1. int., se heurter contre, lutter contre : cum aliqua re Ter. Phorm. 505, lutter contre qqch
¶2. tr., bouleverser : plura per scelera rem publicam conflictare Tac. An. 6, 48, déchirer l'État par un plus grand nombre de forfaits (Plin. 8, 59)
— [surtout au pass.] être maltraité, être tourmenté, subir les assauts de : tot incommodis conflictati Cæs. G. 5, 35, 5, subissant tous ces désavantages ; ut nostri magna inopia necessariarum rerum conflictarentur Cæs. C. 1, 52, 3, en sorte que les nôtres pâtissaient d'une grande disette des choses nécessaires ; gravi pestilentia conflictati Cæs. C. 2, 22, 1, mis à mal par une grave épidémie ; superstitione conflictari Cic. Leg. 1, 32, être tourmenté par la superstition ; conflictatus sævis tempestatibus exercitus Tac. Agr. 22, armée maltraitée par de cruelles tempêtes ; molestiis conflictatus ab aliquo Cic. Fam. 6, 13, 3, en proie aux ennuis du fait de qqn
— [abst] être mal en point, souffrir : plebs Cremonensium inter armatos conflictabatur Tac. H. 3, 32, le peuple de Crémone au milieu des hommes d'armes avait fort à souffrir (H. 3, 82).
===> pour le sens pass. v. conflicto.
¶1. [seult à l'abl.] : choc, heurt : Cic. Cæc. 43 ; Nat. 2, 25 ; Div. 2, 44
— [fig.] Gell. 7, 2, 8
¶2. lutte, combat : Vop. Car. 10.
¶1. tr., heurter ensemble, faire se rencontrer : Lucr. 4, 1216
— [fig.] mettre aux prises, confronter : rem cum re Cic. Inv. 2, 126, une chose avec une autre
¶2. int., se heurter, se choquer : naves inter se conflixerunt Cæs. C. 2, 6, 5, les navires s'entrechoquèrent ; adversi venti confligunt Virg. En. 2, 417, les vents contraires s'entrechoquent
— venir aux prises, lutter, combattre : cum aliquo Cic. Off. 1, 84, livrer bataille à qqn (Pomp. 28 ; Fin. 1, 23, etc.) ; contra conspirationem Brut. Fam. 11, 13 a, 5 ; adversus classem Nep. Hann. 8, 4, lutter contre une conspiration, contre une flotte
— [abst] en venir aux mains, se battre : Cic. Cæc. 46 ; armis Cic. Pis. 20, se battre les armes à la main
— [fig.] : leviore actione Cic. Cæc. 8, engager le conflit par un procès moins grave ; causæ inter se confligunt Cic. Cat. 2, 25, les partis sont en conflit
— [pass. impers.] universa illorum ratione cum tota vestra confligendum puto Cic. Fin. 4, 3, c'est l'ensemble de leur doctrine qui doit être aux prises avec la totalité de la vôtre, à mon avis.
¶1. exciter (aviver) par le souffle : ignem Pl. Rud. 765, allumer du feu ; alicujus opera conflatum incendium Liv. 26, 27, 6, incendie allumé par les soins de qqn
— [fig.] exciter : bellum conflatum opera tua Cic. Phil. 2, 70, guerre excitée par tes soins ; seditio jure conflata Cic. de Or. 2, 124, sédition suscitée à bon droit ; alicui invidiam conflare Cic. Cat. 1, 23, exciter la haine contre qqn
¶2. fondre un métal en lingot, fondre : argenteas statuas Suet. Aug. 52 (Ner. 32), fondre des statues d'argent ; falces in ensem Virg. G. 1, 508, fondre les faux pour en faire des épées
— former par fusion : lateres argentei atque aurei primum conflati atque in ærarium conditi Varr. d. Non. 620, 17, des lingots d'argent et d'or fondus pour la première fois et enfermés dans le trésor public
¶3. [fig.] former par mélange : quibus ex rebus conflatur et efficitur honestum Cic. Off. 1, 14, tels sont les éléments dont l'union forme l'honnête ; monstrum ex contrariis diversisque cupiditatibus conflatum Cic. Cæl. 12, monstre constitué par le mélange de passions contraires et opposées
— former par assemblage, combinaison [de pièces et de morceaux] : exercitum Cic. Phil. 4, 15, forger une armée (Sull. 33) ; ex perditis conflata improborum manus Cic. Cat. 1, 25, une troupe de scélérats formée d'un ramassis de gens sans foi ni loi ; qui alienum æs grande conflaverat Sall. C. 14, 2, celui qui avait accumulé d'énormes dettes ; pecuniam Cic. Sest. 66, ramasser (rafler) de l'argent par tous les moyens
— fabriquer, machiner, susciter : injuria novo scelere conflata Cic. Amer. 1, injustice forgée par une scélératesse sans précédent ; accusationem judiciumque conflare Cic. Verr. 2, 116, machiner (susciter) une accusation et une action judiciaire ; in aliquem crimen invidiamque Cic. Verr. 2, 73, soulever des griefs et de la haine contre qqn (invidiam alicui Cic. Cæl. 29) ; negotium alicui Cic. Verr. 2, 135, susciter à qqn des embarras ; judicia domi conflabant, pronuntiabant in foro Liv. 3, 36, 8, les jugements, c'est chez eux qu'ils les forgeaient et ils les prononçaient au forum.
¶1. couler ensemble, joindre ses eaux, confluer : hi duo amnes confluentes incidunt Oriundi flumini Liv. 44, 31, 4, ces deux rivières mêlant leur cours se jettent dans le fleuve Orionde ; Fibrenus divisus æqualiter in duas partes cito in unum confluit Cic. Leg. 2, 6, le Fibrène partagé en deux bras égaux ne tarde pas à former un courant unique ; ibi Isara Rhodanusque amnes confluunt in unum Liv. 21, 31, 4, c'est là que l'Isère et le Rhône se réunissent ; in Phasin confluunt Plin. 6, 13, ils se jettent ensemble dans le Phase
— copia materiai confluxet ad imum Lucr. 1, 987, l'ensemble de la matière se serait ramassé vers le fond
¶2. [fig.] arriver en masse, affluer, se rencontrer en foule sur un point : confluxerunt et Athenas et in hanc urbem multi... ex diversis locis Cic. Br. 258, accoururent à Athènes comme dans notre ville une foule de gens... venant de points opposés ; perfugarum magnus ad eum cotidie numerus confluebat Cæs. G. 7, 44, en grand nombre les transfuges chaque jour affluaient vers lui ; quod accidet nostris, si ad hæc studia plures confluxerint Cic. Tusc. 2, 6, c'est ce qui arrivera à nos compatriotes, s'ils se portent en trop grand nombre vers ces études
— tot prosperis confluentibus Suet. Tib. 10, malgré ce concours de tant d'événements heureux.
===> arch. confluont (confluunt) Pl. Ep. 527 et conflovont CIL 1, 199, 23 ; subj. pqpf. confluxet Lucr. 1, 987.
===> .
¶1. bêcher, creuser, fouiller : confodiatur terra Cat. Agr. 129, il faut bêcher le sol ; confodere vineta Col. 4, 5, donner une façon aux vignes ; salices confodi jubent Plin. 17, 142, on prescrit de déchausser les saules
¶2. percer de coups : pugnans confoditur Sall. C. 60, 7, il tombe percé de coups en combattant ; confodi aliquot vulneribus Liv. 24, 7, 5, être percé de coups assez nombreux
— [fig.] tot judiciis confossi Liv. 5, 11, 12, accablés [transpercés] par tant de jugements, cf. V.-Max. 8, 1 ; mala quæ vos confodiunt Sen. Vit. 27, 6, les maux qui vous assaillent
— critiquer : quædam ex epistola notis confodere Plin. Ep. 9, 26, 13, marquer de signes critiques certains passages d'une lettre.
¶1. conformation, forme, disposition : conformatio theatri Vitr. 5, 6, agencement d'un théâtre ; conformatio lineamentorum Cic. Nat. 1, 47, arrangement des traits ; conformatio animi Cic. Tusc. 1, 50, forme de l'âme
¶2. [fig.] conformatio vocis Cic. de Or. 1, 18, adaptation de la voix ; verborum Cic. de Or. 1, 151, arrangement des mots ; doctrinæ Cic. Arch. 15, le façonnement de la science (formation produite par la science)
— [en part.]
a) [phil.] conformatio animi Cic. Nat. 1, 105 et abst conformatio Cic. Top. 5, vue de l'esprit, concept ;
b) [rhét.] tour, figure : in sententiarum ornamentis et conformationibus Cic. Br. 140, quand il s'agit d'embellir les pensées et de leur donner un tour figuré
— prosopopée : Her. 4, 66.
¶1. donner une forme, façonner : ad majora nos natura conformavit Cic. Fin. 1, 23, la nature nous a façonnés pour de plus grandes choses ; ursa fetum lambendo conformat Gell. 17, 10, 3, l'ourse lèche ses petits pour leur donner leur forme
¶2. [fig.] former, adapter, composer, modeler : mentem meam cogitatione hominum excellentium conformabam Cic. Arch. 14, je façonnais mon intelligence par l'évocation des meilleurs modèles, cf. de Or. 1, 86 ; 3, 200 ; Off. 1, 7 ; conformare se ad voluntatem alicujus Cic. Fam. 1, 8, 2, se plier aux désirs de qqn.
¶1. âpre, inégal, raboteux, rude : confragosa loca Liv. 28, 2, 1, lieux d'accès difficile, cf. Cic. frg. F. 9, 17
— confrăgōsum, i, n., Sen. Ep. 51, 9, et confrăgōsa, ōrum, n., Quint. 5, 8, 1, endroits, régions difficiles
¶2. [fig.]
a) raboteux, inégal : versus confragosi Quint. 1, 1, 37, vers rocailleux ;
b) embarrassant : condiciones confragosæ Pl. Men. 591, conditions embarrassantes
— confragosior Mall. Gram. 6, 59, 64.
¶1. frotter : caput unguento Cic. Verr. 3, 62, se frotter la tête avec un onguent
¶2. [fig.] confricare genua Pl. Asin. 670, embrasser [en suppliant] les genoux de qqn.
===> pf. -avi [décad.] Veg. Mul. 3, 20, 1.
¶1. briser ; pæne confregi fores Pl. Most. 453, j'ai failli briser la porte ; digitos Cic. Fl. 73, briser les doigts ; tesseram Pl. Cist. 503, rompre la tessère = violer les droits de l'hospitalité
¶2. [fig.] abattre, rompre, détruire : Cic. Verr. 1, 13 ; Val.-Max. 4, 5, 2 ; confringere alicujus superbiam Titin. Com. 141, rabattre l'orgueil de qqn
— confringere rem Pl. Trin. 108, mettre en miettes, dissiper son patrimoine.
===> pf vulg. confugivi Vict. Vit. 3, 29 ; confugiturus Pomer. 3, 12, 1.
===> .
¶1. mêler, mélanger : confundere crebroque commiscere mel, acetum, oleum Plin. 29, 11, mélanger, en remuant souvent le mélange, du miel, du vinaigre, de l'huile ; cum venenum ita confusum esset (cum pane), ut secerni nullo modo posset Cic. Clu. 173, le poison étant si intimement mélangé (au pain), qu'on ne pouvait pas du tout le distinguer
— pass. [avec dat.] : æs auro argentoque confusum Plin. 34, 5, airain mêlé à l'or et à l'argent ; Alpheus Siculis confunditur undis Virg. En. 3, 696, l'Alphée se mêle aux eaux de la mer de Sicile
¶2. [fig.] mélanger, unir : tanta multitudine confusa Cæs. G. 7, 75, 1, une si grande multitude étant mélangée ; duo populi in unum confusi Liv. 1, 23, 2, deux peuples confondus en un seul ; cuperem utrumque, si posset ; sed est difficile confundere Cic. Tusc. 1, 23, je désirerais que tu fasses les deux choses, si c'était possible ; mais il est difficile de les mêler (de traiter les deux questions en même temps) ; philosophia quæ confundit vera cum falsis Cic. Ac. 2, 61, une philosophie qui mêle le vrai au faux [n'en fait pas le départ]; [dat. poét.] rusticus urbano confusus Hor. P. 213, le paysan mêlé au citadin ; [poét.] confundere prœlia cum aliquo Hor. O. 1, 17, 23, engager un combat contre qqn
— part. confusus, a, um, formé par mélange : nec ejus modi est oratio, ut a pluribus confusa videatur Cic. Br. 100, et ce discours n'est pas de nature à montrer l'œuvre d'une collaboration ; res publica ex tribus generibus illis confusa modice Cic. Rep. 2, 41, gouvernement constitué par la combinaison mesurée de ces trois formes
¶3. mettre pêle-mêle ensemble : particulas primum confusas, postea in ordinem adductas a mente divina Cic. Ac. 2, 118, [d'après Anaxagore] ces corpuscules, d'abord jetés pêle-mêle, ont été ensuite mis en ordre par l'intelligence divine ; an tu hæc ita confundis et perturbas ut...? Cic. Dom. 127, ou bien est-ce que tu confonds et brouilles ces questions au point que...? signa et ordines peditum atque equitum confundit Liv. 9, 27, 10, [la cavalerie romaine] jette la confusion dans les enseignes et les rangs de l'infanterie et de la cavalerie ; jura gentium Liv. 4, 1, 2, confondre (bouleverser) les droits des familles
— brouiller, rendre méconnaissable : confuderat oris notas pallor Curt. 8, 3, 13, la pâleur de la mort avait confondu tous les traits du visage
— confusus, couvert de confusion, de rougeur : Curt. 7, 7, 23
— troubler l'esprit : Liv. 34, 50, 1 ; 45, 42, 1, etc.; Tac. H. 1, 44 ; Plin. Ep. 5, 5, 1
— brouiller (fatiguer) l'esprit, la mémoire, etc. : Plin. 20, 36 ; 21, 117 ; Sen. Ben. 5, 25, 1 ; Quint. 1, 12, 1
¶4. [pass.] se répandre (être répandu) dans un ensemble, pénétrer : cibus in eam venam quæ cava appellatur confunditur Cic. Nat. 2, 137, l'aliment se répand dans la veine appelée cave ; est id in totam orationem confundendum Cic. de Or. 2, 322, ce soin de plaire doit pénétrer (se fondre) dans le discours entier ; vis divina toto confusa mundo Cic. Div. 2, 35, un principe divin répandu dans tout l'univers.
¶1. action de mêler, de fondre, mélange : hæc conjunctio confusioque virtutum Cic. Fin. 5, 67, cette union et cette pénétration des vertus entre elles
¶2. confusion, désordre : religionum Cic. Leg. 2, 25, confusion de religions ; suffragiorum Cic. Mur. 47, confusion des votes [vote par tête au lieu du vote habituel par centuries] ; perturbatio et confusio vitæ Cic. Nat. 1, 3, trouble et désordre dans la vie
— confusion, rougeur : Tac. H. 4, 40
— trouble [des sentiments, de l'esprit] : Tac. H. 3, 38 ; Plin. Ep. 1, 22 ; Quint. 12, 5, 3.
¶1. mélangé : in hac confusa atque universa defensione Cic. Sest. 5, = rerum confusarum defensione, dans cette défense qui mélange et embrasse tant d'objets
¶2. sans ordre, confus : oratio confusa, perturbata Cic. de Or. 3, 50, discours plein de confusion et de désordre ; homines inconditis vocibus inchoatum quiddam et confusum sonantes Cic. Rep. 3, 3, les hommes faisant entendre dans des sons inarticulés de confuses ébauches d'idées ; onusti cibo et vino perturbata et confusa cernimus Cic. Div. 1, 60, chargés de nourriture et de vin nous n'avons que des visions troubles et confuses [songes]
¶3. troublé [moralement] : Liv. 1, 7, 6 ; 6, 6, 7 ; 35, 15, 9 ; 35, 35, 18
— figure troublée (bouleversée) : Liv. 45, 15, 1 ; Curt. 6, 7, 18
— visage défiguré : Tac. An. 4, 63
— pavor confusior Plin. 7, pr. 5, crainte plus troublée, qui se traduit par un plus grand trouble.
¶1. arrêter le bouillonnement d'un liquide : Titin. Com. 128
¶2. arrêter, abattre : quod nostras secundas res confutet Cat. d. Gell. 7, 3, 14, chose de nature à arrêter notre prospérité ; maximos dolores recordatione confutat Cic. Tusc. 5, 88, il réduit les plus vives douleurs en faisant appel au souvenir
— [en part.] contenir un adversaire, réduire au silence, confondre, réfuter, convaincre : istos qui me culpant, confutaverim Pl. Truc. 349, je saurais confondre ces gens qui me condamnent, cf. Cic. Nat. 1, 5 ; Tac. An. 15, 51 ; confutare argumenta Stoïcorum Cic. Div. 1, 8, réfuter les raisonnements des Stoïciens ; confutans index Liv. 8, 18, 8, la dénonciatrice tenant tête, soutenant le contraire
— confutatus crimen Cod. Th. 11, 8, 1, convaincu d'un crime, et abst confutatus Amm. 14, 9, 6
— confutatus av. prop. inf. Amm. 17, 9, 5, convaincu de
¶3. déconcerter, décontenancer : confutare obtutum Apul. M. 11, 3, éblouir les yeux.
¶1. tr., geler, faire geler : Plin. 18, 277 ; V. Fl. 3, 578
— [fig.] geler, donner froid : Mart. 14, 147, 2
— coaguler : ubi se congelaverit adeps Scrib. 271, lorsque la graisse sera figée
— durcir, rendre dur : in lapidem aliquid Ov. M. 11, 61, pétrifier qqch
¶2. int., se geler : Hister congelat Ov. Tr. 3, 10, 30, l'Hister se glace
— [fig.] s'engourdir : congelare otio Cic. Fam. 2, 13, 3, s'engourdir dans le repos.
¶1. tr., redoubler : congeminare crebros ictus Virg. En. 12, 714, porter des coups redoublés ; victores pæana congeminant V. Fl. 6, 512, les vainqueurs redisent le péan
¶2. int., se doubler : Pl. Amp. 786.
¶1. int., gémir ensemble [ou] profondément : congemuit senatus Cic. Mur. 51, ce fut un gémissement unanime dans le sénat
— [poét.] supremum congemuit ornus Virg. En. 2, 631, l'orne fit entendre un dernier gémissement
¶2. tr., pleurer, déplorer : congemere aliquem V. Fl. 5, 12, pleurer qqn ; mortem Lucr. 3, 932, s'affliger de mourir.
¶1. engendrer ensemble : Varr. R. 2, 14, 19
— engendrer avec, occasionner : C. Aur. Chron. 4, 3, 21
¶2. ajouter, associer : Acc. Tr. 180.
¶1. amas : congeries lapidum Liv. 31, 39, 8, tas de pierres ; cadaverum congeries V. Fl. 6, 511, monceau de cadavres
— [en part.] tas de bois : Quint. 5, 13, 13
¶2. [fig.] le Chaos : Ov. M. 1, 33
— [rhét.] accumulation : Quint. 8, 4, 3.
¶1. amasser, entasser, amonceler, accumuler : saxis congestis Liv. 1, 51, 9, avec des pierres amoncelées ; alicui munera congerere Cic. Att. 5, 9, 1, charger qqn de présents ; viaticum Cic. Planc. 26, amasser des provisions de route [pour qqn]; in os alicui tritici grana Cic. Div. 1, 78 (in os alicujus Div. 2, 26), entasser des grains de blé dans la bouche de qqn ; magna vis salis ex proximis erat salinis eo congesta Cæs. C. 2, 37, 5, une grande quantité de sel apportée des salines voisines avait été accumulée là
— tela in aliquem Curt. 8, 14, 38, cribler qqn de traits ; congestis telis Tac. An. 2, 11, sous une grêle de traits
— former par accumulation : aram sepulcri congerere arboribus Virg. En. 6, 178, faire un autel funéraire en amoncelant des arbres ; nidamenta Pl. Rud. 889, faire un nid ; [abst] congerere = congerere nidum Virg. B. 3, 69 ; Gell. 2, 29, 5, faire son nid
— [fig.] : quoniam congesta fuit accusatio acervo quodam criminum Cic. Scaur. 4 b, puisque l'accusation a été constituée par une sorte d'amoncellement de griefs
¶2. [fig.] rassembler ; accumuler des noms dans une énumération : Cic. Br. 297 ; Quint. 10, 1, 56 ; (turba patronorum) quam ego congessi in hunc sermonem Cic. Br. 332, (la foule des avocats) dont j'ai accumulé les noms dans cet entretien
— rassembler (accumuler) sur qqn [bienfaits, honneurs, etc.] : ad aliquem Cic. Dej. 12 ; in aliquem Cic. Tusc. 5, 117 ; alicui Tac. An. 1, 4 ; [en part.] entasser contre qqn les injures (in aliquem maledicta Cic. Phil. 3, 15), les accusations (in aliquem crimina Cic. Mil. 64) ; in aliquem causas aliquarum rerum Liv. 3, 38, 7, faire retomber sur qqn les responsabilités de certaines choses.
¶1. vase qui contient un conge : Dig. 33, 7, 13
¶2. distribution de vin, d'huile, etc., faite au peuple : Plin. 31, 89 ; 14, 96
¶3. distribution d'argent : congiaria populo frequenter dedit Suet. Aug. 41, 2, il fit au peuple de fréquentes distributions d'argent, cf. Cic. Phil. 2, 116

¶4. don, présent [en gén.] : Cic. Att. 10, 7, 3 ; Cæl. Fam. 8, 1, 4 ; Sen. Ep. 29, 5.

¶1. int., se congeler : Cic. Nat. 2, 26
— [fig.] Curioni tribunatus conglaciat Cæl. Fam. 8, 6, 3, Curion a un tribunat congelé = ne donne pas signe de vie
¶2. tr., geler, faire geler : conglaciantur aquæ Albin. 2, 101, les eaux se forment en glace, cf. Plin. 2, 152.
¶1. accumulation en forme de globe, agglomération : Sen. Nat. 1, 15, 4
¶2. rassemblement en corps : Tac. G. 7.
¶1. [pass.] se mettre en boule, s'arrondir, se ramasser : Cic. Nat. 2, 116 ; 2, 98 ; conglobata figura Cic. Nat. 2, 118, figure sphérique
¶2. [fig.] rassembler, attrouper [des soldats] : Sall. J. 97, 4 ; Liv. 26, 40, 17, etc. ; cum se in unum conglobassent Liv. 8, 11, 5, après s'être reformés en un seul corps de troupes ; conglobata inter se pars contionis Tac. An. 1, 35, une partie de l'assemblée qui s'était formée en un groupe compact
— in aliquem locum Liv. 10, 5, 9, etc. ; in aliquo loco Tac. An. 14, 32, se rassembler dans un lieu
— definitiones conglobatæ Cic. Part. 55, définitions accumulées
¶3. former par agglomération (aliquem, qqn) [en parl. des atomes] : Sen. Ben. 4, 19, 3.
¶1. coller ensemble, lier ensemble : Varr. R. 3, 16, 23 ; Vitr. 7, 4, 3 ; vulnus Plin. 23, 3, fermer une blessure
¶2. [fig.] former par liaison étroite des éléments, constituer en un tout compact : sic hominem eadem optime, quæ conglutinavit, natura dissolvit Cic. CM 72, ainsi la nature qui a soudé ce tout qui est l'homme, excelle aussi à le désagréger ; rem, dissolutam conglutinare Cic. de Or. 1, 188, constituer en un tout un objet d'étude morcelé
— lier étroitement les éléments d'un tout, cimenter, souder : si utilitas amicitias conglutinaret Cic. Læ. 32, si l'intérêt scellait les amitiés ; a me conglutinata concordia Cic. Att. 1, 17, 10, accord cimenté par moi
— combiner qqch : Pl. Bacch. 693.
¶1. présenter ses félicitations, féliciter : conferre dona congratulantes Pl. Men. 129, faire des cadeaux en félicitant ; complexus hominem congratulatusque Gell. 12, 1, 4, l'ayant embrassé en le félicitant
¶2. se féliciter : congratulabantur libertatem civitati restitutam Liv. 3, 54, 7, ils se félicitaient en commun de ce que l'État avait recouvré sa liberté.
I. int.,
¶1. rencontrer en marche ; aller trouver qqn, aborder qqn, avoir une entrevue avec qqn : cum aliquo Cic. Cæl. 53, etc. ; Cæs. G. 1, 39, 1, etc.
— primordia rerum inter se congressa Lucr. 5, 191, les atomes en se rencontrant
— [abst] : si ipse coram congredi poteris Cic. Pis. 59, si tu peux avoir [avec lui] un entretien de vive voix ; cum erimus congressi Cic. Att. 1, 20, 1, quand nous nous rencontrerons (nous nous trouverons ensemble)
¶2. [sens hostile] se rencontrer dans une bataille, combattre : armis congredi Cæs. G. 1, 36, 3, combattre les armes à la main ; impari numero Cæs. C. 1, 47, 3, lutter avec l'infériorité du nombre ; locus, ubi congressi sunt Cic. Mil. 53, l'endroit où eut lieu la rencontre des adversaires ; cum finitimis prœlio congredi Cæs. G. 7, 65, 2, engager un combat avec les peuples voisins ; eidem quibuscum sæpenumero Helvetii congressi Cæs. G. 1, 40, 7, les mêmes avec lesquels les Helvètes ayant eu de nombreux engagements...
— (alicui) se mesurer avec qqn, être aux prises avec qqn : Virg. En. 1, 475 ; 5, 809 ; Curt. 9, 7, 20
— contra aliquem, marcher en armes contre qqn : Cic. Lig. 9
— [fig.] se mesurer (combattre) en paroles : Cic. Ac. 2, 148, etc. ; cum Academico Cic. Nat. 2, 1, lutter contre un philosophe académicien ; congredere mecum criminibus ipsis Cic. Mur. 67, pour me combattre, fais état seulement des griefs.
II. tr., congredi aliquem, aborder qqn : Pl. Epid. 545 a ; Most. 783 ; Stat. Th. 11, 665
— in congrediendis hostibus Gell. 1, 11, 2, en abordant les ennemis (au moment de l'attaque).
===> inf. prés. de la 4e conj. congrediri *Pl. Aul. 248.
¶1. action de se réunir en troupe : Cic. Fin. 2, 109
¶2. réunion d'hommes, société : nos ad congregationem hominum esse natos Cic. Fin. 3, 65, que nous sommes nés sociables
— propension à se réunir, esprit de société : Cic. Rep. 1, 39 ; Sen. Ep. 5, 3
— assemblée, foule : Vulg. Exod. 16, 2
¶3. [en gén.] réunion : omnis congregatio aquarum Vulg. Levit. 11, 36, toute la masse des eaux ; congregatio criminum Quint. 7, 1, 31, la réunion des chefs d'accusation
— [rhét.] congregatio rerum Quint. 6, 1, 1, récapitulation.
¶1. rassembler : oves Plin. 8, 72, rassembler des brebis
— [pass.] se rassembler : apium examina congregantur Cic. Off. 1, 157, les essaims d'abeilles se rassemblent (Nat. 2, 124)
¶2. rassembler [des hommes] : dissupatos homines Cic. Tusc. 1, 62 (in unum locum Cic. Sest. 91), rassembler (en un même endroit) les hommes dispersés
— hominem in idem Vettii indicium atque in eumdem hunc numerum congregasti Cic. Vatin. 25, cet homme, tu l'as englobé dans les dénonciations aussi de Vettius et dans le nombre aussi de ces gens qu'il poursuivait ; quicum te aut voluntas congregasset aut fortuna conjunxisset Cic. Quinct. 52, un homme avec lequel tu as été ou associé par ta volonté ou lié par le hasard ; quibus me tempus aliquod congregavit Sen. Ep. 62, 2, des gens dont quelque circonstance m'a rapproché
— se congregare cum aliquibus Cic. Fin. 5, 42 ; unum in locum Cic. Phil. 14, 15, se réunir avec certains, se ressembler en un même lieu
— ou congregari : pares cum paribus congregantur Cic. CM 7, qui se ressemble s'assemble ; familiæ congregantur Cic. Verr. 5, 29, les familles se rassemblent ; unum in locum congregentur Cic. Cat. 1, 32, qu'ils se rassemblent en un même lieu ; congregantur in fano Cic. Div. 1, 90, ils se rassemblent dans un temple
— congregari inter se Tac. An. 1, 30, tenir des réunions entre eux ; nulli externo congregantur Plin. 5, 45, ils n'ont de rapport avec aucun étranger
¶3. [part. pass.] formé par rassemblement : hominum cœtus quoquo modo congregatus Cic. Rep. 1, 39, une réunion d'hommes formée par un assemblage quelconque ; multitudo hominum ex servis, ex conductis congregata Cic. Dom. 89, une multitude composée d'un ramassis d'esclaves, de gens à gages
— dont les éléments sont solidement liés : ex quo judicare potestis quanta vis illa fuerit oriens et congregata, cum hæc Cn. Pompeium terruerit jam distracta et exstincta Cic. Dom. 67, ainsi vous pouvez juger quelle était alors cette puissance à sa naissance et dans toute sa cohésion, puisque, désunie et mourante, elle faisait encore trembler Pompée
¶4. rassembler [des choses] : signa unum in locum congregata Tac. An. 1, 28, enseignes rassemblées au même endroit ; infirmiora argumenta congreganda sunt Quint. 5, 12, 4, il faut grouper ensemble les arguments les plus faibles ; turbam tantummodo (verborum) congregat Quint. 10, 1, 7, il ne fait qu'accumuler une masse de mots [dans sa mémoire].
¶1. action de se rencontrer, rencontre [opp. digressio, séparation] : Cic. Q. 1, 3, 4
¶2. action d'aborder qqn, abord, commerce, entrevue, réunion : Cic. Clu. 41 ; Phil. 2, 46 ; de Or. 1, 192 ; Off. 1, 132
— commerce de l'homme et de la femme : Rep. 1, 38
¶3. rencontre, combat : Quadr. H. 10 ; Just. 6, 4, 12
— congressio navalis prœlii Just. 2, 12, 8, engagement d'une bataille navale.
¶1. action de se rencontrer, rencontre [opp. à digressus, séparation] : Cic. Att. 9, 18, 4 ; 11, 12, 3 ; Q. 1, 3, 4, etc.
¶2. entrevue, réunion, commerce : Cic. Fam. 6, 4, 5 ; Sest. 111 ; Læ. 87, etc.
— commerce de l'homme et de la femme : Plin. 12, 54 ; Apul. M. 1, 7
¶3. rencontre, combat : Cic. de Or. 2, 317 ; Cæs. G. 3, 13, 7 ; C. 1, 46, 4 ; 1, 47, 2.
¶1. qui appartient au même troupeau : congrex armentis equinis Apul. M. 7, 16, réuni à des hardes de chevaux
¶2. de la même compagnie, de la même troupe : nullis comissationibus congreges Tert. Pænit. 11, ne se réunissant pour aucune partie de plaisir
— [fig.] étroitement uni, serré : congrex nexus Prud. Symm. 2, 635, nœud serré.
¶1. convenable, juste, conforme : genus dicendi aptum et congruens Cic. de Or. 3, 53, un style approprié et convenable (Part. 54)
— s'accordant, d'accord : hæc duo pro congruentibus sumunt tam vehementer repugnantia Cic. Ac. 2, 44, ils associent, comme étant d'accord, ces deux principes si fortement contradictoires ; verbis discrepans, sententiis congruens Cic. Leg. 1, 30, avec une différence dans les mots, un accord dans les idées ; vita congruens cum disciplina Cic. Br. 117, vie conforme à la doctrine (Br. 141 ; Fin. 2, 45 ; Leg. 1, 38); congruens actio menti Cic. de Or. 3, 222, action oratoire en accord avec les pensées (Fin. 5, 58 ; 2, 99, etc. ; Fam. 9, 24, 1)
— congruens est, congruens videtur avec inf., il est, il paraît convenable de : Tac. An. 4, 2 ; H. 5, 8 ; Plin. Ep. 1, 8, 17, etc.; [avec prop. inf.] Plin. Pan. 38, 6 ; [avec ut subj.] Gell. 17, 8, 13
— pl. n. pris subst., congruentia, des choses concordantes : Liv. 9, 31, 7 ; 42, 17, 1 ; Tac. An. 15, 56
¶2. dont les parties sont en accord : concentus concors et congruens Cic. Rep. 2, 69, un concert où les sons s'accordent et se fondent harmonieusement ; clamor congruens Liv. 30, 34, 1, cris poussés à l'unisson ; Tiberius fuit... æqualis et congruens Suet. Tib. 68, 1, Tibère avait le corps bien proportionné et bien équilibré.
¶1. se rencontrer étant en mouvement : guttæ inter se congruunt Vitr. 7, 8, 2, les gouttes tombant se rencontrent, se réunissent ; Zenon congruere judicat stellas Sen. Nat. 7, 19, Zénon estime que les étoiles se rapprochent (convergent)
— être en mouvement concordant : cum viderit sidera cum ejus (cæli) ipsius motu congruere Cic. Tusc. 5, 69, en voyant les astres participer au mouvement du ciel lui-même
¶2. [fig.] être d'accord, concorder : suos dies mensesque congruere volunt cum solis lunæque ratione Cic. Verr. 2, 129, ils veulent que leurs jours et leurs mois soient en accord avec le cours du soleil et de la lune ; congruere ad aliquid Liv. 1, 5, 5 ; 1, 19, 6, concorder avec qqch
— être en harmonie, en accord : nostri sensus, ut in pace, in bello congruebant Cic. Marc. 16, nos sentiments [à tous deux] étaient en harmonie pendant la guerre, comme pendant la paix
— [avec dat.] : congruere naturæ Cic. Tusc. 5, 82, être en accord avec la nature (Fin. 3, 20 ; 4, 53, etc.) ; animi corporum doloribus congruentes Cic. Tusc. 5, 3, des âmes participant aux douleurs physiques (éprouvant en même temps les douleurs du corps) ; id perspicuum est non omni causæ nec auditori neque personæ neque tempori congruere orationis unum genus Cic. de Or. 3, 210, il est évident qu'un seul et même genre de style ne convient pas à toute espèce de cause, d'auditoire, de rôle [comme avocat], de circonstance ; [avec cum] gestus cum sententiis congruens Cic. Br. 141, geste répondant aux pensées (183 ; Fin. 2, 100 ; 5, 19 ; Div. 1, 97) ; [avec inter se] s'accorder ensemble : Amer. 62 ; Fin. 3, 62 ; Tusc. 4, 30 ; [avec in unum] former un accord unanime : Liv. 3, 24, 6 ; 25, 32, 2
— de aliqua re, être d'accord au sujet d'une chose : Cic. Leg. 1, 53 ; [abl. seul.] (Academici et Peripatetici) rebus congruentes Cic. Ac. 1, 17, (Académiciens et Péripatéticiens) étant d'accord pour le fond (Leg. 1, 38 ; Fin. 2, 45 ; Liv. 8, 6, 15)
¶3. [emploi impers.] : congruit ut et subj. Plin. Ep. 7, 2, 1, il n'est pas contradictoire que, il est logique que...
— forte congruerat ut subj. Tac. H. 1, 7, il y avait eu par hasard coïncidence que, une coïncidence fortuite avait fait que.
¶1. faire des efforts ensemble : undique omnes conisi hostem avertunt Liv. 3, 63, 4, se précipitant de toutes parts, tous d'un commun effort font plier l'ennemi (22, 47, 5 ; 33, 5, 7) ; vix illam (loricam) famuli ferebant conixi humeris Virg. En. 5, 264, c'est à peine si les deux esclaves unissant leurs efforts pouvaient porter cette cuirasse sur leurs épaules ; Galli omni multitudine in unum locum conixi Liv. 31, 21, 10, les Gaulois avec toutes leurs forces portant leurs efforts ensemble sur un seul point (Pl. Mil. 29)
— faire un effort total, tendre tous ses ressorts : quantum coniti animo potes Cic. Off. 3, 6, tout ce que tu peux donner comme effort moral ; ratio conixa per se et progressa longius fit perfecta virtus Cic. Tusc. 2, 47, la raison après avoir fait par elle-même un effort énergique et s'être avancée bien loin dans la voix du progrès devient la vertu parfaite ; fert ingens toto conixus corpore saxum Virg. En. 10, 127, il se raidit de tout son corps pour porter un rocher énorme ; omnibus copiis conisus Ancus Liv. 1, 33, 5, Ancus donnant tout son effort avec l'ensemble de ses troupes (33, 19, 9)
— [avec inf.] : coniterentur modo uno animo omnes invadere hostem Liv. 9, 31, 12, qu'ils fassent seulement tous un effort commun d'un seul cœur pour charger l'ennemi ; Nero effodere proxima Averno juga conisus est Tac. An. 15, 42, Néron fit tous ses efforts pour percer les hauteurs voisines de l'Averne (15, 51)
— [avec ut et subj.] Curt. 5, 8, 7
— [avec ad et gérond.] Tac. An. 15, 66
¶2. [en part.] tendre tous les ressorts, se raidir [pour monter, s'élever] : equitatus noster summa in jugum virtute conititur Cæs. C. 1, 46, 3, nos cavaliers avec la plus grande énergie font effort pour atteindre le sommet : (parvi) conituntur, sese ut erigant Cic. Fin. 5, 42, (les petits) tendent tous leurs muscles pour se mettre debout (Curt. 7, 3, 13) ; jactandis gravius in conitendo ungulis Liv. 21, 36, 8, [les bêtes de somme] en frappant plus violemment de leurs sabots dans leurs efforts pour marcher
— Vettius in præaltam arborem conisus Tac. An. 11, 31, Vettius qui était monté sur un arbre très haut
— conixus in hastam Sil. 10, 251, faisant effort en se portant contre sa lance (s'appuyant sur sa lance)
¶3. [poét.] se raidir pour mettre bas : Virg. B. 1, 15.
===> inf. prés. conitier Acc. d. Cic. Div. 1, 44.
¶1. se fermer : Gell. 17, 11, 4 ; 16, 3, 3
¶2. [surtout en parl. des yeux] : oculis somno coniventibus Cic. Nat. 2, 143, les yeux se fermant dans le sommeil (Har. 38)
— [en parl. des pers. elles-mêmes] fermer les yeux : Pl. Most. 830 ; Cic. de Or. 3, 221 ; Tusc. 1, 117 ; Pis. 11 ; altero oculo conivere Cic. Nat. 3, 8, fermer un œil ; [avec acc. de relation] conivere oculos Ninn. Crass. d. Prisc. 9, 42
¶3. [fig.] fermer les yeux, laisser faire avec indulgence : consulibus si non adjuvantibus, at coniventibus certe Cic. Mil. 32, les consuls sinon donnant leur aide, du moins fermant les yeux (Flacc. 25 ; Cæl. 41) ; in aliqua re, fermer les yeux sur qqch : Cic. Cæl. 59 ; Har. 52 ; Phil. 1, 18.
===> inf. prés. de la 3e conj. conivĕre Calvus d. Prisc. 9, 43
— sur les deux formes du parf. v. Prisc. 9, 23 ; forme conivi Apul. M. 4, 25 ; 11, 3 ; forme conixi Turpil. Com. 173.
¶1. action de jeter, de lancer (des traits) : Cic. Cæc. 43
¶2. [fig.] comparaison : annonæ atque æstimationis *Cic. Verr. 3, 189, comparaison du prix du blé avec son estimation
¶3. explication conjecturale, interprétation : somniorum Cic. Div. 2, 130, interprétation des songes
¶4. [droit] conjectio causas Gai. Inst. 4, 15 ; Paul. Dig. 50, 17, 1, exposé succinct d'une affaire.
¶1. [au propre] jeter : décret de Ti. Sempr. Gracchus dans Gell. 6, 19, 7 ; cf. Gell. 7, 13, 2
¶2. [fig.] conjecturer (aliquid, qqch) : Ter. Eun. 543 ; Liv. 6, 12, 3 ; 29, 14, 9 ; Curt. 4, 9, 11
— rem aliqua re, conjecturer une chose par (d'après) une autre : Liv. 5, 21, 16 ; Tac. An. 1, 12 ; ou de aliqua re Suet. Ner. 40 ; ou ex aliqua re Tac. An. 12, 49 ; 14, 51 ; Gell. 13, 20, 3
— [avec prop. inf.] conjecturer que : Cæs. C. 3, 106, 1 ; Curt. 3, 11, 1, etc. ; Tac. H. 3, 15
— [avec int. ind.] Quint. 7, 3, 5 ; Plin. Pan. 26 ; ex ingenio ducis conjectans in quo tum is pavore esset Liv. 35, 29, 8, pressentant d'après le caractère du chef quel devait être alors son effroi (22, 9, 2 ; 40, 36, 4 ; 45, 10, 9 ; Curt. 7, 8, 2 ; Plin. Ep. 3, 9, 26)
— [abst] faire des conjectures, de aliqua re, sur qqch : Tac. H. 2, 97
¶3. pronostiquer, présager : Suet. Ner. 6 ; Aug. 95 ; Cal. 57.
===> forme dépon. conjector Tert. Nat. 2, 12.
¶1. qui interprète, qui explique : Pl. Pœn. 444
¶2. [en part.] interprète de signes (de songes), devin : Pl. Amph. 1128 ; Cic. Div. 1, 45 ; 1, 72 ; Nat. 1, 55, etc.
===> .
¶1. conjecture : conjectura mentis divinæ Liv. 10, 39, 15, conjecture sur la pensée divine ; humani animi Sen. Ben. 4, 33, 1, conjecture sur le cœur humain, cf. Tac. H. 5, 3 ; Quint. 12, 2, 19, etc. ; consequentium Cic. Fin. 2, 113, faculté de conjecturer les conséquences ; ex lucri magnitudine conjecturam furti capere Cic. Verr. 3, 111, d'après la grandeur du gain conjecturer un vol (de aliqua re Cic. Mur. 9, d'après qqch) ; conjecturam facere de aliquo (ex aliquo) Cic. Verr. 1, 125 ; 5, 34, faire une conjecture sur qqn (d'après qqn) ; ex aliqua re alicujus rei conjecturam facere Cic. Verr. 4, 34, faire d'après qqch des conjectures sur qqch ; de se conjecturam facere Cic. de Or. 2, 298, conjecturer d'après soi ; aliquid conjectura consequi Cic. Cat. 3, 18, se rendre compte d'une chose par conjecture ; conjectura suspicari Cic. Rep. I, 15 ; augurari Cic. Att. 2, 9, 1, soupçonner, juger par conjecture ; ut ego perspicio cum tua conjectura, tum etiam mea Cic. Att. 9, 23, 5, comme de mon côté, je le vois nettement d'après tes présomptions et surtout d'après les miennes
— pl., Sen. Marc. 25
¶2. interprétation des songes, prédiction : Pl. Curc. 246 ; Cic. Div. 1, 24 ; 1, 73
¶3. [rhét.] argumentation conjecturale, qui s'appuie sur des conjectures : Cic. Inv. 2, 16, etc.; Part. 33, etc.; Div. 2, 55 ; ex aliqua re conjecturam sumere Cic. Inv. 2, 47 ; ducere Cic. Inv. 2, 41, tirer de qqch un raisonnement conjectural ; conjecturam inducere Cic. Inv. 2, 99, employer le raisonnement conjectural.
¶1. action de jeter ensemble, d'amonceler : Lucr. 5, 416 ; Liv. 7, 6, 2
— concentration sur un point : Lucr. 4, 959 ; 5, 600
¶2. action de lancer : [des traits] Nep. Pelop. 5, 4 ; Liv. 28, 36, 9, etc. ; [des pierres] Cic. Att. 4, 3, 2 ; ad conjectum teli ventre Liv. 22, 15, 8 ; 26, 4, 7, etc., venir à la distance d'où l'on peut lancer un trait [ou] à laquelle un trait peut porter (à la portée du trait)
— possibilité de lancer des traits : Sall. H. 2, 87 ; Liv. 25, 16, 22
— action d'abattre le bras sur qqch : Lucr. 6, 435
¶3. [fig.] action de jeter, de diriger les regards, in aliquem, sur qqn : Cic. Sest. 115 ; de Or. 3, 222 ; Planc. 21 ; Curt. 9, 7, 25 ; Plin. Pan. 17
— action de diriger l'esprit : Quint. 3, 6, 30.
===> .
¶1. jeter ensemble [sur un point] : lapides telaque in nostros Cæs. G. 1, 46, 1, faire pleuvoir sur les nôtres une grêle de pierres et de traits (2, 6, 3 ; 3, 4, 1, etc.), cf. Cic. Clu. 50 ; Cat. 1, 15, etc.
— jeter en tas (en masse) sur un point, réunir en un point : semina rerum quæ conjecta repente... Lucr. 2, 1061, les éléments des choses, qui, réunis subitement... (2, 1072) ; in hydriam sortes Cic. Verr. 2, 127, jeter les sorts ensemble dans une urne ; nomina in urnam Liv. 23, 3, 7 ; Plin. Ep. 10, 3, 2, jeter (réunir) les noms dans une urne ; sarcinas in medium Liv. 10, 36, 13 ; 28, 2, 3, etc., jeter les bagages en tas au milieu (in medio mss. 10, 36, 1) ; agger in munitionem conjectus Cæs. G. 7, 85, 6, des matériaux de toute espèce jetés en masse sur les travaux de défense [de César] ; domus inflammata conjectis ignibus Cic. Att. 4, 3, 2, on mit le feu à la maison en y jetant des brandons
— [poét.] : spolia igni Virg. En. 11, 194, jeter dans le feu les dépouilles ; juveni facem Virg. En. 7, 456, jeter un brandon contre le jeune homme
¶2. jeter, diriger [les yeux] : oculos in aliquem Cic. Clu. 54 ; Læ. 9, jeter les yeux sur qqn ; [avec int. indir.] : omnium oculi conjecti sunt in unumquemque nostrum, qua fide ego accusem... Cic. Verr. 5, 175, les yeux de tous les citoyens sont dirigés sur chacun de nous pour voir avec quelle loyauté moi j'accuse...
¶3. jeter, pousser, lancer : aliquem in vincula, in carcerem Cic. Verr. 5, 107 ; 5, 17 ; in catenas Cæs. G. 1, 47, 6, jeter qqn dans les fers, en prison ; navis in portum conjecta est Cic. Inv. 2, 98, le navire a été lancé [par la tempête] dans le port ; hostem in fugam Cæs. G. 4, 12, 2, mettre l'ennemi en fuite
— se conjicere in paludem Liv. 1, 12, 10 ; in signa manipulosque Cæs. G. 6, 40, 1 ; in fugam Cic. Cæl. 63, se jeter dans un marais, au milieu des enseignes et des manipules, se mettre à fuir précipitamment ; se in pedes Ter. Phorm. 190, prendre la fuite ; se in noctem Cic. Mil. 49, se jeter [d'aventure] dans la nuit ; se in versum Cic. de Or. 3, 194, s'appliquer à versifier
¶4. [fig.] jeter, pousser, faire entrer, faire aller : aliquem in metum Liv. 39, 25, 11, jeter qqn dans l'effroi ; rem publicam in perturbationes Cic. Fam. 12, 1, 1, jeter l'État dans les troubles ; tantam pecuniam in propylæa Cic. Off. 2, 60, mettre (dépenser) tant d'argent dans les propylées ; legem in decimam tabulam Cic. Leg. 2, 64, introduire une loi dans la dixième table ; in hoc genus conjiciuntur proverbia Cic. de Or. 2, 258, dans ce genre rentrent les proverbes
— culpam in aliquem Cæs. G. 4, 27, 4, faire retomber une faute sur qqn ; oratio improbe in aliquem conjecta Cic. Sest. 40, propos mis méchamment sur le compte de qqn, v. confero §{} 11 ; causam XII Tab. d. Her. 2, 20, présenter une cause (Afran. Com. 216) ; verba inter se conjicere Afran. Com. 309, échanger des mots
¶5. combiner dans l'esprit, conjecturer : conjicere quanta religione fuerit signum illud Cic. Verr. 4, 129, se faire une idée de la vénération qui entourait cette statue ; conjeci Lanuvii te fuisse Cic. Att. 14, 21, 1, j'ai présumé que tu étais à Lanuvium ; quo quid conjicit ? Col. 4, 3, 6, quelle conjecture tire-t-il de ce fait ?
— interpréter des signes, deviner, présager : de matre savianda ex oraculo Apollinis acute conjecit Cic. Br. 53, il a dégagé avec sagacité dans l'oracle d'Apollon le sens des mots « embrasser sa mère »; male conjecta [pl. n.] Cic. Div. 1, 119, les mauvaises interprétations de signes.
===> arch. conjexit = conjecerit Pl. Trin. 722.
¶1. alliage, mélange : conjugatio quædam mellis et fellis Apul. Flor. 18, 11, mélange déterminé de miel et de fiel
¶2. union : corporum Arn. 2, 16, union charnelle
— [en part.]
a) [rhét.] parenté, rapport étymologique des mots : Cic. Top. 12 ;
b) [phil.] enchaînement [des propositions] : Apul. Plat. 3 ;
c) [gram.] conjugaison : Charis. 175, 29 ; Prisc. 17, 93.
¶1. union : corporis atque animæ Lucr. 3, 843, union de l'âme et du corps
¶2. union conjugale, mariage : Cic. Off. 1, 54
— accouplement : Virg. G. 3, 275
¶3. [fig.] époux, épouse : Virg. En. 2, 579 ; 3, 296
¶4. couple d'animaux : Plin. 8, 85.
¶1. unir : amicitia, quam similitudo morum conjugavit Cic. Off. 1, 58, amitié fondée sur la conformité des goûts
¶2. marier : sibi nuptiis alicujus sororem Apul. M. 5, 26, épouser la sœur de qqn
¶3. v. conjugatus.
¶1. conjointement [avec], ensemble, à la fois : Cic. Fam. 5, 12, 2 ; de Or. 2, 248
— [rhét.] aliquid conjuncte elatum Cic. de Or. 2, 158, proposition énoncée conjointement (= conditionnelle) [opp. à simpliciter, d'une manière indépendante, catégorique]
¶2. dans une étroite union (intimité) : Nep. Att. 10, 3
— -tius Cic. Fam. 6, 9, 1 ; -issime Cic. Læ. 2.
¶1. union, liaison : portuum Cic. Verr. 4, 117, l'union des deux ports ; continuatio conjunctioque naturæ quam vocant συμπάθειαν Cic. Div. 2, 142, les liens, les rapports naturels des choses entre elles que les Grecs appellent sympathie (2, 124) ; litterarum inter se conjunctio Quint. 1, 1, 31, action de lier ensemble des lettres [dans la lecture] ; vicinitatis Cic. Planc. 21, liens de voisinage
— consequentium rerum cum primis Cic. Nat. 2, 147, le pouvoir de lier les idées qui suivent avec celles qui précèdent
¶2. liens du mariage, union conjugale : Cic. Off. 1, 11
¶3. liaison avec qqn, relations amicales : Cic. Læ. 71 ; Phil. 2, 23 ; Cæl. 35
— liens de parenté : Cic. Off. 1, 54 ; Fam. 1, 7, 11, etc.
¶4. [rhét.]
a) conjonction : Her. 4, 38 ;
b) liaison harmonieuse des mots dans la phrase : Cic. Part. 21
— [phil.] syllogisme conjonctif, proposition conjonctive : Cic. Ac. 2, 91 ; Top. 57 ; Fat. 12, etc.
— [gram.] conjonction, particule de liaison : Cic. Or. 135 ; Quint. 9, 3, 50, etc.
¶1. propriété cohérente (inhérente), inséparable d'un corps : Lucr. 1, 451
¶2. [plur.] mots de même famille : Cic. de Or. 2, 166
¶3. proposition conjointe (συμπεπλεγμένον) : Gell. 16, 8, 10.
¶1. lié, connexe, concordant : conjuncta constantia inter augures Cic. Div. 2, 82, accord constant des augures entre eux ; cum omnium nostrum conjunctum esset periculum Cic. Fam. 4, 9, 2, comme nous courions tous le même danger
— conjuncta verba Cic. de Or. 3, 149, mots liés ensemble ; conjunctæ causæ Quint. 3, 6, 94, causes complexes (conjuncta ex pluribus causa Quint. 6, 1, 54, cause formée du mélange de plusieurs)
— talis simulatio vanitati est conjunctior quam liberalitati Cic. Off. 1, 44, une telle feinte touche plus à la tromperie qu'à la bienfaisance ; officii præcepta conjuncta naturæ Cic. Off. 1, 6, préceptes moraux d'accord avec la nature
¶2. uni par les liens de l'amitié, du sang, etc. : vir conjunctissimus mecum consiliorum omnium societate Cic. Br. 2, homme que la communauté complète des idées politiques avait étroitement uni à moi ; conjunctissimo animo cum aliquo vivere Cic. Verr. 4, 93, vivre en relations très cordiales avec qqn ; alicui conjunctissimus Cic. Prov. 38, intimement lié à qqn ; ut inter nos conjunctiores simus Cic. Att. 14, 13 B, 5, pour resserrer encore les liens de notre amitié réciproque
— [abst] : conjunctus Quint. 7, 4, 21, parent ; Nep. Att. 7, 1, ami
¶3. uni par le mariage : Varr. R. 1, 17, 5 ; Virg. B. 8, 32 ; [fig., en parl. de la vigne mariée à l'ormeau] Catul. 62, 54.
¶1. lier ensemble, joindre, unir : [constr. avec cum, avec dat., avec inter se] : boves conjungere Cat. Agr. 138, atteler des bœufs ; dextras Virg. En. 1, 514, unir les mains (se serrer la main) ; eam epistulam cum hac epistula conjunxi Cic. Fam. 7, 30, 3, j'ai joint cette lettre à la présente ; eas cohortes cum exercitu suo conjunxit Cæs. C. 1, 18, 4, il réunit ces cohortes à son armée ; libido quæ cum probro privato conjungeret imperii dedecus Cic. CM 42, une licence [si détestable] qu'elle unissait au déshonneur personnel le discrédit de la fonction officielle ; aliquem cum deorum laude conjungere Cic. Pis. 20, associer qqn à la glorification des dieux, le glorifier comme les dieux ; aliquid cum aliqua re conjungitur Cic. Clu. 103, qqch se lie à une chose (a du rapport avec elle)
— castra oppido conjuncta Cæs. C. 2, 25, 1, camp adossé à la place forte ; huic navi alteram conjunxit Cæs. C. 3, 39, 2, à ce navire il en réunit un autre : noctem diei conjunxerat Cæs. C. 3, 13, 2, il avait joint la nuit au jour [marché jour et nuit]; alicui conjungi Liv. 42, 47, 3, etc. (se conjungere Curt. 8, 13, 4), se joindre à qqn ; dextræ dextram Ov. M. 8, 421, unir sa main droite à celle d'un autre ; castra ad Corbionem castris sunt conjuncta Liv. 3, 69, 9, ils établirent leur camp près du camp ennemi aux environs de Corbion (4, 32, 6) ; cf. confero §{} 3
— corporis atque animi potestas inter se conjuncta Lucr. 3, 559, les facultés du corps et de l'âme unies entre elles
— laudem alicujus ad utilitatem nostræ causæ Quint. 4, 1, 16, faire servir l'éloge de qqn à notre cause
— cum in tui familiarissimi judicio tuum crimen conjungeretur Cic. Fam. 5, 17, 2, alors que les griefs articulés contre toi se mêlaient dans le procès de ton intime ami
— [abst] : se conjungere, conjungi, se joindre, se réunir, faire corps : ut paulatim sese legiones conjungerent Cæs. G. 2, 26, 1, pour que peu à peu les légions fissent leur concentration (Liv. 33, 3, 10 ; 38, 2, 9) ; ne tantæ nationes conjungantur Cæs. G. 3, 11, 3, pour empêcher que de si puissantes nations se réunissent
— [pass.] être formé par liaison, union : exercitus qui conjunctus est ex duobus Cic. Phil. 12, 8, armée qui est formée de deux autres, cf. Fin. 2, 44
— mettre en commun : bellum conjungunt Cic. Pomp. 26, ils font la guerre en commun ; cum amicis injuriam conjungere Cic. Fin. 3, 71, associer des amis à une injustice
— maintenir lié, maintenir une continuité dans qqch : abstinentiam cibi conjunxit Tac. An. 6, 26, il s'abstint de toute nourriture, cf. An. 4, 57 ; Suet. Cal. 17
— [gram.] verba conjungere Quint. 8, 3, 36, faire des mots composés
— [rhét.] vocales Cic. Or. 150, fondre ensemble deux voyelles en hiatus [= élider]
¶2. unir par les liens de l'amitié, de la famille, etc. : cognatione cum populo Romano conjunctus Cic. Verr. 4, 72, uni au peuple romain par des liens de parenté ; aliquem alicui Cic. Fam. 15, 11, 2, lier qqn à qqn (créer des liens entre eux) ; aliquem sibi Cæs. C. 3, 21, 4, s'attacher qqn ; homines scelerum fœdere inter se conjuncti Cic. Cat. 1, 33, hommes associés par une alliance de crimes
— constituer [par un lien] : necessitudinem cum aliquo Cic. Verr. 4, 145, se lier intimement avec qqn ; societas inter homines natura conjuncta Cic. Off. 3, 53, société établie par la nature entre les hommes
— [en part.] unir par le mariage, marier : aliquam matrimonio secum conjungere Curt. 6, 9, 30 (sibi Suet. Ner. 28), prendre une femme pour épouse ; Poppææ conjungitur Tac. an 14, 60, il se marie avec Poppée ; Sabinorum conubia conjungere Cic. de Or. 1, 37, nouer (conclure) des mariages avec les Sabins (Fin. 4, 17).
¶1. action de jurer ensemble : Serv. En. 7, 614 ; 8, 5
¶2. conjuration, alliance [de peuples contre Rome] : Cæs. G. 3, 10, 2 ; 4, 2, 30 ; Liv. 6, 2, 2, etc.
¶3. conspiration, complot : Cic. Verr. 5, 10 ; Cat. 1, 6, etc. ; conjurationem facere contra rem publicam Cic. Cat. 2, 6, former une conspiration contre l'État ; conjuratio deserendæ Italiæ ad Cannas facta Liv. 24, 43, 3, le complot formé à Cannes d'abandonner l'Italie
— conjuratio in omne facinus Liv. 39, 18, 3, association (scellée par serment) en vue de toute espèce de crime, cf. 39, 8, 3
¶4. conjuration = les conjurés : cetera multitudo conjurationis Sall. C. 43, 1, le reste des conjurés.
¶1. jurer ensemble ; [t. milit.] prêter le serment en masse [non individuellement] : Cæs. G. 7, 1, 1 ; conjurati Liv. 45, 2, 1, qui ont prêté en masse le serment de fidélité au drapeau
¶2. se lier par serment, se liguer : Virg. En. 8, 5 ; Cæs. G. 3, 23, 2, etc. ; cum ceteris Liv. 34, 11, 7, se liguer avec les autres peuples
— [avec prop. inf.] : inter se conjurant, nihil... acturos Cæs. G. 3, 8, 3, ils s'engagent entre eux par serment à ne rien faire... ; conjurant... se non redituros Liv. 26, 25, 11, ils s'engagent par serment à ne pas revenir...
— [avec subj. seul] Pl. Merc. 536 ; [avec ut subj.] Bell. Hisp. 36, 4
— [av. inf.] Græcia conjurata tuas rumpere nuptias Hor. O. 1, 15, 7, la Grèce liguée pour rompre ton mariage
— in facinora Liv. 39, 16, 3, former une association en vue de crimes
¶3. conspirer, former un complot : Cic. Verr. 5, 17 ; Sull. 60, etc. (inter se Sall. J. 66, 2) ; de interficiendo Pompeio Cic. Mil. 65, comploter le meurtre de Pompée
— [avec inf.] comploter de : Sall. C. 52, 24 ; Liv. 27, 3, 4
— [avec ut subj.] Liv. 4, 51, 1 ; [avec quo subj.] Liv. 39, 14, 8.
===> conjunx Prisc. 140, 21 ; 166, 15, etc., et très souvent d. les mss.
¶1. compter avec (ensemble) : connumerare aliquem inter liberos Dig. 1, 5, 14, compter qqn parmi les enfants
¶2. ajouter à [av. dat.] : Ulp. Dig. 23, 2, 43.
¶1. général athénien : Nep. Con.
¶2. astronome grec : Catul. 66, 7 ; Virg. B. 3, 40.
¶1. se préparer : Ter. Haut. 240 ; ego obviam conabar tibi Ter. Phorm. 52, je me disposais à aller à ta rencontre ; conantibus, priusquam id effici posset, adesse Romanos nuntiatur Cæs. G. 6, 4, 1, comme ils se mettaient en mesure, avant que la chose pût être exécutée, on leur annonce l'arrivée des Romains
¶2. se préparer à qqch, entreprendre qqch : magnum opus et arduum conamur Cic. Or. 33, c'est une œuvre importante et ardue que j'entreprends, cf. Cat. 2, 19 ; Fin. 1, 82 ; frg. d. Quint. 5, 13, 30 ; Liv. 42, 59, 8
— [surt. construit av. inf.] Cic. Amer. 54 ; de Or. 2, 61 ; Ac. 1, 35 ; Clu. 57 ; id quod constituerant facere conantur Cæs. G. 1, 5, 1, ils entreprennent de faire ce qu'ils avaient résolu ; [av. ut] B. Afr. 69 et décad.
— [avec si subj.] faire des tentatives pour le cas où : Cæs. G. 1, 8, 4.
¶1. tr., rendre carré, équarrir : Varr. Men. 96 ; Col. 8, 3, 7
¶2. int., cadrer avec ou ensemble : Sid. Ep. 2, 2, 4.
===> .
¶1. secouer fortement : Cic. Div. 1, 97
— briser, casser : Cat. Agr. 52, 2
¶2. [fig.] ébranler, bouleverser : mens conquassatur Lucr. 3, 600, l'esprit est disloqué ; provinciæ conquassatæ sunt Sulpic. d. Cic. Fam. 4, 5, 4, les provinces ont été bouleversées, cf. Cic. Vat. 19 ; Sest. 56.
¶1. action de se plaindre vivement, de déplorer : conquestiones dolorum præteritorum Sen. Ep. 78, 12, lamentations sur des maux passés
— cri plaintif : Plin. 10, 66
¶2. action de formuler une plainte, un reproche : nullum auxilium est, nulla conquestio Cic. Q. 1, 1, 22, il n'y a nulle assistance, nulle possibilité de plainte, cf. Mur. 7 ; 72
¶3. [rhét.] partie de la péroraison où l'on sollicite la compassion des juges : Cic. Inv. 1, 106 ; 2, 51 ; etc.
===> .
===> formes sync. du parf. : conquiesti Cic. Fam. 1, 1, 1 ; conquierunt Cels. 1, 3 ; conquierint Cels. 6, 6, 34 ; conquiesse Afran. Com. 341 ; Liv. 30, 13, 12
— conquieturus Cic. Mil. 68.
===> formes sync. du parf. : conquisierunt Her. 1, 1 ; conquisierit Cic. Ac. 2, 87 ; Verr. 4, 1 ; conquisisset Cic. Verr. 3, 22
— formes arch. conquæro, conquæsivei, etc. CIL 10, 6950, 11 ; 1, 198, 34 ; 1, 198, 31.
===> consiptum arch. p. consæptum Enn. 335 (P. Fest. 62, 10 ; 64, 5).
¶1. né du même sang, fraternel, de frères : Ov. M. 8, 476 ; Stat. Th. 11, 61
¶2. m. pris subst, parent, [en part.] frère : Cic. Att. 2, 23, 3 ; Ambarri, consanguinei Æduorum Cæs. G. 1, 11, 4, les Ambarres, frères de race des Éduens
— [fig.] consanguineus Leti Sopor Virg. En. 6, 278, le Sommeil parent de la Mort.
===> .
¶1. int., in equos Ov. M. 6, 222 (Lucr. 5, 1297) ; in montem Petr. 116, 1 ; in navem Pl. Bac. 277 ; Cic. Fam. 14, 17, 2 ; Att. 14, 16, 1, monter sur des chevaux, sur une montagne, sur un navire ; cf. *Cæs. G. 5, 7, 4
— [fig.] ad consulatum Val.-Max. 3, 4, 4, s'élever au consulat
¶2. tr., equos Virg. En. 12, 736 ; Liv. 25, 18, 6, etc. ; currum Lucr. 6, 47 ; vallum Cæs. G. 5, 39, 3 ; navem Pl. Merc. 946 ; Cic. Pis. 93 ; Off. 3, 48, etc.; Cæs. G. 4, 23, 1 ; C. 1, 27, 5, etc., monter sur des chevaux, sur un char, sur un retranchement [pour le défendre], sur un navire
— [abst] conscendere, s'embarquer : Cic. Vat. 12 ; Att. 9, 2, etc. ; Cæs. C. 2, 43, 4 ; Liv. 21, 49, 8, etc. ; ab aliquo loco Cic. Phil. 1, 7 ; Att. 9, 14, 3 ; e Pompeiano Cic. Att. 16, 3, 6, s'embarquer à un endroit [= partir par mer d'un endroit], s'embarquer au sortir de la maison de campagne de Pompéies ; Thessalonicæ Liv. 44, 23, 9, s'embarquer à Thessalonique
— [fig.] laudis carmen Prop. 2, 10, 23, s'élever au ton du panégyrique.
¶1. connaissance de qqch partagée avec qqn, connaissance en commun ;
a) [gén. subj.] : hominum conscientia remota Cic. Fin. 2, 28, toute possibilité pour le monde d'avoir une connaissance de la chose étant écartée (= sans que le monde puisse en prendre connaissance) ; consilia seducta a plurium conscientia Liv. 2, 54, 7, des assemblées qui ne sont dans la confidence que d'un petit nombre ; liberti unius conscientia utebatur Tac. An. 6, 21, il n'admettait qu'un seul affranchi dans la confidence ; est tibi Augustæ conscientia Tac. An. 2, 77, tu as la connivence d'Augusta ;
b) [gén. obj.] : in conscientiam facinoris pauci adsciti Tac. H. 1, 25, un petit nombre seulement furent mis dans la confidence du crime ; consilia conscientiæque ejus modi facinorum Cic. Clu. 56, les instigations et la complicité dans de tels forfaits ; propter conscientiam mei sceleris Cic. Clu. 81, pour complicité dans mon crime, pour avoir été d'intelligence avec moi dans le crime
¶2. claire connaissance qu'on a au fond de soi-même, sentiment intime : mea conscientia copiarum nostrarum Cic. Q. 2, 14, 2, le sentiment que j'ai de nos ressources ; conscientia virium et nostrarum et suarum Liv. 8, 4, 10, la claire conscience qu'ils ont de nos forces comme des leurs ; conscientia quid abesset virium Liv. 3, 60, 6, sentant bien l'infériorité de leurs forces ; victoriæ Tac. Agr. 27, le sentiment de la victoire
— præcipitis ut nostram stabilem conscientiam contemnamus, aliorum errantem opinionem aucupemur Cic. Fin. 2, 71, vous nous engagez à mépriser l'assurance que nous donne notre sentiment intime pour rechercher l'opinion flottante d'autrui ; salva conscientia Sen. Ep. 117, 1, sans sacrifier mon sentiment intime (mes convictions)
¶3. [sens moral] sentiment intime de qqch, claire connaissance intérieure : bene actæ vitæ Cic. CM 9, la conscience d'avoir bien rempli sa vie ; fretus conscientia officii mei Cic. Fam. 3, 7, 6, fort du sentiment que j'ai d'avoir rempli mes devoirs ; optimæ mentis Cic. Br. 250, le sentiment d'avoir eu d'excellentes intentions ; mediocrium delictorum conscientia Cic. Mil. 64, la conscience d'avoir commis de légères peccadilles ; cum conscientia scelerum tuorum agnoscas... Cic. Cat. 1, 17, du moment que, conscient de tes crimes, tu reconnais... ; satisfactionem ex nulla conscientia de culpa proponere Catilina d. Sall. C. 35, 2, présenter une justification tirée du fait de n'avoir pas conscience d'une faute (d'un sentiment de son innocence)
¶4. sentiment, conscience [avec idée de bien, de mal] : conscientia animi Cic. Fin. 2, 54 ; Cæs. C. 3, 60, 2, témoignage de la conscience, voix de la conscience ; recta Cic. Att. 13, 20, 4 ; bona Sen. Ep. 43, 5, bonne conscience ; mala Sall. J. 8, mauvaise conscience
— [abst] bonne conscience : nihil me præter conscientiam meam delectavit Cic. Att. 15, 11, 3 (Att. 12, 28, 2), rien ne m'a fait plaisir à part la conscience d'avoir bien agi, cf. Mil. 61 ; 83 ; Clu. 159 ; Tusc. 2, 64 ; conscientia mille testes Quint. 5, 11, 41, conscience vaut mille témoins ; salvā bonā conscientiā Sen. Nat. 4, pr. 15, en conservant la conscience pure
— [abst] mauvaise conscience : angor conscientiæ Cic. Leg. 1, 40, les tourments qu'inflige la conscience ; an te conscientia timidum faciebat ? Cic. Verr. 5, 74, ou bien ta conscience te rendait-elle craintif ? cf. Cat. 2, 13 ; 3, 10 ; Leg. 2, 43, etc. ; ex conscientia diffidens Sall. J. 32, 5, défiant par suite de la conscience qu'il a de ses crimes ; ne quis modestiam in conscientiam duceret Sall. J. 85, 26, pour empêcher qu'on n'interprétât ma réserve comme la conscience de mon indignité
— [d'où] remords : animi conscientia excruciari Cic. Fin. 2, 53, être tourmenté par le remords ; maleficii conscientia perterritus Cic. Clu. 38, effrayé par le remords de son crime ; te conscientiæ stimulant maleficiorum tuorum Cic. Par. 18, les remords de tes crimes t'aiguillonnent, cf. Amer. 67 ; conscientia morderi Cic. Tusc. 4, 45, souffrir des remords de conscience, cf. Off. 3, 85 ; Sall. C. 15, 4.
¶1. [t. officiel] décider [en commun], arrêter : Cic. Leg. 3, 10 ; Liv. 1, 32, 13 ; 10, 18, 2
¶2. sibi consciscere, décider pour soi, se résoudre à : mortem Cic. Clu. 171 ; Verr. 3, 129 ; Br. 43, etc., se donner la mort ; conscientia sibimet ipsi exsilium consciscentes Liv. 29, 36, 12, par conscience de leur culpabilité se frappant eux-mêmes d'exil
— [sans sibi] : Pl. Mil. 1241 ; Liv. 9, 26, 7 ; voluntarium consciverat exsilium Liv. 24, 26, 1, il s'était infligé un exil volontaire
— facinus in se ac suos fœdum consciscunt Liv. 28, 22, 5, ils se résolvent contre eux-mêmes et les leurs à un acte atroce
¶3. se procurer, se ménager qqch : Decl. Catil. 74.
===> formes sync. : conscisset Cic. Clu. 171 ; conscisse Liv. 4, 51, 3.
¶1. ayant connaissance de qqch avec qqn, partageant la connaissance de, confident : homo meorum in te studiorum maxime conscius Cic. Fam. 5, 5, 1, l'homme du monde qui est le plus dans la confidence du dévouement que je te témoigne
— [d'où] qui participe à, complice : maleficii Cic. Clu. 59, complice du crime ; interficiendi Agrippæ Tac. An. 3, 30, complice du meurtre d'Agrippa ; conscios delendæ tyrannidis indicare Cic. Tusc. 2, 52, dénoncer les conjurés qui conspiraient la destruction de la tyrannie
— [avec dat.] : facinori Cic. Cæl. 52, complice d'un crime ; mendacio meo Cic. Verr. 4, 124, complice de mon mensonge
— conscium esse alicui alicujus rei Sall. C. 22, 2 (Ter. Phorm. 156 ; Curt. 6, 6, 36 ; Tac. An. 1, 43), être complice avec qqn de qqch
— [avec in abl.] : in privatis omnibus (rebus) conscius Cic. Att. 1, 18, 1, mon confident dans toutes les affaires privées
— [avec de] Cic. Att. 2, 24, 3, qui est dans le secret d'une chose, complice
¶2. ayant la connaissance intime de, conscient de ; [avec sibi] : cum sibi nullius essent conscii culpæ Cic. Off. 3, 73, conscients de n'avoir aucune responsabilité ; mens sibi conscia recti Virg. En. 1, 604, intelligence consciente du bien, cf. Cæs. G. 1, 14, 2
— [avec in abl.] : nulla sibi turpi conscius in re Lucr. 6, 393, qui a conscience de n'avoir trempé dans aucun acte honteux
— [avec prop. inf.] : mihi sum conscius numquam me... fuisse Cic. Tusc. 2, 10, j'ai conscience de n'avoir jamais été... (Ter. Ad. 348 ; Cic. Fam. 6, 21, 1 ; Liv. 1, 49, 2, etc.)
— [avec int. ind.] : cum mihi conscius essem, quanti te facerem Cic. Fam. 13, 8, 1, ayant conscience de la haute estime que j'ai pour toi
— [abst] : conscii sibi Sall. J. 40, 2, se sentant coupables (Liv. 33, 28, 8 ; Ov. H. 20, 47)
— [sans sibi] : lupus, conscius audacis facti Virg. En. 11, 812, le loup, conscient de son acte audacieux ; conscia mens recti Ov. F. 4, 311, n'ayant rien à se reprocher ; [poét.] conscia virtus Virg. En. 5, 455, courage conscient de lui-même [la conscience de sa valeur]
— [en mauv. part] : conscius animus Lucr. 4, 1135, âme consciente de sa faute, qui se sent coupable (Pl. Most. 544 ; Sall. C. 14, 3).
¶1. inscrire sur une liste, enrôler : legiones Cæs. G. 1, 10, 3, etc. ; exercitum Cic. Pis. 37, enrôler des légions, une armée ; centuriæ tres equitum conscriptæ sunt Liv. 1, 13, 8, on inscrivit (créa) trois centuries de chevaliers
— Collinam novam Cic. Mil. 25, enrôler (former) une nouvelle tribu Colline ; conscribere Cic. Planc. 45, enrôler = former des cabales
¶2. composer, rédiger : librum Cic. Br. 132 ; legem Cic. Agr. 1, 1 ; epistulam Cic. Att. 13, 50, 1 ; condiciones Liv. 26, 24, 8, écrire un livre, rédiger une loi, une lettre, des conditions ; singularum rerum laudes vituperationesque conscribere Cic. Br. 47, composer par écrit sur chaque objet les deux thèses pour et contre
— [abst] écrire : alicui Cic. Att. 11, 5, 3 (ad aliquem Cic. Att. 12, 19, 2) ; de aliqua re Cic. Leg. 1, 13, écrire à qqn, sur qqch ; [avec prop. inf.] écrire que : Suet. Claud. 38
¶3. [poét.] marquer qqch de caractères écrits : mensam vino Ov. Am. 2, 5, 17, écrire avec du vin sur la table
— [plais.] écrire sur le dos de qqn, le sillonner de coups : Pl. Pseud. 545.
===> parf. sync. conscripsti Pl. As. 746.
===> .
¶1. mettre en petits morceaux, hacher : Cat. Ag. 157, 5 ; membra fratris Ov. Tr. 3, 9, 34, couper en morceaux le corps de son frère
¶2. couper autour, détacher en coupant : surculos Plin. 12, 96, couper les scions.
¶1. action de consacrer aux dieux : Cic. Dom. 106 ; 125 ; 128
¶2. action de dévouer aux dieux l'infracteur d'une loi : capitis Cic. Balb. 33, action d'appeler l'anathème sur la tête de l'infracteur
¶3. apothéose des empereurs romains : Suet. Dom. 2 ; Tac. An. 13, 2
¶4. cérémonie magique : Tert. Idol. 15
— protection contre les charmes, amulette : Lampr. Hel. 9, 1.
¶1. consacrer, frapper d'une consécration religieuse : alicujus domum Cic. Dom. 51 ; possessiones Cic. Dom. 127 ; bona Liv. 43, 16, 10, consacrer aux dieux la maison, les biens de qqn, en faire des objets sacrés, cf. P. Fest. 321
— [avec dat.] consacrer à : Martis manubias Musis Cic. Arch. 27, consacrer aux Muses les dépouilles de Mars (Verr. 4, 67 ; 4, 106 ; etc.)
— consecrātus, a, um [souvent] = consacré, saint, enlevé à l'usage profane : Cic. Part. 36 ; Cæs. G. 6, 13, 10 ; 6, 17, 4
¶2. dévouer aux dieux infernaux comme rançon d'une infraction à qqch de consacré : Cic. Balb. 33 ; te tuumque caput sanguine hoc consecro Liv. 3, 48, 5, par ce sang je te dévoue toi et ta tête aux dieux infernaux (j'appelle sur toi leur malédiction) ; cf. Macr. Sat. 3, 9, 10
¶3. consacrer, reconnaître comme ayant un caractère sacré (divin) : Liber, quem nostri majores consecraverunt Cic. Nat. 2, 62, Bacchus, que nos ancêtres ont mis au rang des dieux (Leg. 2, 27, etc. ; Nat. 2, 66)
— tuas virtutes consecratas et in deorum numero conlocatas vides Cic. Q. 1, 1, 31, tu vois tes vertus consacrées et déifiées, cf. Leg. 2, 28
— [apothéose des empereurs] diviniser : Tac. An. 13, 14 ; Suet. Tib. 51 ; Cal. 35, etc.
¶4. [fig.] = immortaliser : Cic. Verr. 2, 51, etc.; Nat. 3, 50 ; Tusc. 5, 11, etc.
¶5. part. consecratus, a, um, qqf = imputé (attribué) [comme qqch de divin] : Cic. Tusc. 3, 1 ; Curt. 8, 5, 17
— consecratum exemplum Plin. 32, 5, exemple consacré.
¶1. s'attacher aux pas de qqn : Ter. Eun. 249
— suivre constamment : Pl. Pseud. 1235 ; Cic. de Or. 2, 117 ; Fin. 5, 56
¶2. [fig.] poursuivre, rechercher : potentiam Cic. Off. 1, 86, rechercher la puissance ; verba Cic. Cæc. 54, s'attacher uniquement aux mots (à la lettre) ; aliquid imitando Cic. de Or. 2, 90, chercher à imiter qqch ; ne plura consecter Cic. de Or. 1, 34, pour ne pas rechercher dans mon exposé un plus grand nombre de considérations
¶3. [idée d'hostilité] : aliquem clamoribus, sibilis Cic. Att. 2, 18, 1, poursuivre qqn de cris, de sifflets ; hostes Cæs. G. 3, 26, 6, poursuivre l'ennemi opiniâtrément ; eos equitatu consectatus Cic. G. 6, 8, 7, s'étant mis à leurs trousses avec la cavalerie ; maritimos prædones Nep. Them. 2, 3, traquer les pirates.
===> inf. pr. consectarier Pl. Pseud. 1235
— sens pass., être poursuivi : Laber. 141 ; cf. Prisc. 793.
¶1. suite, conséquence : afferre consecutionem voluptatis Cic. Fin. 1, 37, produire un effet de plaisir ; cf. Fin. 2, 45 ; de Or. 3, 313
— [rhét.]
a) conclusion : Cic. Inv. 1, 45 ;
b) liaison appropriée : consecutio verborum Cic. Part. 18, construction correcte de la phrase
¶2. action d'obtenir, acquisition, obtention : Tert. Bapt. 18 ; Resur. 52.
¶1. vieillir, arriver à un âge avancé : Ov. M. 8, 634, etc.; Suet. Gr. 6
¶2. [fig.] vieillir, languir : Liv. 9, 19, 6 ; 35, 34, 7, etc. ; in commentariis rhetorum Quint. 3, 8, 67, vieillir (pâlir) sur les traités des rhéteurs
— s'user, dépérir, se consumer : filia lacrimis consenescebat Cic. Clu. 13, la fille se consumait dans les larmes ; quamvis consenuerint vires Cic. CM 29, quel que soit le degré d'affaiblissement des forces ; invidia consenescit Cic. Clu. 5, la haine s'épuise ; omnes illius partis auctores ac socios consenescere Cic. Att. 2, 23, 2, [je te dirai] que tous les chefs et les adhérents de ce parti s'affaiblissent (perdent leur importance) ; noster amicus Magnus, cujus cognomen consenescit Cic. Att. 2, 13, 2, notre ami Pompée dont le surnom de Grand vieillit (perd de sa signification).
¶1. conformité dans les sentiments, accord : omnium gentium Cic. Tusc. 1, 30, accord de toutes les nations ; universæ Galliæ consensio libertatis vindicandæ Cæs. G. 7, 76, 2, accord de la Gaule entière pour reconquérir l'indépendance ; singularis omnium bonorum consensio in me tuendo Cic. Fam. 1, 9, 13, un accord sans exemple de tous les gens de bien en ma faveur ; de aliqua re Cic. Sen. 38, accord sur qqch
— consensio naturæ Cic. de Or. 3, 20, harmonie de l'univers
¶2. [mauv. part] conspiration, complot : Cic. Verr. 5, 9 ; Planc. 37, etc. ; globus consensionis Nep. Att. 8, 4, le noyau de la conjuration.
¶1. accord : Cic. Phil. 4, 12 ; Tusc. 1, 35, etc. ; omnium vestrum consensu Cæs. G. 7, 77, 4, d'après votre jugement unanime ; consensu eorum omnium, Cæs. G. 2, 29, 5, à l'unanimité (ex communi consensu Cæs. G. 1, 30, 4) ; haud dubio consensu civitatis Liv. 9, 7, 15, avec l'assentiment sans réserve de la cité
— aliis Germanorum populis usurpatum raro... apud Chattos in consensum vertit Tac. G. 31, un usage rare chez les autres peuples germaniques est devenu une règle universelle chez les Chattes
— cœtus multitudinis juris consensu sociatus Cic. Rep. 1, 39, association d'une foule d'hommes fondée sur un droit reconnu par tous
— = συμπάθεια : Lucr. 3, 740 ; Cic. Div. 2, 34 ; Nat. 3, 28 (v. conjunctio)
¶2. [mauv. part.] conspiration, complot : Cic. Sest. 86 ; Liv. 4, 14, 4, etc.
I. int.,
¶1. être de même sentiment, être d'accord : animi consentientes Cic. Div. 2, 119, âmes qui sont d'accord ; re consentientes vocabulis differebant Cic. Fin. 4, 5, d'accord sur le fond, ils différaient sur les termes ; de amicitiæ utilitate omnes uno ore consentiunt Cic. Læ. 86, tous d'une seule voix s'accordent à reconnaître l'utilité de l'amitié ; omnes ordines ad conservandam rem publicam mente, voluntate consentiunt Cic. Cat. 4, 18, tous les ordres de l'État n'ont qu'une âme, qu'une volonté pour le salut public
— cum aliquo, être d'accord avec qqn : Pl. Cas. 59 ; Cic. Agr. 1, 26 ; Fin. 4, 72 ; Att. 4, 5, 1
— alicui, alicui rei, être d'accord avec qqn, avec qqch : Clu. 60 ; Fin. 2, 34, etc.; sibi consentire Cic. Off. 1, 5, être conséquent avec soi-même
— [avec prop. inf.] s'accorder à dire que, reconnaître unanimement que : Cic. Fin. 2, 116 ; Rep. 1, 56 ; Phil. 4, 7, etc. (consentitur Gell. 10, 7, 1, on est d'accord pour reconnaître)
— [avec ut] : consensum est ut Liv. 30, 24, 11, il y eut accord pour décider que, cf. 1, 32, 13
— [avec int. ind.] décider en commun : Plin. 10, 58
¶2. s'entendre, conspirer, comploter : [abst] Lex Corn. Cic. Clu. 157 ; Cæs. C. 1, 30, 3 ; 2, 17, 3 ; Liv. 22, 1, 3
— [avec cum] s'entendre (faire cause commune) avec : Cæs. G. 2, 3, 2 ; 2, 3, 5 ; 5, 29, 6
— ad aliquid, pour qqch : Liv. 27, 9, 14 ; 39, 50, 6
— [avec inf.] comploter de : Cic. Agr. 1, 15 ; Phil. 2, 17 ; Fam. 6, 18, 2
— [avec ut] se mettre d'accord pour que, comploter de : Plin. 14, 64 ; Tac. An. 13, 23
¶3. [en parl. de choses] être d'accord : [abst] ratio nostra consentit, pugnat oratio Cic. Fin. 3, 10, nos idées sont d'accord, il n'y a conflit que dans l'expression
— [surtout au part. prés.] consentiens, d'accord, unanime : consentiens laus bonorum Cic. Tusc. 3, 3, l'éloge donné unanimement par les gens de bien ; hominum consentiente auctoritate contenti Cic. Div. 1, 84, satisfaits de la garantie unanime de nos semblables ; in homine non omnia in unum consentientia Liv. 2, 32, 9, l'harmonie ne régnant pas entre toutes les parties du corps humain
— [avec dat.] Cic. Fin. 3, 45 ; 5, 66 ; etc. ; [avec cum] Mur. 1 ; Br. 141, etc. ; Cæs. C. 1, 19, 2 ; [avec inter se] Cic. Off. 1, 98
— de aliqua re Cic. Nat. 1, 44 ; CM 61.
II. tr., décider en accord : bellum Liv. 8, 6, 8, être d'accord pour décider la guerre (1, 32, 12) ; consensa in posterum diem contio Liv. 24, 37, 11, l'assemblée fut décidée d'un commun accord pour le lendemain.
¶1. [gram.] bien construit : non consequens Cic. Part. 18, contraire à la construction
¶2.
a) connexe : pro verbo proprio subicitur aliud, quod idem significet, sumptum ex re aliqua consequenti Cic. Or. 92, au mot propre on en substitue un autre, qui ait le même sens, pris à qq idée voisine ;
b) ce qui suit logiquement : quid cuique consequens sit quidque contrarium Cic. Or. 115, [savoir] ce qui se rattache logiquement à un objet et ce qui est en contradiction avec lui (Fin. 4, 55)
— consequentia Cic. Or. 16, les conséquences logiques (de Or. 2, 166 ; Leg. 1, 45)
— consequens est avec prop. inf. Cic. Tusc. 5, 18, il s'ensuit logiquement que
— consequens est avec ut subj., il est raisonnable, logique que : Cic. Leg. 1, 15 ; [avec prop. inf.] Quint. 5, 10, 77.
I. tr.,
¶1. venir après, suivre aliquem, suivre qqn : Pl. Amp. 880, etc. ; Cic. Verr. 5, 104, etc. ; aliquem vestigiis Cic. Clu. 36, suivre qqn à la trace
— poursuivre [l'ennemi] : Cæs. G. 3, 19, 4 ; Liv. 22, 6, 11, etc.
¶2. suivre [chronologiquement] : hunc consecutus est Syracusius Philistus Cic. de Or. 2, 57, après lui [Thucydide] vint Philistus de Syracuse (2, 93)
¶3. poursuivre, rechercher qqch : voluptates Cic. Fin. 1, 48 ; laudem Cic. Part. 79, rechercher les plaisirs, l'estime ; exilitatem Cic. Br. 284, la maigreur du style
¶4. suivre comme conséquence : eorum opinionem magni errores consecuti sunt Cic. Tusc. 1, 36, leur opinion a donné lieu à de grossières erreurs (4, 19 ; Phil. 1, 32 ; Nep. Dion. 6, 4)
¶5. atteindre, rejoindre, rattraper [qqn] : Cic. Tusc. 1, 103 ; Att. 3, 4, etc.; Cæs. G. 7, 88, 7 ; C. 2, 35, 1, etc.; Liv. 3, 23, 5, etc.
— atteindre un lieu : Cic. Phil. 14, 32 ; Fam. 7, 28, 2
— [fig.] atteindre, obtenir, acquérir [qqch] : honores Cic. Planc. 13, obtenir les magistratures ; quæstus Cic. Pomp. 34, réaliser des gains ; aliquid ab aliquo Cic. Sest. 57 ; Mur. 71, etc., obtenir qqch de qqn ; aliquid ex aliqua re Cic. Pomp. 2 ; Fin. 1, 32, retirer qqch de qqch
— hoc consequi ut subj. Cic. de Or. 1, 130 ; 2, 139, obtenir ce résultat que ; utrumque consequitur ut et... et... Cic. Tusc. 3, 34, il obtient ce double avantage de... et de... ; hoc consequi ne Cic. Clu. 51 ; Fam. 1, 2, 4 ; 1, 9, 6, obtenir ce résultat d'empêcher que ; [avec inf.] vere illud dicitur perverse dicere homines perverse dicendo facillime consequi Cic. de Or. 1, 150, le proverbe a raison de dire qu'en parlant mal on arrive vite à mal parler
— atteindre, égaler : [qqn] Cic. Br. 228 ; Sen. Ben. 5, 5, 3 ; [qqch] de Or. 2, 56 ; Fam. 1, 68 ; Quint. 10, 2, 7
— atteindre, réaliser par la parole, exprimer dignement : verbis laudem alicujus Cic. Sest. 87, exprimer en termes suffisants la gloire de qqn (Phil. 5, 35 ; 14, 29 ; Quir. 5)
— atteindre, embrasser (par la mémoire) : aliquid memoria consequi Cic. Verr. 4, 57 ; Plin. Pan. 75, 1
— atteindre qqn [= lui échoir en partage] : uti Verrem dignus exitus ejusmodi vita consequatur Cic. Verr. 5, 189, [je demande] qu'une fin digne d'une telle existence atteigne Verrès (Sest. 51 ; Nat. 1, 26 ; Fin. 1, 32 ; Quint. 2, 10, 14).
II. int., venir ensuite : præmisso Octavio... consecutus est Dolabella Cic. Phil. 11, 5, Octavius ayant été envoyé en avant..., Dolabella vint ensuite (Phil. 10, 8 ; Cæs. G. 4, 26, 5 ; C. 3, 106, 2)
— [chronologiquement] : Verr. pr. 31 ; Br. 12, etc. ; vilitas annonæ ex summa inopia consecuta est Cic. Pomp. 44, le bas prix du blé a succédé à l'extrême disette
— [comme conséquence] : Part. 133 ; Fin. 4, 54 ; ex quo illud natura consequi ut subj. Cic. Fin. 3, 64, [d'après eux] il s'ensuit naturellement que...
===> sens passif, d'après Prisc. 8, 16 et 8, 18, d. Orbil. et Varr.
¶1. planter, ensemencer : agros Cic. Nat. 2, 130, ensemencer des champs ; ager diligenter consitus Cic. CM 59, parc planté avec soin ; ager arbustis consitus Sall. J. 53, 1, terrain planté d'arbres
— [en parl. de la fécondation] Lucr. 4, 1107 ; Arn. 5, 18
— [fig.] : sol lumine conserit arva Lucr. 2, 211, le soleil parsème les campagnes de sa lumière ; consitus senectute Pl. Men. 756, accablé de vieillesse
¶2. planter : [des oliviers, la vigne] Cat. Agr. 6, 1 ; 6, 4 ; Plin. 17, 187 ; [des arbustes] Varr. R. 1, 4, 2 ; arborem Liv. 10, 24, 5 ; Curt. 6, 5, 14, planter un arbre.
===> parf. conseruisti Cels. Dig. 6, 1, 38 (consevisti PV)
— part. consatus Tert. Resur. 16.
¶1. attacher ensemble, réunir, joindre : avium plumæ in usum vestis conseruntur Sen. Ep. 90, 16, on attache ensemble les plumes des oiseaux pour s'en vêtir ; conserta navigia Curt. 4, 3, 18, navires attachés ensemble ; vincula quis conserta erant vehicula Curt. 9, 1, 17, les liens qui attachaient ensemble les chariots ; sagum fibula consertum Tac. G. 17, saie attachée avec une agrafe
— vir viro, armis arma conserta sunt Curt. 3, 2, 13, les hommes sont serrés les uns contre les autres, les armes contre les armes [phalange]
— [fig.] : virtutes consertæ Sen. Ep. 90, 3, vertus enchaînées entre elles ; nocti diem conserere Ov. Am. 3, 6, 10, lier le jour à la nuit ; exodia conserta fabellis Atellanis Liv. 7, 2, 11, les exodes rattachés aux Atellanes
¶2. [en part.] conserere manum ou manus, en venir aux mains : Pl. Mil. 3 ; Cæs. C. 1, 20, 4 ; cum aliquo, avec qqn : Sall. J. 49, 2 ; Cic. Att. 7, 20, 1 ; inter se Sall. Lep. 19 ; Liv. 7, 40, 14, entre eux
— combat fictif pour la revendication de propriété dans l'ancien système de procédure romain : inde ibi ego te ex jure manum consertum voco Cic. Mur. 26, d'ici (de devant le préteur) je t'invite à en venir aux mains là-bas (Mur. 30 ; de Or. 1, 41, etc. ; Gell. 20, 10, 1 ; 20, 10, 8)
— [d'où] : conserere pugnam, prœlium, certamen Liv. 21, 50, 1 ; 5, 36, 5 ; 35, 4, 2 ; acies Sil. 1, 339, engager le combat, livrer bataille ; alicui pugnam Pl. Bacch. 967, livrer bataille à qqn ; bellum Luc. 3, 560, engager les hostilités
— conserta acies Tac. An. 6, 35, combat de près, mêlée ; sicubi conserta navis esset Liv. 21, 50, 3, si qq part un navire était accroché par abordage ; acerrima pugna conserti exercitus Val.-Max. 3, 2, 1, armées aux prises dans un violent combat
— [abst] conserere, être aux prises, se battre : Liv. 44, 4, 6
¶3. former qqch en attachant des parties entre elles : lorica conserta hamis Virg. En. 3, 467, cuirasse formée d'un entrelacement de mailles, cf. Tac. H. 1, 79 ; monile gemmis consertum Suet. Galb. 18, un collier formé de pierres précieuses ; nubem tam arida quam humida conserunt Sen. Nat. 2, 30, 4, l'union d'éléments secs comme d'éléments humides peut former le nuage
— sermonem conserere, former une conversation par un enchaînement de propos = converser, s'entretenir : Curt. 8, 12, 9.
¶1. conserver : ad se conservandum Cic. Fin. 3, 16, pour sa conservation personnelle ; sese eos conservaturum dixit Cæs. G. 2, 15, 1, il dit qu'il les épargnerait ; cives incolumes Cic. Verr. 5, 152, conserver les citoyens sains et saufs ; res familiaris conservari debet diligentia et parsimonia Cic. Off. 2, 87, on doit conserver sa fortune par l'activité et l'économie
¶2. observer fidèlement : ordinem (rerum) Cic. Com. 6, observer l'ordre (des faits) ; fidem datam Cic. CM 75, garder la foi jurée ; collocationem verborum Cic. de Or. 3, 173, observer avec soin l'arrangement des mots dans la phrase ; mortui voluntatem Cic. Verr. 1, 124, respecter la volonté d'un mort ; majestatem populi Romani Cic. Balb. 35 (Liv. 38, 11, 2), respecter la majesté du peuple romain ; privilegia athletis Suet. Aug. 45, maintenir les privilèges des athlètes.
===> coservus CIL 6, 7532, etc.
¶1. action de s'asseoir avec : tam familiariter, ut communis esset ei consessus Lamp. Alex. Sev. 4, 3, si familièrement qu'il prenait place à côté d'eux ; consessum obtulit senatoribus Lamp. Alex. Sev. 18, 2, il permit aux sénateurs de s'asseoir à côté
¶2. foule assise, réunion, assemblée (dans les tribunaux, au théâtre, etc.) : Cic. Mil. 1 ; Planc. 2 ; CM 64 ; nunquam turpior consessus fuit Cic. Att. 1, 16, 3, jamais on ne vit réunion de gens plus tarés.
¶1. action de considérer : consideratio naturæ Cic. Ac. 2, 127, l'observation de la nature ; consideratio verborum Gell. 13, 28, 6, action de peser les mots ; considerationem intendere in aliquid Cic. Inv. 2, 103, porter toute son attention sur qqch
¶2. égard : Serv. En. 1, 11 ; décad.
¶1. part. de considero
¶2. adjt, réfléchi, pesé, prudent : nihil feci non diu consideratum Cic. Har. 3, je n'ai rien fait qu'après mûre réflexion
— circonspect, prudent : homo consideratus Cic. Cæc. 1, homme avisé
— -tior Cic. Quinct. 11 ; -tissimus Cic. Font. 29.
¶1. s'asseoir : positis sedibus consederunt Liv. 42, 39, 8, des sièges étant installés, ils s'assirent ; in pratulo consedimus Cic. Br. 24, nous nous assîmes sur une pelouse ; Platoni dormienti apes in labellis consederunt Cic. Div. 1, 78, des abeilles se posèrent sur les lèvres de Platon endormi ; ibi considitur Cic. de Or. 3, 18, là on s'assied ; considite transtris Virg. En. 4, 573, prenez place sur les bancs [de rameurs]
— siéger : quo die primum, judices, consedistis... Cic. Verr. 1, 19, le jour où pour la première fois, juges, vous êtes venus en séance
— prendre place dans sa chaire [en parl. du professeur] : Sen. Ep. 88, 4
¶2. [milit.] prendre position, se poster, camper : sub monte Cæs. G. 1, 48, 1, prendre position au pied de la montagne (5, 49, 7 ; 1, 49, 1 ; C. 2, 20, 4, etc.) ; in insidiis Liv. 43, 23, 4, se poster en embuscade, s'embusquer
¶3. se fixer, s'installer, s'établir [qq part pour un certain temps] : dubito an hic Antii considam Cic. Att. 2, 6, 2, je me demande si je ne m'établirai pas ici à Antium ; antequam aliquo loco consedero... Cic. Att. 5, 14, 1, tant que je ne me serai pas fixé qq part... (Cæs. G. 2, 4, 2 ; 4, 8, 3)
— [fig.] : in otio Cic. Att. 2, 4, 2, se fixer dans le repos [= rentrer dans la vie privée, après l'exercice d'une fonction publique] ; totam videmus consedisse urbem luctu Virg. En. 11, 350, nous voyons une ville entière plongée dans le deuil
— ludorum religio in hac urbe consedit Cic. Har. 24, les jeux avec leur caractère sacré se sont fixés dans notre ville
¶4. s'abaisser, s'affaisser : Alpes licet considant Cic. Prov. 34, les Alpes peuvent s'abaisser ; terra consedit Liv. 30, 38, 8, la terre s'affaissa (30, 2, 12) ; mihi visum considere in ignes Ilium Virg. En. 2, 624, je vis Ilion s'abîmer dans les flammes (Tac. H. 3, 33)
— [fig.] : ardor animi cum consedit Cic. Br. 93, quand la chaleur de l'âme s'est apaisée (10 ; Ac. 2, 88) ; consedit utriusque nomen in quæstura Cic. Mur. 18, vos deux noms sont bien restés au repos (dans l'ombre) pendant votre questure ; quia præsentia satis consederant Tac. An. 1, 30, parce que la situation était devenue assez calme
— [rhét.] ut verborum junctio varie considat Cic. de Or. 3, 191, en sorte que la liaison harmonieuse des mots (la période) se termine de façon variée.
===> dans les mss on trouve qqf les formes du pf considi : Enn. Var. 13 ; Liv. 9, 37, 2 ; 28, 12, 15 ; Tac. An. 1, 30 ; Plin. Ep. 6, 20, 14 ; Gell. 5, 4, 1.
¶1. sceller, revêtir d'un sceau : tabulæ signis hominum nobilium consignantur Cic. Quinct. 15, les actes sont scellés des sceaux de ces gens notables ; tabellas dotis Suet. Cl. 29 ; dotem Suet. Cl. 26, sceller (signer) un contrat de mariage
¶2. consigner, mentionner avec les caractères de l'authenticité : isdem litteris tua quæstura consignata est Cic. Cæcil. 28, les actes de ta questure sont consignés dans les mêmes documents ; fundi publicis commentariis consignati Crass. d. Cic. de Or. 2, 224, propriétés, dont mention est faite dans des mémoires livrés au public ; in orationibus nostris auctoritates nostras consignatas habere Cic. Clu. 139, trouver dans mes discours la consignation de mes opinions personnelles.
a) juge assesseur : Suet. Tib. 55 ;
b) celui qui interprète : consiliarius Jovis Cic. Leg. 3, 43, interprète de la volonté de Jupiter.
¶1. tenir conseil, délibérer : Cæs. C. 1, 19, 3 ; Cic. Att. 15, 9, 2
¶2. [avec dat.] délibérer au profit de, conseiller : Hor. P. 196.
I.
¶1. délibération, consultation : cum aliquo consilia conferre Cic. Phil. 2, 38, échanger des vues avec qqn, tenir conseil avec qqn ; adhibere aliquem in consilium Cic. Verr. 2, 74, appeler qqn en consultation (en conseil) [sibi in consilium Cic. Off. 2, 82] ; in consilia publica adhibere Liv. 1, 54, 1, appeler aux délibérations publiques ; mittam in consilium Cic. Verr. 1, 26, je laisserai délibérer [les juges] ; in consilium itur Cic. Verr. 4, 100, on prend une délibération, on passe au vote ; nullo (= nulli) adhibetur consilio Cæs. G. 6, 13, 1, [la plèbe] ne prend part à aucune délibération (ad consilium Cæs. G. 7, 77, 3) ; hæc consilii fuerunt, reliqua necessaria Cic. Fam. 9, 6, 2, sur cela nous pouvions délibérer, le reste était imposé par la nécessité ; quasi consilii sit res ac non necesse sit nobis... Cæs. G. 7, 38, 7, comme si la situation comportait une délibération et comme si bien plutôt ce n'était pas une nécessité pour nous de...; quid efficere possis, tui consilii est Cic. Fam. 3, 2, 2, ce que tu peux faire, à toi de le voir ; vestrum consilium est, non solum meum, quid sit vobis faciendum Cic. Fam. 14, 14, 1, à vous et non point seulement à moi de délibérer sur le parti que vous devez prendre
— consilium habere utrum... an... Sen. Ep. 70, 10, délibérer pour savoir si... ou si..
¶2. [sens abstrait et concret à la fois] consultation et assemblée consultative, conseil [juges, magistrats, sénat, etc.] : venire in consilium publicæ quæstionis Cic. Cæc. 29, venir siéger pour juger dans une affaire criminelle ; ire in consilium Cic. Verr. 1, 31, tenir conseil, se réunir pour délibérer [juges] ; in consilio habebat homines honestos Cic. Verr. 2, 70, il avait en consultation (dans son conseil) des hommes honorables [conseil d'un gouverneur de province, cf. Verr. 5, 10 ; 5, 114, etc.], v. adesse ; consilium habere Cæs. G. 4, 14, 2, tenir un conseil de guerre (délibérer) ; dimissa contione consilium habitum omnibusne copiis Luceriam premerent an... Liv. 9, 15, 1, l'assemblée dissoute, on tint conseil pour savoir s'il fallait avec toutes les forces accabler Lucérie ou si...; ad consilium publicum aliquid deferre Cic. Cat. 3, 7, soumettre qqch au conseil public [= à la délibération du sénat]; publici consilii auctor Cic. de Or. 3, 63 (1, 211 ; 1, 215, etc.), l'homme prépondérant dans les conseils de la cité [= au sénat]; fit publici consilii particeps Cic. Cat. 1, 2, il a voix délibérante dans le conseil de l'État
— [en gén.] toute commission consultative : Liv. 29, 20, 4
¶3. conseil, assemblée : in eo consilio, in quo ex cunctis ordinibus amplissimi viri judicarent Cic. Mil. 5, dans cette assemblée où sont appelés à juger les personnages les plus considérables de tous les ordres ; consilium dimittere Cic. Verr. 5, 163, renvoyer le jury
— patrum consilium Cic. Tusc. 4, 1, le sénat ; in senatu ; sapiens enim est consilium Cic. de Or. 2, 333, dans le sénat ; car c'est une assemblée sage (3, 2 ; Sest. 137, etc.)
— consilio convocato Cæs. G. 3, 3, 1, ayant convoqué un conseil de guerre (consilio advocato Liv. 25, 31, 3)
¶4. résolution, plan, mesure, dessein, projet : ut sunt Gallorum subita et repentina consilia Cæs. G. 3, 8, 3, étant donné que les Gaulois ont des résolutions soudaines et inattendues ; consilium inire Cic. Verr. 5, 103, prendre une résolution ; consilium capit primo stultum Cic. Verr. 5, 101, il prend sur le premier moment une résolution extravagante ; ex aliqua re consilium capere Cæs. C. 3, 43, 1 ; trahere Sall. J. 98, 3, prendre une résolution en s'inspirant de qqch ; ædificandi consilium abjicere Cic. Att. 5, 11, 6, renoncer à un projet de construction ; quasi exitus rerum, non hominum consilia legibus vindicentur Cic. Mil. 19, comme si les lois punissaient le fait accompli et non les desseins des hommes ; consociare se in consilia alicujus Liv. 42, 29, 4, s'associer à la politique de qqn ; communi consilio Cic. Verr. 4, 15, par une mesure prise en commun (officielle) ; privato consilio exercitus comparaverunt Cic. Phil. 3, 14, par une mesure privée (de leur chef) ils ont réuni des armées ; id est gestum consilio urbano Cic. Off. 1, 76, cet acte fut le résultat d'une mesure d'ordre civil
— consilio, à dessein, avec intention : Cic. Lig. 34 ; Br. 276 ; Tusc. 4, 64 ; consilio deorum immortalium Cæs. G. 1, 12, 6, par la volonté des dieux immortels
— former le projet (prendre la résolution) de faire qqch, consilium capere : [avec gérondif] Cic. Ac. 2, 100 ; Cæs. G. 3, 2, 2 ; [avec inf.] Cic. Off. 3, 40 ; Cæs. G. 7, 26, 1 ; [avec ut subj.] Cic. Verr. 1, 140 ; Clu. 71
— consilium inire : [avec gér.] Cic. Mur. 80 ; Cat. 4, 13 ; [avec inf.] Nep. Lys. 3, 1 ; [avec ut] Cic. Cat. 4, 4
— consilium est, l'intention est de : [avec gér.] Cic. Fam. 5, 20, 4 ; Liv. 33, 6, 8 ; [avec inf.] Cic. Att. 5, 5, 1 ; Cæs. G. 7, 77, 12 ; [avec ut subj.] Cic. Sest. 31 ; Cæs. G. 5, 6, 5
— hoc (eo) consilio ut subj., avec l'intention de : Cic. Cat. 3, 8 ; Mil. 47, etc.; Cæs. G. 1, 30, 3 ; 2, 9, 4 ; 7, 72, 2, etc.
— [en part.] plan de guerre, stratagème : consilium imperatorium quod Græci στρατήγημα appellant Cic. Nat. 3, 15, un plan de général que les Grecs appellent stratagème ; consilia cujusque modi Gallorum Cæs. G. 7, 22, 1, expédients de toute espèce imaginés par les Gaulois.
II. conseil, avis : fidele consilium dare Cic. Clu. 85, donner un conseil loyal ; consilio alicujus parere Cic. Off. 1, 84, suivre les conseils de qqn ; mihi consiliis opus est tuis Cic. Att. 2, 22, 4, j'ai besoin de tes conseils ; de meo consilio Cic. Att. 6, 3, 8, sur mon avis ; contra meum consilium Cic. Att. 7, 12, 3, contre mon avis ; ex consilio tuo Cic. Att. 9, 18, 1 (consilio tuo Att. 13, 3, 1), d'après tes avis ; consilio uti Cæs. G. 7, 78, 2, adopter un avis ; suo consilio uti Cæs. C. 1, 51, 2, agir à sa guise.
III. sagesse dans les délibérations, les résolutions, les conseils ; réflexion, prudence, habileté : casu magis et felicitate quam virtute et consilio Cic. Sull. 83, par hasard et par chance plutôt que par une action personnelle et réfléchie ; res virtute et consilio alicujus factæ Liv. 30, 28, 11, exploits accomplis par l'énergie personnelle et par l'initiative prudente de qqn ; mulieres omnes propter infirmitatem consilii... Cic. Mur. 27, toutes les femmes à cause de la faiblesse de leur jugement... (Off. 1, 117); acta illa res est animo virili, consilio puerili Cic. Att. 14, 21, 3, toute l'affaire a été menée avec un courage d'hommes, mais avec une prudence d'enfants.
a) [avec gén.] causa consimilis earum causarum... Cic. de Or. 1, 149, cause exactement semblable aux causes... ;
b) [avec dat.] cui erus est consimilis Pl. Pœn. 823, dont mon maître est tout le portrait ; alicui rei Cic. de Or. 2, 309 ; Phil. 2, 28 ; Cæs. G. 15, 12, 3 ;
c) [avec atque] Pl. Amp. 443 ; Bac. 454 ; Gell. 5, 11, 1 ; [avec et] Lucr. 3, 8 ;
d) [avec quasi] consimile est quasi sorbeas Pl. Mil. 820, c'est comme si tu avalais ;
e) [abst] Ter. Eun. 586 ; Cic. de Or. 3, 25 ; consimili studio Tac. An. 3, 13, avec une égale passion
— consĭmĭlĭa, ĭum, n., choses semblables : in omnibus consimilibus Gell. 2, 17, 6, dans tous les cas analogues.
===> .
¶1. se mettre, se placer, se poser : ad mensam Cic. Tusc. 5, 61, se mettre près de la table [pour servir]; simul cepere aliquid æqui loci, ubi firmo consisterent gradu Liv. 27, 18, 14, aussitôt qu'ils eurent trouvé du terrain plat où poser solidement le pied ; in pedes consistere Sen. Ep. 121, 8, se mettre sur ses pattes [tortue]
— se présenter, se produire : tota in illa contione Italia constitit Cic. Sest. 107, toute l'Italie s'est présentée à cette assemblée (est venue assister à...) ; cum in communibus suggestis consistere non auderet Cic. Tusc. 5, 59, comme il n'osait paraître à la tribune ordinaire ; in causa aliqua Cic. Quinct. 77, se présenter dans une cause [pour la soutenir], cf. Agr. 25 ; Font. 14 ; [d'où] consistere seul, comparaître comme accusateur : Cic. Cæc. 59 ; Sen. Ir. 2, 7, 3
— [fig.] se présenter : Or. 30 ; Br. 133
— [mil.] se placer, prendre position : simul in arido constiterunt Cæs. G. 4, 26, 5, aussitôt qu'ils eurent pris pied sur la terre ferme ; naves nostris adversæ constiterunt Cæs. G. 3, 14, 2, les navires prirent position en face des nôtres ; in orbem consistere Cæs. G. 5, 32, 3, se former en carré ; [fig.] Cic. de Or. 2, 294
— [en parl. de dés] se poser, tomber : Cic. Div. 2, 48
— [fig.] in quo non modo culpa nulla, sed ne suspicio quidem potuit consistere Cic. Amer. 152, un homme sur lequel aucune inculpation, que dis-je ? aucun soupçon n'a pu trouver prise (Clu. 78 ; 83)
— [au pf] constiti, je me trouve placé (établi), [presque synonyme de sum] : Sen. Vit. 26, 1 ; Ben. 4, 11, 4, etc.; Virg. En. 3, 681
¶2. s'arrêter : viatores consistere cogunt Cæs. G. 4, 5, 2, ils forcent les voyageurs à s'arrêter ; sine voce constitit Cic. Har. 2, il s'arrêta sans voix
— faire halte : Cæs. G. 7, 67, 3, etc. ; a fuga Liv. 10, 36, 11, s'arrêter dans sa fuite
— s'arrêter avec qqn (cum aliquo) pour causer : Cic. Verr. pr. 19 ; Att. 2, 24, 4, etc. ; Hor. S. 1, 9, 62
— séjourner qq temps dans un lieu : Cic. Verr. 5, 28, etc.
— se fixer, s'établir dans un lieu : Cæs. G. 7, 3, 1 ; [fig.] Cic. CM 41 ; Quinct. 5
— [fig.] s'arrêter sur qqch, insister sur : in singulis Cic. Part. 120, insister sur chaque point séparément (Verr. 1, 96 ; Inv. 1, 12)
— s'arrêter, s'en tenir à (à un rang déterminé) : Cic. Or. 4 ; Suet. Aug. 2
— [en parl. de choses] s'arrêter, rester immobile : omnis natura consistat necesse est Cic. Tusc. 1, 54, toute la nature (tout l'univers) s'arrête fatalement ; cum mustum constitit Col. 12, 21, 3, quand le moût a cessé de fermenter
— [fig.] s'arrêter, être suspendu, cesser : omnis administratio belli consistit Cæs. C. 2, 12, 1, toute occupation de guerre (tout acte d'hostilité) est suspendue (Liv. 21, 49, 1 ; 35, 4, 1) ; consistere usura debuit Cic. Att. 6, 1, 7, le paiement des intérêts devait s'arrêter, cf. de Or. 1, 1 ; Or. 199 ; Pis. 48
¶3. se tenir [de façon compacte, solide, par étroite union des éléments] : Lucr. 1, 1028, etc.
— [avec ex] être composé de, résulter de : Lucr. 1, 235 ; 1, 636, etc.; Cic. Inv. 2, 121 ; Gell. 4, 1, 10
— [avec abl.] Quint. 3, 8, 7 ; 12, 10, 59
— [avec in] [fig.] consister dans : major pars victus eorum in lacte... consistit Cæs. G. 6, 22, 1 (6, 21, 3), la plus grande partie de leur nourriture consiste en lait
— se fonder (reposer) sur : in eo salus optimi cujusque consistit Cic. Phil. 3, 19, sur lui se fonde le salut de tous les meilleurs citoyens (Verr. 2, 16 ; Marc. 22 ; Ac. 2, 139, etc.) ; rhetorice in actu consistit Quint. 2, 18, 2, la rhétorique se fonde sur la pratique
— [fig.] se maintenir, rester ferme, en parfait équilibre : mente consistere Cic. Phil. 2, 68 ; animo Cic. CM 74, garder son esprit calme, en équilibre, d'aplomb (Q. 2, 3 ; Div. 2, 149) [cf. mens sujet Dom. 139]
¶4. [emploi douteux] trans., établir : Gell. 5, 10, 9.
a) antichambre : Sid. Ep. 2, 2, 13 ;
b) cabinet de l'empereur : Amm. 14, 7, 11 ; Cod. Th. 6, 10, 2.
¶1. part. de consocio
¶2. pris adjt, associé, uni intimement : consociatissima voluntas Cic. Fam. 3, 3, 1, accord parfait des sentiments.
a) associé, intéressé, copartageant : Cod. Just. 10, 2, 3 ;
b) complice : Firm. Math. 3, 13
— consŏcĭa, æ, f., compagne : vitæ consocia Ambr. Ep. 9, 10, épouse.
¶1. consolable, qui peut être consolé : consolabilis dolor Cic. Fam. 4, 3, 2, douleur susceptible de consolation
¶2. consolant : Gell. 16, 19, 12
— consolabilior Ambr. Ep. 39, 3.
¶1. consolation : non egere consolatione Cic. Tusc. 3, 77, n'avoir pas besoin de consolation ; consolatio malorum Cic. Fam. 6, 4, 2, consolation dans le malheur ; consolatio litterarum tuarum Cic. Fam. 5, 13, 1, la consolation que m'apporte ta lettre
— illa consolatio avec prop. inf. Cic. Fam. 6, 4, 4, cette consolation, à savoir que ; [avec ut subj.] Fam. 5, 16, 2 ; [avec quod] Mil. 100
— [fig.] consolation, discours, écrit destiné à consoler : Cic. de Or. 3, 211 ; Quint. 10, 1, 47
— titre d'un traité : in Consolationis libro Cic. Tusc. 4, 63 ; in Consolatione Cic. Tusc. 1, 65, dans ma «Consolation»
¶2. soulagement, encouragement : timoris consolatio tua Cic. Att. 1, 17, 6, tes encouragements dans mes craintes.
¶1. consolider : Vitr. 2, 8, 7
— [fig.] fortifier, affermir : Vulg. Ezech. 34, 4
¶2. consolider [droit] : Dig. 7, 2, 6, v. consolidatio.
¶1. c. consolor, Varr. Men. 347 (Prisc. 8, 25)
¶2. pass. consolari Aug. Conf. 6, 1, 1 : consolatus Just. 22, 6, 4, encouragé
— [sens réfl.] se consoler : Q. Metell. d. Gell. 15, 13, 6 ; As. Poll. d. Prisc. 8, 18.
¶1. rassurer, réconforter, consoler (aliquem, qqn) : Cæs. G. 5, 4, 2 ; de aliqua re Cic. Tusc. 3, 71, touchant qqch ; in aliqua re Cic. Cat. 4, 8, à propos de, dans qqch
¶2. adoucir, soulager [le malheur, la douleur, etc.] : Cic. Vat. 28 ; Fin. 1, 40, etc.
— compenser, faire oublier : (gloriam) esse unam quæ brevitatem vitæ posteritatis memoria consolaretur Cic. Mil. 97, [il dit] que (la gloire) est la seule chose qui dédommage de la brièveté de la vie par le souvenir de la postérité.
===> sens pass., v. consolo.
¶1. part. de consono
¶2.
a) adjt, convenable : Dig. 12, 2, 34 ;
b) subst. f., consonne : Quint. 1, 4, 6.
¶1. produire un son ensemble : Varr. R. 3, 16, 30 ; Petr. 78, 5 ; Sen. Ep. 84, 10
— renvoyer le son, retentir : Virg. En. 8, 305 ; Vitr. 5, 8, 1 ; Tac. An. 14, 32
— être en harmonie ensemble : Sen. Ep. 78, 9
— [rhét.] avoir le même son [terminaison semblable] : Quint. 9, 3, 75
— être en accord, concordance : Quint. 9, 3, 45, etc.
¶2. [fig.] être en accord, en harmonie : secum Sen. Ep. 88, 9 ; sibi Quint. 2, 20, 5, avec soi-même.
¶1. qui sonne ou retentit ensemble, qui est d'accord, harmonieux : consona fila lyræ Ov. Am. 1, 8, 60, les cordes harmonieuses de la lyre ; vox consona linguæ Sil. 17, 448, le même accent
¶2. [fig.] conforme, convenable : vix satis consonum fore, si... Cic. Att. 4, 16, 3, [il pensait] qu'il eût été peu convenable de...; docere consona regno Claud. Laud. Stil. 2, 69, enseigner ce qui convient à un roi
¶3. [gram.] consona, æ, f., consonne : Ter. Maur. 555 ; et consona elementa, consonnes : Ter. Maur. 86.
¶1. participant par communauté de lot, partageant avec, possédant conjointement : alicujus rei Cic. Br. 2 ; Mil. 102 ; Flac. 35 ; in aliqua re Cic. Verr. 3, 155 ; Sen. Ben. 3, 33, 4, copartageant d'une chose, dans une chose ; alicujus Suet. Tib. 1, collègue de qqn, partageant avec qqn (cum aliquo Cic. Mil. 102)
— [poét.] qui est en commun : consortia tecta Virg. G. 4, 153, habitations communes
¶2. en communauté de biens, propriétaire indivis : Varr. L. 6, 65 ; Cic. Verr. 3, 57 ; Plin. Ep. 8, 18, 4 ; frater germanus et... consors etiam censoris Liv. 41, 27, 2, frère germain et même... consort [possédant en commun (n'ayant pas encore partagé) l'héritage paternel]
— [poét.] [subst] frère, sœur : Tib. 2, 5, 24 ; Ov. M. 11, 347 ; Pont. 3, 2, 48 ; [adjt] fraternel : Ov. M. 8, 444 ; 13, 663.
¶1. visible, apparent : Liv. 22, 24, 5 ; 32, 5, 13, etc.
¶2. qui attire les regards, remarquable : Virg. En. 8, 588 ; Liv. 45, 7, 3
— -tior Ov. M. 4, 796 ; Liv. 2, 5, 5 ; Tac. H. 4, 11.
¶1. action de voir, vue, regard : in conspectum alicui se dare Cic. Verr. 5, 86, s'offrir à la vue de qqn ; in conspectum alicujus se committere Cic. Verr. 4, 26, oser se présenter (se risquer) aux regards de qqn ; in conspectu multitudinis Cæs. G. 5, 56, 2, sous les yeux de la foule ; eum venire in conspectum suum vetuit Cic. Fin. 1, 24, il lui interdit de se présenter sous ses yeux
— in conspectu legum mori Cic. Verr. 5, 170, mourir sous le regard (sous la vue) des lois ; in conspectu Italiæ Cic. Verr. 5, 170, sous les yeux de l'Italie (Dom. 100 ; Cæs. G. 5, 6, 5 ; C. 3, 75, 2 ; Liv. 30, 24, 10)
— vue de l'esprit, examen : in conspectu animi aliquid ponere Cic. de Or. 3, 161, mettre qqch sous les yeux de l'esprit ; in hoc conspectu et cognitione naturæ Cic. Leg. 1, 61, dans cet examen et cette étude de la nature ; ne in conspectu quidem relinqui Cic. Fin. 5, 93, ne pas être laissé même à l'examen (= ne pas compter)
— vue d'ensemble, coup d'œil d'ensemble : Cic. Leg. 3, 12, Br. 15 ; Gell. 17, 21, 1
¶2. apparition, présence : conspectu suo prœlium restituit Liv. 6, 8, 6 (cf. oblata species 6, 8, 5), par sa présence il rétablit le combat (35, 36, 8)
— aspect : vester, judices, conspectus et consessus iste Cic. Planc. 2, cet aspect, juges, que présente votre réunion dans ce tribunal, cf. Pomp. 1 ; Fam. 16, 21, 7 ; Val. Max. 1, 6, 13 ; Curt. 6, 9, 2 ; Plin. Ep. 2, 11, 10.
===> dat. conspectu Amm. 25, 10, 3.
¶1. arroser, asperger : aras sanguine Lucr. 4, 1233, arroser les autels de sang ; conspergit me lacrimis Cic. Planc. 99, il me baigne de ses larmes
— parsemer : carnem sale Col. 12, 55, 3, saupoudrer la viande de sel ; herbas floribus Lucr. 2, 33, émailler les herbes de fleurs
— oratio conspersa sententiarum floribus Cic. de Or. 3, 96, style parsemé de figures de pensée, cf. Ac. 1, 8
¶2. verser dessus : vinum vetus Col. 12, 39, 3, arroser de vin vieux.
===> conspar- Lucr. 3, 661 ; Cat.
¶1. verbal de conspicio
¶2. pris adjt, digne d'être remarqué, remarquable : forma conspiciendus Ov. F. 5, 170, remarquable par sa beauté.
I. int., porter ses regards : in cælum Pl. Cist. 622, vers le ciel ; cf. Varr. L. 7, 9 ; Petr. 140, 14.
II. tr.,
¶1. apercevoir : ubi ex litore aliquos singulares ex navi egredientes conspexerant Cæs. G. 4, 26, 2, quand du rivage ils apercevaient des soldats débarquant isolément ; ab decumana porta ac summo jugo nostros victores flumen transisse conspexerant Cæs. G. 2, 24, 2, de la porte décumane et du sommet de la colline ils avaient observé que les nôtres victorieux avaient franchi le fleuve
— apercevoir par la pensée, comprendre : Pl. Pseud. 769 ; Trin. 636
— remarquer : Val.-Max. 7, 5, 3 ; Sen. Nat. 1, 14, 1
¶2. regarder, contempler : Pl. Cap. 91 ; Curc. 363 ; infestis oculis omnium conspici Cic. Cat. 1, 17, être regardé avec des yeux hostiles par tout le monde
— [en part., au pass.] être regardé, attirer les regards (l'attention) : Cic. Pis. 60 ; Sest. 126 ; Sall. C. 7, 6 ; Liv. 5, 23, 5, etc.; in neutram partem conspici Nep. Att. 13, 5, ne se faire remarquer ni dans un sens ni dans l'autre (Ov. Tr. 2, 114).
===> .
===> forme active conspico Greg. Tur. Jul. 9 ; Mart. 35
— passif conspicari, être aperçu : Varr. d. Prisc. 8, 18 ; *Sall. J. 49, 4 (Don. Eun. 384) ; Prop. 4, 4, 34 ; Apul. Flor. 9, p. 32.
¶1. qui s'offre à la vue, visible : conspicuus polus Ov. Tr. 4, 10, 108, le ciel visible, cf. Hor. O. 3, 16, 19 ; Ov. P. 3, 4, 22 ; Tac. An. 2, 20 ; 12, 37
— habere mortem in conspicuo Sen. Brev. 20, 5, avoir la mort devant les yeux
¶2. qui attire les regards, remarquable : Romanis conspicuum eum divitiæ faciebant Liv. 1, 34, 11, ses richesses le signalaient à l'attention des Romains ; viri laude conspicui Plin. Ep. 3, 3, 2, hommes d'un mérite éclatant.
a) accord, union : bonorum omnium Cic. Cat. 4, 22, unanimité des honnêtes gens ;
b) conspiration, complot : Cic. Scaur. 20 ; Suet. Aug. 19, 2.
a) en accord : milites conspirati... Cæs. C. 3, 46, 5, d'un accord commun les soldats...
— [fig.] Sen. Ep. 84, 10 ;
b) ayant conspiré, s'étant conjuré : Phæd. 1, 2, 4
— subst. conspirati, les conjurés : Suet. Dom. 17.
a) conspirate nobiscum Cic. Agr. 1, 26, soyez d'accord avec nous, cf. Phil. 3, 32 ; 11, 2 ; Tusc. 5, 72 ; Lucr. 4, 1216 ; Virg. En. 7, 615 ;
b) conspirer, comploter : Cæs. C. 3, 10, 3 ; in aliquem Suet. Cæs. 80, 4, conspirer contre qqn ; in cædem alicujus Tac. An. 15, 68, comploter la mort de qqn ; cf. Liv. 3, 36, 9 ; conspirare ut Suet. Cæs. 9, s'entendre pour ; conspirare ne Liv. 2, 32, 10, s'entendre pour empêcher que ; conspirare perdere aliquem Suet. Cl. 37, 2, s'entendre pour faire périr qqn.
===> décad., sens trans. :
a) mettre en accord (harmonie) : Manil. 1, 251 ;
b) faire s'accorder, associer : Anth. 727, 9.
¶1. tr., salir de crachat, de bave : Sen. Vit. 19, 3 ; Petr. 23, 4 ; Apul. Apol. 44, 9, nive conspuit Alpes Bibac. d. Quint. 8, 6, 17 (raillerie d'Hor. S. 2, 5, 41), (Jupiter) couvre les Alpes de crachats de neige
— [fig.] cracher sur, conspuer : Tert. Anim. 50
¶2. int., cracher : Vulg. Is. 50, 6.
¶1. qui se tient fermement, consistant : mellis constantior est natura Lucr. 3, 191, le miel est d'une nature plus consistante
— constans ætas Cic. CM 76, âge mûr ; constantissimus motus lunæ Cic. Div. 2, 17, le cours si constant (invariable) de la lune ; constans pax Liv. 6, 25, 6, paix inaltérable
¶2. ferme moralement, constant avec soi-même, conséquent, qui ne se dément pas : Cic. Mil. 81 ; Off. 1, 80 ; Flac. 89 ; Br. 117 ; etc.
¶3. dont toutes les parties s'accordent, où tout se tient harmonieusement : in oratione constanti Cic. Off. 1, 144, dans un discours bien ordonné
— rumores constantes Cic. Fam. 12, 9, 1, bruits concordants ; una atque constanti haruspicum voce commotus Cic. Har. 18, impressionné par la parole toujours identique et concordante des haruspices
— credibilia, inter se constantia, dicere Quint. 5, 4, 2, dire des choses croyables, qui s'accordent entre elles.
¶1. d'une manière continue, invariable : eosdem cursus constantissime servare Cic. Tusc. 1, 68, accomplir invariablement les mêmes parcours ; æqualiter, constanter ingrediens oratio Cic. Or. 198, style qui marche d'une allure égale et soutenue
¶2. avec constance, fermeté : constanter ac non timide pugnare Cæs. G. 3, 25, 1, combattre avec opiniâtreté et hardiment ; aliquid constanter ferre Cic. Tusc. 2, 46, supporter avec constance (fermeté) qqch
— avec pondération : beneficia considerate constanterque delata Cic. Off. 1, 49, services rendus avec réflexion (judicieusement) et posément
¶3. en accord, d'une manière concordante : hi constanter nuntiaverunt... Cæs. G. 2, 2, 4, ceux-ci unanimement annoncèrent que
— d'une manière conséquente : hæc non constantissime dici mihi videntur Cic. Tusc. 5, 23, ces propos ne me paraissent pas des plus conséquents (2, 44, etc.; Off. 1, 71) ; sibi constanter convenienterque dicere Cic. Tusc. 5, 26, être logique et conséquent avec soi-même dans ses propos
— constantius Cic. Ac. 2, 45.
¶1. permanence, continuité, invariabilité : hæc in stellis constantia Cic. Nat. 2, 54, cette permanence dans le mouvement des planètes ; dictorum conventorumque constantia et veritas Cic. Off. 1, 23, la fidélité et la franchise dans les paroles et les engagements ; testium constantia Cic. Verr. 1, 3, invariabilité des témoins ; vocis atque vultus Nep. Att. 22, 1, invariabilité de la voix et du visage
¶2. fermeté du caractère, des principes, constance : Cic. Pomp. 68 ; Sull. 62 ; Dej. 37 ; Phil. 5, 1, 2 ; etc.
¶3. esprit de suite, accord, concordance, conformité : constantiæ causā Cic. Tusc. 2, 5, pour être conséquent avec soi-même (pour être logique); non ex singulis vocibus philosophi spectandi sunt, sed ex perpetuitate atque constantia Cic. Tusc. 5, 31, ce n'est pas sur des maximes isolées qu'il faut juger les philosophes, c'est sur la continuité et l'accord de leurs principes.
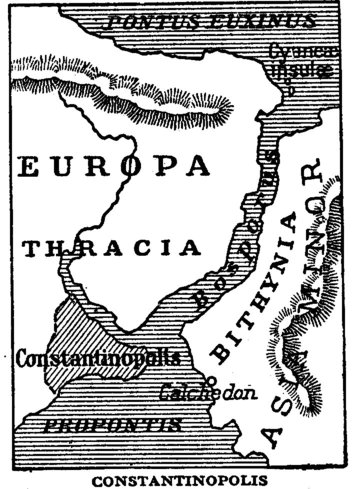
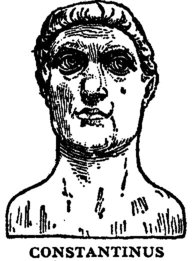
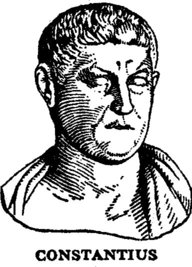
¶1. couvrir, joncher : forum corporibus civium Cic. Sest. 85, joncher le forum de cadavres de citoyens ; contabulationem summam lateribus lutoque Cæs. C. 2, 9, 3, revêtir le dessus du plancher de briques et de mortier, cf. 2, 15, 2
— maria constrata esse Sall. C. 13, 1, [rappeler] que la mer a été couverte de chaussées
— navis constrata, v. constratus
— [poét.] terram consternere tergo Virg. En. 12, 543, couvrir la terre de son corps (abattu), cf. Cic. Arat. 433 ; Lucr. 5, 1333
¶2. abattre, renverser : Enn. An. 188 ; Apul. Apol. 45
¶3. aplanir : Lact. 3, 24, 8.
¶1. presser, serrer : se constipaverant Cæs. G. 5, 43, 5, ils s'étaient entassés, cf. Cic. Agr. 2, 79
¶2. bourrer : Aug. Civ. 18, 24.
¶1. placer debout, dresser : hominem ante pedes Q. Manilii Cic. Clu. 38, placer qqn debout devant Q. Manilius (Verr. 5, 3) ; posteaquam (candelabrum) constituerunt Cic. Verr. 4, 65, quand ils eurent dressé le candélabre
— placer, établir : ante oculos aliquid sibi Cic. Cæl. 79, se mettre devant les yeux qqch ; aperto ac plano litore naves constituit Cæs. G. 4, 23, 6, il établit ses vaisseaux sur une plage nue et plate ; legiones pro castris in acie Cæs. G. 2, 8, 5, établir les légions devant le camp en ligne de bataille
— faire faire halte : Sall. J. 49, 5 ; Liv. 35, 28, 8 (signa constituere Cæs. G. 7, 47, 1) ; [fig.] Cic. de Or. 2, 328
— élever, construire, fonder : turres duas Cæs. G. 7, 17, 1, élever deux tours ; castella ad extremas fossas Cæs. G. 2, 8, 3, élever (établir) des redoutes à l'extrémité du fossé ; [fig.] senectus fundamentis adulescentiæ constituta Cic. CM 62, vieillesse reposant sur les fondements de la jeunesse
¶2. fixer (établir) qqn à un endroit déterminé : Cic. Agr. 2, 10 ; 2, 83 ; Cæs. G. 1, 13, 3, etc.
— aliquem regem apud Senones Cæs. G. 5, 54, 2, établir qqn comme roi chez les Sénonais ; aliquem sibi quæstoris in loco Cic. Verr. 1, 77, placer qqn près de soi comme questeur ; Athenæum maxima apud regem auctoritate constitui Cic. Fam. 15, 4, 6, j'ai établi Athénée auprès du roi avec [dans] le plus grand crédit
¶3. établir, instituer : alicui legem, jus Cic. Cæc. 40, instituer pour qqn une loi, une jurisprudence ; eorum causa judicium de pecuniis repetundis est constitutum Cic. Cæcil. 11, c'est à cause d'eux que l'action judiciaire pour concussion a été formée
— constituer, fonder : si utilitas amicitiam constituet Cic. Fin. 2, 78, si c'est l'intérêt qui fonde l'amitié ; posteaquam victoria constituta est Cic. Amer. 16, après que la victoire eut été fixée (définitivement acquise) ; pacem constituere Cic. Amer. 22, établir la paix
— constituer, organiser, fonder : civitates Cic. de Or. 1, 35, fonder les États (1, 36) ; composita et constituta res publica Cic. Leg. 3, 42, gouvernement bien ordonné et constitué ; civitas constituta Cic. Br. 7 ; Agr. 2, 10, cité ayant sa constitution, ses lois bien établies ; rem nummariam Cic. Off. 3, 80, régler la monnaie (fixer sa valeur); rem familiarem Cic. Phil. 11, 4, organiser (remettre en ordre) ses affaires ; tribus constitutis legionibus Cæs. G. 6, 1, 4, trois légions ayant été constituées (organisées), cf. Cic. Pomp. 57 ; legio constituta ex veteranis Cic. Phil. 14, 27, légion constituée de vétérans
— [pass.] être constitué solidement : cum corpus bene constitutum sit Cic. Fin. 2, 92 (Tusc. 2, 17), quand on a une bonne constitution physique ; viri sapientes et bene natura constituti Cic. Sest. 137, les hommes sages et bien constitués moralement ; jam confirmata constitutaque vox Quint. 11, 3, 29, voix déjà affermie et complètement formée
— ineuntis ætatis inscitia senum constituenda et regenda prudentia est Cic. Off. 1, 122, l'inexpérience de la jeunesse doit trouver un appui et une direction dans la prudence des vieillards
— [pass.] constitui ex = constare ex, résulter de, être formé de : Her. 1, 26 ; 1, 27 ; Quint. 7, 4, 16
¶4. décider, fixer, établir : accusatorem Cic. Cæcil. 10, fixer l'accusateur ; præmia, pœnas Cæs. G. 6, 13, 5, établir des récompenses, des châtiments ; colloquio diem Cæs. G. 1, 47, 1, fixer un jour pour une entrevue ; pretium frumento Cic. Verr. 3, 171, fixer un prix au blé ; ut erat constitutum Cic. Phil. 2, 108, comme cela avait été décidé ; quid vectigalis Britannia penderet, constituit Cæs. G. 5, 22, 4, il fixa le montant du tribut que devait payer la Bretagne
— cum aliquo, décider, fixer avec qqn : dies quam constituerat cum legatis Cæs. G. 1, 8, le jour qu'il avait fixé de concert avec les députés (Cic. Cat. 1, 24) ; constitui cum hominibus, quo die mihi Messanæ præsto essent Cic. Verr. 2, 65, je fixai d'entente avec eux le jour où ils devaient se mettre à ma disposition à Messine
— [avec prop. inf.] décider que : Ter. Hec. 195
— alicui constituere et prop. inf., fixer (promettre) à qqn que : Cic. Off. 1, 32 ; de Or. 1, 265
— [avec ut subj.] constituimus inter nos ut... Cic. Fin. 5, 1, nous avons décidé entre nous de...
— [abst] fixer un rendez-vous à qqn : Juv. 3, 12
¶5. définir, établir, préciser une idée : quo constituto sequitur... Cic. Nat. 2, 75, cela établi, il s'ensuit que...; eo (honesto), quale sit, breviter constituto Cic. Fin. 2, 44, après avoir établi brièvement la nature de l'honnête ; primum constituendum est, quid quidque sit Cic. Or. 116, il faut établir d'abord en quoi consiste chaque point du débat ; nondum satis constitui molestiæne plus an voluptatis adtulerit mihi Trebatius noster Cic. Fam. 11, 27, 1, je ne me suis pas encore rendu compte avec précision si c'est du chagrin ou du plaisir que notre Trébatius m'a le plus causé ; bona possessa non esse constitui Cic. Quinct. 89, j'ai établi qu'il n'y avait pas possession des biens, cf. Off. 2, 9
¶6. se déterminer à faire qqch, prendre une résolution : ut constituerat Cæs. G. 1, 49, 4, comme il l'avait décidé ; quid in proximam noctem constituisset, edocui Cic. Cat. 2, 13, j'ai montré ce qu'il avait résolu pour la nuit suivante ; constituerunt... comparare Cæs. G. 1, 3, 1, ils résolurent de rassembler... ; non prius agendum constituit... Cæs. G. 7, 36, 1 ; (7, 54, 2), il décida de ne pas agir avant... ; constituere ut subj., décider de, décider que : Cæs. G. 7, 78, 1 ; C. 3, 1, 2 ; Cic. Clu. 102 ; Off. 3, 80, etc.
— [abst] de aliquo, de aliqua re, prendre une résolution sur qqn, sur qqch : Cæl. Fam. 6, 7, 5 ; Brut. Fam. 11, 20, 3 ; Cæs. G. 6, 13, 4 ; Nep. Eum. 12, 1 ; Liv. 37, 56, 1.
¶1. [en gén.] état, condition, situation : corporis Cic. Off. 3, 117, complexion ; herba aliam constitutionem habet Sen. Ep. 121, 14, l'herbe présente un caractère différent
¶2. [en part.]
a) définition : summi boni Cic. Fin. 5, 45, définition du souverain bien ;
b) [rhét.] état de la question, fond de la cause : Cic. Inv. 1, 10 ; Her. 1, 18 ;
c) arrangement, disposition, organisation : rei publicæ Cic. Rep. 2, 37, l'organisation de l'État ;
d) disposition légale, constitution, institution : justum continetur natura vel constitutione Quint. 7, 4, 5, la justice est fondée sur la nature ou une institution ; cf. Sen. Ben. 4, 38, 2 ; Nat. 2, 59, 8 ; Quint. 7, 4, 6 ; Gai. Inst. 2, 5, 3.
¶1. chose convenue, convention : quid attinuerit fieri in eum locum constitutum Cic. Cæl. 61, à quoi bon fixer un rendez-vous dans cet endroit ; ad constitutum à l'époque (à l'heure) convenue, fixée, [ou] au rendez-vous : Cic. Att. 12, 1, 1 ; Varr. R. 2, 5, 1 ; Sen. Nat. 7, 6, 2 ; aliquod constitutum habere cum aliquo Cic. Fam. 7, 4, avoir qq rendez-vous avec qqn
¶2. constitution, loi, décret : Cod. Th. 1, 11, 5 ; 12, 41, 1
— [fig.] loi, règle : Sen. Nat. 3, 16, 3
¶3. promesse de payer [sans stipulation] : Paul. Dig. 13, 5, 21 ; Ulp. Dig. 13, 5, 1.
¶1. se tenir arrêté : constant, conserunt sermones inter sese Pl. Curc. 290, ils restent arrêtés, ils causent ; in fossis sicubi aqua constat Cat. Agr. 155, si l'eau séjourne quelque part dans les fossés
¶2. se tenir par la réunion des éléments constitutifs, se maintenir, être constitué, exister, subsister [dans Lucr. souvent voisin de esse : 1, 510 ; 1, 582, etc.] ; antiquissimi fere sunt, quorum quidem scripta constent Cic. de Or. 2, 93, presque les plus anciens, du moins de ceux dont nous avons les écrits ; si ipsa mens constare potest vacans corpore Cic. Nat. 1, 25, si l'intelligence par elle-même peut exister sans le corps (1, 92) ; adeo ut paucis mutatis centurionibus idem ordines manipulique constarent Cæs. C. 2, 28, 1, au point que, quelques centurions seulement étant changés, centuries et manipules restaient les mêmes ; uti numerus legionum constare videretur Cæs. G. 7, 35, 3, pour que le nombre des légions parût n'avoir pas changé ; litteræ constabant Cic. Verr. 2, 187, les lettres (caractères) étaient en parfait état, v. litura
— [avec abl.] être constitué par (avec) : ceterarum rerum studia, et doctrina et præceptis et arte constare Cic. Arch. 18, [nous savons] que toutes les autres études supposent un enseignement, des leçons, un art (Inv. 1, 70 ; Nep. Att. 13, 2) ; nonne fatendumst corporea natura animum constare animamque ? Lucr. 3, 167, ne doit-on pas reconnaître que l'esprit et l'âme sont d'une nature matérielle ?
— [avec ex] résulter de, être composé de : homo constat ex anima et corpore caduco et infirmo Cic. Nat. 1, 98, l'homme est composé d'une âme et d'un corps faible et débile ; temperantia constat ex prætermittendis voluptatibus corporis Cic. Nat. 3, 38, la tempérance consiste à laisser de côté les plaisirs du corps ; virtus quæ constat ex hominibus tuendis Cic. Off. 1, 157, la vertu qui repose sur la protection de nos semblables
— [avec in abl.] : monuit ejus diei victoriam in earum cohortium virtute constare Cæs. C. 3, 89, 4, il fit observer que la victoire de cette journée reposait sur le courage de ces cohortes (dépendait de) ; suum periculum in aliena vident salute constare Cæs. G. 7, 84, 4, ils voient que pour eux le danger est lié au salut des autres [ils échapperont au danger si leurs camarades sont sauvés]; cf. penes eos summam victoriæ constare intellegebant Cæs. G. 7, 21, 3, ils comprenaient que l'ensemble de la victoire reposait entre leurs mains
— [avec de] Lucr. 4, 1229 ; Apul. Mund. 20, etc.
— [avec abl. ou gén. de prix] être (se tenir) à tel prix, coûter : si sestertium sex milibus quingentis tibi constarent ea quæ... Cic. Verr. 4, 28, si tu avais payé six mille cinq cents sesterces ce que... ; parvo Sen. Ben. 6, 38, 1, coûter peu ; virorum fortium morte victoria constat Cæs. G. 7, 19, 4, la victoire se paie par la mort d'hommes vaillants ; dimidio minoris Cic. Att. 13, 29, 2, coûter moitié moins ; pluris Sen. Nat. 1, 17, 8, coûter plus ; v. care (-ius et -issime) ; gratis, viliter (-ius, -issime)
¶3. se tenir solidement, se maintenir fermement dans ses éléments constitutifs, être d'aplomb (en équilibre) : priusquam totis viribus fulta constaret hostium acies Liv. 3, 60, 9, sans attendre que l'armée ennemie fût en bon ordre de bataille avec toutes ses forces ; pugna illis constare non potuit Liv. 1, 30, 10, pour eux le combat ne put se continuer en bon ordre
— in ebrietate lingua non constat Sen. Ep. 83, 27, dans l'ivresse la parole n'est pas assurée ; ut non color, non vultus ei constaret Liv. 39, 34, 7, au point qu'il changea de couleur et de visage ; Vitruvio nec sana constare mens nec... Liv. 8, 19, 6, Vitruvius d'une part ne gardait pas de sang-froid...
— mente vix constare Cic. Tusc. 4, 39, à peine garder l'équilibre de sa raison ; ne auribus quidem atque oculis satis constare poterant Liv. 5, 42, 3, ils ne pouvaient même plus disposer vraiment de leurs oreilles et de leurs yeux
— auri ratio constat Cic. Flacc. 69, le compte de l'or est juste (Font. 3) ; deparcos esse quibus ratio impensarum constaret Suet. Ner. 30, [il jugeait] crasseux ceux qui tenaient un compte exact de leurs dépenses
— [fig.] mihi et temptandi aliquid et quiescendi illo auctore ratio constabit Plin. Ep. 1, 5, 16, je trouverai dans ses conseils les raisons justificatrices, soit de tenter qqch, soit de me tenir tranquille ; mihi confido in hoc genere materiæ lætioris stili constare rationem Plin. Ep. 3, 18, 10, je suis convaincu que dans un sujet de ce genre un style fleuri est bien justifié
¶4. être d'accord avec, s'accorder avec : [avec dat.] qui se et sibi et rei judicatæ constitisse dicit Cic. Clu. 106, celui qui déclare avoir été d'accord et avec lui-même et avec son premier jugement ; si humanitati tuæ constare voles Cic. Att. 1, 11, 1, si tu veux ne pas déroger à ton affabilité habituelle ; si tibi constare vis Cic. Tusc. 1, 9, si tu veux être constant (conséquent) avec toi-même ; [avec cum] considerabit, constetne oratio aut cum re aut ipsa secum Cic. Inv. 2, 45, il examinera, si le discours ou bien répond au sujet ou bien est conséquent (Flacc. 5)
— [abst] : video constare adhuc omnia Cic. Mil. 52, je vois que jusqu'ici tout se tient (s'accorde) ; nec animum ejus regis constare satis visum Liv. 44, 20, 7, [ils déclarèrent] que les dispositions de ce roi ne leur avaient pas paru bien constantes
¶5. emploi impers. constat : [avec prop. inf.] c'est un fait établi (reconnu, constant) que ; alicui, pour qqn ; inter omnes, pour tout le monde (tout le monde reconnaît que) : cum cædem in Appia factam esse constaret Cic. Mil. 14, comme il était bien reconnu que le crime avait été commis sur la voie Appienne ; ubi Cæsarem primum esse bellum gesturum constabat Cæs. G. 3, 9, 9, où il était sûr que César entamerait les hostilités ; omnibus constabat hiemari in Gallia oportere Cæs. G. 4, 29, 4, il était évident pour tous qu'il fallait hiverner en Gaule ; ut inter homines peritos constare video Cic. de Or. 1, 104, comme je vois que tous les gens compétents le reconnaissent (de Or. 3, 3) ; constitit fere inter omnes... oportere Cic. Fin. 5, 17, presque tout le monde est d'accord qu'il faut...
— [avec interr. ind.] : alicui constat quid agat Cic. Tusc. 4, 35 ; Cæs. G. 3, 14, 3, qqn voit nettement ce qu'il doit faire ; neque satis constabat animis, tam audax iter consulis laudarent vituperarentne Liv. 27, 44, 1, (il n'était pas bien net pour les esprits si...) on ne voyait pas nettement s'il fallait approuver ou blâmer la marche si audacieuse du consul ; non satis mihi constiterat (-ne... an...) Cic. Fam. 13, 1, 1, je ne vois pas clairement si... ou si... ; nec satis certum constare apud animos poterat utrum... an... Liv. 30, 28, 1, et il ne pouvait pas être établi comme une chose bien certaine dans les esprits si... ou si... (on ne voyait pas de façon précise...).
¶1. int., faire du vacarme : [en parl. d'un orateur] Gell. 4, 1, 4 ; ululatibus Apul. M. 8, 27, faire entendre de bruyants gémissements
¶2. tr., faire retentir : Apul. M. 4, 26.
¶1. construction ; [fig.] structure (hominis, de l'homme) : Cic. Ac. 2, 86
¶2. assemblage de matériaux pour construire : lapidum Sen. Pol. 18, 2, assemblage des pierres
— [rhét.] verborum Cic. de Or. 1, 17, etc., assemblage, arrangement des mots dans la phrase
— [gram.] construction syntaxique : Prisc. 17, 52, etc.
¶3. disposition des livres dans une bibliothèque : Cic. Att. 4, 5, 3, (v. 4, 8, 2).
¶1. entasser par couches (avec ordre), ranger : dentes in ore constructi Cic. Nat. 2, 134, les dents rangées dans la bouche ; acervi nummorum apud istum construuntur Cic. Phil. 2, 97, on empile chez lui les écus
— garnir : constructæ dape mensæ Catul. 64, 304, tables garnies de mets
¶2. bâtir, édifier : navem Cic. CM 72, construire un vaisseau
— [gram.] construire : Prisc. 17, 156.
¶1. tr., conseiller fortement : Pl. Merc. 143
¶2. int., donner un avis favorable : Pl. Asin. 261
— alicui Pl. Trin. 527, circonvenir (enjôler) qqn.
===> .
¶1. tr., accoutumer : bracchia consuescunt Lucr. 6, 397, ils exercent leurs bras ; consuescere juvencum aratro Col. 6, 2, 9, habituer un jeune bœuf à la charrue
¶2. int., s'accoutumer, prendre l'habitude [consuevi, j'ai l'habitude : Cæs. G. 5, 56, 2, etc.] :
a) [abst] consuescere multum est Virg. G. 2, 272, il est important de prendre l'habitude ; ut consuevi Cæs. Att. 9, 16, 3, selon mon habitude ;
b) [avec infin.] s'habituer à : Cic. Tusc. 1, 75 ; de Or. 1, 261 ; Cæs. G. 1, 33, 3
— [avec inf. pass.] Cic. Com. 46 ; Cæs. G. 1, 44, 4 ; 7, 32, 3 ;
c) [avec dat.] dolori Plin. Ep. 8, 23, 8, s'habituer à la douleur ;
d) [avec abl.] consuescere libero victu Col. 8, 15, s'habituer à chercher sa nourriture
— consuescere cum aliquo Ter. Hec. 555 ; Pl. Amp. 1122, avoir commerce avec qqn
— v. consuetus.
===> formes sync. du pf. : consuemus Prop. 1, 7, 5 ; consueris Cic. de Or. 1, 157 ; consueram, consuesse, etc.
¶1. habitude, coutume, usage : ad alicujus consuetudinem moremque deduci Cic. Off. 1, 118, être amené à prendre les usages et les habitudes de qqn ; de mea consuetudine (dicturus sum) Cic. de Or. 1, 208, c'est de ma pratique personnelle (que je vais parler)
— consuetudo eorum est ut... non eant Cæs. C. 1, 48, 7, leur habitude est de ne pas aller...; Germanorum consuetudo est... resistere Cæs. G. 4, 7, 3, l'habitude des Germains est de résister (5, 41, 7)
— consuetudo laborum Cic. Tusc. 2, 35, l'habitude de supporter les fatigues ; hominum immolandorum Cic. Font. 21, l'habitude des sacrifices humains
— ex consuetudine sua... exceperunt Cæs. G. 1, 52, 4, d'après leurs habitudes, ils reçurent... ; pro mea consuetudine Cic. Arch. 23, suivant mon habitude ; consuetudine sua... ducebat Cæs. G. 2, 19, 3, suivant sa coutume il conduisait (3, 23, 6 ; 4, 12, 2, etc.) ; præter consuetudinem Cic. Div. 2, 60, contre l'habitude (contra consuetudinem Cic. Off. 1, 148)
¶2. [droit] coutume : Cic. Inv. 2, 67 ; 2, 162 ; de Or. 1, 212, etc.
— consuetudinis jura Cic. Verr. 4, 122, droit de la coutume, droit des gens
¶3. usage courant de la langue, langue courante : Cic. Or. 76 ; Br. 258 ; etc.
¶4. liaison, intimité : Cic. Br. 1 ; Verr. 2, 172, etc.
— rapports, relations : Cic. Or. 33 ; Mil. 21 ; Fam. 4, 13, 1
— liaison, amour : Liv. 39, 9, 6 ; Suet. Tib. 7, etc. ; consuetudo stupri Sall. C. 23, 3, relations coupables.
¶1. part. de consuesco : Pl. Aul. 637 ; Cic. Rep. 3, 8 ; Sall. J. 50, 6 ; Virg. En. 10, 866
¶2. pris adjt, habituel, accoutumé : Ter. And. 155 ; Virg. G. 4, 429 ; consuetissima verba Ov. M. 11, 637, les paroles les plus habituelles.
¶1. consul : Mario consule Cic. Arch. 5, sous le consulat de Marius ; a Crasso consule et Scævola usque ad Paulum et Marcellum consules Cic. Br. 328, du consulat de Crassus et de Scævola jusqu'à celui de Paulus et de Marcellus ; L. Pisone A. Gabinio consulibus Cæs. G. 1, 6, 4, sous le consulat de L. Pison et A. Gabinius
— [abréviations] : sing. Cos. ; pl. Coss.
¶2. proconsul : Liv. 26, 33, 4
¶3. épithète de Jupiter : Vop. Firm. 3, 4.
===> .
I. int.,
¶1. délibérer ensemble ou délibérer avec soi-même, se consulter, réfléchir : Pl. Mil. 219 ; Rud. 1036, etc. ; Ter. Ad. 982, etc. ; Sall. C. 1, 6
— de aliquo, de aliqua re, sur qqn, sur qqch : Cic. Agr. 2, 88 ; Sull. 63 ; Sall. C. 51, 5 ; Liv. 3, 41, 3 ; qui consulunt Cic. Top. 71, ceux qui tiennent conseil (qui cherchent les décisions utiles)
— in commune Ter. And. 548, songer à l'intérêt commun (Tac. Agr. 12 ; An. 12, 5) ; in publicum Plin. Ep. 9, 13, 21, envisager le bien public ; in medium Virg. En. 11, 335, délibérer en vue de l'intérêt général (Tac. H. 2, 5) ; in unum Tac. H. 4, 70, se concerter
¶2. prendre une résolution, des mesures : ad summam rerum Cæs. C. 3, 51, 4, prendre des mesures en vue de l'intérêt général ; aliter mihi de illis ac de me ipso consulendum Cic. Att. 7, 13, 3, je ne dois pas prendre les mêmes mesures à leur égard qu'en ce qui me concerne
— [en part.] prendre une résolution (une mesure) fâcheuse, funeste, cruelle, etc. : graviter de se consulere Cic. Att. 3, 23, 5, prendre contre soi-même une détermination fâcheuse, cf. Cæl. Fam. 8, 16, 1 ; Liv. 28, 29, 8 ; in aliquem Ter. Haut. 437 ; Liv. 8, 13, 14 ; Tac. Agr. 16, contre qqn
¶3. prendre des mesures pour qqn (qqch), alicui (alicui rei) ; avoir soin de qqn (qqch), pourvoir à, veiller à, s'occuper de : parti civium Cic. Off. 1, 85, s'occuper d'une partie seulement des citoyens ; alicujus commodis Cic. Q. 1, 1, 27, veiller aux intérêts de qqn ; timori magis quam religioni Cæs. C. 1, 67, 3, obéir à la crainte plutôt qu'au respect de son serment militaire
— [avec ut subj.] veiller à ce que, pourvoir à ce que : Cic. Verr. 1, 153 ; Off. 2, 74 ; Cat. 2, 26 ; [avec ne] veiller à ce que ne pas : Ter. Phorm. 469 ; Virg. En. 9, 320 (quominus Cic. Verr. 3, 16).
II. tr.
¶1. délibérer sur qqch, examiner qqch (rem) : Pl. Most. 1102 ; Pers. 844, etc. ; cum ea, quæ consulebantur, ad exitum non pervernirent Cic. Fam. 10, 22, 2, comme sur les questions mises en délibération on n'arrivait pas à une solution ; re consulta et explorata Cic. Att. 2, 16, 4, l'affaire étant délibérée et examinée ; nihil salutare in medium consulebatur Liv. 26, 12, 7, on ne cherchait aucune mesure salutaire en vue de l'intérêt commun ; (rem) delatam consulere ordine non licuit Liv. 2, 28, 2, sur cette affaire soumise au sénat il ne put y avoir de délibération régulière
— quid agant, consultunt Cæs. G. 7, 83, 1, ils délibèrent sur ce qu'ils doivent faire
¶2. consulter qqn, qqch (aliquem, aliquid) : senatum Cic. Phil. 2, 15, consulter le sénat ; populum Cic. Rep. 2, 31, le peuple ; Apollinem Cic. Leg. 2, 40, Apollon ; [un jurisconsulte] Mur. 25 ; Br. 155 ; consulentibus respondere Cic. Br. 306, donner des réponses aux consultations des clients (Or. 143 ; Leg. 10, 1) ; vos consulo quid mihi faciendum putetis Cic. Verr. pr. 32, je vous demande à titre de consultation ce que vous pensez que je doive faire ; Themistocles cum consuleretur, utrum... filiam collocaret an... Cic. Off. 2, 71, comme on demandait à Thémistocle s'il donnerait sa fille en mariage à... ou bien...
— speculum Ov. Ars. 3, 136, consulter le miroir ; aures Quint. 9, 4, 93 ; vires Quint. 10, 2, 18, consulter l'oreille, les forces ; consulere veritatem Cic. Or. 159, consulter la vérité [= la prononciation régulière]
— [abst] consulter, recueillir les suffrages : Cic. Att. 12, 21, 1
¶3. consulter sur qqch (aliquid): quæ consuluntur, minimo periculo respondentur Cic. Mur. 28, aux consultations demandées la réponse se fait avec bien peu de risque ; rem nulli obscuram consulis Virg. En. 11, 344, tu nous consultes sur une question qui n'a d'obscurité pour personne ; si jus consuleres Liv. 39, 40, 6, si on le consultait sur un point de droit
— consulam hanc rem amicos quid faciendum censeant Pl. Men. 700, je consulterai là-dessus mes amis, en leur demandant ce que je dois faire, à leur avis (Stat. Th. 7, 6, 29)
¶4. [formule] : boni consulere aliquid, estimer comme bon qqch, trouver bon, agréer, être satisfait de : Pl. Truc. 429 ; Varr. L. 7, 4 ; Cat. d. Gell. 10, 3, 17 ; Quint. 1, 6, 32 ; hoc munus rogo, qualecumque est, boni consulas Sen. Ben. 1, 8, 1, ce présent, je te prie, quel qu'il soit, de lui faire bon accueil.
===> part. fut. consuliturus (au lieu de consulturus) Fort. 7, 8, 50 et [avec le sens de consolaturus] Fort. 8, 3, 254
— forme déponente sunt consulti de consulor : Commod. Instr. 1, 22, 5.
¶1. action de délibérer : Ter. Hec. 650 ; Cic. Off. 3, 50 ; Sall. J. 27, 2
— point soumis à une délibération, question, problème : Cic. Rep. 1, 36 ; de Or. 3, 109 ; 111 ; Part. 4 ; Liv. 35, 42, 4
¶2. question posée à qqn : Att. 8, 4, 3 ; [en part.]
a) question posée à un juriste : Cic. Top. 66 ;
b) question soumise à un chef : Plin. Ep. 10, 96, 9.
¶1. int. délibérer mûrement [ou] souvent : de bello Cæs. G. 5, 53, 3, débattre la question de la guerre ; consultare utrum... an Cic. Att. 16, 8, 2, débattre la question de savoir si... ou si, cf. Off. 1, 9 ; Sall. C. 52, 3
— s'occuper sans cesse de [dat.] : rei publicæ Sall. C. 6, 6, veiller sans cesse au bien de l'État
¶2. tr.
a) délibérer fréquemment (rem, sur qqch) : Pl. Bac. 1154 ; Liv. 1, 55, 6 ; 28, 26, 1 ; Gell. 1, 23, 5
b) consulter, interroger : quid me consultas quid agas ? Pl. Mil. 1097, pourquoi me demander ce que tu dois faire ? consultare aves Plin. Pan. 76, 7, consulter les augures.
¶1. conseiller : Sall. J. 64, 5 ; 85, 47, etc. ; Tac. An. 6, 10, etc.
¶2. celui qui consulte, qui demande conseil : Cic. Mur. 22 ; Balb. 45, etc.
¶1. résolution, mesure prise, plan : facta et consulta Cic. Leg. 1, 62, les actions et les desseins (Liv. 10, 39, 10 ; 25, 16, 4); mollia consulta Tac. An. 1, 40, mesures sans énergie
— [en part.] décret du sénat : de senatus consulto certior factus ut... Cæs. G. 7, 1, informé du sénatus-consulte ordonnant que...
¶2. réponse d'un oracle : Virg. En. 6, 151.
¶1. réfléchi, étudié, pesé : omnia consulta ad nos et exquisita deferunt Cic. de Or. 1, 250, [les parties en cause] nous apportent toutes les questions étudiées et épluchées
— consultius est Dig. 2, 15, 15, il est plus prudent, il vaut mieux
¶2. qui est avisé dans, versé dans : juris Cic. Phil. 9, 10, versé dans le droit ; juris atque eloquentiæ Liv. 10, 22, 7, versé dans le droit et dans l'art de la parole ; consultissimus vir omnis divini atque humani juris Liv. 1, 18, 1, profondément versé dans tout le droit divin et humain
— jure consulti Cic. Mur. 27, jurisconsultes [juris consultus dici debet, non jure consultus, licet Cicero pro Murena ita dixerit Char. 1, 82, 5]
— consultior Tert. Marc. 2, 2, plus avisé
¶3. m. pris subst, consultus, i, jurisconsulte : Cic. Cæc. 79 ; Br. 148 ; Hor. S. 1, 1, 17.
¶1. action de faire la somme : Col. 12, 13, 7
¶2. ensemble, accumulation : Cels. 1, 3, 83
— [rhét.] accumulation [d'arguments] : Quint. 9, 2, 103
— récit d'ensemble : Plin. 4, 121
¶3. accomplissement, achèvement : consummatio operis Quint. 2, 18, 2, exécution d'un ouvrage ; maximarum rerum Sen. Brev. 1, 3, accomplissement des plus grandes choses ; alvi Plin. 26, 43, élaboration de l'estomac ; gladatorium Plin. 8, 22, expiration de l'engagement des gladiateurs ; primi pili CIL 6, 3580 a, 11, expiration du temps de service dû par un centurion primipile.
¶1. part. de consummo
¶2. adjt, achevé, accompli : vir consummatæ sapientiæ Sen. Ep. 72, 7, homme d'une sagesse accomplie ; consummatus orator Quint. 2, 19, 1, orateur parfait
— -tissimus Plin. Ep. 2, 7, 6.
¶1. additionner, faire la somme : Col. 5, 3, 4
— former un total de : Col. 3, 5, 4
¶2. accomplir, achever : ad eam rem consummandam Liv. 29, 23, 4, pour mener à bonne fin ce projet
— [abst] finir son temps de service : Suet. Cal. 44, 1
— [fig.] parfaire, porter à la perfection : eum consummari mors non passa est Quint. 10, 1, 89, la mort ne lui permit pas de développer tout son talent, cf. 10, 5, 14 ; Sen. Ep. 88, 28.
¶1. employer, dépenser : pecuniam in aliqua re Cic. Verr. 2, 141, dépenser de l'argent à qqch ; in his rebus dies decem consumit Cæs. G. 5, 11, 6, il emploie dix jours à cela ; ætatem in aliqua re Cic. Off. 1, 2, consacrer sa vie à qqch ; multam operam frustra consumpsi Cic. Tusc. 1, 103, j'ai dépensé beaucoup d'activité en pure perte ; quantum Aristoxeni ingenium consumptum videmus in musicis ! Cic. Fin. 5, 50, combien Aristoxène n'a-t-il pas dépensé de son intelligence dans l'étude de la musique !
— omne id aurum in ludos Liv. 35, 5, 9, consacrer tout cet or aux jeux, cf. Val.-Max. 3, 1, 1 ; Quint. 3, 11, 13
¶2. consommer, épuiser : consumptis omnibus telis Cæs. C. 1, 46, 1 ; consumptis lacrimis Cic. Phil. 2, 64, ayant consommé tous les traits, les larmes étant épuisées ; frumenta a tanta multitudine consumebantur Cæs. G. 6, 43, 3, les récoltes étaient consommées par cette foule énorme (G. 7, 77, 1, etc.)
— dissiper [les biens, la fortune, etc.] : Cic. Amer. 6 ; Cæs. G. 1, 11, 6 ; Sall. C. 12, 2
— passer le temps [avec idée de dépense complète] : horas multas suavissimo sermone consumere Cic. Fam. 11, 27, 5, passer bien des heures dans les plus agréables entretiens ; tempus dicendo Cic. Verr. 2, 96, consumer le temps en discours ; frustra diebus aliquot consumptis proficiscitur Cæs. C. 1, 33, 4, ayant laissé vainement s'écouler un bon nombre de jours, il part ; consumitur vigiliis reliqua pars noctis Cæs. G. 5, 31, 4, le reste de la nuit se passe à veiller
— mener à bout, épuiser : prope omnem vim verborum ejusmodi, quæ scelere istius digna sint, aliis in rebus consumpsi Cic. Verr. 5, 159, j'ai presque épuisé pour d'autres faits toute la masse des expressions capables de rendre dignement sa scélératesse ; risus omnis pæne consumitur Cic. Fam. 15, 21, 2, tout le rire dont on est capable est presque épuisé ; qui misericordiam consumpserunt Curt. 6, 8, 6, ceux qui ont épuisé la pitié ; ignominiam consumpsistis Tac. H. 3, 24, vous avez toute honte bue
¶3. venir à bout de, consumer, détruire : cum eam (quercum) vetustas consumpserit Cic. Leg. 1, 2 (Marc. 11), quand le temps aura fait disparaître ce chêne
— [pass.] être consumé, détruit par le feu : Cæs. C. 2, 14, 2 ; Liv. 25, 7, 6
— faire périr : si me vis aliqua morbi consumpsisset Cic. Planc. 90, si quelque attaque d'une maladie m'avait enlevé (Rep. 1, 4 ; Har. 39 ; Off. 2, 16 ; Font. 42 ; Cæs. C. 3, 87, 3)
— [pass.] être exténué, usé par qqch, succomber : exercitus fame consumptus Cæs. G. 7, 20, 12, armée épuisée par la faim ; inedia et purgationibus et vi ipsius morbi consumptus es Cic. Fam. 16, 10, 1, la diète, les purgations, la force même du mal ont épuisé tes forces ; mærore consumptus Liv. 40, 54, 1, épuisé par le chagrin
— [fig.] editi montes, quorum altitudo totius mundi collatione consumitur Sen. Nat. 4, 11, 4, montagnes élevées dont la hauteur disparaît (n'est rien) en comparaison de l'ensemble de l'univers ; tela omnia pectore consumere Sil. 5, 642, recevoir (épuiser) tous les traits dans sa poitrine (10, 128) ; jugulo ensem Stat. Th. 813, avoir une épée plongée dans son cou [l'épée disparaît dans le cou].
===> formes sync. du parf. : consumpse Lucr. 1, 223 ; consumpsti Prop. 1, 3, 37
— l'orth. consumsi, consumtum se trouve parfois dans les mss.
===> .
¶1. action d'employer, emploi : Her. 4, 32
¶2. action d'épuiser, épuisement : Cic. Tim. 18.
¶1. garnir de planches, planchéier, munir de planchers = d'étages : turres contabulantur Cæs. G. 5, 40, 6, on munit de planchers (d'étages) les tours ; turres contabulatæ Liv. 24, 34, 7, tours à étages
— murum turribus Cæs. G. 7, 22, 3, garnir d'étages le mur au moyen de tours, garnir le mur de tours avec étages
¶2. couvrir : contabulato mari molibus Curt. 5, 7, 8, la mer étant recouverte d'un pont de bateaux (Suet. Cal. 19).
¶1. contact : contagio pulmonum Cic. Nat. 2, 138, contact avec les poumons, cf. Dom. 108 ; Div. 1, 63 ; cum corporibus Cic. Tusc. 1, 72, contact avec les corps
— [fig.] relation, rapport : contagio naturæ Cic. Fat. 5, rapport des phénomènes naturels entre eux (συμπάθεια), cf. Div. 2, 33
¶2. contagion, infection : Enn. d. Cic. Tusc. 3, 26 ; contagio pestifera Liv. 28, 34, 4, épidémie de peste
— [fig.] contagion, influence pernicieuse : contagio imitandi ejus belli Cic. Verr. 5, 6, l'exemple contagieux de cette guerre ; contagiones malorum Cic. Off. 2, 80, la contagion du mal.
¶1. part. de contamino
¶2. adjt, souillé, impur : Cic. Pis. 20 ; Liv. 2, 37, 9 ; homo sceleribus contaminatissimus Cic. Prov. 14, l'individu le plus souillé de crimes.
¶1. mélanger, mêler : fabulas Ter. Andr. 16, fondre ensemble plusieurs comédies
¶2. souiller par contact : Don. And. 16 ; Liv. 1, 48, 7 ; 45, 5, 4 ; Suet. Ner. 56
— [fig.] corrompre, souiller : contaminare se vitiis Cic. Tusc. 1, 72, se souiller de vices, cf. Cic. Cat. 1, 29 ; veritatem mendacio Cic. Sull. 45, altérer la vérité par un mensonge ; v. contaminatus.
¶1. verbal de contemno
¶2. adj., méprisable, négligeable, sans valeur, insignifiant : Cic. Br. 51 ; 273 ; Verr. 3, 67 ; 4, 132.
===> formes -tempno [certains mss.] ; -temsi, -temtum : Inscr.
¶1. visible : Chalcid. Tim. 135
¶2. qui vise bien : Amm. 23, 4, 2 ; 30, 5, 16.
¶1. action de viser : Plin. 6, 194
¶2. action de regarder attentivement, contemplation : contemplatio cæli Cic. Div. 1, 93, la contemplation du ciel
— [fig.] contemplation intellectuelle, examen approfondi : Cic. Ac. 2, 127 ; Nat. 1, 50
— [en part.] considération, égard : contemplatione alicujus ou alicujus rei Ulp. Dig. 3, 5, 3, 20 ; Apul. M. 8, 30, en considération de qqn, de qqch.
¶1. celui qui contemple, contemplateur, observateur : Cic. Tusc. 1, 69 ; Sen. Helv. 8, 4
¶2. viseur, tireur : Amm. 19, 1, 7.
===> étymologie d. P. Fest. 38.
¶1. part. de contemno
¶2. adjt, dont on ne tient pas compte, méprisable : quæ vox potest esse contemptior quam Milonis ? Cic. CM 27, y a-t-il parole plus méprisable que celle-ci de Milon ? contemptissimi consules Cic. Sest. 36, les consuls les plus méprisables.
¶1. action de mépriser, mépris : Liv. 24, 5, 5 ; Quint. 11, 3, 80 ; Tac. An. 6, 45
¶2. fait d'être méprisé : Lucr. 3, 65 ; Liv. 4, 3, 8 ; 6, 2, 4 ; contemptui esse alicui Cæs. G. 2, 30, 4, être objet de mépris pour qqn.
I. tr.,
¶1. tendre [avec force] : tormenta telorum Cic. Tusc. 2, 57, tendre les machines à lancer des traits ; (fides) contenta nervis Cic. Fin. 4, 75, (lyre) tendue au moyen de ses cordes ; nervos Varr. L. 8, 63 (Cic. Fat. 21 ; Fam. 15, 14, 5), tendre les muscles (fig. = faire effort)
— lancer [un trait, un javelot] : Virg. En. 10, 521 ; Sil. 1, 323
— [fig.] vires Lucr. 4, 989, tendre ses forces ; animum in tales curas Ov. P. 1, 5, 11, tendre son esprit vers de telles occupations
— qui cursum huc contendit suum Pl. Cist. 534, celui qui dirige vivement sa course ici, cf. Virg. En. 5, 834
¶2. chercher à atteindre, à obtenir qqch, prétendre à : honores Varr. Men. 450, solliciter les charges ; hic magistratus a populo summa ambitione contenditur Cic. Verr. 2, 131, cette magistrature, on la sollicite du peuple avec les plus vives compétitions, cf. Læ. 39 ; Att. 1, 8, 10, etc.
— [abst] contendere ab aliquo, solliciter qqn avec insistance : Cic. Amer. 4 ; Planc. 12 ; Att. 6, 2, 10, etc. ; a me valde contendit de reditu in gratiam Cic. Q. 3, 1, 15, il m'entreprend vivement pour une réconciliation
— [avec ut, ne] : contendit ab eo, ut causam cognosceret Cic. Verr. 1, 73, il le pressa d'instruire la cause ; pro suo jure contendet, ne patiamini... Cic. Verr. 5, 2, comme c'est son droit, il vous demandera avec insistance de ne pas souffrir... (Cæs. C. 3, 97, 1)
— [avec inf.] hoc non contendo... mutare animum Cic. Q. 1, 1, 38, je ne prétends pas modifier un caractère ; [avec prop. inf.] Vell. 2, 48, 1
¶3. soutenir énergiquement, affirmer, prétendre, aliquid, qqch : Cic. Off. 2, 71 ; Amer. 47, etc.
— [surtout avec prop. inf.] soutenir que : Verr. 5, 19 ; Font. 1 ; Arch. 15 ; Sest. 107, etc. ; Cæs. G. 6, 37, 7, etc. ; apud eos contendit falsa iis esse delata Nep. Them. 7, 2, devant eux, il affirme qu'on leur a fait de faux rapports
¶4. comparer : leges Cic. Inv. 2, 145 ; causas Cic. Cat. 2, 25, comparer les lois, les partis en présence ; rem cum re Cic. Agr. 2, 96 ; Inv. 2, 173, comparer une chose avec une autre ; [poét.] rem rei, aliquem alicui : Lucil. 24 ; 277 ; Hor. Ep. 1, 10, 26 ; Aus. 160, 9 ; 419, 33.
II. int.,
¶1. bander les ressorts, tendre son énergie, faire effort, se raidir : lateribus Cic. de Or. 1, 255 ; voce Cic. Lig. 6, faire effort des poumons, de la voix ; ad summam gloriam Cic. Phil. 14, 32, tendre vers la gloire la plus haute ; ad ultimum animo Cic. Mur. 65, tendre de toute son énergie vers le point le plus éloigné
— [avec inf.] : tranare contenderunt Cæs. G. 1, 53, 2, ils s'efforcèrent de traverser à la nage (3, 15, 1 ; 3, 26, 5 ; 5, 21, 4, etc.)
— [avec ut, ne] : eos vidimus contendere ut... pervenirent Cic. Verr. 5, 181, nous les avons vus s'efforcer de parvenir... (Sest. 5 ; Phil. 9, 15, etc.) ; remis contendit ut... Cæs. G. 5, 8, 2, il tente à force de rames de...; ea ne fierent, contendit Cic. Att. 12, 4, 2, il s'est opposé à cela de toutes ses forces
¶2. marcher vivement, faire diligence : quæ res eum nocte una tantum itineris contendere coegit ? Cic. Amer. 97, qu'est-ce qui le forçait à fournir une telle course en une seule nuit [= marcher sur un si long parcours] ? in Italiam magnis itineribus contendit Cæs. G. 1, 10, 3, il se porte vivement en Italie par grandes étapes (1, 7, 1 ; 4, 18, 2) ; [avec ad] G. 2, 7, 3, etc. ; statim exanimatus ad ædes contendit Cic. Verr. 1, 67, aussitôt il se hâte à perdre haleine vers la maison
— [avec inf.] : Bibracte ire contendit Cæs. G. 1, 23, 1, il se hâte d'aller à Bibracte (G. 3, 6, 4, etc.)
¶3. se mesurer, lutter, rivaliser : cum aliquo, cum aliqua re, avec qqn, avec qqch : Cic. Flacc. 5 ; Balb. 59 ; Mil. 68 ; Off. 1, 38 ; Nat. 3, 10, etc. ; ingenio cum aliquo Cic. Verr. 5, 174, rivaliser de talent avec qqn ; de aliqua re eum aliquo Cic. Sull. 83, lutter avec qqn pour qqch
— prœlio Cæs. G. 1, 48, 3 ; contra populum Romanum armis Cæs. G. 2, 13, 3, se mesurer dans un combat (les armes à la main) contre le peuple romain ; cum aliquo Cæs. G. 1, 31, 6, etc., avec qqn ; inter se de potentatu contendebant Cæs. G. 1, 31, 4, ils luttaient entre eux pour la suprématie
— lutter pour les magistratures, pour les honneurs, etc., de honore, de dignitate, etc.: Cic. Mur. 21 ; Sull. 24, etc.
— discuter : cum aliquo de mittendis legatis Cæs. C. 3, 90, 2, discuter avec qqn pour l'envoi d'une ambassade
— [poét.] rivaliser, lutter avec qqn, alicui : Lucr. 3, 6 ; Prop. 1, 7, 3 ; 1, 14, 7 ; Sen. Nat. 1, 11, 2.
¶1. action de tendre [ou] d'être tendu avec effort, tension, contention, effort : Cic. Tusc. 2, 57 ; Arch. 12 ; Cæl. 39 ; de Or. 2, 22, etc.
— [en part.] élévation de la voix [portée dans le registre élevé] : Cic. de Or. 1, 261 ; 3, 224 ; Off. 1, 136 ; [ou] effort de la voix, ton animé : Cic. Br. 202 ; Or. 85, etc.
— éloquence soutenue, style oratoire [opp. à sermo, conversation, style familier] : Off. 1, 132 ; de Or. 3, 177, etc.; [ou] éloquence animée, passionnée : de Or. 1, 255 ; 2, 213 ; Br. 276 ; Or. 59, 109, etc.
— tension des corps pesants vers un point (pesanteur, gravité) : Cic. Nat. 2, 116
¶2. lutte, rivalité, conflit : Cic. Clu. 44 ; Cat. 4, 13 ; Phil. 5, 32 ; Marc. 5 ; Off. 1, 90, etc.; Cæs. G. 1, 44, 9 ; 7, 48, 4, etc.
— de aliqua re ou alicujus rei, pour qqch : commodi alicujus Cic. Læ. 34 ; honorum Cic. Off. 1, 87, lutte (rivalité) pour tel ou tel avantage, pour les magistratures
— venit in contentionem utrum sit probabilius... Cic. Div. 2, 129, il y a conflit sur la question de savoir laquelle des deux opinions est la plus probable...
¶3. comparaison : ex aliorum contentione Cic. Pomp. 36, par comparaison avec des choses différentes ; fortunarum contentionem facere Cic. Pis. 51, faire la comparaison des destinées ; rei cum re Cic. Inv. 2, 125, d'une chose avec une autre
— [rhét.] antithèse : Her. 4, 21 ; 4, 58 ; Quint. 9, 3, 81 ; [dans de Or. 3, 205, il faut entendre «affirmation triomphant de l'adversaire », cf. Or. 138]
— [gram.] degré de comparaison : Varr. L. 8, 75.
¶1. tendu : contentis corporibus Cic. Tusc. 2, 54, en tendant les muscles du corps ; contentissima voce Apul. M. 4, 10, d'un ton de voix très élevé
¶2. appliqué fortement : mens contenta in aliqua re Lucr. 4, 964, esprit appliqué fortement à qqch (alicui rei Ov. M. 15, 515) ; contento cursu Cic. Mur. 30, à vive allure.
===> comp. contentiores Pl. Pœn. 460.
¶1. tr., ranger par trois : Grom. 200, 3
¶2. int., être dans sa troisième année : Vulg. Isai. 15, 4.
¶1. broyer, piler : medium scillæ Varr. R. 2, 7, 8, piler le cœur d'un oignon
¶2. user par le frottement, par l'usage : viam Sacram Prop. 3, 23, 15, user le pavé de la voie Sacrée ; [fig., en parl. d'un livre souvent feuilleté] Cic. Fam. 9, 25, 1
¶3. accabler, épuiser, détruire : aliquem oratione Pl. Cist. 609, assommer qqn par ses discours ; boves Lucr. 2, 1161, exténuer des bœufs ; corpora Tac. Agr. 31, s'épuiser physiquement
— [fig.] réduire en poudre, anéantir : alicujus injurias oblivione Cic. Fam. 1, 9, 20, réduire à néant par l'oubli les injustices de qqn, cf. Tusc. 5, 85
¶4. user, consumer [temps] : ætatem in litibus Cic. Leg. 1, 53, user sa vie dans les procès ; operam frustra Ter. Phorm. 209, perdre son temps, conterere se in geometria Cic. Fin. 1, 72, employer tout son temps à l'étude de la géométrie ; cum in foro conteramur Cic. de Or. 1, 249, puisque nous passons notre vie au Forum
— [fig.] épuiser par l'usage [un sujet] : quæ sunt horum temporum, ea jam contrivimus Cic. Att. 9, 4, 1, tout ce qu'on peut dire sur les affaires présentes, nous l'avons déjà épuisé
— cf. contritus.
===> formes sync. contrieram Cic. Fam. 1, 9, 20 ; 9, 25, 1 ; contrieris Ov. Med. 89
— pf. conterui Apul. M. 8, 23.
===> .
¶1. attestation, affirmation fondée sur des témoignages : Gell. 10, 3, 4
— contestatio litis, ouverture d'un débat judiciaire [par l'appel des témoins] : Gai. Inst. 3, 180 ; Dig. 3, 3, 40
¶2. [fig.] prière pressante, vives instances : Cic. frg. A. 7, 10.
¶1. prendre à témoin, invoquer : contestari deos hominesque Cic. Verr. 4, 67, prendre à témoin les dieux et les hommes
¶2. commencer (entamer) un débat judiciaire, en produisant les témoins : Cic. Att. 16, 15, 2 ; Gell. 5, 10, 8 ; Cod. Just. 3, 9
— [passivt] cum lis contestatur Aufid. Bass. d. Prisc. 8, 18, quand le procès est entamé ; cum lis contestata esset Cic. Com. 54, le procès étant engagé
— n. à l'abl. absolu contestato, en produisant des témoins : Ulp. Dig. 1, 25, 3, 1
¶3. [fig.] contestatus, a, um, attesté, éprouvé : Cic. Flacc. 25.
¶1. entrelacer, ourdir : Cic. Nat. 2, 158
¶2. [fig.] unir, relier, rattacher : (rem cum re, une chose à une autre) Cic. Or. 120 ; Rep. 1, 16 ; Fam. 5, 12, 2
— epilogum defensioni Sen. Contr. 7, 5, 7, rattacher la péroraison à la défense ; contexta sceleribus scelera Sen. Ir. 1, 16, 2, crimes formant une trame ininterrompue
— continuer, prolonger : interrupta Cic. Leg. 1, 9, renouer le fil de ce qui a été interrompu ; carmen longius Cic. Cæl. 18, prolonger la citation d'une poésie ; sapientis contexitur gaudium Sen. Ep. 72, 4, la joie du sage est d'une trame inaltérable ; historia contexta Nep. Att. 16, 4, histoire suivie
¶3. former par assemblage, par entrelacement : Cæs. G. 6, 16, 4 ; C. 1, 54, 2 ; 2, 2, 1 ; [par couches successives] Cæs. G. 7, 23, 4 ; trabibus contextus acernis equus Virg. En. 2, 112, cheval formé d'un assemblage de poutres d'érable
— [fig.] : orationem Quint. 10, 6, 2, composer un discours ; crimen Cic. Dej. 19, ourdir une accusation.
¶1. assemblage : Lucr. 1, 243 ; Cic. Fin. 5, 32
¶2. [fig.] réunion, enchaînement : Cic. Fin. 5, 83
— succession [de lettres] : Quint. 1, 1, 24
— contexture d'un discours : Cic. Part. 82 ; in contextu operis Tac. H. 2, 8, au cours de l'ouvrage.
¶1. int., se taire [ne pas parler] : Calp. Ecl. 4, 98 ; Lact. 5, 2, 9
¶2. tr., taire : Prosp. Ep. 1, 3 ; pf. pass. impers. conticitum est Prisc. Gram. 3, 470.
¶1. int., se taire [cesser de parler] : repente conticuit Cic. Cat. 3, 10, brusquement il se tut ; nunquam de vobis gratissimus sermo conticescet Cic. Phil. 14, 33, jamais on ne cessera de parler de vous avec reconnaissance
— [fig.] devenir muet, cesser : Cic. Pis. 26 ; Br. 324
¶2. tr., taire, cacher [décad.] : Arn. Nat. 5, 2 ; Ps. Cypr. Jud. incr. 8.
¶1. qui touche, qui atteint : Gell. 9, 1, 2
¶2. qui touche, contigu (alicui rei, à qqch) : Tac. An. 6, 45 ; 15, 38
¶3. à portée de [dat.] : Virg. En. 10, 457.
¶1. joint à, attenant à (alicui rei, cum aliqua re, à qqch) : Cic. Cæc. 11 ; Nat. 2, 117 ; Fam. 15, 2, 2
— pl. n. continentia, lieux avoisinants : Plin. 18, 215
¶2. qui se tient, continu : terra continens Cic. Rep. 2, 6 et contĭnens, tis, f., continent : Cæs. G. 4, 28, 3 ; 5, 2, 3, etc.
— continentibus diebus Cæs. C. 3, 84, 2, les jours suivants ; labor continens Cæs. G. 7, 24, 1, travail ininterrompu ; oratio Cic. Tusc. 1, 17, exposé suivi
¶3. continent, sobre, tempérant : Cic. Tusc. 4, 36 ; Att. 6, 6, 3 ; non continentior in vita hominum quam in pecunia Cæs. C. 1, 23, 4, aussi respectueux de la vie des hommes que de leur argent ; moderatissimi homines et continentissimi Cic. Arch. 16, les plus modérés et les plus sages des hommes
¶4. [rhét.] contĭnens, tis, n., l'essentiel, le principal [dans une cause] : Quint. 3, 6, 104 ; 3, 11, 9 ; continentia causarum Cic. Part. 103, les points essentiels des procès, cf. Top. 95.
¶1. en se touchant : continenter sedere Catul. 37, 6, être assis les uns près des autres
— de suite, sans interruption, continuellement : biduum continenter Liv. 25, 7, 7, pendant deux jours sans arrêt
¶2. sobrement, avec tempérance : Cic. Off. 1, 106
— continentissime Aug. Conf. 6, 12.
¶1. maîtrise de soi-même, modération, retenue : Cic. Inv. 2, 164 ; Verr. 4, 115
¶2. contenance, contenu : Macr. Somn. 2, 12, 2
¶3. contiguïté, voisinage : Sol. 7, 26 ; Macr. S. 5, 15, 5.
¶1. maintenir uni, relié : capillum Varr. L. 5, 130, maintenir des cheveux réunis ; neque materiam ipsam cohærere potuisse, si nulla vi contineretur Cic. Ac. 1, 24, [ils pensaient] que la matière elle-même n'aurait pu être cohérente, si elle n'était maintenue par quelque force, cf. Cæs. G. 1, 25, 6
— maintenir en état, conserver : hæc ipsa virtus amicitiam et gignit et continet Cic. Læ. 20, cette vertu même tout à la fois engendre et maintient l'amitié, cf. Leg. 2, 69 ; Off. 2, 84, etc.; pars oppidi mari disjuncta ponte rursus adjungitur et continetur Cic. Verr. 4, 117, la partie de la ville séparée par la mer se relie en revanche et fait corps grâce à un pont
— [fig.] omnes artes quasi cognatione quadam inter se continentur Cic. Arch. 2, tous les arts sont unis les uns aux autres par une sorte de parenté, cf. de Or. 3, 21 ; Leg. 1, 35 ; Rep. 3, 45, etc.
¶2. embrasser, enfermer : isdem mœnibus contineri Cic. Cat. 1, 19, être enfermé dans les mêmes murailles ; quam angustissime aliquem continere Cæs. C. 3, 45, 1, tenir qqn enfermé le plus étroitement possible ; reliquum spatium mons continet Cæs. G. 1, 38, 5, l'espace restant, un mont l'occupe ; vicus altissimis montibus continetur Cæs. G. 3, 1, 5, le bourg est enfermé (dominé) par de très hautes montagnes
— maintenir dans un lieu : in castris Cæs. G. 4, 34, 4 ; 6, 36, 1 ; castris Cæs. G. 1, 48, 4 ; 2, 11, 2 ; 3, 17, 5, etc. ; intra castra Cæs. G. 5, 58, 1, maintenir au camp, à l'intérieur du camp ; sese vallo Cæs. G. 5, 44, 5, se maintenir derrière le retranchement
— [fig.] : non mea gratia familiaritatibus continetur Cic. Mil. 21, il n'est pas vrai que mon crédit se limite au cercle de mes relations intimes ; Latina suis finibus continentur Cic. Arch. 23, les œuvres latines se renferment dans leurs frontières, cf. Cat. 4, 21 ; de Or. 1, 192 ; hæc, quæ vitam omnem continent, neglegentur ? Cic. Fin. 1, 12, ces questions-ci, qui par leur objet embrassent toute la vie, on les laissera de côté ? tales res, quales hic liber continet Cic. Or. 148, des sujets, comme ceux que traite ce livre (Cæl. 40 ; Sest. 14) ; libris contineri Cic. Top. 2, être renfermé dans des livres
¶3. maintenir, retenir [dans le devoir] : in officio Cæs. G. 3, 11, 2 ; 5, 3, 6 ; in fide Liv. 21, 52, 8
¶4. renfermer en soi, contenir : alvo Cic. Div. 1, 39, porter dans son sein ; amicitia res plurimas continet Cic. Læ. 22, l'amitié porte en elle un très grand nombre d'avantages, cf. Fin. 2, 18 ; Div. 1, 125, etc.
— quæ res totum judicium contineat, intellegetis Cic. Amer. 34, vous comprendrez quelle est la question qui contient (d'où dépend) tout le procès ; intellecto eo, quod rem continet Cic. Tusc. 3, 58, ayant compris ce dont tout dépend (ce qui est l'essentiel), savoir que... cf. Fin. 4, 14
— d'où le passif, contineri aliqua re, consister dans qqch : non enim venis et nervis et ossibus di continentur Cic. Nat. 2, 59, car les dieux ne sont pas composés de veines, de nerfs et d'os ; eruditissimorum hominum artibus eloquentia continetur Cic. de Or. 1, 5, l'éloquence est constituée par l'ensemble des connaissances des hommes les plus instruits (Marc. 22 ; 28 ; Fin. 2, 48, etc.)
¶5. contenir, réprimer, réfréner [qqn ou les passions de qqn] : Cic. Cat. 2, 26 ; Verr. 5, 167, etc.; Verr. 1, 62 ; 4, 101 ; Tusc. 4, 22 ; Nat. 2, 34 ; non potest exercitum is continere qui se ipse non continet Cic. Pomp. 38, il ne peut contenir ses troupes le général qui ne sait se contenir lui-même
— non contineri ne Liv. 40, 58, 1 ; non contineri quin Cæs. C. 2, 12, 4 ; quominus Curt. 7, 4, 19, ne pas être empêché de
— contenir, réprimer [le rire, la douleur, etc.] : Cic. Phil. 2, 93 ; Sest. 88 ; [sa langue] Q. 1, 1, 38 ; hominem furentem continui Cic. Har. 1, j'ai arrêté (fait taire) ce dément
— sese continere Cic. de Or. 2, 85, se contraindre ; contineo me, ne incognito adsentiar Cic. Ac. 2, 133, je suspends mon jugement pour ne pas acquiescer à ce que je ne connais point
— tenir éloigné de [ab aliquo, ab aliqua re] : ab aliquo manus alicujus Cic. Cat. 1, 21, retenir qqn de porter les mains sur qqn ; milites a prœlio Cæs. G. 1, 15, 4, empêcher les soldats de combattre ; se ab assentiendo Cic. Ac. 2, 104, se garder de donner son assentiment.
I. tr.,
¶1. toucher, atteindre : funem manu Virg. En. 2, 239, toucher de la main les cordages ; cibum terrestrem rostris Cic. Nat. 2, 122, atteindre du bec la nourriture sur le sol ; terram osculo Liv. 1, 56, 12, baiser la terre ; victrices dextras consulum Liv. 28, 9, 6, toucher les mains victorieuses des consuls ; avem ferro Virg. En. 5, 509, atteindre d'un trait un oiseau ; Italiam Virg. En. 5, 18, aborder l'Italie
— Helvii fines Arvernorum contingunt Cæs. G. 7, 7, 5, les Helviens touchent le territoire des Arvernes ; turri contingente vallum Cæs. G. 5, 43, 6, une tour touchant le rempart ; ut... neque inter se contingant trabes Cæs. G. 7, 23, 3, en sorte que... les poutres ne se touchent pas les unes les autres
— [fig.] arriver jusqu'à, atteindre : quos in aliqua sua fortuna publica quoque contingebat cura Liv. 22, 10, 8, ceux que, au milieu d'une certaine prospérité personnelle, le souci aussi de l'État venait toucher ; contactus nullis ante cupidinibus Prop. 1, 1, 2, jusque-là n'ayant été atteint d'aucune passion
— [en part.] infecter, contaminer : civitas contacta rabie duorum juvenum Liv. 4, 9, 10, la cité atteinte de la rage des deux jeunes gens ; contacti ea violatione templi Liv. 29, 8, 11, souillés par cette violation du temple ; dies (Alliensis) religione contactus Liv. 6, 28, 6, la journée de l'Allia frappée de malédiction [considérée comme néfaste]
¶2. toucher, être en rapport (relation) avec : aliquem propinquitate, amicitia Liv. 25, 8, 2 ; sanguine, genere Liv. 45, 7, 3, toucher à qqn par la parenté, l'amitié, le sang, la naissance ; deos Hor. S. 2, 6, 52, approcher des dieux ; modico usu aliquem Tac. An. 4, 68, avoir quelques relations avec qqn
— concerner, regarder : hæc consultatio Romanos nihil contingit Liv. 34, 22, 12, cette délibération ne concerne pas du tout les Romains ; mea causa quæ nihil eo facto contingitur Liv. 40, 14, 9, ma cause que ce fait ne touche (n'intéresse) en rien.
II. int.,
¶1. arriver [alicui, à qqn], échoir, tomber en partage : quod isti contigit uni Cic. de Or. 2, 228, ce qui lui est arrivé à lui seul (Off. 1, 153 ; Fam. 5, 21, 1, etc. ; Cæs. G. 1, 43, 4)
— [en mauv. part.] : Tusc. 5, 15 ; Cat. 1, 16 ; Nat. 1, 27 ; CM 71 ; Off. 2, 50, etc.
— [abst] arriver, se produire : id facilitate mea contigit Cic. de Or. 2, 15, c'est le résultat de ma complaisance excessive ; [avec ex] Quint. 11, 1, 53
¶2. avec inf. : celeriter antecellere omnibus contigit Cic. Arch. 4, il lui fut donné de surpasser promptement tout le monde ; non cuivis homini contingit adire Corinthum Hor. Ep. 1, 17, 36, il n'est pas donné à n'importe qui d'aller à Corinthe ; Romæ nutriri mihi contigit Hor. Ep. 2, 2, 41, j'ai eu le bonheur d'être élevé à Rome
— [avec ut subj.] : Pl. Amph. 187 ; Cic. de Or. 3, 3 ; Br. 118 ; 290 ; Phil. 5, 49, etc.
¶1. part. de continuo
¶2. adjt, continu, continuel, ininterrompu : continuatum iter Cæs. C. 3, 36, 8, marche ininterrompue, cf. Cic. Flacc. 25
— continuatissimus Sid. Ep. 8, 3, 4.
¶1. incontinent, à l'instant : Cic. Verr. 4, 48 ; de Or. 1, 121
— immédiatement après : Fam. 10, 12, 3 ; Tusc. 4, 42 ; Cæs. G. 7, 42, 6
¶2. [lien logique] : non continuo Cic. de Or. 2, 199 ; Tusc. 3, 5 ; Fin. 4, 75, il ne s'ensuit pas que, ce n'est pas une raison pour que ; continuone...? Cic. Tusc. 3, 40, est-ce une raison pour que... ?
¶3. continuellement, sans interruption : Varr. L. 7, 13 ; Quint. 2, 20, 3 ; 9, 1, 11.
¶1. faire suivre immédiatement, assurer une continuité, joindre de manière à former un tout sans interruption ; domus, qua Palatium et Mæcenatis hortos continuaverat Tac. An. 15, 39, la maison grâce à laquelle il avait joint de façon continue le Palatin aux jardins de Mécène ; fundos Cic. Agr. 3, 14 ; agros Liv. 34, 4, 9, acquérir des propriétés attenantes, étendre ses propriétés ; latissime agrum Cic. Agr. 2, 70, étendre au loin ses terres
— [surt. au pass.] : aer mari continuatus et junctus est Cic. Nat. 2, 117, l'air fait suite et se joint à la mer ; ædificia mœnibus continuantur Liv. 1, 44, 4, les maisons sont attenantes aux remparts ; atomi aliæ alias adprehendentes continuantur Cic. Nat. 1, 54, les atomes s'accrochant les uns aux autres forment un tout continu ; priusquam continuarentur hostium opera Liv. 23, 17, 5, sans attendre que les ouvrages de circonvallation de l'ennemi se rejoignent (se ferment) entièrement
— [fig.] : continuata verba Cic. de Or. 3, 149, mots disposés en période ; hi sunt evitandi continuati pedes Cic. Or. 194, il faut éviter une continuité de ces pieds
¶2. faire succéder [dans le temps] sans interruption : dapes Hor. S. 2, 6, 108, faire succéder les mets sans interruption ; paci externæ continuatur discordia domi Liv. 2, 54, 2, à la paix extérieure succède la discorde intérieure
— faire durer sans discontinuité : hiemando continuare bellum Liv. 5, 2, 1, continuer la guerre en prenant les quartiers d'hiver ; magistratum Sall. J. 37, 2, prolonger une magistrature ; familia rerum gestarum gloria continuata Cic. Flacc. 25, famille qui s'est continuée par la gloire des actions accomplies ; continuato diem noctemque opere Cæs. 1, 62, 1, ouvrage mené sans interruption jour et nuit, cf. 3, 11, 1 ; 3, 36, 8 ; ei dantur imperia et ea continuantur Cic. Rep. 1, 68, on lui donne des commandements et même on lui en assure la continuité
¶3. int., durer, persister : Cels. 2, 4.
¶1. [dans l'espace] avec le dat. ou abst : aer continuus terræ est Sen. Nat. 2, 6, 1, l'air touche à la terre ; Leucas continua Ov. M. 15, 289, Leucade jointe au continent = qui est une presqu'île ; continui montes Hor. Ep. 1, 16, 5, chaîne de montagnes ; pl. n. continua Liv. 30, 5, 7, les parties adjacentes
— continuus principi Tac. An. 6, 26, toujours aux côtés de l'empereur
— [fig.] oratio continua Sen. Ep. 89, 17, exposé continu ; lumina continua Quint. 12, 10, 46, ornements entassés
¶2. [dans le temps] : continuos complures dies Cæs. G. 4, 34, 4, pendant plusieurs jours consécutifs ; triumphi duo continui Liv. 41, 7, 1, deux triomphes coup sur coup ; honores continui Cic. Mur. 55, continuité des magistratures [dans une famille]
— [fig.] qui ne s'interrompt pas : continuus accusandis reis Suillius Tac. An. 11, 6, Suillius, accusateur infatigable.
¶1. assemblée du peuple convoquée et présidée par un magistrat [dans laquelle on ne vote jamais], cf. P. Fest. 38, 4 ; advocare contionem Cic. Sest. 28 ; habere Cic. Phil. 6, 18, convoquer, présider l'assemblée du peuple ; Locrensium contionem habuit Liv. 29, 21, 7, il réunit l'assemblée des Locriens ; laudare aliquem pro contione Sall. J. 8, 2 ; Liv. 7, 7, 3, faire l'éloge de qqn devant le peuple ; dimittere, summovere contionem, congédier, lever l'assemblée, v. ces verbes
— assemblée des soldats : Cæs. G. 5, 52, 5
¶2. harangue, discours public : contiones habere Cic. Br. 305, prononcer des discours politiques, des harangues ; contionem apud milites habuit Cæs. C. 3, 73, 2, il prononça une harangue devant les troupes
— discours [en gén.] : Thucydides contionibus melior Quint. 10, 1, 73, Thucydide a l'avantage pour les discours
¶3. [expressions] : in contionem prodire Cic. Agr. 3, 1, s'avancer pour parler dans l'assemblée, ou [comme on parlait du haut des rostres] in contionem ascendere Cic. Fin. 2, 74, se présenter pour parler, monter à la tribune (cf. Verr. Fl. d. Gell. 18, 7, 7).
¶1. être assemblé : vos universos timent contionantes Liv. 39, 16, 4, ils vous craignent quand vous êtes tous réunis
¶2. haranguer, prononcer une harangue : contionari ex alta turri Cic. Tusc. 5, 59, haranguer le peuple du haut d'une tour ; pro tribunali Tac. An. 1, 61, haranguer du haut de son tribunal ; apud milites Cæs. C. 1, 7, 1, faire une harangue devant les soldats ; ad populum Suet. Aug. 84, 2, devant le peuple ; de aliqua re, de aliquo, au sujet de qqch, de qqn : Cic. Har. 8 ; Fam. 12, 22, 1
¶3. dire dans une harangue : contionatus est se non siturum Cic. Q. 2, 4, 6, il déclara qu'il ne permettrait pas
— [avec acc. n. hæc] Liv. 22, 14, 15
— [av. subj seul, idée d'ordre] Cæs. C. 3, 6, 1
¶4. dire publiquement, proclamer : caterva tota contionata est... Cic. Sest. 118, le chœur entier s'écria...; hoc futurum sibylla contionata est Lact. 4, 18, la sibylle a prédit cela.
¶1. tourner, faire tourner (tournoyer) : membra Cic. Div. 1, 120, se tourner ; proram ad... Virg. En. 3, 562, tourner la proue vers... ; amnes in alium cursum contorti Cic. Div. 1, 38, cours d'eau que l'on a détournés dans une autre direction
— [en part.] brandir, lancer : telum Lucr. 1, 971, lancer un javelot
¶2. [fig.]
a) tourner qqn dans tel ou tel sens : auditor ad severitatem est contorquendus Cic. de Or. 2, 72, il faut amener l'auditeur à la sévérité ;
b) lancer avec force : quæ verba contorquet ! Cic. Tusc. 3, 63, quels traits il lance ! periodos uno spiritu Plin. Ep. 5, 20, 4, lancer des périodes d'une haleine.
¶1. action de tourner : C.-Aur. Chr. 1, 464
¶2. entortillement : contortiones orationis Cic. Fat. 71, expressions obscures.
¶1. part. de contorqueo
¶2. adjt, entortillé, compliqué, enveloppé : Cic. de Or. 1, 250
— impétueux, véhément : Cic. Or. 66
— contorta, ōrum, n., passages véhéments : Quint. 9, 4, 116.
I. adv.,
¶1. en face, vis-à-vis : Pl. Cas. 938 ; Most. 1105 ; Liv. 1, 16, 6 ; 5, 37, 8 ; Tac. An. 2, 10
¶2. au contraire, contrairement, au rebours :
a) [attribut] quod totum contra est Cic. Fin. 4, 40, ce qui est tout le contraire (Lucr. 3, 108 ; Cic. Fin. 3, 50 ; Off. 1, 49 ; 2, 8); utrumque contra accidit Cic. Fam. 12, 18, 2, sur les deux points, c'est le contraire qui est arrivé, cf. Or. 191 ;
b) [liaison] : ille... hic contra Cic. Sull. 17, celui-là... celui-ci au contraire (Off. 1, 108 ; Or. 36 ; Font. 33 ; Fin. 4, 36) ; augendis rebus et contra abjiciendis Cic. Or. 127, en amplifiant les choses ou au contraire en les ravalant ; contraque Cic. Fin. 2, 55, etc., et au contraire ; non... sed contra Cic. de Or. 3, 67, non pas... mais au contraire ; ut hi miseri, sic contra illi beati Cic. Tusc. 5, 16, si ceux-ci sont malheureux, par contre ceux-là sont heureux
¶3. contrairement à ce que, au contraire de ce que : simulacrum Jovis contra atque ante fuerat, ad orientem convertere Cic. Cat. 3, 20, tourner la statue de Jupiter contrairement à sa position antérieure, vers l'orient ; contra ac ratus erat Sall. C. 60, 5, contrairement à ce qu'il avait pensé, cf. Cic. Fin. 4, 41 ; Or. 137 ; Cæs. G. 4, 13, 5 ; C. 3, 12, 2
— contra quam fas erat Cic. Clu. 12, contrairement à ce qui était permis (Inv. 2, 136 ; Pis. 18 ; de Or. 2, 86 ; Leg. 2, 11); contra quam... solet Liv. 30, 10, 4, contrairement à ce qui se fait d'ordinaire.
II. prép. avec acc.,
¶1. en face de, vis-à-vis de, contre : contra Galliam Cæs. G. 5, 13, 1, en face de la Gaule (3, 9, 9 ; 4, 20, 3, etc.)
¶2. contre, en sens contraire de : contra naturam Cic. Fin. 3, 18 ; contra morem majorum Cic. Amer. 100, contrairement à la nature, à la coutume des ancêtres ; contra impetum fluminis Cæs. G. 4, 17, 5, contre le courant du fleuve
— contre (en luttant contre) rem publicam contra improbos cives defendere Cic. Sest. 51, défendre l'État contre les mauvais citoyens ; contra aliquem pugnare Cæs. G. 2, 33, 4, combattre qqn ; copias contra aliquem ducere Cæs. G. 7, 61, 5, mener les troupes contre qqn
¶3. = erga, envers, à l'égard de : Plin. 8, 23.
===> contra après son subst. : Lucr. 6, 715 ; Virg. En. 1, 13 ; 5, 414
— quos contra Cic. Verr. 1, 24 ; 5, 153 ; Mur. 9 ; Or. 34 ; hos contra singulos Cic. Fin. 5, 22.
¶1. action de contracter, contraction : digitorum Cic. Nat. 2, 150, action de fermer la main ; contractio frontis Cic. Sest. 19, action de plisser le front
¶2. action de serrer, d'abréger : Cic. Att. 5, 4, 4 ; de Or. 3, 196
— [fig.] contractio animi Cic. Tusc. 4, 66, resserrement de l'âme, accablement, v. contraho.
¶1. replié, fermé : Quint. 11, 3, 95
¶2. resserré, étroit, mince : Nilus contractior Plin. Pan. 30, 3, le Nil plus resserré dans son cours ; contractiores noctes Cic. Par. 5, nuits plus courtes ; contractior oratio Cic. Br. 120, langage trop ramassé, cf. Or. 78
— contracta paupertas Hor. Ep. 1, 5, 20, l'étroite pauvreté, qui vit à l'étroit
— modéré, restreint : studia contractiora Cic. Cæl. 76, passions qui se restreignent davantage
¶3. [fig.] replié sur soi : contractus leget Hor. Ep. 1, 7, 12, dans le recueillement il lira
¶4. [expr.] porca contracta Cic. Leg. 2, 55, truie due comme expiation.
¶1. contraction, resserrement : Varr. R. 1, 68
¶2. action d'engager, de commencer une affaire : Quint. 4, 2, 49
— [en part.] contrat, convention, pacte, transaction : Serv. Sulpic. d. Gell. 4, 4, 2 ; Dig. 50, 16, 19.
a) [abst] contra qui dicet Cic. Inv. 2, 151, le contradicteur, l'adversaire ;
b) alicui, alicui rei, parler contre qqn, contre qqch : Quint. 5, 10, 13 ; Tac. D. 25 ; etc.
— [avec prop. inf.] répliquer que : Sen. Contr. 7, 8, 10
— non contradici quin Liv. 8, 2, 2, [il répondit] qu'on ne formulait pas d'opposition à ce que
— [décad.] s'opposer, faire obstacle : [avec ne] ne Fabius mitteretur contradixit A.-Vict. Vir. 34, 5, il s'opposa à ce que Fabius fût envoyé.
¶1. tirer (faire venir) ensemble, rassembler : cohortes ex finitimis regionibus Cæs. C. 1, 15, 5 ; exercitum in unum locum Cæs. G. 1, 43, 3, rassembler les cohortes des régions voisines, l'armée en un même point ; ad spectaculum contracta multitudine Liv. 45, 33, 3, une multitude étant assemblée pour le spectacle ; pauci admodum patrum... contracti ab consulibus Liv. 2, 13, 12, un petit nombre seulement de sénateurs furent réunis par les consuls ; senatum contrahere V.-Max. 2, 2, 6, réunir le sénat ; decuriones Plin. Ep. 5, 7, 4, réunir les décurions ; pecuniam Sen. Ben. 7, 15, 1, rassembler de l'argent, recueillir des fonds (Tac. An. 1, 37 ; Plin. Ep. 10, 90)
— faire venir [à soi], contracter : æs alienum Cic. Cat. 2, 4, etc., contracter des dettes ; aliquid damni Cic. Fin. 5, 91, faire une perte ; morbum Plin. 30, 65 ; pestilentiam Plin. 36, 202, contracter une maladie, la peste ; tristitiam Plin. 24, 24, devenir triste ; omnia culpa contracta sunt Cic. Att. 11, 9, 1, tout est venu par ma faute ; ea est a nobis contracta culpa ut Cic. Att. 11, 24, 1, la faute dont je me suis chargé est telle que...; contracto inter Ætolos et Tralles certamine Liv. 27, 32, 4, un combat étant engagé entre les Étoliens et les Tralles ; causam certaminis cum Minucio contrahere volebat Liv. 22, 28, 4, il voulait trouver le prétexte d'un combat avec Minucius ; contrahere alicui cum aliquo bellum Liv. 24, 42, 11, attirer à qqn une guerre avec qqn ; alicui negotium Cic. Cat. 4, 9, attirer des embarras à qqn, lui créer des difficultés ; plus periculi Liv. 2, 23, 14, s'attirer plus de danger
¶2. resserrer, contracter : frontem Cic. Clu. 72 ; membra Cic. Div. 1, 120, contracter le front, les membres ; pulmones se contrahunt Cic. Nat. 2, 136, les poumons se contractent
— contraxi vela Cic. Att. 1, 16, 2, je calai la voile (je me modérai)
— réduire, diminuer : castra Cæs. G. 5, 49, 7, rétrécir son camp ; tempus epularum Plin. Pan. 49, réduire le temps des banquets
— [rhét.] nomina Cic. Or. 153, contracter les noms
— [abst] contrahere, faire une contraction dans la prononciation : Cic. Or. 153 ; 155
— resserrer : universitatem generis humani Cic. Nat. 2, 164, resserrer l'universalité du genre humain [pour passer à l'examen des individus], cf. Ac. 1, 38 ; Læ. 20 ; appetitus Cic. Off. 1, 103, restreindre les penchants ; jura Sil. 11, 682, restreindre les droits [de la royauté] ; contrahi Sen. Ep. 120, 21, se rapetisser, se ravaler
— [en part.] : animos contrahere Cic. Leg. 2, 38, serrer l'âme, le cœur (accabler) ; animas formidine contrahitur Lucr. 5, 1218, le cœur est serré par la crainte ; sol tum quasi tristitia quadam contrahit terram, tum vicissim lætificat Cic. Nat. 2, 102, grâce au soleil, la terre est tantôt comme serrée de tristesse, tantôt alternativement épanouie de joie ; te rogo ne contrahas ac demittas animum Cic. Q. 1, 1, 4, je te supplie de ne pas te laisser aller au découragement et à l'abattement ; cf. Læ. 48
¶3. avoir un lien (des rapports) d'affaire [cum aliquo, avec qqn], engager une affaire [avec qqn] : cum illo nemo rationem, nemo rem ullam contrahebat Cic. Clu. 41, personne n'engageait un compte, ni la moindre affaire avec lui (Sull. 56 ; Scaur. 18) ; negotia, rem contrahere Cic. Off. 2, 40 ; 2, 64 ; 3, 61, faire des affaires ; qui nihil omnino cum populo contrahunt Cic. Tusc. 5, 105, ceux qui n'ont absolument rien à faire avec le peuple ; rerum contractarum fides Cic. Off. 1, 15, fidélité aux engagements, respect des contrats ; male contractis rebus Cic. Att. 7, 7, 7, les affaires étant mal engagées.
¶1. qui est en face, du côté opposé : Cic. Mur. 89 ; Phil. 2, 26 ; Cæs. C. 3, 45, 2 ; etc. ; contraria vulnera Tac. H. 3, 84, blessures reçues en face
— [avec dat.] en face de : Sen. Nat. 5, 17, 2 ; Plin. 37, 131
¶2. opposé, contraire : video utrumque ictu cecidisse contrario Cic. Tusc. 4, 50, je vois qu'ils sont tombés tous deux en se frappant réciproquement ; in contrarias partes fluere Cic. Div. 1, 78, écouler en sens contraire ; [avec dat.] opposé à : Cæs. G. 4, 17, 5 ; Ov. M. 8, 471 ; 13, 183
— in contrarium, dans le sens contraire : Liv. 28, 30, 9 ; Sen. Nat. 2, 24, 1 ; Plin. 2, 128, etc. ; ex contrario, du point opposé (diamétralement opposé) : Sen. Nat. 1, 4, 1 ; Ep. 122, 2, etc.
¶3. [fig.] contraire, opposé : contrarias causas dicere Cic. de Or. 2, 30, plaider des causes opposées ; in contrarias partes disputare Cic. de Or. 1, 158, soutenir le pour et le contre ; ex contraria parte Cic. Br. 145, du point de vue opposé
— contraire à qqch : [alicui rei] Cic. Verr. 3, 27 ; Leg. 3, 42 ; Fin. 2, 28 ; Ac. 1, 36 ; [alicujus rei] Inv. 2, 157 ; Tusc. 4, 34 ; Fin. 4, 67 ; [avec inter se] Clu. 140 ; de Or. 2, 223 ; [avec ac, atque] contraire de (ce que) : Verr. 1, 120 ; Rep. 6, 17 ; [avec quam] Quint. 9, 2, 50
— [rhét.] contraria, membres de phrase antithétiques : cum contrariis opponuntur contraria Cic. Or. 166, quand on fait des oppositions antithétiques [grec ἀντίθετα] ; in contrariis referendis Cic. Or. 166, dans le rapprochement de membres antithétiques [relatio contrariorum Cic. Or. 166]; [sing., rare] Or. 220
— ex contrario, contrairement, au contraire : Cic. Com. 47 ; Fin. 5, 36 ; Cæs. G. 7, 30, 3 (contrario Sen. Nat. 6, 13, 4 ; Ep. 94, 2 ; Quint. 10, 1, 19)
¶4. [log.] qui est en contradiction (alicui rei, avec une chose) : Cic. Or. 115
— contraria, les contradictions : de Or. 2, 166 ; Leg. 2, 45, etc.
¶5. défavorable, ennemi, hostile, nuisible : Varr. R. 1, 16, 6 ; Suet. Oth. 8 ; [avec dat.] averna vocantur, quia sunt avibus contraria Lucr. 6, 741, on appelle ces lieux avernes, parce qu'ils sont funestes aux oiseaux (Plin. 18, 152 ; 20, 90, etc.; Ov. M. 2, 380, etc.) ; monens imperaturo contrariam esse (philosophiam) Suet. Ner. 52, lui remontrant que la philosophie était mauvaise pour un futur empereur.
¶1. attouchement : Cic. Nat. 1, 77
¶2. détournement [droit] : Paul. Dig. 47, 2, 1.
¶1. [en gén.] toucher, manier : pecuniam Suet. Cal. 42, manier de l'argent ; pectora Ov. M. 8, 606, palper la poitrine
¶2. [en part.] :
a) tâter, visiter, fouiller : Suet. Claud. 35, 2 ;
b) avoir commerce avec : Pl. Pœn. 698 ; Suet. Dom. 1, 3 ; Tac. An. 14, 35 ;
c) s'approprier indûment, dérober : Gai. Inst. 3, 195 ; Dig.
¶3. [fig.] contrectare aliquid oculis Tac. An. 3, 12, repaître ses yeux de la vue de qqch ; mente voluptates Cic. Tusc. 3, 33, goûter des plaisirs par la pensée.
¶1. int., commencer à trembler [choses et pers.] : Cic. Har. 63 ; de Or. 1, 121
— [fig.] chanceler, vaciller : Cic. Sest. 68
¶2. tr., trembler devant, redouter : Hor. O. 2, 12, 8 ; Sen. Ep. 65, 24 ; Just. 32, 4, 10.
¶1. apporter sa part en commun, ajouter pour sa part : Ov. M. 7, 231
— ajouter de manière à confondre : proprios tecum annos contribuisse velim Tib. 1, 6, 60, je voudrais que mon lot d'années se confondît avec le tien ; [avec dat.] Sen. Ben. 6, 5, 4 ; Brev. 15, 1 ; Col. 9, 13, 9
¶2. ajouter (annexer) de manière à incorporer : [avec dat.] Curt. 5, 3, 16 ; Liv. 26, 24, 15 ; Achaico concilio contribui Liv. 36, 35, 7, se joindre à l'assemblée achéenne
— [avec cum] : qui erant cum Oscensibus contributi Cæs. C. 1, 60, qui étaient incorporés avec les Osciens
— [avec in acc.] incorporer dans : Liv. 32, 19, 4 ; 33, 34, 8
— in unam urbem contributi Liv. 31, 30, 6, groupés en une seule ville
¶3. disposer, arranger, classer : Vell. 2, 20, 2 ; Col. 2, 9, 17.
¶1. balance, compensation [de l'actif et du passif] : Dig. 16, 2, 1
¶2. action de contribuer à une dépense commune : Dig. 14, 2, 1.
a) brisement, destruction, ruine : Lact. 7, 18 ;
b) accablement : Aug. Conf. 7, 7.
¶1. mouvement opposé : controversia aquæ Ulp. Dig. 39, 2, 24, le cours opposé de l'eau
¶2. [en gén.] controverse, discussion [entre deux antagonistes, deux parties] : nulla controversia mihi tecum erit Pl. Aul. 261, il n'y aura pas de difficultés entre nous ; rem in controversiam vocare Cic. de Or. 2, 291 ; adducere Cic. de Or. 1, 183 ; deducere Cæs. G. 7, 63, soumettre une affaire à un débat, appeler le débat sur une affaire ; controversiam facere Cic. Or. 121, engendrer une discussion [en parl. de choses]; mais Liv. 3, 40, 10, soulever une discussion (mettre en question) [en parl. de pers.] ; controversias habere Cic. Verr. 2, 122, avoir des contestations, cf. Cæs. G. 5, 44, 2 ; 5, 44, 4 ; controversiam componere Cæs. C. 3, 109, 1, arranger une contestation
— numquam erat controversia quid intellegerem Cic. Fin. 1, 16, jamais il n'y avait de débat sur la question de savoir ce que je comprenais
— controversia non erat quin verum dicerent Cic. Cæc. 31, on ne contestait pas leur véracité : nihil controversiæ fuit quin consules crearentur... Liv. 4, 17, 7, il n'y eut pas de contestation sur l'élection au consulat de... ; sine controversia Cic. Off. 3, 7, sans conteste
¶3. [en part.]
a) point litigieux, litige [discussion juridique] : sive ex controversia causa constat, ut hereditatis Cic. de Or. 2, 104, soit que le débat porte sur un litige, comme dans une affaire d'héritage ;
b) débat judiciaire, procès : civilium controversiarum patrocinia suscipere Cic. Or. 120, se charger (comme avocat) de procès civils ;
c) controverse, déclamation : Sen. Contr. 1 ; Quint. 2, 1, 9 ; Tac. D. 35.
¶1. tourné vis-à-vis : Amm. 14, 2, 3
— contraire, opposé : Macr. Somn. 1, 6, 24
¶2. controversé, discuté, mis en question, douteux, litigieux : res controversa Cic. Leg. 1, 52, question très discutée, cf. Div. 2, 104 ; Mur. 28
— controversa, ōrum, n., points litigieux : Quint. 5, 14, 14.
¶1. massacrer, égorger ensemble, en bloc : Suet. Cal. 28 ; Sen. Ep. 115, 5
¶2. accabler de coups [une seule pers.] : Cic. Sest. 79 ; [fig.] republicam Cic. Sest. 24, ruiner l'État.
¶1. pousser avec force : Lucr. 6, 510
— pousser ensemble : Lucr. 6, 1254
¶2. entasser, refouler : Varr. R. 1, 54, 2 ; Cic. Cæl. 63.
¶1. camarade de tente, camarade [entre soldats] : Cic. Lig. 21 ; Tac. H. 1, 23
— attaché à la personne d'un général : Cic. Cæl. 73 ; Planc. 27 ; Suet. Cæs. 42, 1
¶2. [en gén.] camarade, compagnon ; [attaché à la personne d'un magistrat] Cic. Fam. 9, 20, 1 ; Br. 105
— m. et f., compagnon, compagne [entre esclaves de sexe différent] : Col. 12, 1, 1 ; Petr. 57, 6
— [fig.] compagnon inséparable : contubernalis Quirini Cic. Att. 13, 28, 3, compagnon de Romulus = César [dont la statue se dressait dans le temple de Quirinus-Romulus].
¶1. camaraderie entre soldats qui logent sous la même tente : Tac. An. 1, 41, 3
— vie commune d'un jeune homme avec un général auquel il est attaché : Cic. Planc. 27 ; Liv. 42, 11, 7 ; contubernio patris militabat Sall. J. 64, 4, il servait en qualité d'attaché à son père
¶2. commerce, société, intimité, liaison d'amitié : per contubernium Arei philosophi Suet. Aug. 89, 1, grâce à la fréquentation du philosophe Aréus ; contubernium hominis Sen. Ir. 3, 8, 2, la cohabitation avec l'homme
— [en part.] cohabitation, concubinage : Col. 12, 1, 2 ; Dig. 40, 4, 59
— [fig.] felicitatis et moderationis dividuum contubernium est Val.-Max. 9, 5, le bonheur et la modération n'habitent pas ensemble
¶3. tente commune : Cæs. C. 3, 76, 3 ; tente : progrediuntur contuberniis Tac. An. 1, 41, 1, ils sortent de leurs tentes
— logement commun : Suet. Ner. 34, 1
— logement d'esclaves : Tac. H. 1, 43
— alvéole des abeilles : Plin. 11, 26.
===> formes arch. : contuor Pl. As. 403 ; Lucr. 4, 35
— forme active contuo Pacuv. Tr. 6.
¶1. opiniâtreté, esprit d'indépendance ; obstination, fierté [en mauv. et bonne part] : Cic. Verr. 4, 89 ; Liv. 2, 61, 6 ; Cic. Tusc. 1, 71
— [jurispr.] contumace : Dig. 42, 1, 53
¶2. [fig.] entêtement des animaux : Col. 6, 2, 11
— dispositions rebelles [des plantes] : Plin. 16, 134.
¶1. opiniâtre, obstiné, fier [surt. en mauv. part] : Cic. Verr. 2, 192 ; Suet. Tib. 2, 4
— [en b. part.] constant, ferme, qui tient bon : Tac. H. 1, 3
— [jurispr.] contumax : Dig. 42, 1, 53
¶2. [fig.] rétif : Col. 6, 2, 10
— récalcitrant, rebelle [en parl. des choses] : Plin. 12, 50 ; Mart. 9, 12
— -cior Cic. Verr. 2, 192 ; -issimus Sen. Ep. 83, 21.
¶1. parole outrageante, outrage, affront : contumeliam dicere alicui Pl. Curc. 478, injurier qqn ; contumeliam jacere in aliquem Cic. Sull. 23, lancer une injure à qqn ; contumelias alicui imponere Cic. Verr. 4, 20, faire subir des affronts à qqn ; alicui contumeliam facere Ter. Phorm. 972 ; Liv. 8, 23, 7 ; Sen. Ep. 70, 20, etc., outrager qqn [mais Ant. d. Cic. Phil. 3, 22, facere contumeliam = contumelia adfici, v. Quint. 9, 3, 13] ; per contumeliam Cæs. C. 1, 9, 2 d'une façon outrageante ; tanta contumelia accepta Cæs. G. 7, 10, 2, après avoir subi un tel affront
— blâme, reproche : Hor. Epod. 11, 26
¶2. [fig.] injures [des éléments] : Cæs. G. 3, 13, 3.
¶1. faire en forme d'éminence : Plin. 10, 100
¶2. couvrir d'un tertre, enterrer : Mart. 8, 57, 4 ; Ov. Tr. 3, 3, 32.
¶1. écraser, broyer, piler : Cat. Agr. 7, 4 ; Cæs. C. 3, 58, 3 ; radices Col. 7, 7, 2, broyer des racines
¶2. écraser, briser, meurtrir de coups, assommer : aliquem fustibus Pl. Aul. 409, rompre qqn de coups de bâton ; manus Cic. Fl. 73, rompre les mains de qqn ; classis victa, contusa Inscr. d. Liv. 40, 52, 6, flotte vaincue, écrasée ; articulos Hor. S. 2, 7, 16, paralyser les mains
¶3. [fig.] contudi audaciam Cic. Phil. 13, 29, j'ai écrasé son audace ; contudi animum Cic. Att. 12, 44, 3, je me suis réduit, dompté ; Hannibalem Liv. 27, 2, 2, abattre Hannibal ; ingenium Ov. Tr. 15, 12, 31, briser les ressorts de l'esprit ; contundam facta Talthybi Pl. Stich. 305, je surpasserai [littt, j'écraserai] les exploits de Talthybius.
¶1. trouble, affolement : Cic. Tusc. 4, 19
¶2. trouble, dérangement, malaise : conturbationes oculorum Scrib. 19, éblouissement ; conturbatio mentis Cic. Tusc. 4, 30, dérangement de l'esprit.
¶1. [en gén.] mettre en désordre, troubler, altérer : ordines Sall. J. 50, 4, mettre le trouble dans les rangs ; oculus conturbatus Cic. Tusc. 3, 15, œil troublé (vue brouillée); rem publicam Sall. C. 37, 10, bouleverser l'État, cf. Cic. Har. 39 ; necesse est vocem conturbari Lucr. 4, 559, il faut que la voix s'altère
— [fig.] troubler, effrayer, inquiéter : Cic. Verr. 2, 74 ; Nat. 2, 1 ; 90, etc., valetudo tua me valde conturbat Cic. Att. 7, 2, 2, ta santé m'inquiète fort
— troubler, embrouiller : Lucr. 3, 483 ; Cic. Off. 3, 40 ; [abst] Off. 3, 81
¶2. [en part.] jeter le desordre dans les comptes, les brouiller, les bouleverser : Dig. 11, 3, 1 ; conturbasti mihi rationes Ter. Eun. 868, tu as brouillé tous mes calculs
— [abst] suspendre les paiements, faire faillite : Cic. Planc. 68 ; Juv. 7, 129.
¶1. perche à ramer : Virg. En. 5, 208 ; Tac. An. 14, 5
¶2. épieu, pique : Tac. An. 6, 35.
¶1. action d'écraser, de meurtrir : Plin. 17, 227 ; Col. 12, 49, 2
¶2. contusion : Scrib. 101.
¶1. mariage [dans sa plénitude légale] : Cic. de Or. 1, 37 ; Off. 1, 54
— [poét., pl. pour sing.] Virg. En. 3, 319
¶2. droit de mariage : Cic. Rep. 2, 63 ; Liv. 4, 1, 1 ; 8, 14, 10 ; etc.
¶3. union des sexes : Lucr. 3, 777
— [en parl. des plantes] ente, greffe : Plin. 16, pr. 1.
===> chez les poètes souvent trisyll. : Virg. En. 1, 73 ; 3, 136, etc.
— orth. conn- moins bonne.
¶1. cône : Lucr. 4, 430 ; Cic. Nat. 1, 24
¶2. [fig.] sommet d'un casque : Virg. En. 3, 468
— pomme de cyprès : Col. 6, 7, 2
— sorte de cadran solaire : Vitr. 9, 8, 1.
¶1. prendre des forces, croître, grandir : convalescunt arbores Varr. R. 1, 23, 6, les arbres poussent ; convaluit flamma Quint. 5, 13, 13, la flamme a grandi ; convalescere ex morbo Cic. Fat. 28 ou abst convalescere Cat. d. Gell. 3, 7, 19 ; Cic. Tusc. 3, 5, se rétablir
— convalescentes, ĭum, m., convalescents : Plin. 20, 34
¶2. [fig.] convaluit Cic. Att. 7, 3, 4, il est devenu puissant ; convaluit annona Suet. Aug. 42, 2, le marché du blé s'est assaini ; opinio convaluit Gell. 4, 11, 1, l'opinion s'est accréditée
— [jurispr.] être valide (valable), avoir son effet : Dig. 29, 1, 33.
===> abl. convalle ; convalli Varr. R. 1, 12, 4 ; Apul. M. 1, 7.
¶1. tr., tacheter de tout côté : Apul. Apol. 50, 2
¶2. int., varier beaucoup : C. Aur. Chron. 1, 1, 7.
¶1. le dieu qui préside au charriage de la récolte : Fab. Pict. d. Serv. G. 1, 21
¶2. compagnon de voyage : [par mer] Cic. Att. 10, 17, 1 ; [par terre] Apul. M. 1, 15.
¶1. [en gén.] transporter par charroi, charrier, apporter : Cæs. G. 7, 74 ; C. 1, 48, 5 ; Cic. Mil. 75
¶2. [en part.] rentrer [la récolte] : Varr. L. 5, 35 ; Plin. 16, 35.
¶1. arracher : signa convelli jussit Cic. Div. 1, 77, il ordonna d'arracher les étendards [de la terre où ils sont fixés] = de se mettre en marche (Liv. 3, 7, 3 ; 22, 3, 11 ; 22, 33, 12 ; etc.); convolsis repagulis Cic. Verr. 4, 94, les barres de fermeture étant arrachées ; vectibus infima saxa turris convellunt Cæs. C. 2, 11, 3, ils sapent au moyen de leviers les fondements de la tour
— arracher d'un endroit : [abl.] Roma prope convulsa sedibus suis Cic. Pis. 52, Rome presque arrachée de ses fondements ; Herculem suis sedibus convellere Cic. Verr. 5, 186, arracher Hercule de sa demeure (son emplacement), cf. Virg. En. 2, 464 ; Plin. Ep. 7, 19, 8 ; [avec e, ex] Cic. Verr. 5, 187 ; Leg. 1, 54 ; Liv. 38, 43, 5 ; [avec a, ab] Virg. G. 1, 457 ; En. 3, 24
¶2. [médec.] convulsus, a, um, qui a des spasmes, des convulsions : Plin. 25, 98 ; Quint. 11, 3, 20 ; convulsa, ōrum, n., convulsions : Plin. 20, 157, etc.
¶3. [fig.] ébranler : si eam opinionem ratio convellet Cic. Clu. 6, si la raison ébranle cette opinion ; eo judicio convulsam penitus scimus esse rem publicam Cic. Br. 115, nous savons que ce procès ébranla (troubla) profondément la république
— démolir, détruire : leges Cic. Pis. 10, saper des lois ; acta Dolabellæ Cic. Phil. 2, 83, annuler (infirmer) les actes de Dolabella.
===> parf. convelli Cic. Dom. 54 ; Har. 41 ; Leg. 1, 54 ; etc. ; convulsi Hier. Ep. 3, 3.
¶1. adjt, qui se rencontre, qui se réunit : amantes facere convenas Pl. Mil. 139, réunir des amants
¶2. subst. pl., convenæ, ārum, m., étrangers venus de partout, fugitifs, aventuriers : Cic. de Or. 1, 37 ; Tusc. 5, 58.
===> .
===> .
¶1. qui est en bon accord, qui vit en bonne intelligence : bene convenientes propinqui Cic. Off. 1, 58, parents qui s'entendent bien
— [en parl. de choses] en harmonie : Off. 1, 144 ; 3, 35
¶2. qui est d'accord avec, conforme à : nihil conveniens decretis ejus Cic. Fin. 2, 99, rien qui soit conforme à sa doctrine
— [avec ad] Cic. Læ. 17
— [avec in abl.] Liv. 45, 19, 3
— [avec cum] Nigid. d. Gell. 19, 4, 4
¶3. convenable, séant : nihil convenientius ducens quam... Suet. Aug. 10, 1, estimant que rien n'était plus séant que...
— convenientissimus Plin. Pan. 87, 1 ; Ep. 10, 3, 2.
¶1. accord parfait, harmonie, sympathie : convenientia naturæ Cic. Div. 2, 124, v. conjunctio ; convenientia naturæ cum extis Cic. Div. 2, 34, rapport entre les phénomènes naturels et les entrailles des victimes ; convenientia partium Cic. Off. 1, 14, proportion des parties
¶2. [abst] convenance (ὁμολογία) : Cic. Fin. 3, 21.
I. int.,
¶1. venir ensemble, se rassembler : equites qui toti Galliæ erant imperati conveniunt Cæs. G. 7, 66, 1, les cavaliers qui avaient été commandés à toute la Gaule se rassemblent ; cum de communi officio convenissent Cic. Off. 1, 144, comme ils s'étaient réunis à propos de leur fonction commune (Verr. 4, 77 ; etc.)
— venir à un rassemblement, à une convocation : qui ex iis novissimus convenit necatur Cæs. G. 5, 56, 2, celui d'entre eux qui s'est présenté le dernier au rassemblement est mis à mort (6, 37, 6 ; 7, 39, 1)
— [ex] venir de, [in acc., ad] pour se rassembler dans, vers : cum incredibilis in Capitolium multitudo ex tota urbe convenisset Cic. Sest. 26, comme une incroyable multitude était venue de tous les points de la ville se rassembler au Capitole ; unum in locum Cic. Verr. 3, 114, se réunir au même endroit ; totius fere Galliæ legati ad Cæsarem gratulatum convenerunt Cæs. G. 1, 30, 1, les députés de la Gaule presque entière vinrent trouver César pour le remercier ; ad signa Cæs. G. 6, 1, 2, rejoindre ses enseignes (= son corps) ; ad ædes Cic. Verr. 1, 67, se rassembler vers la maison
— [avec in abl.] : uno in loco omnes adversariorum copiæ convenissent Cic. Div. 2, 52, toutes les troupes de ses adversaires se seraient trouvées réunies en un seul et même endroit (Verr. 2, 160)
— [avec ad = ensuite de] : ad clamorem hominum Cæs. G. 4, 37, 2, se réunir aux cris poussés par les Gaulois ; ad signum Liv. 23, 35, 16, se rassembler au signal donné
— [droit] : in manum Cic. Flacc. 84 ; Top. 14, venir sous la puissance [du mari], se marier (ou viro in manum Cic. Top. 23)
¶2. convenir, s'adapter : in aliquid Pl. Pseud. 1181 ; Cat. Agr. 21, 1, s'adapter à qqch ; ad aliquid Cic. Fin. 3, 46
— alicui Hor. Ep. 2, 1, 56, aller bien à qqn
— [abst] corona non convenit Cic. de Or. 250, la couronne ne va pas
— [fig.] s'accorder [avec], convenir [à] : conveniunt mores Ter. And. 696, nos caractères se conviennent ; nomen non convenit Ter. And. 942, le nom ne s'accorde pas (n'est pas le même) ; ita dicere ut sibi ipse non conveniat Cic. Br. 209, parler de manière à se contredire ; huic omnia dicendi ornamenta conveniunt Cic. Or. 92, à ce genre de style tous les ornements conviennent
— hæc tua deliberatio non convenit cum oratione Largi Cic. Fam. 6, 8, 2, ton indécision sur ce point ne s'accorde pas avec les propos de Largus ; captivorum oratio cum perfugis convenit Cæs. C. 2, 39, 2, le récit des captifs s'accorde avec celui des transfuges ; hæc vitia videntur in quemvis potius quam in istum convenire Cic. Verr. 1, 128, ces vices semblent convenir a n'importe qui plutôt qu'à cet homme ; hoc maledictum minime in illam ætatem conveniret Cic. Dej. 28, une telle injure ne s'accorderait pas avec son âge ; hæc contumelia ad maximam partem civium convenit Cic. Sull. 23, cet outrage retombe sur la plus grande partie des citoyens (Inv., 179 ; Fin. 3, 35)
— convenit impers., [avec inf.] il convient que, il est logique que : qui convenit polliceri operam suam... cum... nesciant ? Cic. Rep. 1, 11, est-il logique qu'ils promettent leurs services... quand ils ne savent pas...? cf. Verr. 2, 159 ; Font. 27 ; Sull. 93, etc. ; conveniet cum in dando munificum esse, tum... Cic. Off. 2, 64, il conviendra de se montrer généreux en donnant, et aussi de...
— [avec prop. inf.] : te interfectum esse convenit Cic. Cat. 1, 4, il conviendrait que tu eusses été mis à mort ; qui convenit, quæ causa fuerit ad constituendum judicium, eamdem moram esse ad judicandum ? Cic. Cæc. 7, est-il logique que la raison qui a fait instituer une action judiciaire en retarde la marche ? (Clu. 128 ; Liv. 29, 20, 2)
¶3. convenir à plusieurs, être l'objet d'un accord, d'une convention : signum quod convenerat Cæs. C. 1, 28, 3, le signal qui avait été convenu ; condiciones pacis antea convenire non potuerant Cæs. C. 3, 10, 8, les conditions de paix n'avaient pu jusque-là être l'objet d'un accord (on n'avait pu s'accorder sur...)
— hoc mihi cum tuo fratre convenit Cic. Fin. 5, 87, là-dessus nous sommes d'accord, ton frère et moi (Tusc. 5, 39 ; Fam. 13, 6, 2) ; pax quæ cum T. Quinctio convenit Liv. 34, 43, 2, la paix dont on est convenu avec T. Quinctius ; judex qui inter adversarios convenit Cic. Clu. 120, le juge qui est agréé par les deux parties (Leg. 3, 7 ; Cæs. G. 2, 19, 6)
¶4. convenit impers., il y a accord : [avec prop. inf.] interfectum esse a Clytæmnestra Agamemnonem convenit Cic. Inv. 1, 31, il y a accord sur ce point qu'Agamemnon a été tué par Clytemnestre ; interfectam matrem esse a filio convenit mihi cum adversariis Cic. Inv. 1, 31, mes adversaires reconnaissent avec moi que la mère a été tuée par son fils (Tusc. 3, 46 ; Amer. 79) ; inter omnes convenire oportet commotiones... esse vitiosas Cic. Tusc. 4, 61, tous doivent convenir que les émotions... sont vicieuses
— [av. int. ind.] : cum, quid factum sit, convenit Cic. Inv. 1, 12, quand on est d'accord sur le fait (Nep. Han. 13, 1 ; Liv. 30, 16, 2, etc.) ; si, quid esset prodesse, mihi cum Ennio conveniret Cic. Off. 3, 62, si j'étais d'accord avec Ennius sur la définition de l'utile
— [avec ut, ne] : mihi cum Dejotaro convenit ut ille... esset Cic. Att. 6, 1, 14, je suis convenu avec Déjotarus (il est convenu entre Déjotarus et moi) qu'il viendra..., (Phil. 13, 37 ; Liv. 5, 17, 5 ; 24, 6, 4 ; 33, 13, 14 ; etc.) ; ita convenit, ne unis castris miscerentur Liv. 10, 27, 2, il fut convenu qu'ils ne seraient pas confondus dans le même camp
— [abst] convenit, il y a accord : Cic. Phil. 13, 2 ; Liv. 1, 25, 1 ; 30, 40, 12 ; cum de re conveniat Cic. Fin. 4, 72, puisqu'il y a accord sur le fond ; alicui cum aliquo Cic. Lig. 18 ; Verr. 4, 147 ; Phil. 5, 13 ; Nep. Ages. 2, 3 ; inter aliquos de aliqua re Cic. Nat. 3, 9 ; Liv. 26, 15, 1, etc., il y a accord de qqn avec qqn, entre des personnes sur une question
¶5. tours particuliers :
a) pax conventa Sall. J. 112, 2 = pax quæ convenit, la paix qui a été conclue ; quibus conventis Liv. 30, 43, 7 = quæ cum convenissent, l'accord étant fait sur ce point ;
b) sujet nom de pers. : cum de præda non convenirent Just. 15, 4, 23, comme ils n'étaient pas d'accord sur le butin.
II. tr., rencontrer qqn, joindre qqn (aliquem) : aliquem in itinere Cæs. G. 1, 27, 1, joindre qqn en chemin ; mulier, te conventam volant Pl. Cist. 304, femme, on veut te parler ; mihi hoc homine convento est opus Pl. Curc. 302, j'ai besoin de joindre cet homme ; Atilium sua manu spargentem semen convenerunt Cic. Amer. 58, ils trouvèrent Atilius en train de semer de sa propre main ; Romam rediens ab nuntio uxoris erat conventus Liv. 1, 58, 6, il avait été rencontré par le messager de sa femme au moment où il revenait à Rome ; tribuni plebi non desistebant clam inter se convenire Cic. Agr. 2, 12, les tribuns de la plèbe ne cessaient pas de se voir mutuellement en secret.
===> arch. coveniatis Cat. Or. 40, 1 ; convenibo Pl. Cas. 548
— subj. convenam, at Pl. Bac. 348 ; Trin. 583, correction pour la métrique.
¶1. petite réunion, petit groupement : Cic. Sest. 91
¶2. lieu de réunion : Tac. An. 14, 15 ; Amm. 15, 5, 31.
¶1. assemblée du peuple : Varr. L. 6, 87 ; P. Fest. 113, 10
— réunion, jonction : Merc. Cyr. p. 284
— union charnelle : Arn. Nat. 5, 10 ; Aug. Faust. 22, 50
— in manum conventio Serv. En. 4, 103, action de venir sous la puissance du mari, cf. Gai. Inst. 3, 14
¶2. convention, pacte : Liv. 27, 30, 12 ; Plin. Ep. 5, 1, 2
¶3. citation en justice : Cod. Just. 3, 6, 3.
¶1. [en gén.] assemblée, réunion : Cic. Verr. 4, 107 ; Nep. Dion. 9, 1
— assemblée (congrès) d'États : Nep. Ep. 6, 1 ; Liv. 28, 5, 14 ; 38, 30, 2
¶2. [en part.]
a) assises [tenues par les gouverneurs de province], session judiciaire : conventum agere Cic. Verr. 5, 28, tenir les assises ; conventibus peractis Cæs. G. 5, 1, 5, la session terminée ;
b) communauté formée par les citoyens romains établis dans une ville de province ; colonie romaine : Cic. Lig. 24 ; Cæs. C. 2, 19, 3
¶3. rencontre [de deux étoiles, conjonction] : Sen. Nat. 7, 12, 4
— commerce charnel : Arn. 2, 70
— agglomération des atomes : Lucr. 1, 611
¶4. [rare] accord : ex conventu Cic. Cæc. 22 ; Att. 6, 3, 1, d'après la convention, cf. Nov.-Just. 119, 11.
a) rafler : Cic. Off. 3, 78 ;
b) étriller, rosser : Pl. Rud. 845.
===> convorram Pl. St. 375.
¶1. action de tourner et retourner qqch, usage fréquent de qqch : Sen. Ben. 3, 2, 2
¶2. action de séjourner : Plin. 10, 100
¶3. commerce, intimité, fréquentation : Sen. Ep. 7, 1 ; Quint. 6, 3, 17.
¶1. action de tourner, mouvement circulaire, révolution : conversiones astrorum Cic. Tusc. 1, 62, les révolutions des astres
— retour périodique Cic. Tim. 14
— [médec.]
a) renversement : Plin. 8, 166 ;
b) abcès : Col. 6, 17, 6
¶2. changement, mutation, métamorphose : Cic. Fl. 94
— changement d'opinion : Plin. 9, 18
— conversion [religieuse] : Aug. Civ. 7, 33
— traduction : Quint. 10, 5, 4
— [rhét.]
a) répétition du même mot en fin de période : Cic. de Or. 3, 206 ;
b) = ἀντιμεταϐολή, répétition des mêmes mots dans un ordre inverse : Her. 4, 39 ; Cic. de Or. 3, 207 ;
c) tour périodique [de la phrase], période : Cic. de Or. 3, 190.
¶1. se tenir habituellement dans un lieu : Plin. 10, 6
¶2. vivre avec : conversari alicui Col. 6, 37 ; Sen. Ep. 32, 2 ; cum aliquo Sen. Ep. 41, 5, ou abst conversari Sen. Ep. 108, 4, vivre en compagnie de qqn
¶3. se conduire, se comporter : male conversari Ulp. Dig. 26, 7, 5, se conduire mal.
I. tr.,
¶1. tourner entièrement, retourner, faire retourner : converso baculo Cic. Verr. 5, 142, avec son bâton retourné ; palam anuli ad palmam convertere Cic. Off. 3, 38, retourner le chaton de la bague vers la paume de la main ; itinere converso Cæs. G. 1, 23, 3, revenant sur leurs pas ; acies in fugam conversa Cæs. G. 1, 52, 6, armée en fuite ; se convertere Cic. Cæl. 35, se retourner ; sese convertere Cæs. C. 1, 46, 1, tourner le dos, prendre la fuite ; boum vox Herculem convertit Liv. 1, 7, 7, le mugissement des bœufs fit retourner Hercule
— [fig.] retourner = changer complètement : omnia nimia in contraria fere convertuntur Cic. Rep. 1, 68, tout excès d'ordinaire se change en excès contraire ; conversam habent demonstrationem suam Cic. Verr. 4, 132, ils ont maintenant leur démonstration toute retournée ; ne in graves inimicitias convertant se amicitiæ Cic. Læ. 78, [prendre garde] que les amitiés ne se métamorphosent en ardentes inimitiés ; conversæ sunt omnium mentes Cæs. G. 1, 41, 1, les dispositions d'esprit de tous furent retournées
— [milit.] castra castris Cæs. C. 1, 81, 3, changer un camp contre un autre, changer de camp à chaque instant
— faire passer d'un état dans un autre : Hecuba in canem conversa Cic. Tusc. 3, 63, Hécube changée en chienne ; in naturam aliam converti Cic. Nat. 3, 21, prendre une autre nature ; in eumdem colorem se convertere Cic. Div. 2, 20, prendre la même couleur
— faire passer d'une langue dans une autre, traduire : e Græco in Latinum librum Cic. Off. 2, 87, traduire un livre du grec en latin ; aliquid in Latinum Cic. Tusc. 3, 29, traduire qqch en latin ; quæ sunt conversa de Græcis Cic. Fin. 1, 6, des œuvres traduites des œuvres grecques
¶2. tourner, faire tourner : ad centuriones ora convertunt Cæs. G. 6, 39, 1, ils tournent leurs regards vers les centurions ; omnium oculos ad se convertebat Nep. Alc. 3, 5, il attirait sur lui les regards de tous ; sica in me conversa Cic. Mil. 37, poignard tourné contre moi ; spelunca conversa ad aquilonem Cic. Verr. 4, 107, caverne tournée vers l'aquilon ; in infimo orbe luna convertitur Cic. Rep. 6, 17, dans le dernier cercle se meut la lune
— [fig.] me ab omnibus ceteris cogitationibus ad unam salutem rei publicæ convertistis Cic. Sull. 40, m'enlevant à toute autre pensée vous m'avez tourné uniquement vers le salut de l'État ; ad hunc se confestim a Pulione omnis multitudo convertit Cæs. G. 5, 44, 10, toute la foule des ennemis se détournant aussitôt de Pulion se porte contre lui ; animos hominum ad me converteram Cic. Br. 321, j'avais attiré sur moi l'attention du monde ; in se odia convertere Cic. Dej. 18, attirer sur soi les haines ; eloquentiam ad bonorum pestem Cic. Off. 2, 51, faire servir l'éloquence à la perte des gens de bien
— aliquid in rem suam Cic. Amer. 114 ; 115 ; 144, détourner qqch à son profit ; cf. Verr. 3, 176.
II. int.,
¶1. se retourner, revenir : in regnum suum convortit Sall. J. 20, 4, il revient dans son royaume ; (J. 101, 6 ; Lucr. 4, 334 ; Gell. 1, 26, 3)
— [fig.] Pl. Stich. 414 ; Lucr. 5, 1422 ; Tac. An. 3, 55
¶2. se changer : num in vitium virtus possit convertere Cic. de Or. 3, 114, [discuter] si la vertu peut se changer en vice, cf. Br. 141 ; Fat. 14 ; Sall. C. 52, 27 ; J. 85, 9.
===> inf., convertier Lucr. 1, 796 ; Cic. Arat. 269 (515).
¶1. convexe, arrondi, de forme circulaire : Ov. M. 1, 26 ; Plin. 5, 38
¶2. courbé, incliné : convexa cornua Plin. 11, 125, cornes courbées
— convexo in tramite Virg. En. 11, 515, dans un chemin creux
¶3. convexum, i, n., et le plus souvent convexa, ōrum, n., concavité, creux : in convexo nemorum Virg. En. 1, 310, dans un fond entouré de bois ; convexa vallium Just. 3, 10, 24, le creux des vallées ; convexa cæli Virg. En. 4, 451, la voûte du ciel.
¶1. int., se mouvoir avec rapidité : Poet. d. Fest. 206, 12
¶2. tr., mettre en vibration, mouvoir avec rapidité : Apul. Flor. 12, 4.
===> convicio, āre : B. Hisp. 33, 2 ; Orig. Mat. 18, 125.
¶1. éclat de voix, clameur, vacarme, criailleries : convicium facere Pl. Bac. 874, faire du tapage
— cris [de certains animaux] : Phæd. 1, 6, 5 ; 3, 16, 3
¶2. [en part.] cri marquant la désapprobation :
a) cris d'improbation, vives réclamations : Cic. Ac. 2, 125 ; Pis. 63 ;
b) invectives, cris injurieux : Cic. Cæl. 6 ;
c) reproche, blâme : Cic. Or. 160
¶3. [fig.] celui qui est l'objet des reproches, vaurien : Pl. Merc. 59.
¶1. commerce, vie commune, société : Cic. Off. 3, 21 ; Sen. Helv. 15, 2
¶2. banquet, festin : Vell. 2, 33, 4 ; Quint. 6, 3, 27 ; Tac. An. 2, 28.
¶1. confondre un adversaire : Cic. Fin. 1, 13 ; Leg. 1, 38
— [fig.] Fin. 2, 99 ; 3, 1 ; Tim. 8
¶2. convaincre [= prouver la culpabilité] : eum mores ipsius convincerent Cic. Sull. 71, ses mœurs le convaincraient ; certis litteris convincitur Cic. Verr. 5, 103, il est convaincu par des pièces précises ; in hoc scelere convictus Cic. Sull. 83, convaincu de ce crime, cf. Inv. 2, 32 ; aliquem inhumanitatis, amentiæ convincere Cic. Phil. 2, 9, convaincre qqn de grossièreté, d'extravagance
— convinci avec inf., être convaincu d'avoir fait qqch : Liv. 45, 14 ; Tac. An. 4, 31 ; 13, 44 ; Curt. 9, 8, 9
¶3. démontrer victorieusement [une erreur, une faute, etc.] : falsa Cic. Nat. 1, 91, dénoncer le faux ; convictis Epicuri erroribus Cic. Nat. 2, 3, les erreurs d'Épicure étant définitivement démontrées (Cæs. G. 1, 40, 12)
— prouver victorieusement une chose contre qqn : volo facinus ipsius qui id commisit voce convinci Cic. Quinct. 79, je veux que ce crime soit victorieusement prouvé par les paroles du coupable lui-même ; quod apud patres convicium... Tac. An. 14, 40, ce fait fut démontré devant le sénat
— [avec prop. inf.] prouver victorieusement [contre qqn] que : Cic. de Or. 1, 42.
¶1. repas, festin : Cic. CM 45 ; Pl. Men. 464
¶2. réunion de convives : *Petr. 109, 5 ; Sen. Tranq. 1, 8.
¶1. int., donner ou prendre un repas : Cic. Verr. 3, 105 ; Suet. Cæs. 48
¶2. tr., absorber : C. Aur. Chron. 1, 1, 8.
===> inf. arch. convivarier Ter. Haut. 206.
¶1. ver-coquin, sorte de chenille de vigne : Cat. Agr. 95, 1 ; Plin. 17, 264
¶2. liseron [plante] : Plin. 21, 24.
===> .
===> .
===> cooptassint = cooptaverint Liv. 3, 64, 10
— forme copto CIL 1, 206, etc.
¶1. naître, apparaître : portenta mira facie coorta Lucr. 5, 838, monstres d'aspect étrange qui prennent naissance ; coortum est bellum Cæs. G. 3, 7, 1, la guerre éclata ; risus omnium coortus est Nep. Epam. 8, 5, un rire général éclata
¶2. [en parl. des phénomènes naturels] : maximo coorto vento Cæs. G. 5, 54, 1, un grand vent s'étant levé ; tempestas subito coorta est Cæs. G. 4, 28, 2, une tempête éclata tout à coup
¶3. se lever pour combattre, s'élever contre : signo dato coorti Liv. 8, 9, 13, se levant au signal donné ; cooriri ad pugnam Liv. 21, 32, 8, se dresser pour combattre ; cooriri in rogationes Liv. 4, 3, 2, s'élever contre des projets de loi.
¶1. île de la mer Égée ; v. Cous, a, um
¶2. Coos, f., ville de l'île de Calydna : Plin. 4, 71.
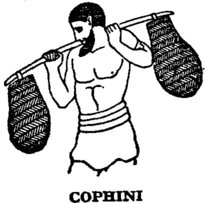
¶1. abondance : frugum Cic. Dom. 17 ; pecuniæ Cic. Inv. 2, 115 ; librorum Cic. Att. 2, 6, 1 ; virorum fortium Cic. Pomp. 27, abondance de moissons, d'argent, de livres, d'hommes courageux
¶2. abondance de biens, richesse : copia cum egestate confligit Cic. Cat. 2, 25, la richesse lutte contre le dénûment ; in summa copia Cic. CM 8, au sein d'une extrême opulence ; bonam copiam ejurare alicui Cic. Fam. 9, 16, 7, jurer à qqn qu'on n'est pas solvable
— [pl.] ressources de tout genre, richesse, fortune : exponit suas copias omnes Cic. Verr. 4, 62, il étale toutes ses richesses ; facultates rerum et copiæ Cic. Off. 1, 9, les facultés (moyens d'existence) et les richesses ; publicani suas rationes et copias in illam provinciam contulerunt Cic. Pomp. 17, les publicains ont transporté dans cette province leurs comptes et leurs fonds ; copiæ rei frumentariæ Cæs. G. 2, 10, 4, ressources en blé ; consularibus copiis instructus Cic. Dom. 119, soutenu de la puissance consulaire ; meis inimicis meis copiis resistere Cic. Pis. 18, résister à mes ennemis avec mes propres moyens ; se eorum copiis aluerunt Cæs. G. 4, 4, 7, ils vécurent sur les ressources de ce peuple, cf. 1, 31, 5 ; C. 3, 78, 3 ; Cic. Dej. 14 ; Att. 7, 9, 2, etc.
— ressources intellectuelles et morales : Att. 7, 21, 1
¶3. [milit.] troupe, forces militaires [surtout au pl.] : navalis copia Cic. Verr. 4, 103, forces navales, cf. Sall. C. 56, 1 ; 56, 3 ; J. 44, 2 ; Liv. 3, 57, 9 ; 9, 17, 3, etc. ; copiæ magnæ, exiguæ Cic., Cæs., troupes nombreuses, restreintes ; pedestres Cic., Cæs., de fantassins ; equitatus peditatusque Cæs. G. 5, 47, 5, troupes de cavalerie et d'infanterie
¶4. [rhét.] abondance [des idées ou des mots], abondance oratoire, richesse du génie, richesse du style : Cic. de Or. 2, 98 ; 3, 31 ; etc.; Or. 37, etc.; Br. 216, etc.
¶5. faculté, pouvoir [de faire, d'obtenir qqch] : Capuæ potiendæ Liv. 22, 13, 4, possibilité de prendre Capoue ; civibus suis consilii sui copiam facere Cic. de Or. 3, 133, mettre ses avis à la disposition de ses concitoyens ; alicui alicujus copiam facere Ter. Phorm. 113, donner accès à qqn chez qqn ; copiam alicujus habere Sall. J. 111, 1, avoir la libre disposition de qqn ; dare senatus copiam Tac. An. 11, 2, accorder une audience du sénat ; habere magnam copiam societatis conjungendæ Sall. J. 83, 1, avoir une belle occasion de faire alliance
— pro rei copia Sall. J. 90 : ex copia rerum Sall. J. 39 ; ex copia Sall. J. 76, d'après la situation, étant donnée la situation
— pro copia, suivant ses facultés, son pouvoir, ses ressources : Liv. 26, 11, 9 ; 27, 6, 19 ; 28, 21, 10
— copia est ut subj., il y a possibilité de : Pl. Bacch. 422 ; Merc. 990 ; Ter. Haut. 328 ; [avec inf.] Sall. C. 17, 6 ; Virg. En. 9, 482.
===> forme copies d'après Charis. 118, 19 ; abl. pl. copis CIL 10, 6662, etc.
===> .
¶1. qui abonde, bien pourvu : copiosum patrimonium Cic. Amer. 6, riche patrimoine ; homo copiosus Cic. Verr. 1, 65, homme d'une grande fortune ; aliqua re Cic. Cat. 2, 18 (Gell. 16, 19, 7), abondamment pourvu de qqch ; locus copiosus a frumento Cic. Att. 5, 18, 2, endroit riche sous le rapport du blé ; [avec gén.] Sol. 11, 11
¶2. [rhét.] riche d'idées ou de mots, abondant, ayant l'abondance oratoire : Cic. Verr. 2, 88 ; Mur. 48 ; de Or. 2, 75 ; 2, 214 ; Fin. 3, 51 ; Tusc. 2, 35, etc.
— ayant la richesse du génie : Cic. Ac. 1, 17 ; Off. 2, 16
— -sior Off. 2, 76 ; -issimus Cæs. G. 1, 23.

===> .
===> .
===> formes usitées : acc. copem, abl. copi.
¶1. tout ce qui sert à attacher, lien, chaîne : Pl. Ep. 617 ; Nep. Dat. 3, 2 ; copula torta Att. Tr. 575, cordage
— laisse : Ov. Tr. 5, 9, 28
— fermoir [d'un bracelet] : Capit. Maxim. Jun. 1, 8
— crampon, grappin : Cæs. G. 3, 13, 8
¶2. [fig.]
a) lien moral, union : Hor. O. 1, 13, 18 ; Nep. Att. 5, 3
— époux, épouse : Cassiod. Var. 1, 37 ;
b) enchaînement, suite des mots : Quint. 7, 10, 17
— composition d'un mot : Nigid. d. Gell. 10, 5, 1.
¶1. lier ensemble, attacher : hominem cum belua Cic. Ac. 2, 139, unir l'homme à la bête ; auro res aurum copulat Lucr. 6, 1078, une substance soude l'or à l'or ; copulati in jus pervenimus Cic. Verr. 4, 148, accrochés l'un à l'autre nous arrivons devant le préteur
— unir, associer : voluptatem cum honestate Cic. Tusc. 5, 85, joindre la volupté à la vertu (Fin. 1, 50 ; Off. 3, 119) ; quid naturæ copulatum habuit Alcibiadis somnium ? Cic. Div. 2, 143, quel lien avec la nature trouve-t-on dans le songe d'Alcibiade ?
— former d'une façon solide (bien liée) : concordiam copulare Liv. 4, 43, 11, établir fermement la concorde
¶2. [rhét.]
a) lier des mots et les fondre en un seul dans la prononciation : Cic. Or. 154 ;
b) verba copulata, simplicia Cic. Or. 115, mots groupés en phrase, considérés isolément ; Quint. 10, 6, 2
— [log.] proposition qui se lie à une autre : Cic. Fat. 30 ; cf. Gell. 16, 8, 10.
===> forme sync. coplata Lucr. 6, 1086
— inf. pass. copularier Arn. 6, 22.
¶1. cuisine : Arn. 4, 6 ; Pall. 1, 37, 4
¶2. art du cuisinier : Apul. Plat. 2, 9 ; Isid. 20, 2, 32.
¶1. int., faire la cuisine : Pl. Aul. 408
¶2. tr., préparer comme mets : Pl. Ps. 875.
¶1. cuire, faire cuire, aliquid, qqch [solide ou liquide] : qui illa coxerat Cic. Tusc. 5, 98, celui qui avait fait le repas ; cibaria cocta Liv. 29, 25, 6, etc., blé cuit (biscuit)
— [abst] faire la cuisine : Pl. Aul. 325 ; 429 ; Ter. Ad. 847
— pl. n. cocta Suet. Cl. 38, 2, aliments cuits
— v. cocta, f.
¶2. brûler, fondre [chaux, métal, etc.] : Cat. Agr. 16 ; 38, 4, etc. ; Plin. 31, 111, etc. ; coctus later Mart. 9, 75, 2, brique cuite [opp. crudus], cf. Cat. Agr. 39, 2 ; agger coctus Prop. 3, 11, 22, mur de briques cuites ; robore cocto Virg. En. 11, 553, d'un bois durci au feu
— brûler [martyres] : Lact. Mort. 13, 3
¶3. mûrir, faire mûrir : Cat. Agr. 112, 2 ; Varr. R. 1, 7, 4, etc. ; Virg. G. 2, 522 ; Cic. CM 71
— [qqf] dessécher, brûler : Varr. R. 3, 14, 2 ; Virg. G. 1, 66
¶4. digérer : confectus coctusque cibus Cic. Nat. 2, 137, l'aliment élaboré et digéré (2, 136)
¶5. [fig.]
a) méditer, préparer mûrement (cf. mijoter) : bellum Liv. 8, 36, 2, préparer sourdement la guerre (3, 36, 2) ;
b) faire sécher (d'ennui), tourmenter : Enn. An. 336 ; Pl. Trin. 225 ; Virg. En. 7, 345 ; Quint. 12, 10, 77.
===> formes trouvées dans les mss. : quoquo, coco.
¶1. cœur [viscère] : Cic. Div. 1, 119 ; Cels. 4, 1
— estomac : Hor. S. 2, 3, 28
¶2. [fig.] :
a) [poét.] corda = animi : Lucr. 3, 894, etc. ; [en parl. de pers.] lecti juvenes, fortissima corda Virg. En. 5, 729, l'élite de la jeunesse, les cœurs les plus intrépides
— [en parl. d'anim.] levisomna canum corda Lucr. 5, 864, les chiens au sommeil léger ;
b) cœur [siège du sentiment] : corde amare ou corde atque animo suo Pl. Cap. 420 ; Truc. 177, aimer de tout cœur ; cor spectantis tangere Hor. P. 98, toucher le cœur du spectateur ;
c) [expr.] cordi esse alicui, être agréable à qqn, lui tenir au cœur : Cic. Att. 5, 3, 3 ; Or. 53 ; Læ. 15 ; Quinct. 93 ; Cæs. G. 6, 19, 4 ; Liv. 1, 39, 4 ; 8, 7, 6 ; cordi est (alicui) avec inf., qqn a à cœur de, tient absolument à : Pl. Most. 823 ; Liv. 28, 20, 7 ; [avec prop. inf.] Liv. 9, 1, 4
— cordi habere Gell. 2, 29, 20 ; 17, 19, 6 ; 18, 7, 3, même sens ;
d) intelligence, esprit, bon sens : Enn. An. 374 ; Pl. Mil. 779 ; Ter. Phorm. 321 ; Lucr. 1, 737 ; 5, 1107 ; Cic. Fin. 2, 24 ; 91 ; Phil. 3, 16.
¶1. adv., en face, devant, en présence : coram videre Cic. Br. 208, voir sur place (personnellement) ; coram cum aliquo loqui Cic. Fam. 6, 8, 3, parler à qqn de vive voix ; coram adesse Cic. Phil. 13, 33, être présent personnellement ; coram ipse audiat Liv. 29, 18, 20, qu'il écoute lui-même ce qui sera dit en sa présence ; ut veni coram Hor. S. 1, 6, 56, quand je fus devant toi
— publiquement, ouvertement : traditio coram pugillarium Suet. Aug. 37, remise publique de tablettes
¶2. prép. avec abl., coram aliquo, en présence de, devant qqn : Cic. Br. 88 ; Pis. 12, etc.
— senatu coram Tac. An. 3, 18, devant le sénat (3, 14 ; 3, 24, etc.)
— avec acc. ou gén. [décad.].
¶1. nom d'homme : Hor. S. 2, 5, 57
¶2. v. Cora 3.
¶1. rhéteur syracusain : Cic. de Or. 1, 91 ; [jeu de mots avec corax 1] de Or. 3, 81
¶2. nom d'esclave : Pl. Capt. 657
¶3. montagne d'Étolie : Liv. 36, 30, 4.
¶1. ville des Èques : Liv. 2, 39, 4
¶2. ville d'Hispanie : Liv. 39, 42, 1.
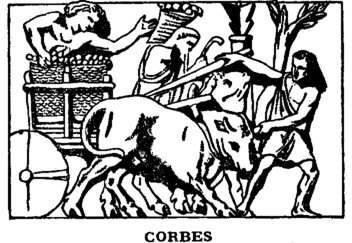
===> abl. -i Cat. Agr. 136 ; -e Cic. Sest. 82.
¶1. le cordace [danse licencieuse] : Petr. 52, 8
¶2. [fig.] [en parlant du rythme trochaïque] manquant de tenue : Cic. Or. 193 ; Quint. 9, 4, 88.
¶1. poétesse grecque : Prop. 2, 3, 21
¶2. femme chantée par Ovide : Ov. Tr. 4, 10, 60.
a) les Corinthiens : Apul. M. 10, 35 ;
b) étrangers résidant à Corinthe : P. Fest. 60, 11.
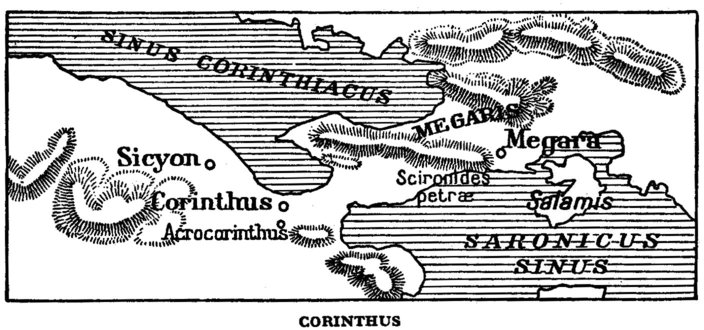
¶1. peau (cuir, robe) des animaux : Cat. Agr. 135, 3 ; Cic. Nat. 2, 121
¶2. peau de l'homme : corium concidere alicui Pl. Amp. 85 ; corium petere (alicujus) Cic. Tull. 54, tanner le cuir à qqn, fustiger qqn ; ludere suo corio Mart. 3, 16, 4 (de alieno corio Apul. M. 7, 11), risquer sa peau (celle d'autrui)
¶3. enveloppe, peau des arbres et des fruits : Plin. 15, 112 ; Dig. 32, 52
¶4. [fig.]
a) courroie, lanière, fouet : Pl. Pœn. 139 ;
b) surface, superficie, couche : corium arenæ Vitr. 7, 3, 8, couche de sable.

¶1. corne des animaux : Virg. B. 3, 87 ; G. 3, 232
¶2. [en gén, tout objet dont la substance ressemble à la corne, ou qui a la forme d'une corne, ou qui est fait de corne] : corne du pied des animaux : Cat. Agr. 72 ; Virg. G. 3, 88
— cornée de l'œil : Plin. 11, 148
— bec des oiseaux : Ov. M. 14, 502
— défense de l'éléphant, ivoire : Varr. L. 7, 39 ; Plin. 8, 7
— antenne des insectes : Plin. 9, 95
— corne, pointe d'un casque : Liv. 27, 33, 2
— cornes du croissant de la lune : Virg. G. 1, 433
— bras d'un fleuve : Ov. M. 9, 774
— cor, trompette : Cic. Sull. 17 ; Virg. En. 7, 615
— arc : Virg. B. 10, 59
— vase à huile : Hor. S. 2, 2, 61
— lanterne : Pl. Amp. 341
— entonnoir : Virg. G. 3, 509
— table d'harmonie : Cic. Nat. 2, 144
— antenne [de vaisseau] : Virg. E. 3, 549
— bouton d'ivoire aux extrémités du bâton autour duquel se roulait un livre ; [au plur.] le bâton lui-même : Mart. 11, 107, 1 ; Tib. 3, 1, 13
— sommet, point culminant d'une montagne : Stat. Th. 5, 532
— pointe extrême (extrémité) d'un lieu : Liv. 25, 3, 17 ; Tac. An. 1, 75
— houppe de cheveux : Juv. 13, 165
— langue de terre qui s'avance dans la mer, promontoire : Ov. M. 5, 410
— aile d'une armée : Cæs. G. 1, 52, etc. ; equitatum omnem in cornibus locat Sall. J. 49, 6, il place toute la cavalerie aux ailes
¶3. [fig.]
a) corne, en tant que symbole de la force ou de l'abondance = courage, énergie : cornua sumere Ov. A. Am. 1, 239, prendre courage ; addis cornua pauperi Hor. O. 3, 21, 18, tu m'inspires de l'audace malgré ma pauvreté
— v. cornu copia ;
b) symbole de la résistance, de l'hostilité : cornua alicui obvortere Pl. Ps. 1021, montrer lès dents à qqn (tourner ses cornes contre qqn), cf. Hor. Epo. 6, 12 ;
c) attribut de divinités fluviales : Virg. G. 4, 371 ; Mart. 10, 7.
===> autres formes :
a) v. cornum 1, cornus 1 ;
b) décadence : gén. cornuis Capel. 3, 293 ; corni M.-Emp. 1, 87, etc.
— dat. cornui Capel. 3, 293
— abl. pl. cornuis Treb. Gall. 8, 2 ; cornubus Capel. 3, 293.

¶1. bête à cornes : Varr. R. 2, 7, 2
¶2. poisson de mer inconnu : Plin. 32, 145.
¶1. petite couronne : Plin. 21, 5
— [fig.] ce qui est donné par-dessus le marché, pourboire, gratification : Cic. Verr. 4, 49 ; Phæd. 5, 7, 34
¶2. corollaire (géom.) : Boet. Consol. 3, pros. 10.
¶1. couronne : Pl. Men. 463 ; Cic. Fl. 75 ; sub corona vendere Cæs. G. 3, 16, 4, vendre des prisonniers de guerre [on les exposait en vente couronnés de fleurs]

¶2. [fig.]
a) cercle, assemblée, réunion ; [en part., cercle formé par les assistants dans les débats judiciaires] : Cic. Fl. 69 ; Fin. 2, 74 ;
b) ligne d'une armée assiégeante, cordon de troupes : Cæs. G. 7, 72, 2 ; Liv. 23, 18, 5 ;
c) ligne de soldats qui défendent une enceinte : Liv. 4, 19, 8 ;
d) larmier, corniche : Curt. 9, 4, 30 ;
e) circuit, pourtour d'un champ : Cat. Agr. 6, 3 ;
f) couronne [art vétérinaire] : Col. 6, 29, 3 ;
g) cercle lumineux autour du soleil, halo : Sen. Nat. 1, 2.
¶1. dont on fait des couronnes : Plin. 21, 164
— en forme de couronne : Plin. 14, 42
— [en part.] coronarium aurum Cic. Agr. 1, 12, or coronaire [présent fait à un général victorieux par les provinces]
¶2. de corniche : coronarium opus Vitr. 7, 4, 4, moulure de corniche.
¶1. donner un corps : corporari Plin. 7, 66, prendre un corps, se former ; mundus undique corporatus Cic. Tim. 5, monde entièrement corporel ; corporatus Christus Lact. 4, 26, le Christ fait homme
— [fig.] coloribus corporari Non. 37, 13, être colorié
¶2. réduire à l'état de cadavre, tuer : Acc. Tr. 604 ; Enn. Scen. 114.
¶1. corps [en gén.] : corporis dolores Cic. Fin. 1, 55, douleurs physiques
— élément matériel : corpus aquæ Lucr. 2, 232 = aqua, l'eau ; corpora rerum Lucr. 1, 679 (ou corpora 1, 689, etc.), corps élémentaires, éléments, atomes
¶2. chair du corps : ossa subjecta corpori Cic. Nat. 2, 139, os recouverts de chair ; corpus amittere Cic. Fam. 7, 26, 2 ; Lucr. 1, 1038, perdre sa chair, maigrir ; in corpus ire Quint. 2, 10, 5, prendre du corps, devenir charnu
— [fig.] corpus eloquentiæ Quint. 10, 1, 87, etc., la substance, l'essentiel de l'éloquence
¶3. personne, individu : nostra corpora Sall. C. 33, 2, nos personnes (Liv. 9, 8, 5 ; 31, 46, 16) ; liberum corpus Liv. 3, 56, 8, une personne libre
¶4. corps inanimé, cadavre : Cæs. G. 2, 10, 3 ; 2, 27, 3 ; Liv. 32, 13, 8, etc.
— [poét.] âmes des morts, apparences de corps : Virg. En. 6, 303 ; 306
— tronc [opp. à la tête] : Ov. M. 11, 794
— parties génitales : Hor. S. 1, 2, 43 ; 2, 7, 67 ; Phæd. 3, 11, 3
¶5. [fig.] corps, ensemble, tout : [ossature d'un vaisseau] Cæs. C. 1, 54, 2 ; [ensemble de fortifications] Cæs. G. 7, 72, 2 ; [corps (ensemble) de l'État] Cic. Off. 1, 85 ; corpus nullum civitatis Liv. 26, 16, 9, pas de cité politiquement organisée ; in corpus unum confusi Liv. 34, 9, 3, confondus en un seul corps de nation ; [en part.] nation : Liv. 1, 17, 2
— corps d'ouvrage : Cic. Fam. 5, 12, 4 ; Q. 2, 11, 4 ; corpus omnis juris Romani Liv. 3, 34, 7, un corps de tout le droit romain, cf. le titre Corpus juris Cod. Just. 5, 13.
¶1. corpuscule, atome : Lucr. 2, 152 ; Cic. Nat. 1, 66
¶2. corps faible, chétif : Juv. 10, 173
— [terme de caresse] mignonne : Pl. Cas. 843
¶3. petite collection : Just. Præf. 4.
a) ramasser, rassembler une somme d'argent : Pl. Pœn. 1363 ;
b) enlever en bloc : Ter. Haut. 141 ;
c) recueillir avec peine : Lucr. 1, 401.
¶1. part. de corrigo
¶2. adjt, corrigé, amélioré : fit correctior Gell. 15, 4, 2, il s'amende.
¶1. action de prendre, de saisir : Gell. 20, 10, 8
— [médec.] attaque d'une maladie : Scrib. 171
— réprimande, reproche : Tert. Pudic. 14
¶2. décroissance : correptiones dierum Vitr. 9, 9, 7, diminution de la longueur des jours
— action de prononcer brève (une voyelle, une syllabe), abrègement : Quint. 7, 9, 13.
a) fouet : Diocl. 10, 19 ;
b) lacet de soulier : Varr. Men. 180 ; Cic. Div. 2, 84.
¶1. redresser : digitum Plin. 7, 83, redresser un doigt ; cursum navis Liv. 29, 27, 14, faire reprendre à un vaisseau sa route directe ; correxere se flexus fluminum Plin. 3, 16, des cours d'eau ont rectifié leurs courbes
¶2. [fig.] redresser, améliorer, réformer, guérir : corrigere aliquem ad frugem Pl. Trin. 118, ramener qqn au bien
— corriger un orateur, un écrivain (Cic. Br. 310 ; Or. 176) ; qqn en défaut (Tusc. 4, 65 ; Mur. 60) ; un écrit (Att. 6, 2, 3 ; 16, 11, 2 ; Fin. 1, 17) ; les mœurs (Leg. 3, 32 ; Verr. 3, 2) ; une erreur, une faute (Att. 3, 14, 1 ; Fin. 1, 28 ; Verr. 2, 104 ; Sull. 63)
— corriger, changer [sans idée d'amélioration] Verr. 1, 111 ; Phil. 8, 32 ; Ac. 1, 35.
===> forme conr- : Inscr.
¶1. saisir : arcum Virg. En. 1, 188, saisir son arc ; hominem corripi jussit Cic. Verr. 3, 57, il fit saisir cet homme
— corpus de terra Lucr. 4, 1000 ; corpus e stratis Virg. En. 3, 176, se lever vivement de terre, de sa couche ; corpus e somno Lucr. 3, 164, s'arracher au sommeil ; se corripere Virg. En. 6, 472, s'élancer ; intro se corripere Ter. Hec. 364, entrer vivement
— [poét.] : corripere viam Virg. En. 1, 418 ; campum Virg. G. 3, 104, prendre vivement une route, se saisir de l'espace (dévorer l'espace) ; gradum Hor. O. 1, 3, 33, presser le pas
— flamma corripuit tabulas Virg. En. 9, 537, la flamme saisit les ais ; correpti flamma Liv. 28, 23, 4, saisis par la flamme ; turbine correptus Lucr. 5, 1232, saisi par un tourbillon ; turbo tecta corripiens Sen. Nat. 7, 5, 1, la trombe emportant les maisons ; nec singula morbi corpora corripiunt Virg. G. 3, 472, les maladies n'attaquent pas les corps isolément ; valetudine adversa corripitur Tac. An. 12, 66, la maladie le saisit ; segetes sol nimius, nimius corripit imber Ov. M. 5, 483, un soleil excessif, des pluies excessives attaquent les moissons
¶2. [fig.] se saisir de, s'emparer de : pecunias, pecuniam Cic. Verr. 2, 30, etc., faire main basse sur des sommes d'argent (les rafler) ; fascibus correptis Sall. C. 18, 5, s'étant saisis des faisceaux consulaires
— se saisir de qqn en accusateur, se faire accusateur de qqn : Tac. An. 2, 28 ; 3, 49, etc. ; a delatoribus corripitur Tac. An. 6, 40, les délateurs s'emparent d'elle
— se saisir de qqn en paroles, le malmener : clamoribus judices corripuerunt Cæl. Fam. 8, 2, 1, on hua les juges ; convicio consulis correpti Cæs. C. 1, 2, 5, en butte aux invectives du consul ; [d'où] déchirer qqn en paroles, le blâmer de façon mordante : Liv. 2, 28, 5 ; Sen. Nat. 6, 20, 5 ; Quint. 11, 1, 68 ; ab eo me correptum cur ambularem Plin. Ep. 3, 5, 16, [je me souviens] qu'il me demanda compte avec vivacité d'une promenade que je faisais
¶3. resserrer : membra timore Lucr. 5, 1223, ramasser ses membres sous l'effet de la crainte
— réduire en resserrant : impensas Suet. Tib. 34, réduire les dépenses ; vitam Sen. Ep. 74, 27, raccourcir la vie
— [gram.] rendre une syllabe brève dans la prononciation, la prononcer brève : Varr. L. 7, 33 ; Sen. Nat. 2, 56, 2 ; Quint. 1, 5, 18 ; 1, 6, 32, etc.
===> la forme conr- se trouve çà et là dans les mss.
¶1. inviter ensemble, à la fois : Cic. Quinct. 25 ; Phil. 3, 20 ; corrogati auditores Quint. 10, 1, 18, auditeurs que l'on a réunis à force d'instances
¶2. quêter partout, solliciter de partout : Cic. Verr. 3, 184 ; Her. 4, 9 ; Cæs. G. 3, 102, 4.
¶1. détruire, anéantir : frumentum flumine atque incendio Cæs. G. 7, 55, 8, détruire le blé par l'eau et par le feu (7, 64, 3 ; C. 2, 10, 6 ; Sall. J. 55, 8 ; 76, 6 ; Liv. 22, 11, 5 ; 25, 11, 11)
— res familiares corruperant Sall. J. 64, 6, ils avaient réduit à néant leur fortune ; magnas opportunitates Sall. C. 43, 3, réduire à néant de belles occasions ; libertas corrumpebatur Tac. An. 1, 75, la liberté disparaissait
¶2. [fig.] gâter, détériorer [physiquement ou moralement] : aqua corrumpitur Cic. Nat. 2, 20, l'eau se corrompt (Sall. J. 55, 8) ; sanguis corruptus Cic. Tusc. 4, 23, sang gâté ; oculos Pl. Merc. 501, gâter ses yeux [en pleurant] ; litteras publicas Cic. Verr. 1, 60 ; tabulas Cic. Arch. 8, falsifier des registres officiels ; nomen alicujus Sall. J. 18, 10, altérer le nom de qqn dans la prononciation
— altérer les idées de qqn : Cic. Fin. 1, 21 ; corrumpitur oratio Quint. 8, 3, 58, le style se gâte ; os in peregrinum sonum corruptum Quint. 1, 1, 13, prononciation qui s'altère en prenant des sons étrangers
— mores civitatis Cic. Leg. 3, 32, corrompre les mœurs d'une cité ; Hannibalem ipsum Capua corrupit Cic. Agr. 1, 20, Capoue a gâté Hannibal lui-même ; homo corruptus Ctc. Cat. 2, 7, homme corrompu, débauché ; milites soluto imperio licentia atque lascivia corruperat Sall. J. 39, 5, le commandement s'étant relâché, l'armée avait été corrompue par la licence et le désordre
— corrompre, séduire une femme : Ter. Haut. 231 ; Tac. An. 4, 7 ; Suet. Cæs. 50, etc.
— [en part.] corrompre, gagner qqn : nec me laudandis majoribus meis corrupisti Cic. Fin. 1, 33, et tu ne m'as pas amadoué en louant mes ancêtres ; aliquem pecunia Cic. Off. 2, 53, corrompre qqn à prix d'argent ; judicium corruptum Cic. Clu. 4, jugement acheté, cf. 63 ; 64 ; 73, etc. ; Mil. 46 ; ad sententias judicum corrumpendas Cic. Clu. 125, pour acheter la sentence des juges.
===> inf. pass. corrumpier Lucr. 6, 18
— orth. conr- N.-Tir. 46, 63
— corumptum Lucr. 6, 1135 [mss].
I. int.,
¶1. s'écrouler, crouler : ædes corruerunt Cic. Top. 15, une maison s'est écroulée (Att. 14, 9, 1 ; Div. 1, 26 ; 1, 78) ; arbor corruit Ov. M. 8, 777, l'arbre tombe ; pæne ille timore, ego risu corrui Cic. Q. 2, 8, 2, nous avons failli nous écrouler, lui de peur, moi de rire (Liv. 1, 25, 5 ; 8, 9, 12 ; 22, 3, 11, etc.) ; in vulnus Virg. En. 10, 488, tomber sur sa blessure (en avant) ; quo cum conruit (ales) Lucr. 6, 824, quand l'oiseau s'est abattu là
¶2. [fig.] Lacedæmoniorum opes corruerunt Cic. Off. 1, 84, la puissance de Lacédémone s'écroula ; si uno meo fato et tu et omnes mei corruistis Cic. Q. 1, 4, 1, si mon seul destin a causé votre ruine et à toi et à tous les miens
— [en parl. d'un comédien] échouer, faire un four : Cic. CM 64
— échouer en justice : Plin. Ep. 3, 9, 34.
II. tr.,
¶1. ramasser, entasser : ditias Pl. Rud. 542, des richesses ; cf. Varr. L. 5, 139 ; Lucr. 5, 368
¶2. abattre, faire tomber : Catul. 68, 52 ; Apul. M. 8, 8.
===> conr- N.-Tir. 75, 75.
a) séducteur, corrupteur : Ter. Ad. 793 ;
b) lieu de perdition : Frontin. Aq. 77.
¶1. part. de corrumpo ; adjt, avec comp. Hor., Curt., Sen. etc. ; sup. Sall., Tac., etc.
¶2. = correptus (de corripio) : Paul. Sent. 5, 4, 13.
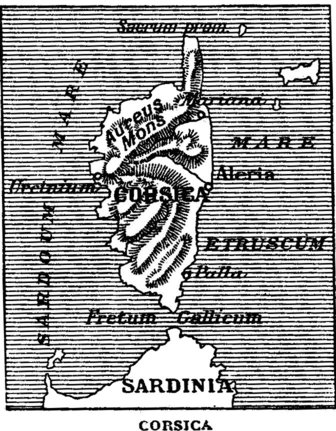
¶1. vaisseau rond, chaudière, cuve : Pl. Pœn. 1291 ; Plin. 36, 191
— [en part.] le trépied d'Apollon : Virg. En. 3, 92 ; l'oracle même : Virg. En. 6, 347

¶2. [fig.]
a) espace circulaire : Enn. An. 9 ;
b) cercle d'auditeurs, auditoire : Tac. D. 19, 4
¶3. rideau, voile : Isid. 19, 26, 9 ; Ambr. Ep. 20, 24.
¶1. habitants de Cortone d'Étrurie : Plin. 3, 52
¶2. habitants d'une ville de la Tarraconnaise : Plin. 3, 24.
¶1. int., cosser, heurter de la tête : Lucr. 2, 320
— s'agiter, branler : apes pennis coruscant Virg. G. 4, 73, les abeilles battent des ailes ; coruscat abies Juv. 3, 254, une poutre branle
— briller, étinceler : Pacuv. d. Cic. de Or. 3, 157 ; Virg. G. 4, 98
— impers. coruscat Vulg. Esdr. 4, 16, 10, il fait des éclairs
¶2. tr., agiter, brandir, darder, secouer : gæsa coruscant Galli Virg. En. 8, 661, les Gaulois brandissent des javelots ; linguas coruscant (colubræ) Ov. M. 4, 494, (les couleuvres) dardent leurs langues.
¶1. agité, tremblant : Virg. En. 1, 164
— [fig.] corusca fabulari Pl. Rud. 526, dire des choses tremblotantes
¶2. brillant, étincelant : Lucr. 6, 203 ; Virg. G. 1, 234
— acc. n. adv. : Sil. 16, 119.
===> scoruscus Ital. Luc. 17, 24.
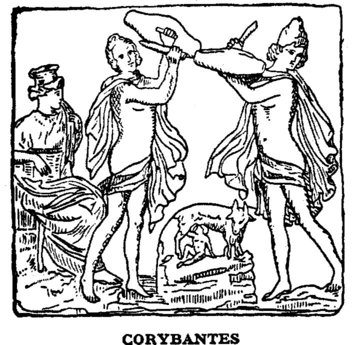
¶1. fils de Cybèle : Cic. Nat. 3, 57
— fils de Proserpine : Serv. En. 3, 111
¶2. Corybante, v. Corybantes
— [fig.] Corybante, fou furieux : de conviva Corybanta videbis Juv. 5, 25, tu verras le convive transformé en Corybante.

¶1. nom d'un guerrier : Virg. En. 6, 228
¶2. v. Coryna.
===> .
¶1. (costa) qui a de bonnes côtes : Varr. R. 2, 5, 8
¶2. (costum) fait avec le costum [plante] : Ps. Garg. 209.
¶1. cothurne, chaussure montante :

a) à l'usage des chasseurs : Cic. Fin. 3, 46 ; Virg. B. 7, 32 ; Juv. 6, 105 ;
b) à l'usage des acteurs tragiques : Hor. P. 280
¶2. [fig.] tragédie : Hor. P. 80
— sujet tragique : Juv. 15, 29
— style élevé, sublime : Virg. En. 8, 10 ; Quint. 10, 1, 68
— peinture de grand style : Plin. 35, 111
— majesté, prestige : Amm. 21, 16, 1.
===> sur l'orth. du mot v. Quint. 1, 7, 6 ; les mss. ont aussi bien cotidie que cottidie ; v. Thes.

===> .
¶1. os de la hanche ; hanche, cuisse : Cels. 4, 22 ; Plin. Ep. 2, 1, 5
— râble : Mart. 7, 20
¶2. angle rentrant : Grom. 139, 16.
¶1. Crantor [frère de Phénix] : Ov. M. 12, 316
¶2. philosophe de l'Académie : Cic. de Or. 3, 67.
¶1. indigestion de vin [mal de tête, nausées], ivresse : edormi crapulam Cic. Phil. 2, 30, cuve ton vin, cf. Pl. Most. 1122 ; v. exhalo ; crapulæ plenus Liv. 9, 30, 9, gorgé de vin
¶2. résine qu'on mêlait au vin : Plin. 14, 124
¶3. excès de nourriture : Isid. 20, 2, 9 ; Aug. Conf. 10, 31, 45 ; Jul. 4, 14, 73.
¶1. adv., demain : Pl. Most. 654 ; Cic. Att. 12, 44, 3 ; cras mane Cic. Att. 10, 30, 2, demain matin
¶2. subst. n., le jour de demain : Mart. 5, 58, 2.
¶1. épaisseur : Plin. 16, 210 ; Gell. 17, 9, 7
¶2. sédiment, dépôt : Col. 12, 12, 1.
¶1. d'une manière épaisse : crasse linere Col. 12, 46, 2, enduire d'une, couche épaisse, cf. 12, 44, 5
¶2. grossièrement : crasse compositum carmen Hor. Ep. 2, 1, 76, poème sans art
— confusément : Sen. Ep. 121, 12
— d'une manière terne : crassius gemmæ nitent Plin. 37, 106, les pierres ont moins d'éclat.
¶1. épais : arbores crassiores Cat. Agr. 28, 2, arbres plus épais
¶2. dense, gras : crassæ paludes Virg. G. 2, 110, marais fangeux ; crassus homo Ter. Hec. 440, gros homme ; crassum filum Cic. Fam. 9, 12, 2, gros fil ; crassus aer Cic. Tusc. 1, 42, air épais ; crassus ager Varr. R. 1, 24, 1 ; Cic. Fl. 71, terre grasse
¶3. [fig.] crassum infortunium Pl. Rud. 883, gros malheur
— [en part.] grossier, lourd, stupide : crassi senes Varr. d. Non. 86, 24, vieillards stupides ; crassa turba Mart. 9, 23, la foule grossière ; crassiora nomina Mart. 12, 18, 12, noms barbares
— crassissimus Cic. Nat. 2, 17.
===> d. les mss. souvent confusion avec grassus, grossus.
¶1. de demain : crastinus dies Pl. Stich. 635 ; Cic. Att. 15, 8, 2 ; le jour de demain ; die crastini Pl. Most. 881 ; Gell. 10, 24, 8 et crastino die Liv. 2, 56, 9, etc., demain
— in crastinum, à demain, pour demain : Pl. Ps. 1355 ; Cic. de Or. 2, 367
¶2. [poét.] à venir, futur : Stat. Th. 3, 562.


a) herse de labour : Plin. 18, 173 ; Virg. G. 1, 94 ;
b) claie, instrument de supplice : Pl. Poen. 1025 ; Liv. 1, 51, 9 ;
c) [seulement au pluriel] : claies, fascines : Cæs. G. 7, 58, 1, etc.; Liv. 10, 38, 5
— [fig.] crates [acc. pl.] pectoris Virg. En. 12, 508, le thorax ; crates favorum Virg. G. 4, 214, les claies des rayons de miel.
===> nom. cratis Varr. L. 7, 55 ; Veg. Mul. 1, 56, 5 ; acc. cratim Pl. Pœn. 1025 ; mais -em habituel.
===> .
I. tr.,
¶1. confier en prêt : aliquid (alicui) Pl. As. 501, prêter qqch (à qqn); Aul. 15 ; Ep. 549, etc.; Cat. Agr. 5, 2 ; Cic. Post. 4 ; 5 ; pecuniæ creditæ Cic. Off. 2, 78, sommes prêtées ; solutio rerum creditarum Cic. Off. 2, 84, paiement des dettes
¶2. confier : se suaque omnia alicui Cæs. G. 6, 31, 4, confier à qqn sa personne et ses biens ; quos tuæ fidei populus credidit Cic. Q. 1, 1, 27, ceux que le peuple a confiés à ta protection ; se pugnæ Virg. En. 5, 383, se hasarder à combattre
¶3. tenir pour vrai qqch, croire qqch : homines id quod volunt credunt Cæs. G. 3, 18, 6, on croit ce qu'on désire (C. 2, 27, 2) ; res tam scelesta credi non potest Cic. Am. 62, un fait aussi criminel ne peut trouver créance ; re credita Cic. de Or. 1, 175, le fait ayant été tenu pour vrai
— [poét.] croire qqn [seult au pass.] : Cassandra non umquam credita Teucris Virg. En. 2, 246, Cassandre que n'ont jamais crue les Troyens ; cf. Ov. H. 16, 129 ; 20, 9 ; M. 7, 98, etc. ; credemur Ov. F. 3, 351, on me croira
¶4. croire, penser :
a) [avec prop. inf.] cum reliquum exercitum subsequi crederet Cæs. G. 6, 31, 1, croyant que le reste de l'année suivait immédiatement ; nostros præsidia deducturos crediderant Cæs. G. 2, 33, 2, ils avaient cru que les nôtres emmèneraient les postes
— [pass. imp.] : credendum est Cæs. G. 5, 28, 1 ; creditur, creditum est, etc. Liv. 8, 26, 7 ; 8, 35, 11, etc., on doit croire, on croit, on a cru que
— [pass. pers.] : navis præter creditur ire Lucr. 4, 388, on croit que le navire se déplace ; Catilina creditur... fecisse Sall. C. 15, 2, on croit que Catilina a fait... ; mora creditur saluti fuisse Liv. 22, 51, 4, on croit que ce retard fut le salut ;
b) [avec deux acc.] : quoscumque novis rebus idoneos credebat Sall. C. 39, 6, tous ceux qu'il croyait bons pour une révolution (J. 75, 10) ; Scipionem Hannibal præstantem virum credebat Liv. 21, 39, 8, Hannibal tenait Scipion pour un homme supérieur ; (eos) crederes victos Liv. 2, 43, 9, on les aurait pris pour des vaincus ; qui postulat deus credi Curt. 6, 11, 24, celui qui demande qu'on le croie un dieu (8, 5, 5 ; 8, 5, 15) ; ejus sanguine natus credor Ov. F. 3, 74, on me croit né de son sang ;
c) credo formant parenth., je crois, je pense, j'imagine, [souvent ironique] : Cic. Cat. 1, 5 ; Sull. 11 ; Fin. 1, 7 ; Tusc. 1, 52, etc.;
d) [abl. n. du part. credito avec prop. inf.] la croyance étant que : Tac. An. 3, 14 ; 6, 34.
II. int.,
¶1. avoir confiance, se fier : alicui Cic. Fam. 5, 6, 1, avoir confiance en qqn (Dom. 29 ; Att. 3, 20, 1, etc.) ; nemo umquam sapiens proditori credendum putavit Cic. Verr. 1, 38, jamais aucun homme de bon sens n'a pensé que l'on devait avoir confiance dans un traître ; neque pudentes suspicari oportet sibi parum credi Cæs. C. 2, 31, 4, et les gens qui ont du point d'honneur ne doivent pas soupçonner qu'on n'a guère confiance en eux ; promissis alicujus Cic. Mur. 50, se fier aux promesses de qqn : cf. Sall. J. 106, 3 ; Liv. 45, 8, 6, etc.
¶2. [en part.] ajouter foi, croire : alicui jurato Cic. Com. 45, croire qqn qui a prêté serment ; testibus Cic. Font. 21, croire les témoins (Br. 134 ; Top. 74 ; Att. 1, 16, 10, etc.) ; id tibi non credidit Cic. Dej. 18, il ne t'a pas cru sur ce point (Ac. 2, 9 ; Att. 2, 22, 2 ; Fam. 2, 16, 3 ; etc.)
— recte non credis de numero militum Cic. Att. 9, 9, 2, tu as raison de ne pas ajouter foi au nombre des soldats (Fam. 3, 11, 5)
— [en parenth.] mihi crede Cic. Tusc. 1, 103 ; Verr. 4, 28, etc.; mihi credite Cic. Verr. 4, 132, crois-moi, croyez-moi ; qqf crede mihi : credite hoc mihi Cic. Verr. 4, 133, croyez-moi sur ceci.
===> subj. prés. arch. : creduam, as, at Pl. Pœn. 747 ; Bac. 476, etc. ; creduis, it Pl. Amp. 672 ; Cap. 605 ; Truc. 307
— inf. credier Pl. Ps. 631 ; Lucr. 4, 849
— credin = credisne Pl. Cap. 962 ; Pœn. 441.
===> .
¶1. crédule : creduli senes Cic. Læ. 100, vieillards crédules
— alicui Virg. B. 9, 34 ; Hor. O. 1, 11, 8 ; in rem Ov. F. 4, 312, prompt à croire qqn, qqch
— [fig.] credulæ rates Sen. Hipp. 530, vaisseaux aventureux
¶2. cru facilement Tac. H. 1, 34.
¶1. accroissement, croissance : Varr. Men. 199
¶2. semence : Isid. 9, 5, 5.
¶1. créer, engendrer, procréer, produire : Lucr. 1, 51 ; Cic. Fin. 5, 38 ; Rep. 1 frg 2 ; Tim. 47 ; Liv. 1, 3, 7 ; creari ex imbri Lucr. 1, 784, être produit par l'eau ; nil posse creari de nilo Lucr. 1, 156, que rien ne peut être créé de rien, cf. 3, 278 ; seminibus certis quæque creantur Lucr. 1, 169, tous les corps sont créés de germes déterminés, cf. 2, 387 ; nos illorum (majorum) sanguine creatos videtis Cic. Agr. 2, 1, vous voyez que nous sommes issus de leur sang ; humana stirpe creatus Lucr. 1, 733, issu de souche humaine
— [poét., creatus av. abl.] né de, fils de : Aquilone creatus Ov. M. 7, 3, fils d'Aquilon, cf. 7, 666 ; 9, 23, etc.
— enfanter : Hor. Ep. 1, 2, 44
— [en part.] créer, choisir, nommer [un magistrat, un chef, etc.] : Cic. Leg. 3, 9 ; Cæs. G. 7, 33 ; ducem gerendo bello Liv. 1, 23, 8, nommer un chef de guerre
— [en parl. du président de l'assemblée] faire élire : Cic. Nat. 2, 10 ; Agr. 2, 16 ; Att. 9, 9, 3
¶2. [fig.] causer, faire naître, produire : venter creat omnes hasce ærumnas Pl. Mil. 33, c'est mon ventre qui est la cause de tous ces ennuis ; creare tædium Quint. 9, 4, 143, faire naître le dégoût ; errorem Cic. Div. 2, 55, être une cause d'erreur.
===> creassit = creaverit Cic. Leg. 3, 9.
¶1. montagne de l'île de Lesbos : Plin. 5, 140
¶2. v. Creo.
¶1. [seulement au neutre sing.] obscur : creperum noctis Symm. Ep. 1, 13, 1, l'obscurité de la nuit
— crĕpĕrum, i, n., crépuscule : Isid. Orig. 5, 31, 7
¶2. douteux, incertain : in re crepera Pac. Tr. 128, dans une situation critique ; cf. Acc. Tr. 601 ; Lucr. 5, 1296 ; Varr. L. 6, 5.
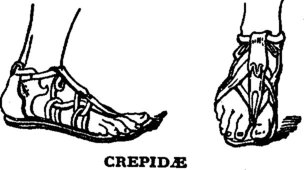
¶1. base, socle, piédestal, soubassement : Plin. 36, 66 ; Cic. Or. 224
¶2. avancée, saillie d'un rocher, d'un mur, bord du rivage : [en part.]
a) quai, môle, jetée : Cic. Verr. 5, 97 ; Juv. 5, 8 ;
b) crepido semitæ Petr. 9, 1, trottoir ;
c) [archit.] saillie, bordure : Vitr. 4, 6, 3.
¶1. plante inconnue : Plin. 21, 99
¶2. c. crepida : Apul. M. 11, 8.

¶1. int., rendre un son sec, craquer, craqueter, claquer, pétiller, retentir : intestina mihi quando esurio, crepant Pl. Men. 926, mes boyaux crient, quand j'ai faim ; crepare solidum Pers. 5, 25, rendre un son plein ; crepans digitus Mart. 3, 82, 15, claquement de doigt ; cum primum crepuerit catena Sen. Ep. 9, 8, au premier bruit (cliquetis) des chaînes ; fores crepuerunt ab ea Ter. Eun. 1029, la porte a crié de chez elle, cf. Haut. 613
— péter : Mart. 12, 77
— éclater, crever, se fendre : Aug. Serm. 275, 2
¶2. tr., faire sonner, faire retentir : crepare aureolos Mart. 5, 19, 14, faire sonner des pièces d'or ; faustos ter crepuere sonos Prop. 3, 10, 4, elles applaudirent à trois reprises (Hor. O. 2, 17, 26)
— [fig.] répéter sans cesse, avoir toujours à la bouche : sulcos et vineta crepat mera Hor. Ep. 1, 7, 84, il n'a plus à la bouche que labours et vignobles.
===> crĕpo, ĕre, Eutych. 5, 486, 22 ; Oribas. Syn. 4, 35.

¶1. venir à l'existence, naître : qui postea creverunt Varr. R. 3, 1, 7, ceux qui naquirent ensuite, cf. Lucr. 6, 527 ; quæcumque e terra crescunt Lucr. 1, 868, tout ce que la terre produit (crescere de Lucr. 4, 1214)
— [poét.] cretus, a, um, avec abl. ou ab, né de, issu de, provenant de : Lucr. 2, 906 ; 5, 6 ; Virg. En. 9, 672 ; Ov. M. 13, 750 ; Virg. En. 4, 191 ; Ov. M. 4, 607
¶2. croître, grandir, s'élever, s'accroître : crescere non possint fruges, arbusta, animantes Lucr. 1, 808, rien ne pourrait croître, moissons, arbres, animaux, cf. Cic. Div. 2, 33 ; Quint. 1, 2, 7 ; Suet. Oth. 1 ; Liger ex nivibus creverat Cæs. G. 7, 55, 10, la Loire avait grossi par la fonte des neiges
— in frondem crines crescunt Ov. M. 1, 550 ; in ungues manus Ov. M. 2, 479, ses cheveux poussent en feuillage, ses mains s'allongent en griffes
¶3. croître, s'augmenter : intellectum est non mihi absenti crevisse amicos Cic. Sest. 69, on constata non pas que pendant mon absence le nombre de mes amis avait augmenté ; cum hostium opes animique crevissent Cic. Pomp. 45, comme les forces et la hardiesse des ennemis s'étaient accrues, cf. Nep. Alc. 5, 3 ; Liv. 5, 46, 4 ; 44, 4, 1 ; ex his studiis crescit oratio Cic. Arch. 13, ces études permettent à l'éloquence de se développer ; crescebat in eos odium Cic. Har. 46, la haine croissait contre eux
¶4. grandir en considération, en puissance : per aliquem Cæs. G. 1, 20, 2, devoir son élévation à qqn ; ex aliquo Cic. Amer. 83 ; Liv. 29, 37, 17 ; de aliquo Cic. Verr. 5, 173 ; ex aliqua re Cic. Clu. 77, s'élever, se faire valoir aux dépens de qqn ; se servir de qqn comme d'un piédestal ; trouver dans qqch l'occasion de s'élever
— cresco et exsulto Sen. Ep. 34, 1, je me sens grandir et je triomphe.
===> forme sync. cresse Lucr. 3, 681
— crescendis rebus Lucr. 1, 585 (mss), v. Gaffiot. M. Belge, t. 33, p. 226, Rem. 4.
===> .
a) blanc, pour la toilette : Petr. 23, 5 ;
b) craie à cacheter : Cic. Fl. 37 ;
c) argile des potiers : Plin. 14, 123 ;
d) craie à blanchir [les habits] : Pl. Aul. 719 ; Poen. 969 ;
e) creta notati Hor. S. 2, 3, 246, = acquittés (par des cailloux blancs ; usage grec);
f) = 2 calx §3 : Sen. Ep. 108, 32.
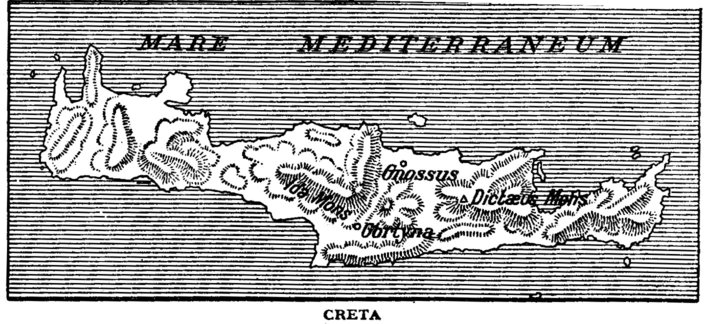

¶1. accusation, chef d'accusation, grief : cum respondero criminibus Cic. Planc. 4, quand j'aurai répondu aux accusations ; crimen sceleris maximi Cic. Cæl. 56 ; avaritiæ Cic. Verr. 2, 192, accusation d'un très grand crime, de cupidité ; crimina alicujus Liv. 40, 23, 9, accusations portées par qqn (Nep. Ep. 7, 3) ; in aliquem Liv. 6, 14, 11, accusation contre qqn ; alicui proditionis crimen inferre Cic. Verr. 5, 106, faire retomber sur qqn l'accusation de trahison ; in aliquem crimen intendere Liv. 9, 26, 11, porter une accusation contre qqn ; non erat in hoc crimen ullum Cic. Verr. 2, 162, il n'y avait pas là matière à une accusation ; esse in crimine Cic. Verr. 4, 100, être l'objet d'une accusation ; dare alicui crimini pecuniam accepisse Cic. Verr. 5, 73, accuser qqn d'avoir reçu de l'argent ; cf. Br. 277 ; Verr. 1, 12 ; 5, 131 ; Dom. 95 ; res crimini est alicui, une chose est un sujet d'accusation contre qqn, fait accuser qqn : Cic. Verr. 5, 19 ; Br. 135 ; Mur. 73 ; aliquem, aliquid in crimen vocare Cic. Verr. 3, 217 ; Balb. 5 ; Planc. 54, etc., accuser qqn, qqch ; incurrere in crimen hominis nimium grati Cic. Planc. 91, s'exposer au reproche d'excès de reconnaissance
— meum (tuum) crimen = l'accusation portée soit par moi (toi), soit contre moi (toi) Cic. Verr. 5, 153 ; 2, 49, etc. ; crimen senectutis Cic. CM 67, grief contre la vieillesse ; navale crimen Cic. Verr. 5, 131, chef d'accusation concernant la flotte ; crimen propulsare, defendere Cic. Sul. 12, repousser, réfuter une accusation ; ubi est crimen ? Cic. Sest. 80, où est le grief articulé ?
— perpetuæ crimen posteritatis eris Ov. Tr. 4, 9, 26, tu seras à jamais l'objet des reproches de la postérité
— sere crimina belli Virg. En. 7, 339, sème des griefs qui produisent la guerre
¶2. la faute, le crime même que l'on accuse [emploi poét. et postclassique avec qqes ex. dans Liv.] cf. 40, 8, 7 ; 40, 12, 10
— faits criminels, adultères : Ov. M. 6, 131
— méfait, inconvénient : brassicæ Plin. 20, 91, du chou
— culpabilité : Virg. En. 12, 600 ; Prop. 1, 11, 30.
===> sens pass., v. crimino.
¶1. d'accusateur, qui comporte des accusations, des imputations ; médisant, agressif : criminosior oratio Her. 4, 52, discours ayant plus de force accusatrice ; res alicui criminosa Cic. Verr. 5, 46, fait donnant lieu à une accusation contre qqn ; criminosus homo Cic. Clu. 94, accusateur passionné, homme agressif ; criminosi iambi Hor. O. 1, 16, 2, ïambes satiriques ; criminosissimus liber Suet. Cæs. 75, 5, infâme libelle
¶2. digne de reproche, blâmable, criminel : Apul. Apol. 40
— crīmĭnōsus, i, m., un criminel : Tert. Idol. 14
— un accusé : Hier. Ep. 147, 9.

¶1. petit cheveu : Ambr. Luc. 6, 7, 19
¶2. (fig.) lien, entrave : Aug. Ps. 57, 4.
¶1. cheveu, chevelure : septem crines Mart. 12, 32, 4, sept cheveux ; crinis sparsus Ov. M. 1, 542, chevelure éparse
— pl., Cic. Verr. 3, 76 ; Cæs. C. 3, 9 ; Liv. 1, 13, 1 ; trahere aliquem crinibus Virg. En. 2, 404, traîner qqn par les cheveux
— [en part.] tresses, nattes [coiffure d'une matrone] : Pl. Mil. 792 ; Most. 226 ; Varr. L. 7, 44 ; Fest. 339 ; 355
¶2. [fig.] [en parl. d'objets qui ressemblent aux cheveux] : crinis polyporum Plin. 9, 86, bras des polypes
— chevelure des comètes : Virg. En. 5, 528
— rayons, rais de lumière : V. Fl. 1, 205.
===> f. d. Pl. Most. 226 ; Atta. frg. 1 (Non. 202, 29).
¶1. part. de crinio
¶2. adjt, qui a beaucoup de cheveux, qui a une longue chevelure : Enn. Sc. 31 ; Virg. En. 9, 635 ; Mart. 12, 49
— [fig.] stella crinita Suet. Cæs. 88, comète ; crinita galea juba Virg. En. 7, 785, casque surmonté d'une crinière
— crinitior Gloss. 4, 218, 27.
¶1. part. de crispo
¶2. adjt, bouclé, frisé : Vulg. Isai. 3, 24 ; Plin. 16, 70
— ridé, qui se ride : nasus crispans Pers. 3, 87, nez qui se plisse
— tremblant : crepitus crispans Plin. 2, 198, ébranlement avec craquement.
¶1. friser, boucler Plin. 29, 82
— [fig.] faire onduler, froncer, rider : apio crispatur tellus Col. 10, 166, la terre se couvre des frisures de l'ache ; crispare aurum Stat. Th. 8, 568, ciseler en or ; pelagus V. Fl. 1, 311, rider la mer
¶2. agiter, brandir : hastilia Virg. En. 1, 313, brandir des javelots
— remuer vivement : Arn. 7, 33
— v. crispans.
¶1. crépu, frisé : crispi cincinni Pl. Truc. 287, boucles de cheveux bien frisés ; homo crispus Pl. Rud. 125, un bonhomme frisé
— [fig.] élégant : Gell. 1, 5, 4
¶2. onduleux, tors : marmor undatim crispum Plin. 36, 55, marbre à veines ondées ; abies crispa Enn. d. Cic. Tusc. 3, 44, sapin tordu (gondolé) [par le feu]
— vibrant : Juv. 6, 382
— crispior Plin. 8, 46 ; -issimus Col. 11, 3, 26.
¶1. crête [d'un oiseau] : Varr. R. 3, 9, 4
— [fig.] illi surgebant cristæ Juv. 4, 70, il dressait sa crête, se rengorgeait
¶2. touffe : crista foliorum Plin. 22, 86, touffe de feuilles
— aigrette, panache : Lucr. 2, 633 ; Liv. 10, 39, 12
— clitoris : Juv. 6, 422.

¶1. de safran : crocei odores Virg. G. 1, 56, les parfums du safran ; croceus tinctus Plin. 10, 134, sauce au safran
¶2. de couleur de safran, jaune, doré : Virg. G. 1, 447 ; En. 11, 475
— crŏcĕa, ōrum, n., vêtements de soie couleur safran : Vulg. Jer. Thr. 4, 5.
===> corcodilus Phæd. 1, 25, 4 ; Mart. 3, 93, 7
— crocodillus, corcodillus, corcodrillus : Décad.
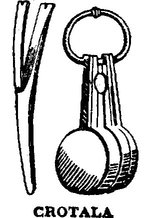
a) un crucifié : Petr. 112, 5 ;
b) pendard, gibier de potence : Apul. M. 10, 7
— crŭcĭārĭum, ĭi, n., crucifiement : Commod. Instr. 1, 32, 8.
¶1. torture, supplice : in cruciatum dari Cic. Amer. 119, être livré au bourreau (Cæs. G. 1, 31, 12) ; abi in malum cruciatum Pl. Aul. 459, va te faire pendre
— [fig.] tourments, souffrance. Cic. Cat. 4, 10
¶2. pl., instruments de torture : Cic. Verr. 5, 163.
¶1. mettre en croix : Lact. Mort. 2, 1
¶2. [en gén.] faire périr dans les tortures, supplicier : Pl. Cap. 731 ; Cas. 445 ; Ter. Eun. 384
— [passif d. Cic.]; cum vigiliis et fame cruciaretur Cic. Fin. 2, 65, alors qu'on le faisait périr par l'insomnie et la faim
¶3. [fig.] torturer, tourmenter : illa te res cruciat Cic. Fam. 5, 16, 4, cet événement te torture, cf. Att. 8, 15, 2 ; Tusc. 1, 111 ; se ipsa cruciavit Cic. Clu. 32, elle s'est torturée elle-même ; cruciari dolore corporis Cic. Tusc. 2, 7, être torturé par la douleur physique
— cruciare se Pl. Bac. 493 et cruciari Pl. Cap. 594, se tourmenter, souffrir ; [avec prop. inf.] souffrir de ce que : Pl. Cap. 600 ; Ter. Haut. 673 ; [av. quod] Pl. Cap. 996 ; Balb. Att. 8, 15 a, 2 ; [av. quia] Pl. Mil. 1032 ; [av. cum] Pl. Trin. 1170 [av. ne] cruciatur et sollicita est ne... Cic. Mur. 88, la mère tourmentée et augoissée appréhende que...
— crucians cantherius Pl. Cap. 813, bidet qui torture, au dos anguleux.
¶1. ne pas se digérer [aliment] : Heges. 5, 24, 2 ; Rufin. Clem. 4, 18
¶2. [fig.] devenir violent, cruel : cœpit crudescere morbus Virg. G. 3, 504, le mal s'est mis à empirer ; crudescit seditio Tac. H. 3, 10, la sédition devient plus violente.
¶1. indigestion : Cic. CM 44 ; Col. 6, 6, 1
— excès de nourriture Plin. 17, 219
¶2. pl., crudités : Plin. 26, 41.
¶1. saignant, cru, non cuit : Pl. Aul. 430 ; Ov. F. 6, 158 ; Liv. 29, 27, 5
— brique non cuite : Varr. R. 1, 14, 4 ; Curt. 8, 10, 25 ; Plin. 18, 99, etc.
— fruit vert : Cic. CM 71 ; Col. 12, 10, 3
— brut, non travaillé [cuir] : Varr. L. 5, 116 ; Virg. En. 5, 69 ; G. 3, 20
— blessure saignante, non cicatrisée : Ov. Tr. 3, 11, 19 ; Plin. Ep. 5, 16, 11
— non digéré : Cels. 1, 2, etc.
— [activt] qui n'a pas digéré, [ou] qui digère difficilement : Roscius crudior fuit Cic. de Or. 1, 124, Roscius a fait une trop mauvaise digestion, cf. Clu. 168 ; Fin. 2, 23 ; Cat. Agr. 125 ; Varr. R. 2, 4, 21 ; Hor. S. 1, 5, 49 ; Cels. 2, 10 ; Sen. Ep. 89, 22
¶2. [fig.] encore vert, frais [vieillesse] : Virg. En. 6, 304 ; Tac. Agr. 29
— récent : crudum servitium Tac. An. 1, 8, servitude toute fraîche
— qui n'a pas la maturité pour le mariage : Mart. 8, 64, 11
— lecture mal digérée : Quint. 10, 1, 19
¶3. [fig.] dur, insensible, cruel : Pl. Pœn. 1108 ; Truc. 644 ; Ov. Am. 4, 240
— crudus ensis Virg. En. 10, 682, épée impitoyable ; cruda bella Ov. Am. 3, 8, 58, guerres cruelles.
¶1. mettre en sang [par le meurtre, en tuant] : vigiles cruentant Enn. An. 165, ils massacrent les sentinelles, cf. Cic. Pis. 47
— ensanglanter, souiller de sang : Cic. Div. 1, 60 ; Sest. 80 ; Mil. 18
— [fig.] blesser, déchirer : Cic. Phil. 2, 86
¶2. teindre en rouge : Sen. Contr. 2, 15, cf. Suet. Dom. 16.
¶1. sanglant, ensanglanté, inondé de sang : Cic. Mil. 33 ; Quint. 4, 2, 13 ; cruentus sanguine civium Cic. Phil. 4, 4, couvert du sang des citoyens ; cruenta victoria Sall. C. 58, 21, victoire sanglante
— de couleur rouge sang : Virg. G. 1, 306
¶2. sanguinaire, cruel : hostis cruentus Sen. Marc. 20, 3, ennemi cruel ; cruenta ira Hor. O. 3, 2, 11, colère sanguinaire
— crŭenta, ōrum, n., carnage : Hor. S. 2, 3, 223
— cruentior Ov. M. 12, 592 ; Cels. 2, 8 ; -tissimus Vell. 2, 52, 2.

a) force vitale, vie : Luc. 7, 579 ;
b) meurtre, carnage : Ov. M. 4, 161 ; Hor. S. 2, 3, 275.
¶1. v. Crustumeria
¶2. fleuve d'Ombrie : Plin. 3, 115.
¶1. croix, gibet : figere crucem ad supplicium... Cic. Verr. 3, 6, dresser une croix pour le supplice... ; tollere in crucem aliquem Cic. Verr. 1, 7, faire mettre en croix qqn
— timon d'un char : Stat. S. 4, 3, 28
¶2. [fig.]
a) gibier de potence : Pl. Pers. 795 ;
b) peste [en parl. d'une courtisane] : Ter. Eun. 383 ;
c) peine, tourment, fléau : crucem in malo quærere Ter. Phorm. 544, d'un petit mal faire un grand, chercher malheur sur malheur (se jeter d'un mal dans un pire); summum jus summa crux Col. 1, 7, 2, l'extrême justice devient cruauté ; i in crucem Pl. As. 940 ; abi in malam crucem Pl. Pœn. 271, va au diable, va te faire pendre.
===> m. Gracch. d. P. Fest. 150 ; 151 ; Enn. d. Non. 195, 10 ; Prisc. 169, 10
— gén. pl. crucum Plin. d. Char. 141, 17 ; Tert. Apol. 16 ; Nat. 1, 12.
¶1. la glace : Sen. Nat. 3, 25, 12 ; Plin. 37, 83
¶2. cristal, cristal de roche : Curt. 3, 3, 8 ; Plin. 36, 79 ; 127 ; 136, etc.
— objet en cristal :
a) sorte de perle : [-lus, f.] Prop. 4, 3, 52
b) coupe : [-los] Luc. 10, 160: [pl. n. crystalla] Mart. 8, 77, 5 ; 9, 22, 7 ;
c) pl. n., vases de cristal : Stat. S. 3, 4, 58.
===> forme crust- Apul. M. 6, 13
— dans la plupart des passages le genre ne peut se définir.
¶1. part. de cubo
¶2. adjt
a) qui n'est pas d'aplomb, qui penche, qui va en pente : Lucr. 4, 518 ; Hor. O. 1, 17, 12 ;
b) qui reste à plat, immobile [en parl. de poissons] : Col. 8, 17, 9
¶3. subst, l'alité, le malade : Cels. 3, 4.
===> .
===> .
¶1. couche, lit : Cic. Tusc. 5, 90
— [en part.] lit nuptial : Catul. 61, 183 ; Virg. En. 3, 324
— chambre à coucher, chambre [en gén.] : cubile salutatorium Plin. 15, 38, salle de réception
¶2. nid, niche, tanière, gîte des animaux : [rat] Pl. Truc. 869 ; [chiens] Varr. R. 2, 9, 12 ; [bêtes sauvages] Cic. Nat. 2, 126
¶3. [fig.] domicile, demeure : Hesperium cubile Solis Hor. O. 4, 15, 16, l'Occident où le soleil se couche ; avaritiæ non jam vestigia, sed ipsa cubilia Cic. Verr. 2, 190, non plus seulement les traces de l'avidité, mais son repaire même
¶4. [archit.] cavité ou assise [où reposent des pierres, des poutres] : Vitr. 2, 8, 1 ; Plin. 36, 96.
¶1. cubitus [anat.] Cels. 8, 1
— coude : Pl. Stich. 286 ; ponere cubitum apud aliquem Petr. 27, 4, s'accouder (= s'attabler) chez qqn ; reponere cubitum Petr. 65, 6, se replacer sur son coude = se remettre à manger
¶2. coude, inflexion, courbure : Plin. 3, 111
¶3. coudée, mesure de longueur : Cic. Leg. 2, 66 ; Att. 13, 12, 3.
¶1. action d'être couché, de dormir : cubitu surgere Cat. Agr. 5, 6, se lever
¶2. lit, couche : Plin. 24, 59.
¶1. être couché, être étendu : in lectica cubans Cic. Verr. 4, 51, étendu dans sa litière
¶2. [en part.]
a) être au lit, dormir : postremus cubitum eat Cat. Agr. 5, 5, qu'il aille au lit le dernier ;
b) avoir commerce avec une femme : Pl. Amp. 112 ;
c) être à table : Cic. de Or. 2, 363 ;
d) être malade, être alité : Hor. S. 1, 9, 18 ;
e) être calme [en parl. de la mer] : Mart. 5, 1, 4 ;
f) pencher : v. cubans.
===> cubavi Gloss. 5, 448, 38 ; -basse Quint. 8, 2, 20 ; -aris Prop. 2, 16, 23
— cubaturus Cass. Fel. 1, p. 4, 5.

a) galant : Pl. Asin. 934 ;
b) imbécile : Pl. Pers. 382 ;
c) fainéant : [cucullus] Hor. S. 1, 7, 31.
¶1. gourde [plante] : Col. 11, 3, 48 ; Plin. 19, 61
— [fig.] cucurbitæ caput Apul. M. 1, 15, tête sans cervelle
¶2. ventouse : Juv. 14, 58 ; Scrib. 46.
¶1. battre, frapper : Lucr. 1, 1044 ; Plin. 33, 69
— [en part.] battre au fléau : Col. 2, 10, 4
— [fig.] hæc in me cudetur faba Ter. Eun. 381, c'est sur moi que cela retombera
¶2. travailler au marteau, forger : argentum cudere Ter. Haut. 740, battre monnaie, cf. Pl. Most. 892
— [fig.] forger, machiner : Pl. Epid. 476.
===> pf. cudi d'après Char. 246, 5 ; Phoc. 433, 24 ; mais cusi d'après Diom. 369, 3.
===> arch. quoiquoimodi Pl. Bac. 400.
¶1. [relatif] à qui appartenant, de qui, dont : is, cuja res est Cic. Verr. 1, 142, celui à qui l'affaire appartient ; is cuja ea uxor fuerat Plin. d. Gell. 9, 16, 5, celui dont ç'avait été la femme ; is cuja interfuit Cic. d. Prisc. p. 950, celui à qui cela importait
¶2. [interrog.] : cujum pecus ? Virg. B. 3, 1, à qui le troupeau ?
===> arch. quojus, a, um [rel.] Pl. Rud. 745 ; Ps. 1042, etc.
— [interr.] Ps. 702 ; Merc. 721, etc.
===> arch. quojanam Pl. Rud. 229.
===> gén. pl. culleum Cat. Agr. 11, 1.
¶1. cousin, moustique
— [fig.] culex cana Pl. Cas. 239 (en parl. d'un amoureux à cheveux blancs)
— Culex, titre d'un poème attribué à Virgile
¶2. herbe à punaises : Pallad. 4, 9, 8.
¶1. faîte, sommet : culmina Alpium Cæs. G. 3, 2, 5, les hauteurs des Alpes ; [voûte du ciel] Cic. Arat. 26 ; culmen ædis Liv. 27, 4, 11, le faîte d'un temple
— [poét.] édifice, temple : V. Fl. 5, 446
¶2. [fig.] apogée, le plus haut point : summum culmen fortunæ Liv. 45, 9, 7, le plus haut degré de fortune
¶3. [poét.] = culmus, paille [de fève] : Ov. F. 4, 734.
a) [du blé] tuyau de blé, chaume : Cic. CM 51 ; Virg. G. 1, 111 ;
b) [des autres plantes] : Col. 12, 15, 3
— [fig.] chaume, toit de chaume : Virg. En. 8, 654.
¶1. faute, culpabilité : in culpa esse Cic. Læ. 78, être coupable ; in simili culpa esse Cic. Fin. 1, 33, commettre la même faute ; culpa est in aliquo Cic. Fam. 1, 9, 13, une faute est imputable à qqn ; non est ista mea culpa, sed temporum Cic. Cat. 2, 3, ce n'est pas là ma faute, mais celle des circonstances ; in hoc uno genere omnes inesse culpas istius maximas avaritiæ, majestatis... crudelitatis Cic. Verr. 5, 42, [en affirmant] que dans ce seul chef d'accusation se trouvent renfermées toutes les formes les plus graves de sa culpabilité, cupidité, lèse-majesté... cruauté ; culpa corrupti judicii Cic. Verr. 5, 183, la responsabilité de la corruption des juges ; alicujus rei culpam in aliquem conjicere Cæs. G. 4, 27, 4, rejeter la responsabilité d'une chose sur qqn ; suam culpam in senectutem conferunt Cic. CM 14, ils rejettent sur la vieillesse une faute qui leur est imputable ; culpam in aliquem transferre Cic. Font. 18 ; derivare Cic. Verr. 2, 49, faire passer, détourner une faute sur qqn ; culpam rei sustinere Cic. Leg. 3, 37, porter la responsabilité d'une chose ; alicujus culpam in se suscipere Cic. Verr. 4, 91, prendre sur soi la faute de qqn ; sunt ista non naturæ vitia, sed culpæ Cic. Tusc. 3, 73, ces défauts-là relèvent non pas de la nature, mais de notre responsabilité [ils nous sont imputables]
¶2. faute, écart passionnel : Virg. En. 4, 19 ; Ov. M. 2, 37, etc. ; Tac. An. 3, 24
¶3. [droit] faute commise par négligence, négligence : Dig. 17, 2, 72, etc.; Hor. S. 2, 6, 6
¶4. [poét., sens concret] le mal (ce qui pèche, ce qui est défectueux) : Virg. G. 3, 468
— défectuosité d'un travail : Vitr. 3, 1, 4.
===> forme ancienne colpa Prisc. 2, 27, 12.
¶1. façonner en forme de couteau : Plin. 8, 91
¶2. niveler, aplanir avec le soc : Grom. 26, 11.
¶1. coutre de charrue : Plin. 18, 171
¶2. [en gén.] couteau : emere bovem ad cultrum Varr. R. 2, 5, 11, acheter un bœuf pour l'abattre ; culter tonsorius Petr. 108, 11, rasoir ; culter venatorius Petr. 40, 5, couteau de chasse
— in cultro ou in cultrum collocare Vitr. 10, 14 ; 10, 10, placer [une pierre, une brique] sur l'arête [et non sur la face]
— [fig.] me sub cultro linquit Hor. S. 1, 9, 74, il me laisse sous le couteau = dans la détresse.

¶1. celui qui cultive, qui soigne : agrorum Liv. 2, 34, 11, laboureur ; vitis Cic. Fin. 5, 40, vigneron
— [abst] paysan, cultivateur : Sall. J. 46, 5 ; Liv. 21, 34, 1
¶2. habitant : cultores ejus collis Liv. 24, 10, 11, les habitants de cette colline ; cultor cæli Pl. Amp. 1065, habitant du ciel, cf. Catul. 61, 2 ; Sall. J. 17, 7
¶3. [fig.]
a) juvenum Pers. 5, 63, assidu à former la jeunesse ; imperii Romani Liv. 26, 32, 4, zélé partisan de Rome ; veritatis Cic. Off. 1, 109, tenant de la vérité ;
b) celui qui honore, qui révère : diligens religionum cultor Liv. 5, 50, 1, scrupuleux observateur des rites ; cultor deorum Hor. O. 1, 34, 1, adorateur des dieux.
¶1. [en gén.] culture : Cat. Ag. 61, 2 ; Cic. Agr. 2, 84 ; Fl. 71 ; vitium Cic. Fin. 4, 38, culture de la vigne, cf. CM 53 ; agri culturas docuit usus Lucr. 5, 1447, l'expérience enseigna les différentes façons de cultiver la terre
¶2. [en part. et abst] l'agriculture : Varr. R. 1, 18 ; pl. culturæ Col. 11, 1, 30, les différentes cultures
¶3. [fig.]
a) culture [de l'esprit, de l'âme] : cultura animi philosophia est Cic. Tusc. 2, 13, c'est la philosophie qui est la culture de l'âme ;
b) action de cultiver qqn, de lui faire sa cour : Hor. Ep. 1, 18, 86 ;
c) action d'honorer, de vénérer, culte : Min. Fel. 23, 12 ; Lamp. Hel. 3, 5.
¶1. cultivé : ager cultior Varr. R. 1, 2, 20 ; cultissimus Cic. Com. 33, champ mieux cultivé, admirablement cultivé
— pl. n. culta, ōrum, Lucr. 1, 165, etc.; Virg. G. 1, 153, etc., lieux cultivés, cultures
¶2. soigné, paré, orné : Suet. Cæs. 67 ; Curt. 3, 3, 14 ; veste candida cultus Plin. 16, 251, vêtu de blanc
— ingenia cultiora Curt. 7, 8, 11, natures plus cultivées, plus ornées.
¶1. action de cultiver, de soigner : agricolarum Cic. Agr. 2, 26, le travail des laboureurs ; regiones omni cultu vacantes Cic. Tusc. 1, 45, régions sans aucune culture ; agrorum Cic. Leg. 2, 88, travail, culture des champs ; qui cultus habendo sit pecori Virg. G. 1, 3, quels soins apporter à l'entretien du troupeau, cf. Cic. Nat. 2, 158 ; cultus et curatio corporis Cic. Nat. 1, 94, les soins et l'entretien du corps (Off. 1, 106) ; eodem victu et cultu corporis utuntur Cæs. G. 6, 24, 4, ils ont la même nourriture et les mêmes conditions d'existence matérielle (vêtement, habitation, etc.) ; vestitus cultusque corporis Cic. Læ. 49, le vêtement et la parure ; tenuis victus cultusque Cic. Læ. 86, une table et un confort modestes
— incinctus Gabino cultu Liv. 10, 7, 3, ayant ceint la toge à la manière des Gabiens
— [fig.] : cultus animi Cic. Fin. 5, 54, nourriture, entretien de l'esprit, cf. Liv. 39, 8, 3 ; Sen. Ben. 6, 15, 2
¶2. action de cultiver, de pratiquer une chose : studiorum liberalium Sen. Brev. 18, 4 ; litterarum Gell. 14, 6, 1, culture des arts libéraux, de la littérature ; religionis V. Max. 1, 6, 13, etc., pratique de la religion, cf. Tac. Agr. 4 ; Sen. Ir. 3, 17, 1
— action d'honorer [parents, patrie, dieux, etc.] : Cic. Inv. 2, 161 ; Part. 88 : [en part.] deorum, culte des dieux, honneurs rendus aux dieux : Cic. Leg. 1, 60 ; Nat. 2, 5 ; 2, 8, etc. ; Tusc. 1, 64 ; CM 56
¶3. manière dont on est cultivé, état de civilisation, état de culture, genre de vie : funera sunt pro cultu Gallorum magnifica Cæs. G. 6, 19, 4, les funérailles sont magnifiques eu égard au degré de civilisation des Gaulois ; homines ad hunc humanum cultum civilemque deducere Cic. de Or. 1, 33, amener les hommes à notre état de civilisation et d'organisation sociale ; agrestis cultus Cic. Rep. 2, 4, genre de vie champêtre (Liv. 7, 4, 7)
¶4. recherche, luxe, élégance, raffinement : [dans les édifices] Sen. Const. 15, 5 ; Ep. 86, 9, etc.; [dans le style] Sen. Contr. 2, præf. 1 ; Ep. 114, 10 ; Tac. D. 20 ; Quint. 2, 10, 11, etc.
— [en m. part.] Sall. C. 13, 3 ; Liv. 29, 21, 13.
¶1. [idée d'accompagnement, de société] : habitare cum aliquo Cic. Att. 14, 20, 4, habiter avec qqn ; vagari cum aliquo Cic. Att. 8, 2, 3, errer avec qqn ; habere rem cum aliquo Cæs. G. 2, 3, 5, avoir une chose en commun avec qqn
— una cum, v. una
¶2. [accompagnement dans le temps] : cum prima luce Cic. Att. 4, 3, 4, au point du jour ; simul cum, v. simul ; exit cum nuntio Cæs. G. 5, 46, il part aussitôt la nouvelle reçue
¶3. [accompagnement, qualification, manière d'être] : magno cum luctu et gemitu totius civitatis Cic. Verr. 4, 76, au milieu de la désolation et des gémissements de la cité entière (1, 49 ; Liv. 9, 31, 8, etc.) ; cum dis bene juvantibus Liv. 21, 43, 7, avec l'aide favorable des dieux
— stare cum pallio purpureo Cic. Verr. 4, 86, se tenir debout en manteau de pourpre ; esse cum telo Cic. Mil. 11, avoir une arme sur soi, être armé ; vidi argenteum Cupidinem cum lampade Cic. Verr. 2, 115, j'ai vu le Cupidon d'argent portant son flambeau, cf. 4, 109 ; venire Romam cum febri Cic. Att. 6, 9, 1, venir à Rome ayant (avec) la fièvre ; si esset cum iisdem suis vitiis nobilissimus Cic. Clu. 112, si avec tous ses vices il était en outre de la plus haute noblesse ; esse cum imperio Cic. Fam. 1, 1, 3, avoir un commandement ; si cum signis legiones veniunt Cic. Att. 14, 5, 1, si les légions viennent enseignes déployées ; suaviter et cum sensu Cic. de Or. 2, 184, délicatement et avec tact
— ager cum decumo effert Cic. Verr. 3, 113, le champ produit dix pour un, dix fois autant (Varr. R. 1, 44, 1 ; Plin. 18, 95) ; cum centesima fruge fenus reddente terra Plin. 5, 24, la terre donnant en moisson un revenu de cent pour un
— cum eo quod, ajoutant que, avec cette réserve que : sit sane, sed tamen cum eo, quod sine peccato meo fiat Cic. Att. 6, 1, 7, soit, mais à la condition pourtant qu'il n'y ait rien là-dedans à me reprocher ; cum eo quod... accidit ut Quint. 10, 7, 13, avec cette réserve qu'il arrive que... (2, 4, 30 ; 12, 10, 47) ; cum eo ut subj., avec cette circonstance que (Liv. 30, 10, 21) ; avec cette stipulation que (Liv. 8, 14, 8) (que ne... pas, cum eo ne Col. 5, 1, 4)
¶4. (accompagnement et conséquence) : ut beneficium populi Romani cum vestra atque omnium civium salute tueatur Cic. Mur. 2, afin qu'il conserve pour votre salut et celui de tous les citoyens la faveur que lui a faite le peuple romain (Rep. 2, 16 ; Cat. 1, 33 ; Verr. 1, 63) ; C. Flaminius cecidit apud Trasumennum cum magno rei publicæ vulnere Cic. Nat. 2, 8, C. Flaminius succomba à Trasimène, portant ainsi un coup terrible à la république
¶5. [instrumental] : [poét.] cum lingua lingere Catul. 98, 3, lécher avec la langue
¶6. [construction de certains verbes marquant relations avec qqn] agere cum ; res est alicui cum ; loqui cum ; stare, facere cum, etc., v. ces verbes ; [lutte, rivalité] certare, pugnare cum ; [liaison] jungere cum ; [divergence] dissidere, differre, etc. ; [construction de verbes composés de cum] : comparare, consentire, conferre, cum, etc.
===> cum se lie à la suite des pronoms personnels (touj. dans Cic.) : mecum, tecum, secum, nobiscum, vobiscum ; à la suite du pron. relat., le plus souvent : quocum (quicum), quacum, quocum, quibuscum.
I. indic.,
¶1. [constr. archaïques] : istuc sapienter fecit, quom... dedit Pl. Bacch. 338, il a fait preuve là de sagesse en donnant ; isto tu pauper es, quom nimis sancte piu's Pl. Rud. 1234, c'est par là que tu es pauvre, en étant trop scrupuleusement honnête, cf. Ps. 822 ; Ter. Phorm. 966 ; propter hanc rem quom Pl. Cap. 216, en raison de cette circonstance que [sur ab eo cum Varr. L. 7, 79, v. Gaffiot. Subj. p. 114, note]
¶2. fuit quoddam tempus cum homines... vagabantur Cic. Inv. 1, 2, il y eut une certaine époque où les hommes erraient çà et là... cf. Pl. Aul. 4 ; Merc. 533 ; Trin. 402, etc. ; Lucr. 6, 295 ; Cic. Fam. 11, 27, 4 ; Off. 1, 31 ; Lig. 20 ; Planc. 65 ; fuit cum hoc dici poterat Liv. 7, 32, 13, il y eut un temps où l'on pouvait dire...; renovabitur prima illa militia, cum... solebat Cic. Verr. 5, 33, on rappellera ces débuts de son service militaire, où il avait coutume...
— [en part., après une date] depuis que : anni sunt octo, cum... Cic. Clu. 82, il y a huit ans que ; nondum centum et decem anni sunt, cum... lata lex est Cic. Off. 2, 75, il n'y a pas encore cent dix ans que la loi fut portée...; vigesimus annus est cum me petunt Cic. Phil. 12, 24, voilà vingt ans qu'ils m'attaquent
¶3. qqf cum = tum + une particule de liaison (cf. qui) : cum interim Liv. 4, 51, 4, mais cependant, dans le même temps.
II. subj. [nuance consécutive] : fuit antea tempus, cum Germanos Galli virtute superarent Cæs. G. 6, 24, 1, il fut jadis un temps (tel que) où les Gaulois étaient supérieurs en courage aux Germains ; in id sæculum Romuli cecidit ætas, cum Græcia... esset Cic. Rep. 2, 18, l'époque de Romulus tomba en un siècle (tel que) où la Grèce était..., cf. Pl. Capt. 516 ; Ter. Haut. 1024 ; Varr. R. 3, 1, 1 ; Cic. Com. 33 ; Off. 3, 50 ; Mil. 69 ; de Or. 1, 1 ; Br. 7
— nec quom... rear Pl. Most. 158, il n'y a pas de circonstances où je croie, cf. Ter. Haut. 560.B conjonction ; souvent en corrélation avec tum, tunc, nunc, etc.
I. ind.,
¶1. quand, lorsque, au moment où : cum hæc scribebam, putabam... Cic. Fam. 6, 4, 1, au moment où j'écrivais cela, je pensais (3, 13, 2 ; Att. 5, 2, 1 ; Br. 2, 1, 1, etc.)
— cum id argumentis docuerat, tum etiam exemplorum copia nitebatur Cic. de Or. 1, 90, quand il en avait donné des preuves, alors il recourait aussi à une foule d'exemples ; mihi causam adtulit casus gravis civitatis, cum... poteram Cic. Div. 2, 6, ce qui m'a déterminé, ce sont les malheurs de la cité, quand je pouvais... (Mur. 6 ; Verr. 4, 77 ; Fin. 2, 61 ; de Or. 2, 70 ; Agr. 2, 100 ; Fam. 11, 8, 11 ; 8, 9, 2 ; Cæs. G. 4, 17, 4 ; G. 7, 35, 4 [α]) ; resistito gratiæ, cum officium postulabit Cic. Mur. 65, tiens tête au crédit, quand le devoir le demandera ; officia reperientur, cum quæretur... Cic. Off. 1, 125, on trouvera les devoirs, quand on cherchera... ; cum hæc docuero, tum illud ostendam Cic. Clu. 9, quand j'aurai montré cela, alors je ferai voir ceci ; ceteri senes cum rem publicam defendebant, nihil agebant ? Cic. CM 15, les autres vieillards, en défendant l'État, ne faisaient-ils donc rien ? de te, cum tacent, clamant Cic. Cat. 1, 21, à ton sujet, en se taisant, ils crient ; satis mihi dedisti, cum respondisti... Cic. Tusc. 2, 28, tu m'as assez accordé, en répondant...
— cum primum Cic. Nat. 2, 124, aussitôt que ; dies nondum decem intercesserant, cum alter filius necatur Cic. Clu. 28, dix jours ne s'étaient pas encore écoulés que le second fils est tué ; vix agmen novissimum... processerat, cum Galli... non dubitant Cæs. G. 6, 8, 1, à peine l'arrière-garde s'était-elle avancée... que les Gaulois n'hésitent pas à...
— avec inf. hist. : jamque dies consumptus erat, cum tamen barbari nihil remittere Sall. J. 98, 2, et le jour était déjà écoulé que les barbares pourtant ne se donnaient aucune relâche, cf. Liv. 2, 27, 1
— antériorité marquée après cum, mais non en français : cum mihi proposui regnantem Lentulum..., perhorresco Cic. Cat. 4, 12, toutes les fois que je me représente Lentulus sur le trône, je vois en frissonnant... (Læ. 94 ; Tusc. 5, 77 ; Div. 2, 145, etc.; Cæs. G. 6, 16, 5) ; cum remiserant dolores pedum, non deerat in causis Cic. Br. 130, quand la goutte lui laissait quelque relâche, il ne se dérobait pas aux plaidoiries
¶2. notion causale latente : sine trahi (amiculum), cum egomet trahor Pl. Cist. 115, permets que ce mantelet traîne, quand moi-même je me traîne ; facta eloquar multo melius quam illi, quom sum Juppiter Pl. Amph. 1134, j'exposerai tout ce qui s'est passé beaucoup mieux qu'eux, alors que je suis Jupiter ; at senex ne quod speret quidem habet ; at est eo meliore condicione quam adulescens, cum id quod ille sperat hic consecutus est Cic. CM 68, mais, dira-t-on, le vieillard n'a même pas lieu d'espérer ; eh bien ! il est ainsi en meilleure condition que le jeune homme, alors que, ce que l'autre espère, lui l'a obtenu, cf. de Or. 2, 154 ; Arch. 10 ; Rep. 3, 47 ; Clu. 131 ; Pomp. 33 ; Phil. 5, 14 ; Virg. B. 3, 16
¶3. notion adversative-concessive latente : sat sic suspectus sum, cum careo noxia Pl. Bacch. 1004, je suis assez soupçonné comme cela, quand [pourtant] je suis innocent de toute faute ; cf. Aul. 113 ; Rud. 383 ; Ter. Eun. 243 ; Phorm. 23, etc. ; Lucr. 1, 566 ; 1, 726 ; o beatos illos qui, cum adesse ipsis non licebat, aderant tamen... Cic. Phil. 1, 36, heureux ces gens qui, lorsqu'ils ne pouvaient être là en personnes, étaient là pourtant... cf. Verr. 3, 125 ; Cæc. 42 ; Mur. 77 ;
— cum interea, cum interim, quand cependant : Pl. Pers. 174 ; Men. 446 ; Ter. Hec. 39 ; Cic. Verr. 5, 162 ;
— inf. hist. après cum interim : Liv. 3, 37, 5, etc.
¶4. avec les v. de sentiment : salvos quom advenis, gaudeo Pl. Most. 1128, alors que tu arrives bien portant, je me réjouis (Amph. 681 ; Men. 1031 ; Rud. 1365, etc.); magna lætitia nobis est, cum te di monuere uti... Sall. J. 102, 5, c'est pour nous une grande joie de voir que les dieux t'ont donné l'inspiration de ; tibi gratulor, cum tantum vales apud Dolabellam Cic. Fam. 9, 14, 3, je te félicite du moment que tu as tant de crédit auprès de Dolabella ; cum isto animo es, satis laudare non possum Cic. Mil. 99, du moment que tu as ces sentiments, je ne saurais assez te louer, cf. Fam. 13, 24, 2 ; Verr. 2, 149 ; Fin. 3, 9 ; Off. 2, 22.
II. subj.,
¶1. [notion causale] : du moment que, vu que, étant donné que, puisque : cum amicitiæ vis sit in eo ut..., qui id fieri poterit si... ? Cic. Læ. 92, puisque l'essence de l'amitié consiste à..., comment ce résultat pourra-t-il se produire si...? (Cat. 1, 15 ; Font. 35 ; Ac. 2, 66 ; Phil. 14, 12 ; Or. 27 ; Fin. 1, 34, etc.); cum præsertim Cic. Br. 3, étant donné surtout que (præs. cum Arch. 10) ; quippe cum Cic. Br. 69 ; Læ. 28 ; Off. 2, 34 ; Leg. 1, 5, etc., puisque (qqf utpote cum Cic. Att. 5, 8, 1 ; ut cum Quint. 10, 1, 76)
— cum... tum : id, cum ipse per se dignus putaretur, tum auctoritate et gratia Luculli impetravit Cic. Arch. 7, il l'obtint, d'abord parce qu'il en était jugé digne par lui-même, et ensuite grâce à l'influence et au crédit de Lucullus, cf. Dom. 32
— [liaison de deux faits] du moment que : cum in convivium venisset... non poterat Cic. Verr. 4, 48, du moment qu'il était venu (qu'il se trouvait) dans un festin il ne pouvait... (Rep. 2, 59 ; Off. 2, 41 ; de Or. 1, 232 ; Cæs. G. 5, 19, 2 (β) ; G. 7, 16, 3 ; C. 2, 41, 6 ; 3, 24, 2 ; Liv. 2, 27, 8 ; 23, 3, 10 ; 44, 29, 3 ; Tac. A. 1, 10, 7 ; 3, 10, 14)
¶2. [notion adversative-concessive] quoique, quand pourtant : Græcia, cum jamdiu excellat in eloquentia, tamen... Cic. Br. 26, la Grèce, quoique depuis longtemps elle excelle dans l'éloquence, cependant... (Verr. 3, 78 ; de Or. 1, 126 ; Br. 28 ; 314 ; Clu. 110, etc.)
— [simple opposition] alors que, tandis que : solum (animantium) est particeps rationis, cum cetera sint omnia expertia Cic. Leg. 1, 22, il est le seul (des animaux) qui participe de la raison, tandis que les autres en sont tous dépourvus (Verr. 5, 95 ; 178 ; Clu. 65 ; Mur. 11 ; Tusc. 5, 13 ; de Or. 3, 60, etc.; Cæs. G. 4, 12, 1 ; 4, 24, 3 ; Liv. 23, 27, 5 ; 28, 14, 19 ; Tac. H. 1, 39)
— cum interea, cum interim, quoique cependant, tandis que cependant, alors que cependant : simulat... cum interea... machinetur Cic. Verr. pr. 15, il feint... quoique cependant il machine... (Varr. R. 3, 16, 2 ; Lucr. 5, 394 ; Cic. Verr. 2, 25 ; 3, 62 ; Pis. 9 ; Sull. 16 ; Fam. 15, 4, 3)
— cum... tum : quæ cum sint gravia, tum illud acerbissimum est quod... Cic. Mur. 56, ces choses ont beau être pénibles, le plus dur, c'est que... cf. 55 ; Fam. 15, 9, 1 ; Off. 3, 5
¶3. [acception voisine de l'instrumental] : cum neget..., nonne tollit...? Cic. Nat. 1, 29 = negando, nonne tollit, en déclarant que ne pas..., ne supprime-t-il pas... ? cf. Font. 44 ; Top. 10 ; Agr. 2, 19, etc.
— [acception voisine de in + gérondif] = quand il s'agit de : nonne ille artifex, cum faceret Jovis formam, contemplabatur aliquem... ? Cic. Or. 9, cet artiste, quand il s'agissait pour lui de faire (en faisant) la statue de Jupiter, ne contemplait-il pas un modèle...? cum peterem magistratum, solebam... Cic. de Or. 1, 112, en faisant acte de candidature, j'avais l'habitude (Brut. 143 ; 190 ; Fin. 3, 19, etc.) ; nusquam cunctabundus, nisi cum in senatu loqueretur Tac. An. 1, 7, n'ayant nulle part d'hésitation sauf dans ses paroles au sénat
¶4. [acception participiale] : cum ageremus vitæ supremum diem, scribebamus hæc Cic. Fin. 2, 96, c'est en vivant mon dernier jour que je t'écris ceci (cf. dederam ad te litteras exiens e Puteolano Cic. Att. 15, 1 a, 1, je t'ai écrit hier en partant de ma maison de Putéoles) ; cum hanc jam epistulam complicarem, tabellarii a vobis venerunt Cic. Q. 3, 1, 17, j'étais déjà en train de fermer cette lettre, quand des messagers arrivèrent de votre part (cf. cenato mihi et jam dormitanti epistula est reddita Cic. Att. 2, 16, 1, j'avais dîné et je commençais à m'endormir, quand on m'a remis ta lettre) ; cum hæc agerem, repente ad me venit Heraclius Cic. Verr. 4, 137, je m'occupais donc ainsi, quand un beau jour Héraclius vint me voir ; mihi, cum de senectute vellem aliquid scribere, tu occurrebas dignus... Cic. CM 2 (= mihi volenti...), ayant l'intention d'écrire sur la vieillesse, c'est à toi que je pensais, comme à l'homme digne... ; adulescentium greges vidimus certantes pugnis, calcibus..., cum exanimarentur priusquam victos se faterentur Cic. Tusc. 5, 77, nous avons vu des troupes de jeunes gens luttant des poings, des pieds..., perdant la vie plutôt que de s'avouer vaincus ; per stadium ingressus esse Milo dicitur, cum humeris sustineret bovem Cic. CM 33, Milon s'avança, dit-on, dans le stade en portant un bœuf sur ses épaules ; cum quinque et viginti natus annos dominatum occupavisset Cic. Tusc. 5, 57, ayant pris (après avoir pris) le pouvoir à vingt-cinq ans
— [en part. après audire] : sæpe soleo audire Roscium, cum ita dicat... Cic. de Or. 129, souvent j'entends Roscius disant ceci..., j'entends dire ceci à Roscius... (de Or. 2, 22 ; 144 ; 155 ; 365 ; Br. 205 ; Verr. 3, 3 ; Clu. 29 ; Dom. 93 ; Nat. 1, 58 ; Div. 1, 104, etc.)
— cum... tum : cum peracutus esset ad excogitandum... tum erat... Cic. Br. 145, tout en étant très fin pour découvrir..., il était... ; cum artifex ejus modi sit, ut..., tum vir ejus modi est ut... Cic. Quinct. 78, tout en étant un tel artiste que... il est aussi un homme tel que... (Fam. 9, 16, 1)
¶5. [subj. potentiel du passé] : vix erat hoc plane imperatum, cum... videres Cic. Verr. 4, 86, l'ordre était à peine donné complètement qu'on eût pu voir...
III. tours particuliers :
a) cum maxime, quand (alors que) précisément : tum, cum maxime fallunt, id agunt ut viri boni esse videantur Cic. Off. 1, 41, au moment où précisément ils trompent, ils travaillent à se faire passer pour hommes de bien ; cum hæc maxime cognosceremus, repente adspicimus Cic. Verr. 2, 187, nous étions précisément en train de prendre connaissance de ces faits, quand soudain nous apercevons...
— [emploi adverbial] : nunc cum maxime Cic. CM 38 ; Clu. 12 ; Liv. 29, 17, 7 ou cum maxime Cic. Off. 2, 22 ; Verr. 4, 82, précisément en ce moment, maintenant plus que jamais ; [ dans le passé] : cum maxime hoc significabat... Cic. de Or. 1, 84, alors surtout il faisait entendre que... ou tum maxime Liv. 27, 4, 2 ou tum cum maxime Liv. 33, 9, 3 ; 40, 13, 4 ; 40, 32, 1 ; 43, 7, 8 ou tunc cum maxime Curt. 3, 2, 17
— [avec un adv. au superl.] : cum plurimum Liv. 33, 5, 9 ; Plin. 25, 121, au plus ; cum longissime Suet. Tib. 38, à la plus grande distance alors ;
b) cum... tum [employés comme adv. de corrélation], d'une part... d'autre part : cum summi viri, tum amicissimi mors Cic. Læ. 8, la mort d'un homme si éminent et à la fois si cher à ton cœur ; cum meo judicio, tum omnium Cic. Br. 183, d'après mon sentiment, comme aussi d'après le sentiment de tous ; cum omnium rerum simulatio vitiosa est, tum amicitiæ repugnat maxime Cic. Læ. 92, l'hypocrisie en toutes choses est un vice, mais c'est avec l'amitié qu'elle est surtout incompatible ; cum... tum vero Cic. Red. 25 ; tum maxime (in primis Cic. Br. 298) Att. 11, 6, 1 ; tum etiam Cic. Rep. 2, 1, d'une part... d'autre part vraiment, d'autre part surtout, d'autre part aussi ; cum alia multa, tum hoc Cic. Flacc. 94, entre autres choses, ceci ; parmi beaucoup d'autres choses, celle-ci en particulier ; cum multa, tum etiam hoc Cic. Verr. 4, 147, entre autres choses, ceci surtout ; cum multis in rebus, tum in amicitia Cic. Læ. 48, dans maints objets et en particulier dans l'amitié ; cum sæpe alias, tum Cic. Br. 144, en maintes autres circonstances, et en particulier.
===> pour toute cette syntaxe de cum, v. Gaffiot. Subj. ; Pour le vrai latin ; Rev. de Phil. t. 32.
a) villa de Cumes : Cic. Att. 4, 10, 2 ;
b) pays de Cumes : Plin. 17, 243
— -āni, ōrum, m., habitants de Cumes : Cic. Att. 10, 13, 1.
¶1. augmenté, agrandi, multiplié : mensura cumulatiore Cic. Br. 15, dans une mesure plus grande ; benigne omnia cumulata dare Liv. 27, 45, 11, ils donnaient généreusement tout en surabondance
¶2. qui est à son comble, plein, parfait : Cic. Fam. 9, 14, 5 ; Att. 14, 17, 5 ; Tusc. 1, 109 ; perfecta cumulataque virtus Cic. Sest. 86, vertu parfaite et dans sa plénitude
¶3. [avec gén.] surchargé de : scelerum cumulatissime Pl. Aul. 825, toi, le plus chargé de crimes.
¶1. entasser, accumuler : materies cumulata Lucr. 1, 990, matière entassée ; cumulata arma et corpora Liv. 25, 16, 19, armes et corps entassés ; ut aliud super aliud cumularetur funus Liv. 26, 41, 8, en sorte que les morts s'entassaient les unes sur les autres ; sæculi res in unum diem fortuna cumulavit Curt. 4, 16, 10, la fortune a entassé les événements de tout un siècle en une seule journée ; probra in aliquem Tac. An. 1, 21, accumuler les outrages sur qqn, cf. 13, 2 ; 14, 53
— per acervos corporum, quos in media maxime acie cumulaverant Liv. 37, 43, 7, à travers les monceaux de cadavres qu'ils avaient accumulés surtout au centre de la ligne de bataille
¶2. augmenter en entassant, grossir : scelere scelus Cic. Cat. 1, 14, ajouter un crime à un autre ; eloquentia bellicam laudem Cic. Off. 1, 116, cumuler l'éloquence et la gloire militaire ; æs alienum cumulatum usuris Liv. 2, 23, 6, dette grossie par les intérêts ; invidiam Liv. 3, 12, 8, accroître la haine, ajouter à la haine ; accesserunt quæ cumularent religiones animis Liv. 42, 20, 5, il s'ajouta d'autres prodiges pour augmenter dans les esprits les craintes superstitieuses
— porter à son comble, couronner : totam eloquentiam Cic. de Or. 3, 91 ; gaudium Cic. Att. 4, 1, 2, donner son couronnement à toute l'éloquence, mettre le comble à la joie ; summum bonum cumulatur ex integritate corporis et ex mentis ratione perfecta Cic. Fin. 5, 40, le souverain bien trouve son couronnement dans l'intégrité du corps et dans le parfait état de l'intelligence
¶3. remplir en accumulant : aras oneratis lancibus Virg. En. 8, 284, charger les autels de plats garnis de viandes, cf. En. 11, 50 ; Liv. 8, 33, 21 ; Curt. 5, 1, 20 ; Tac. G. 27 ; locus strage semiruti muri cumulatus Liv. 32, 17, 10, lieu rempli des décombres du mur à moitié renversé
— aliquem muneribus Virg. En. 5, 532, combler qqn de présents ; omni laude cumulatus Cic. de Or. 1, 20, pourvu de toutes les qualités, accompli ; plurimis et maximis voluptatibus cumulatus Cic. Fin. 2, 63, jouissant des plaisirs accumulés, les plus variés et les plus grands ; cumulari maximo gaudio Cic. Att. 14, 17 a, 1, être rempli de la joie la plus vive ; multis laudibus cumulatus Tac. H. 4, 39, chargé d'une foule d'éloges.
¶1. amas, amoncellement : armorum cumulos coacervare Liv. 5, 39, 1, entasser les armes en monceaux ; cumulus aquarum Ov. M. 15, 508, vagues amoncelées ; sarcinarum Liv. 10, 36, 13, monceau de bagages
¶2. surplus, surcroît : magnus ad tua pristina erga me studia cumulus accedet Cic. Fam. 15, 12, 2, ce sera beaucoup ajouter aux témoignages que tu m'as donnés jusqu'ici de ton dévouement ; cumulus dierum Cic. Prov. 26, un surcroît de jours ; ita magnum beneficium tuum magno cumulo auxeris Cic. Fam. 13, 62, tu ajouteras ainsi beaucoup à ton bienfait
— couronnement, comble, apogée : aliquem cumulum illorum artibus (eloquentia adfert) Cic. de Or. 3, 143, (l'éloquence apporte) à leurs sciences qqch qui les couronne ; accesserint in cumulum manubiæ vestrorum imperatorum Cic. Agr. 2, 62, que s'ajoutent pour comble les dépouilles conquises par vos généraux
— [rhét.] = péroraison : Quint. 6, 1, 1.
¶1. berceau d'enfant : Cic. Div. 1, 79
— gîte, nid d'oiseau : Virg. G. 4, 66 : Plin. 10, 99
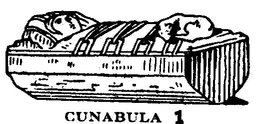
¶2. [fig.]
a) lieu de naissance : cunabula gentis nostræ Virg. En. 3, 105, le berceau de notre race ;
b) première enfance, naissance, origine : a primis cunabulis Col. 1, 3, 5, dès le berceau ; non in cunabulis consules facti Cic. Agr. 2, 100, qui ne doivent pas le consulat à leur naissance ; cunabula juris Dig. 1, 2, 2, les origines du droit.
¶1. qui tarde, qui hésite : cunctans ad opera Col. 11, 1, 14, lent au travail
— qui résiste : cunctans ramus Virg. En. 6, 211, rameau qui résiste ; mellis est cunctantior actus Lucr. 3, 193, le miel est plus compact (coule plus lentement)
¶2. [fig.] irrésolu, indécis, circonspect : Plin. Ep. 2, 16, 4 ; senectā cunctantior Tac. H. 3, 4, que l'âge a rendu plus indécis.
===> sens pass., v. cuncto.
¶1. serrer (maintenir) avec un coin : Plin. 16, 206 ; Sen. Ep. 118, 16 ; [fig.] Quint. 4, 3, 4
¶2. donner la forme d'un coin : Mel. 3, 6, 4
— [pass.] prendre la forme d'un coin : Plin. 3, 29.
¶1. coin [à fendre, ou à caler] : Cat. Agr. 10, 3 ; Cic. Tusc. 2, 23 ; Virg. G. 1, 144 ; [cunei = les chevilles, les jointures dans un vaisseau] Ov. M. 11, 514
¶2. [fig.]
a) formation de bataille en forme de coin, de triangle : Cæs. G. 6, 40, 2 ; Liv. 2, 50, 9 ; Virg. En. 12, 269 ;
b) section de bancs au théâtre : Vitr. 5, 6 ; Suet. Aug. 44, 2 ; Juv. 6, 61 ; cunei omnes Phæd. 5, 7, 35, tous les gradins = toute l'assemblée ;
c) figure triangulaire, triangle : Vitr. 7, 4, 4, etc.
¶1. lapin : Varr. R. 3, 12, 6 ; Catul. 25, 1
¶2.
a) [en gén.] galerie souterraine, canal souterrain, conduit, tuyau : Cic. Off. 3, 90 ; Col. 8, 17, 4 ; Plin. 6, 128 ; Sen. Nat. 3, 21, 6 ;
b) [en part.] galerie de mine, mine, sape : Cic. Cæc. 88 ; Cæs. G. 3, 21, 3 ; 7, 22, 2 ; cuniculis venæ fontis intercisæ sunt Hirt. G. 8, 43, 4, au moyen de sapes on coupa l'adduction d'eau
— [fig.] cuniculis oppugnare Cic. Agr. 1, 1, attaquer par des moyens détournés.
¶1. grand vase en bois, tonneau : Varr. d. Non. 83, 24 ; Cic. Pis. 67 ; Cæs. C. 2, 11
¶2. sarcophage : CIL 6, 12202.
¶1. désir, envie : veri videndi Cic. Tusc. 1, 44, désir de voir le vrai ; flagrare cupiditate Cic. de Or. 1, 134, brûler d'ardeur
¶2. désir violent, passionné : pecuniæ Cæs. G. 6, 22, amour de l'argent, cupidité ; nimia cupiditas principatus Cic. Off. 1, 18, ambition effrénée du pouvoir
— passion : cæca dominatrix animi cupiditas Cic. Inv. 1, 2, la passion maîtresse aveugle de l'âme ; indomitæ cupiditates Cic. Verr. 1, 62, passions indomptées ; temeritatem cupiditatemque militum reprehendere Cæs. G. 7, 52, 1, blâmer la témérité et l'ardeur trop passionnée des soldats
— convoitise, cupidité : Cic. Amer. 101 ; Verr. 4, 60, etc.
— passion, partialité : Flacc. 21 ; 64 ; Planc. 43 ; Liv. 24, 28, 8
— passion amoureuse : Curt. 8, 4, 27 ; Suet. Cal. 24.
===> gén. pl. cupiditatum, mais aussi cupiditatium (Cic. Sest. 138 ; Liv. 34, 4, 12 ; Sen. Ep. 5, 7, etc.).
¶1. [poét.] désir, envie : urbis condendæ Liv. 1, 6, 3, le désir de fonder une ville ; gloriæ Sall. C. 7, 3, désir de la gloire
— cupido incesserat Æthiopiam invisere Curt. 4, 8, 3, l'envie lui était venue de visiter l'Éthiopie
¶2. désir passionné, passion : honorum cæca cupido Lucr. 3, 59, l'aveugle amour des honneurs
— passion amoureuse : Lucr. 4, 1153, etc. ; Hor. S. 1, 5, 111 ; 2, 7, 85 ; Tac. An. 3, 22 ; 14, 35
— cupidité, convoitise : Tac. An. 12, 57
— ambition démesurée : Sall. J. 64, 5.
===> m., Pl. Amp. 840 ; Hor. S. 1, 1, 61 ; Ep. 1, 1, 33 ; O. 2, 16, 15, etc.
— cuppedo Lucr. 7, 1082 ; 4, 1090.
¶1. qui désire, qui souhaite, qui aime : te audiendi Cic. de Or. 2, 16, désireux de t'entendre ; vitæ Cic. Fam. 14, 4, 1, attaché à la vie ; contentionis quam veritatis cupidiores Cic. de Or. 1, 47, plus épris de la discussion que de la vérité ; nostri cupidissimus Cic. de Or. 1, 104, très épris de moi, plein d'attachement pour moi
— scientiam non erat mirum sapientiæ cupido patria esse cariorem Cic. Fin. 5, 49, il n'était pas étonnant qu'un homme épris de savoir préférât la science à sa patrie
— in perspicienda rerum natura cupidus Cic. Off. 1, 154, passionné dans l'étude de la nature
— avec inf. [poét.] : cupidus moriri [v. morior
===> ] Ov. M. 14, 215, souhaitant la mort (Prop. 1, 19, 9)
¶2. [en mauv. part.] avide, passionné : pecuniæ Cic. Verr. 1, 8, avide d'argent ; rerum novarum, imperii Cæs. G. 5, 6, avide de changement, de domination
— partial, aveuglé par la passion : Cic. Verr. 4, 124 ; Font. 21 ; Cæc. 8 ; Clu. 66 ; [en part., passion politique] : non cupidus Cic. Mur. 83, sans passion politique, modéré
— cupide, avide : Quint. 11, 1, 88 ; Cic. Pomp. 64 ; Sest. 93
— épris d'amour, amoureux : Ov. M. 4, 679 ; 11, 63.
¶1. désirer, souhaiter, convoiter (cupere, c'est le penchant naturel ; optare, le souhait réfléchi ; velle, la volonté, cf. Sen. Ep. 116, 2) : pacem Cic. Att. 14, 20, 4, désirer la paix ; ad eum, quem cupimus optamusque vestitum redire Cic. Phil. 14, 2, reprendre le vêtement de paix vers lequel vont nos aspirations et nos vœux ; novas res Sall. J. 70, 1, désirer un changement politique ; res cupita Liv. 26, 7, 2, chose désirée ; n. cŭpītum, pris subst, désir : Pl. Pœn. 1271 ; Sen. Ep. 88, 29 ; Tac. An. 4, 3 ; 13, 13
— asperiora vina rigari cupiunt Plin. 17, 250, les vins trop durs demandent à être coupés
— [avec inf.] : Cic. Verr. 5, 65 ; Fin. 4, 19 ; etc. ; dissoluti si cupiamus esse Cic. Verr. 4, 115, même si nous désirions être indifférents
— [avec prop. inf.] : cupio me esse clementem Cic. Cat. 1, 4, je désire être indulgent (Sull. 32 ; Dom. 32 ; Leg. 1, 4 ; Or. 32 ; Br. 282) ; quem servatum esse plurimi cupiunt Cic. Clu. 200, dont un très grand nombre désirent le salut ; qui patriam exstinctam cupit Cic. Fin. 4, 66, celui qui désire la ruine de sa patrie
— avec ut (ne) : Pl. Cap. 102 ; Cic. Læ. 59, Fam. 2, 8, 3 ; Plin. Ep. 5, 17, 6 ; 10, 47, 1
— [subj. seul] : Cic. Att. 2, 18, 4 ; Virg. En. 10, 442 ; Plin. Ep. 5, 14, 9
¶2. avoir de la passion, de l'amour pour qqn : Pl. Mil. 1050 ; Ov. M. 3, 353, etc.
¶3. [abst] avoir de l'attachement, de l'intérêt, vouloir du bien, être bien disposé ; alicui, pour qqn : Cic. Q. 1, 2, 10 ; Planc. Fam. 10, 4, 4 ; Cæs. G. 1, 18, 8
— alicujus causa, en faveur de qqn : Cic. Att. 15, 3, 2 ; Fam. 13, 6 a ; 13, 64, 1
¶4. emploi arch. avec gén. : domi cupio Pl. Trin. 842, je suis désireux de rentrer chez moi
— être amoureux de (alicujus) : Pl. *Mil. 964.
===> formes sync. cupisti, cupisset, cupisse fréq. dans Cic.
— 4e conj. cupiret Lucr. 1, 71.
¶1. c. cuppediæ, Varr. L. 5, 146
¶2. v. cupido
===> .
¶1. gourmand : Pl. Trin. 239
¶2. c. cuppedia 2 : P. Fest. 48, 15.
¶1. tonnelet de bois : Ulp. Dig. 33, 6, 3, 1
¶2. petit tombeau : CIL 6, 13236.
¶1. [direct] pourquoi ? : Pl., Ter., Cic., Cæs., etc.
— [avec une prop. inf.] : Liv. 5, 24, 5
— [poét. après plus. mots] : Hor. S. 2, 7, 104
¶2. [indirect, avec subj.] : duæ sunt causæ cur Cic. Fam. 15, 20, 2 ; non fuit causa cur Cic. Clu. 169 ; quæ causa est cur Cic. Læ. 48 ; quid est causæ cur Cic. Fl. 5 ; adferre rationem cur Cic. Fam. 6, 8, 1 ; Phil. 2, 56, il y a deux raisons, il n'y avait pas de raison, quelle raison y a-t-il pour que ; apporter une explication pour justifier que ; argumentum adferre cur Cic. Nat. 3, 10, apporter une preuve que ; quid est cur Cic. de Or. 1, 69, quelle raison y a-t-il pour que ; nihil habet in se gloria cur expetatur Cic. Tusc. 1, 109, la gloire n'a rien en soi qui justifie qu'on la recherche ; nihil necessitatis adfert, cur nascantur animi, similitudo Cic. Tusc. 1, 80, la comparaison n'apporte aucune preuve décisive d'une naissance de l'âme ; mora, cur non extemplo oppugnarentur, ea fuit, quod... Liv. 32, 32, 5, le retard expliquant qu'on ne les attaquât pas sur-le-champ vint de ce que...
===> arch. quor Pl. Amp. 409 ; As. 591, etc. ; qur Pl. Amp. 581 ; Ep. 575, etc. ; CIL 1, 1454 ; cf. Prisc. 1, 48.
¶1. soin : in aliqua re aliquid operæ curæque ponere Cic. Off. 1, 19, mettre dans qqch de l'activité et du soin (Div. 1, 93) ; cura diligentiaque Cic. de Or. 3, 184, du soin et de l'exactitude (de la conscience); omnes meas curas cogitationesque in rem publicam conferebam Cic. Off. 2, 2, je consacrais aux affaires publiques tous mes soins et toutes mes pensées ; omni cura in aliquid incumbere Cic. Fam. 12, 24, 2, s'appliquer à qqch de toute sa sollicitude ; cum cura et studio Quint. 10, 7, 29, avec soin et application
— rerum alienarum Cic. Off. 1, 30, soin (conduite, direction, administration) des affaires d'autrui ; quocum mihi conjuncta cura de publica re et de privata fuit Cic. Læ. 15, avec lequel je m'occupais en parfaite union des affaires publiques et de nos affaires privées ; agere curam de aliquo Liv. 8, 3, 8, s'occuper des intérêts de qqn (alicujus Liv. 6, 15, 11 ; pro aliquo Ov. H. 15, 302)
— res curæ est mihi, je prends soin de qqch, je m'en occupe, je m'y intéresse : Cic. Fam. 1, 9, 24 ; Cæs. G. 1, 33, 1 ; 1, 40, 11 ; pollicetur sibi magnæ curæ fore ut omnia.. restituerentur Cic. Verr. 4, 73, il promet d'apporter le plus grand soin à faire tout restituer ; mihi erit curæ explorare... Plin. Ep. 7, 10, 2, je m'occuperai de scruter...; curæ aliquid habeo = res est curæ mihi Sall. C. 21, 5 ; Cæl. Fam. 8, 8, 10 ; Nep. Att. 20, 4 ; Sen. Ben. 1, 8, 2
— curæ est alicui de aliqua re, qqn prend soin de qqch : sic recipiunt, Cæsari de augenda mea dignitate curæ fore Cic. Att. 11, 6, 3, ils promettent que César s'occupera d'accroître mes honneurs (Fam. 10, 1, 1 ; Att. 12, 49, 3 ; Sall. J. 26, 1)
¶2. [en part.] administration d'une chose publique : rerum publicarum Sall. J. 3, 1, le soin des affaires publiques ; annonæ Suet. Tib. 8 ; ærarii Suet. Aug. 36 ; operum publicorum Suet. Aug. 37, administration (intendance) des vivres, du trésor public, des travaux publics
— [droit] tutelle, curatelle : Dig. 3, 1, 1, etc.
— [médec.] traitement : Cels. 2, 10 ; Vell. 2, 123 ; [fig.] Cic. Fam. 5, 16, 5
— [agric.] soin, culture : Virg. G. 1, 228
¶3. [sens concret]
a) travail, ouvrage de l'esprit : Tac. An. 4, 11 ; D. 3 ; Ov. P. 4, 16, 39 ; pl. Tac. An. 3, 24 ;
b) gardien, intendant : Ov. H. 1, 104
¶4. souci, sollicitude, inquiétude : Enn. d. Cic. CM 1 ; cura et sollicitudo Cic. Att. 15, 14, 3, souci et inquiétude ; curæ metusque Cic. Div. 2, 150, soucis et craintes ; sine cura esse Cic. Att. 12, 6, 4, n'avoir pas de souci ; omnis quæ me angebat de re publica cura Cic. Br. 10, toute l'inquiétude qui me tourmentait au sujet de la république
— mihi maximæ curæ est non de mea quidem vita, sed... Cic. Fam. 10, 1, 1, je suis très en souci non certes pour ma vie, mais...; curam gerere pro aliquo Virg. En. 12, 48, prendre souci de qqn ; dare curas alicui Her. 4, 21, donner des soucis à qqn
¶5. souci amoureux, tourments de l'amour, amour : Hor. P. 85 ; Prop. 1, 15, 31 ; cura puellæ Prop. 3, 21, 3, amour pour une jeune fille
— objet de l'amour, amour : Virg. B. 10, 22 ; Hor. O. 2, 8, 8 ; Prop. 2, 25, 1.
¶1. part. de curo
¶2. subst. m., le médecin traitant : Cels. 3, 8.
===> .
¶1. action de s'occuper de, soin : Cic. Nat. 1, 94 ; 2, 158 ; Fin. 4, 39
— [arch. av. acc.] quid tibi hanc curatio est rem Pl. Amp. 519, de quoi te mêles-tu ?
¶2. [en part.]
a) administration, charge, office ; magistratus, curationes, sacerdotia Cic. Verr. 2, 126, les magistratures, les charges, les sacerdoces ; curationem et quasi dispensationem regiam suscipere Cic. Rab. Post. 28, se charger de l'administration et pour ainsi dire de l'intendance royale ;
b) curatelle, office de curateur : Dig. 27, 1, 30 ;
c) cure, traitement d'une maladie : Cic. Tusc. 4, 30 ; Off. 1, 83 ; etc.; Nep. Att. 21, 3.
a) bien soigné : boves curatiores Cat. Agr. 103, bœufs mieux soignés
b) = accuratus : curatissimæ preces Tac. An. 1, 13, prières les plus pressantes.
¶1. sorte de câble : Isid. 19, 4, 2
¶2. c. curcuma : Veg. Mul. 1, 26, 3 ; Chir. 296.
¶1. des Curètes, Crétoise : C. terra Ov. M. 8, 153, la Crète
¶2. ancien nom de l'Acarnanie : Plin. 4, 5.
¶1. curie, une des divisions du peuple romain : Liv. 1, 13, 6
¶2. lieu de réunion des curies, temple où elles se réunissaient : Varr. L. 5, 155 ; Ov. F. 3, 140
¶3. curie [lieu où le sénat s'assemblait], assemblée du sénat, sénat : Cic. Rep. 2, 31 ; Cat. 4, 2 ; Mil. 90 ; de Or. 3, 167 ; Sest. 97
— la curie fut appelée primitt curia Hostilia Cic. Fin. 5, 2 ; Liv. 1, 30, 2
— plus tard curia Pompeia Cic. Div. 2, 23 ; Gell. 14, 7, 7 ; curia Julia Suet. Cæs. 60
¶4. lieu de réunion d'une assemblée [en gén.] : curia Saliorum Cic. Div. 1, 30, le temple où se réunissent les Saliens ; curia Martis Juv. 9, 101, l'Aréopage.
a) celui qui est de la même curie ou (= δημότης) du même bourg : Pl. Aul. 179 ; Cic. Off. 2, 64 ;
b) personne de la cour, courtisan, serviteur du palais : Amm. 21, 12, 20 ; Symm. Ep. 9, 10 ;
c) décurion [d'un municipe] : Isid. Orig. 9, 4, 24.
¶1. curion [prêtre d'une curie] : curio maximus Liv. 27, 8, 1, le chef des curions
¶2. crieur public : Mart. 2, Præf.
¶1. de curie : P. Fest. 62, 11
¶2. de curion : curionium æs ou abst curionium P. Fest. 49, 9, salaire (traitement) de curion.
¶1. qui a du soin, soigneux : in omni historia curiosus Cic. Tusc. 1, 108, qui apporte ses soins à toute espèce de recherche historique ; ad investigandum curiosior Cic. Fam. 4, 13, 5, plus scrupuleux dans ses recherches ; medicinæ Plin. 25, 7, qui s'applique à la médecine
¶2. soigneux à l'excès, minutieux : Varr. L. 6, 46 ; Quint. 8, 3, 55 ; cf. Gell. 13, 1 ; 18, 15
¶3. avide de savoir, curieux : curiosissimi homines Cic. Nat. 1, 97, les hommes les plus avides de savoir (Fam. 3, 1, 1 ; Varr. R. 2, 3, 5) ; curiosis oculis Cic. Sest. 22, avec des yeux curieux ; omnia scire, cujuscumque modi sint, cupere curiosorum est putandum Cic. Fin. 5, 49, désirer tout savoir, sans choix, doit être regardé comme le fait d'une pure curiosité
— [mauv. part] curieux, indiscret : Cic. Fin. 1, 3 ; Flac. 70
— vétilleux : Cic. Fin. 2, 28
— [pris subst] espion : Suet. Aug. 27 ; [et plus tard] agent de police secrète : Cod. Th. 12, tit. 23, etc.
¶4. qui a du souci, cf. curio 3 : Afran. Com. 250.
¶1. avoir soin de, soigner, s'occuper de, veiller à : magna di curant, parva neglegunt Cic. Nat. 2, 167, les dieux prennent soin des grandes choses et laissent de côté les petites ; negotia aliena Cic. Top. 66 ; mandatum Cic. Att. 5, 7, s'occuper des affaires d'autrui, remplir un mandat
— corpus Lucr. 2, 31 ; 5, 937 ; Liv. 21, 54, 2, etc., ou membra Hor. S. 2, 2, 81, ou cutem Hor. Ep. 1, 2, 29, ou pelliculam Hor. S. 2, 5, 38 ou se Cic. de Or. 3, 230, etc., prendre soin de soi = manger, se réconforter : curati cibo Liv. 9, 37, 7, après s'être réconfortés [le repas fini]
— vineam Cat. d. Plin. 17, 195 ; apes Col. 9, 14, etc., prendre soin de la vigne, des abeilles
— curare aliquem Cic. Ac. 2, 121, veiller sur qqn, [ou] l'entourer de soins, de prévenances Plin. Ep. 1, 5, 15, etc.
— alia cura Pl. Mil. 929 ; aliud cura Ter. Phorm. 235, ne t'inquiète pas de cela, sois tranquille
— [constr. avec acc. et adj. verbal] faire faire qqch, veiller à l'exécution de qqch : pontem faciundum curat Cæs. G. 1, 13, 1, il fait faire un pont ; obsides inter eos dandos curaverat Cæs. G. 1, 19, 1, il leur avait fait échanger des otages
— [avec ut (ne) subj., ou avec subj. seul] prendre soin que : cura ut valeas Cic. Fam. 7, 5, 3, etc., prends soin de te bien porter ; confirmat curaturum se esse ne quid ei noceretur Cic. Verr. 2, 99, il donne l'assurance qu'il aura soin d'empêcher qu'il lui soit fait le moindre tort ; curavit... sumerent Cic. Ac. 2, 71, il fit en sorte qu'ils prissent...
— [avec inf.] se donner la peine de, se soucier de, se préoccuper de (dans Cic. le plus souvent non curo) : in Siciliam ire non curat Cic. Att. 7, 15, 2, il ne se soucie pas d'aller en Sicile (Ac. 1, 4 ; Fin. 6, 32 ; Tusc. 5, 87 ; de Or. 1, 91, etc.) ; qui modo res istas scire curavit Cic. Flacc. 64, celui qui s'est seulement donné la peine de savoir ces choses-là ; [avec prop. inf.] Planc. 62 ; Phil. 10, 17 ; Fin. 3, 62
¶2. [abst] s'occuper, donner des soins, faire le nécessaire : Pl. Bacch. 227 ; Cas. 526 ; Pseud. 232
— de Annio curasti probe Cic. Att. 5, 1, 2, tu as bien réglé mon affaire avec Annius (12, 23, 2 ; Fam. 9, 16, 9 ; 16, 12, 1)
— [avec dat., arch.] : rebus publicis curare Pl. Trin. 1057, donner ses soins aux affaires publiques (Truc. 137 ; Rud. 146 ; Gell. 17, 9, 6)
— [t. milit.] exercer le commandement : Sall. C. 59, 3 ; J. 46, 7 ; 57, 2 ; 60, 1
¶3. s'occuper d'une chose officielle, administrer : bellum maritimum curare Liv. 7, 26, 10, diriger la guerre sur mer ; Asiam Tac. An. 4, 36 ; Achaiam Tac. An. 5, 10, administrer (gouverner) l'Asie, l'Achaïe ; legiones Tac. An. 6, 30, commander des légions
— [abst] : duo additi qui Romæ curarent Tac. An. 11, 22, deux [questeurs] furent ajoutés pour remplir leur office à Rome
¶4. [médec.] soigner, traiter, guérir, aliquem, qqn : Cic. CM 67 ; Clu. 40 ; Pis. 13, etc.; [une maladie] Amer. 128 ; Curt. 5, 9, 3 ; Quint. 2, 3, 6 ; etc. ; vulnus Planc. Fam. 10, 18, 3 ; Liv. 1, 41, 2, etc., soigner une blessure ; [abst] medicinæ pars quæ manu curat Cels. 7, præf., la chirurgie ; v. curans
— [plaist] provinciam curare Cic. Att. 6, 1, 2, traiter = gouverner une province
¶5. [commerce] faire payer, payer [une somme], régler : rogant eum ut sibi id quod ab ipsis abisset pecuniæ curet Cic. Verr. 2, 55, ils lui demandent de leur régler la somme qu'ils ont déboursée (Quinct. 15 ; Fam. 5, 20, 3 ; Att. 1, 8, 2, etc.) ; redemptori tuo dimidium pecuniæ curavi Cic. Q. 2, 4, 2, j'ai fait payer à ton entrepreneur la moitié de la somme.
===> formes arch. coiro CIL 1, 801, etc. ; coero Cic. Leg. 3, 10 ; CIL 1, 563, etc. ; couro CIL 9, 3574, etc. ; coro CIL 14, 2837 ; quro CIL 6, 32806, etc.
— subj. parf. curassis Pl. Most. 526 ; etc. ; inf. pass. curarier Pl. Capt. 737, etc.
¶1. course : curriculum facere unum Pl. Trin. 1103, ne faire qu'une course, courir tout d'une traite ; curriculo Pl. Mil. 522 ; Ter. Haut. 733, en courant, à la course
¶2. [en part.] lutte à la course : Cic. Leg. 2, 22 ; quadrigarum curriculum Cic. Mur. 57, course de chars, cf. Hor. O. 1, 1, 3
¶3. endroit où l'on court, carrière, lice, hippodrome : tantum abest a primo, vix ut in eodem curriculo esse videatur Cic. Br. 173, il est si loin du premier qu'à peine il semble courir dans la même lice, cf. CM 27
— [fig.] curriculum vitæ Cic. Rab. Perd. 30, ou vivendi Cic. Tim. 12, la carrière de la vie ; curricula mentis Cic. CM 38, la carrière où s'exerce la pensée ; curriculum industriæ nostræ Cic. Phil. 7, 7, le champ de mon activité
¶4. char employé dans les jeux du cirque, char de course : Tac. An. 14, 14
— char, char de guerre : Varr. d. Non. 287, 22 ; Cic. Har. 21 ; Curt. 8, 14, 8.
¶1. char : Cic. Att. 13, 21, 3 ; Virg. G. 3, 359
— [en part.] char de triomphe : Cic. Cæl. 34
— [fig.] triomphe : Cic. Fam. 15, 6, 1
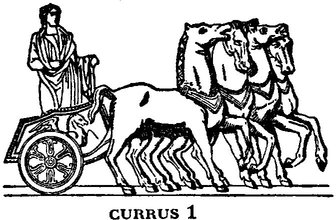
¶2. [poét.] :
a) navire : Catul. 64, 9 ;
b) attelage d'un char : Virg. G. 1, 514 ;
c) train de la charrue : Virg. G. 1, 174.
===> dat. curru [dans le vers dactyl.] Virg. B. 5, 29 ; En. 1, 156 ; 3, 541 ; 7, 724
— gén. pl. currum Virg. En. 6, 653.
¶1. int., courir souvent, courir çà et là : Cic. CM 17 ; Verr. 4, 41 ; Nat. 2, 115
¶2. tr., parcourir : Capel. 3, 262.
¶1. action de courir, course : ingressus, cursus Cic. Nat. 1, 94, la marche, la course ; huc magno cursu contenderunt Cæs. G. 3, 19, 1, ils se portèrent là d'une course précipitée
— course, voyage : mihi cursus in Græciam per tuam provinciam est Cic. Att. 10, 4, 10, pour aller en Grèce je passe par ta province ; tantos cursus conficere Cic. Pomp. 34, accomplir de si grands parcours ; cursum dirigere aliquo Nep. Milt. 1, 6, diriger sa course qq part ; cursus maritimi Cic. Nat. 2, 131, courses (voyages) en mer
— direction : cursum tenere Cæs. G. 4, 26, 5, maintenir sa direction [en mer], gouverner (G. 5, 8, 2) ; ut nulla earum (navium) cursum tenere posset Cæs. G. 4, 28, 2, en sorte qu'aucun d'eux (navires) ne pouvait conserver sa direction
— course, cours : stellarum Cic. Rep. 6, 17, cours des étoiles ; siderum Cic. Tusc. 5, 10, des astres ; cours d'un fleuve (Div. 1, 38)
— cours, circulation du sang : Sen. Ben. 4, 6, 3
— course, marche des navires : Cic. Nat. 2, 87 ; Mur. 33 ; Liv. 21, 49, 9, etc.
¶2. [sous l'Empire] : cursus publici Cod. Just. 12, 51, etc., service des dépêches, poste impériale
¶3. [fig.] cours, marche : cursus rerum Cic. Div. 1, 127, le cours des choses ; totius vitæ cursum videt Cic. Off. 1, 11, il embrasse tout le cours de la vie ; cursum vitæ conficere Cic. Tusc. 3, 2 ; Cæl. 39, etc., achever le cours de son existence
— [poét.] in cursu meus dolor est Ov. M. 13, 508, ma douleur suit son cours, persiste, cf. F. 5, 245 ; 6, 362
— cursus Cic. Br. 3 ; cursus honorum Cic. CM 60, carrière politique ; tuorum honorum cursus Cic. Fam. 3, 11, 2, le cours de tes magistratures
— [rhét.] marche, allure du style : verborum cursus incitatus Cic. Br. 233, allure vive, impétueuse du style, cf. de Or. 1, 161 ; 3, 136 ; Or. 201
— [en part.] allure du rythme, mouvement réglé de la phrase : esse quosdam certos cursus conclusionesque verborum Cic. Or. 178, [on a remarqué] que les phrases se déroulent et s'achèvent suivant un rythme défini.
¶1. écourté, tronqué : dolia curta Lucr. 4, 1026, jarres tronquées [faisant vase de nuit]; curta vasa Juv. 3, 271, vases ébréchés ; curti Judæi Hor. S. 1, 9, 70, les Juifs circoncis ; curtus equus Prop. 5, 1, 20, cheval écourté [une fois sacrifié, on lui coupait la queue]
¶2. [fig.]
a) sententia quasi curta Cic. Fin. 4, 36, pensée pour ainsi dire tronquée ;
b) incomplet, boiteux [en parl. du rythme oratoire] : Cic. Or. 168 ;
c) mince, insuffisant : Hor. O. 3, 24, 64.
¶1. de char, relatif au char : curules equi Liv. 24, 18, 10, chevaux que l'État fournissait pour atteler les chars dans les processions que l'on faisait dans le Cirque ; curulis triumphus Suet. Aug. 12, le grand triomphe [par opposit. à l'ovation] ; curules ludi Minuc. 37, les jeux du cirque
¶2. curule, qui donne droit à la chaise curule : sella curulis Liv. 1, 8, 3, chaise curule ; curulis ædilitas Cic. Har. 27, 27, édilité curule ; curulis magistratus Gell. 3, 18, magistrature curule, v. ædilis
— cŭrūlis, is, f., chaise curule : Tac. An. 1, 75
— cŭrūlis, is, m., édile curule : Plin. 18, 42 ; cŭrūles Stat. S. 4, 1, 5, les magistratures curules.
¶1. courber, plier, voûter : curvare arcum Stat. Achill. 1, 487, bander un arc ; Hadriæ curvantis Calabros sinus Hor. O. 1, 33, 16, de l'Adriatique qui creuse les golfes calabrais ; curvata senio membra Tac. An. 1, 34, membres courbés par l'âge
— [au passif] s'infléchir : unda curvata in montis faciem Virg. G. 4, 361, l'onde qui s'infléchit en forme de montagne ; portus in arcum curvatus Virg. En. 3, 533, port qui s'infléchit en forme d'arc
¶2. [fig.] fléchir, émouvoir : Hor. O. 3, 10, 16.
¶1. courbe, courbé, recourbé, plié : curvæ falces Virg. G. 1, 508, faux recourbées ; curva litora Catul. 64, 74, rivages sinueux ; curvus arator Virg. B. 3, 42, le laboureur courbé sur la charrue ; curvum æquor Ov. M. 11, 505, mer orageuse (dont les vagues se recourbent)
— qui dévie : curvæ quadrigæ Manil. 1, 740, char qui se détourne de son chemin
— creux : curvæ cavernæ Virg. En. 3, 674, cavernes profondes
¶2. [fig.] = pravus, qui n'est pas droit, contourné : curvo dignoscere rectum Hor. Ep. 2, 2, 44, distinguer le bien du mal ; curvi mores Pers. 3, 52, fléchissement des mœurs ; invenimus qui curva corrigeret Plin. Ep. 5, 21, 6, nous avons trouvé un homme capable de redresser ce qui est courbe (de travers).
===> .
¶1. pointe : Cæs. C. 2, 2, 2 ; Plin. 18, 172 ; Virg. En. 5, 208 ; cuspis aquilæ Suet. Cæs. 62, extrémité pointue de l'étendard qu'on enfonçait en terre, cf. Liv. 8, 8, 10
¶2. tout objet pointu : [épieu, javelot] Virg. En. 11, 41 ; [broche à rôtir] Mart. 14, 221, 2 ; [trident de Neptune] Ov. M. 12, 580 ; [aiguillon d'abeille] Plin. 21, 78 ; [dard du scorpion] Ov. M. 2, 199
— tube en argile : Varr. R. 1, 8, 4
— membre viril : Pompon. Com. 69.
¶1. action de garder, garde, conservation : agitare custodiam Pl. Rud. 858, faire bonne garde ; custodia pastoris Col. 8, 4, 3, la surveillance du berger ; ignis Cic. Leg. 2, 29, la garde du feu sacré ; custodiæ causa Cæs. C. 1, 28, 3, pour monter la garde ; custodia justitiæ Cic. Fin. 2, 113, respect de la justice ; custodia decoris Quint. 11, 1, 57, observation des convenances
¶2. garde, sentinelles, corps de garde : custodiam reliquerant Cæs. G. 2, 29, 4, ils avaient laissé une garde ; de custodia Germani Suet. Cal. 45, 1, Germains de la garde du corps ; custodiæ Mænapiorum Cæs. G. 4, 4, 4, les corps de garde installés par les Ménapiens
¶3. lieu où l'on monte la garde, poste : hæc custodia mea est Cic. Phil. 12, 24, voilà mon poste ; in portubus atque custodiis Cic. Pomp. 16, dans les ports et les postes [de douane]
¶4. prison : in custodias includere Cic. Verr. 5, 144, jeter dans les prisons ; libera custodia Liv. 24, 45, 8, prison libre, détention chez un particulier ou dans une ville, cf. Sall. C. 47, 3
¶5. prisonnier, détenu : in recognoscendis custodiis Suet. Tib. 61, 5, en parcourant la liste des détenus, cf. Sen. Ep. 5, 7 ; 77, 18 ; etc., Serv. En. 11, 184.
===> gén. custodias Sall. d. Charis. 107, 12 [interpr. fausse].
===> .
¶1. [en gén.] garder, conserver, protéger, défendre : corpus Cic. Mil. 67, garder la personne de qqn ; poma in melle Col. 12, 45, 3, conserver des fruits dans du miel ; se custodire Cic. Nat. 2, 126, être sur ses gardes ; templum ab Hannibale Nep. Hann. 9, 4, garder un temple contre Hannibal ; memoria aliquid Cic. de Or. 1, 127, retenir qqch dans sa mémoire ; custodire modum ubique Quint. 4, 2, 35, être toujours dans la mesure ; custodire quod juraveris Plin. Pan. 65, 2, respecter son serment
¶2. [en part.]
a) surveiller, tenir l'œil sur : custodire aliquem, ne quid auferat Cic. Cæcil. 51, surveiller qqn, pour l'empêcher de rien dérober ;
b) tenir secret : ejus (orationis) custodiendæ et proferendæ arbitrium tuum Cic. Att. 15, 13, 1, libre à toi de garder par devers toi ce discours ou de le publier ;
c) tenir en prison : Cic. Verr. 5, 68
¶3. [abst] prendre garde, avoir soin de : custodiendum est ut Quint. 11, 1, 6, il faut veiller à ce que ; [avec ne] Quint. 8, 3, 73.
===> impf. sync. custodibant Catul. 64, 319
— fut. custodibo Pl. Cap. 729.
¶1. [en gén.] garde, gardienne, protecteur, protectrice : nullus est portis custos Cic. Cat. 2, 27, il n'y a pas un garde aux portes ; quarta vigilia... de muro cum vigiliis custodibusque nostris conloquitur Cæs. C. 1, 22, à la quatrième veille... du haut du rempart il parle à nos sentinelles et à nos gardes ; fani custodes Cic. Verr. 4, 94, les gardiens du temple ; hortorum custodes Suet. Cal. 59, les gardes des jardins ; [abst] custodes Virg. G. 3, 406, chiens de garde ; dei custodes hujus Urbis Cic. Sest. 53, les dieux protecteurs de Rome ; senatum rei publicæ custodem collocaverunt Cic. Sest. 137, ils ont préposé le sénat à la garde de l'État ; custos dignitatis fortitudo Cic. Tusc. 2, 33, le courage est le garant de notre dignité
¶2. [en part.]
a) surveillant [d'un jeune homme, d'une femme] : Pl. Mil. 146 ; bone custos Ter. Ph. 287, ô excellent pédagogue ;
b) custos corporis Liv. 24, 7, 4, garde du corps ;
c) contrôleur, surveillant [chargé dans les comices d'empêcher la fraude des suffrages] : Varr. R. 3, 5, 18 ; Cic. Agr. 2, 22 ;
d) courson, sarment réservé pour recéper : Cat. Agr. 33, 1 ;
e) le Bouvier [constellation] : Vitr. 9, 4, 1.
¶1. peau : intra cutem Planc. Fam. 10, 18, 3, sous la peau ; curare cutem Hor. Ep. 1, 2, 29, soigner sa personne ; intra cutem suam cogere aliquem Sen. Ep. 9, 13, faire rentrer qqn dans sa coquille ; te intus et in cute novi Pers. 3, 30, je te connais à fond, intimement
— cuir : Mart. 1, 103, 6
¶2. [en gén.] enveloppe : cutis uvæ Plin. 15, 112, peau du raisin ; cutis nucleorum Plin. 15, 36, pellicule des amandes ; cutis summa terræ Plin. 20, 207, écorce de la terre ; cutis aquæ Sid. 5, 541, la glace
¶3. [fig.] vernis, apparence : virtutis solam ut sic dixerim cutem Quint. 10, 2, 15, [reproduire] pour ainsi dire l'écorce seule de la vertu ; cutis quædam elocutionis Quint. 5, 12, 18, une sorte de vernis du style.
===> acc. cutim Apul. Apol. 50
— pl. rare : Prop. 4, 5, 4 ; Plin. 7, 12, et décad.
a) à boire : Pl. Pers. 771 ; 794 ; Pœn. 274 ; St. 706 ; cf. Isid. 20, 5, 4 ;
b) à puiser le vin dans le cratère pour remplir les coupes : Hor. S. 1, 6, 117 ; ad cyathum stare Suet. Cæs. 49, servir d'échanson, cf. Hor. O. 1, 29, 8 ; Prop. 4, 8, 37 ;

c) mesure pour les liquides ou qqf les solides [douzième partie du sextarius] : Cat. Agr. 109 ; Hor. S. 1, 1, 55 ; Plin. 14, 85 ; 21, 185.
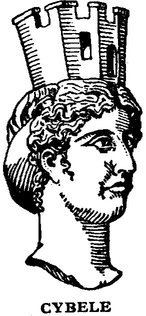

¶1. de Cymé [en Éolie] : Cic. Flacc. 17
— subst. m. pl., habitants de Cymé : Liv. 38, 39
¶2. v. Cumæus.
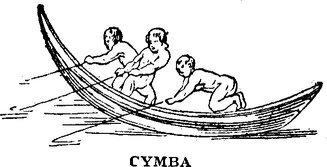

===> cymbalum, gén. plur. : Catul. 63, 21.
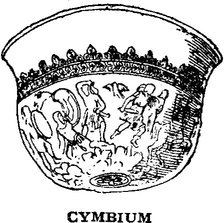
¶1. ville d'Éolie : Liv. 37, 11, 15 ; v. Cymæus
¶2. Cumes, v. Cumæ.
¶1. de chien : Chalc. Com. 125 ; cynicus spasticus Plin. 25, 60, sujet au spasme cynique
¶2. cynique, des Cyniques (v. Cynici) : cynica institutio Tac. An. 16, 34, l'École cynique (des philosophes cyniques).
¶1. Cynosure ou petite Ourse [constellation] : Cic. Ac. 2, 66 ; poet. Nat. 2, 105
¶2. ville d'Arcadie : Stat. Th. 4, 295.
¶1. m., fils de Télèphe, changé en cyprès : Ov. M. 10, 121
¶2. f., ancien nom d'Anticyre [en Phocide] : Stat. Th. 7, 344.
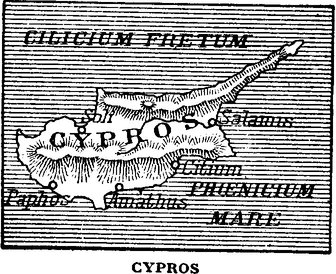
===> acc. -on Ov. M. 10, 718 ; abl. -o Ov. M. 10, 270.
¶1. de Cyrène [ville] : Cyrenæa urbs Sil. 8, 159, Cyrène
— Cȳrēnæi, ōrum, Cic. Ac. 2, 76, c. Cyrenaici
¶2. de Callimaque : Prop. 4, 6, 4.
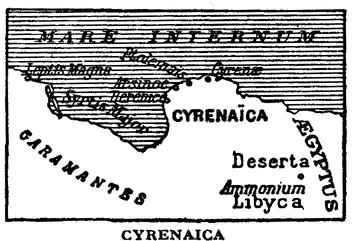
¶1. Cyrène [mère d'Aristée] : Virg. G. 4, 321
¶2. ville, v. Cyrenæ.
¶1. Cyrus [fils de Cambyse et de Mandane, roi de Perse] : Cic. Leg. 2, 56
— Cyrus le jeune, frère d'Artaxerce Mnémon : Cic. Div. 1, 52

¶2. fleuve d'Asie qui se jette dans la mer Caspienne : Plin. 6, 26
¶3. nom d'un architecte : Cic. Q. 2, 2, 2
— autre personnage du même nom : Hor. O. 1, 17, 25.
===> acc. -ŏn Ov. Tr. 1, 10, 29.